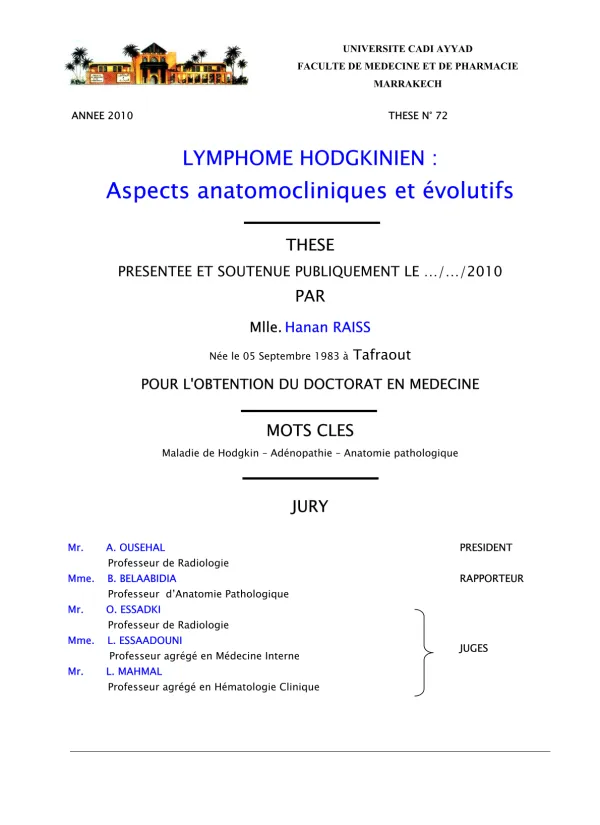
Thèse sur le Lymphome de Hodgkin : Aspects Anatomocliniques et Évolutifs
Informations sur le document
| Auteur | Mlle. Hanan Raiss |
| instructor | Pr. A. Ousehal (Président) |
| École | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Marrakech |
| Spécialité | Médecine |
| Lieu | Marrakech |
| Type de document | Thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 2.18 MB |
- Lymphome de Hodgkin
- Anatomie pathologique
- Médecine interne
Résumé
I.Diagnostic du Lymphome de Hodgkin
Le diagnostic du lymphome de Hodgkin (LH) repose principalement sur la biopsie ganglionnaire (97,4% des cas dans cette étude), révélant la présence de cellules de Reed-Sternberg et leurs variantes. L'examen histologique précise le type histologique (sclérose nodulaire étant le plus fréquent), crucial pour le pronostic. Des biopsies ostéomédullaires sont parfois nécessaires. L'immunohistochimie permet de confirmer le diagnostic et de différencier le LH d'autres lymphomes, notamment en recherchant des marqueurs spécifiques comme CD20, CD79a, CD15, CD30 et EMA. L'implication du virus Epstein-Barr (VEB) est étudiée, sa présence variant selon le type histologique. Le diagnostic différentiel inclut des lymphomes à grandes cellules B, le lymphome anaplasique à grandes cellules (LAGC), le lymphome T angio-immunoblastique (LAI), et la mononucléose infectieuse (particulièrement chez les adolescents), nécessitant une analyse approfondie incluant l'immunophénotypage et la recherche de réarrangements clonaux des gènes des Ig.
1. Biopsie et Diagnostic Histologique
Le diagnostic du lymphome de Hodgkin repose en grande majorité sur l'analyse histologique d'une biopsie ganglionnaire. Dans l'étude présentée, 97,4% des diagnostics positifs ont été établis grâce à ce procédé, dont 97,3% à partir de ganglions superficiels et seulement 1,9% de ganglions profonds. Un cas exceptionnel mentionne un diagnostic posé à partir d'une biopsie ostéomédullaire. L'examen histologique permet d'identifier la présence des cellules de Reed-Sternberg, marqueur caractéristique de la maladie, ainsi que leurs variantes morphologiques. L'anatomopathologiste détermine également le type histologique, un élément important pour le pronostic, bien que sa prédominance comme facteur pronostique soit aujourd'hui remise en question en raison des progrès thérapeutiques et de la fréquence de la sclérose nodulaire dans tous les stades. Les données de l'étude corroborent les données de la littérature, avec une forte prépondérance de biopsies ganglionnaires pour le diagnostic.
2. Préparation des Échantillons et Analyse Microscopique
La préparation des échantillons pour l'analyse anatomopathologique est décrite avec précision : le ganglion doit être prélevé en entier et envoyé frais au laboratoire. La congélation est indispensable pour les études moléculaires, tandis que des frottis d'apposition permettent une analyse immédiate. L'étude immunohistochimique peut être effectuée sur coupes en paraffine ou en congélation. L'analyse microscopique des cellules de Reed-Sternberg (RS) est détaillée. Leur aspect le plus caractéristique est la présence de deux noyaux symétriques avec un nucléole « en œil de chouette », mais des variations morphologiques existent, rendant le diagnostic parfois difficile à poser. L'étude précise que les cellules RS sont souvent rares, même en cas d'atteinte hépatique importante, parfois même absentes, soulignant l'importance de l'immunohistochimie dans ces cas complexes. La description de lésions non spécifiques, représentant environ 30% des cas, et de leurs aspects morphologiques (lymphocytaire, lympho-histiocytaire ou polymorphe) complète la description.
3. Immunohistochimie et Diagnostic Différentiel
L'immunohistochimie joue un rôle crucial dans la confirmation du diagnostic et le diagnostic différentiel du lymphome de Hodgkin. Les cellules tumorales expriment un profil immunohistochimique caractéristique. Habituellement, on observe une expression des antigènes CD20 et CD79a (associés aux lymphocytes B), de l'antigène CD45 et de bcl6. L'EMA est exprimé dans 50% des cas, tandis que CD15 et CD30 sont généralement absents, excepté dans de rares cas. La présence du virus Epstein-Barr est variable et son rôle pronostique reste incertain. Le document détaille les difficultés diagnostiques face à des lymphomes B à grandes cellules, particulièrement riches en cellules T et histiocytes. Il mentionne également le diagnostic différentiel avec le lymphome anaplasique à grandes cellules (ALCL), soulignant l'importance de la détection de la protéine ALK (non exprimée dans le LH classique) et la distinction entre ALK+ et ALK-, ainsi que le lymphome T angio-immunoblastique (LAI) et la mononucléose infectieuse, cette dernière pouvant présenter des cellules atypiques ressemblant à des cellules de Sternberg.
II.Présentation Clinique et Extension du Lymphome de Hodgkin
L'atteinte ganglionnaire médiastinale (71,1% des cas) est fréquente, souvent associée à une atteinte pulmonaire. Les adénopathies abdominales profondes ont été retrouvées chez 33,3% des patients dans cette étude. Des signes neurologiques (paraplégie, troubles sphinctériens) peuvent survenir dans de rares cas (3,3%), liés à des métastases osseuses et à une atteinte du canal rachidien. La classification d'Ann Arbor, complétée par la classification de Cotswolds (tenant compte de la taille des masses ganglionnaires), guide la stratégie thérapeutique. Les signes généraux (fièvre, sueurs nocturnes, perte de poids), importants pour le stade évolutif (A ou B), sont plus fréquents dans les pays en voie de développement (jusqu'à 85%). La TEP au FDG est un outil d'imagerie performant pour le diagnostic et la surveillance.
1. Localisation et Extension de la Maladie
L'étude souligne la fréquence de l'atteinte ganglionnaire médiastinale dans le lymphome de Hodgkin, observée chez 71,1% des patients, un taux comparable aux données de la littérature. Une atteinte parenchymateuse pulmonaire accompagne fréquemment l'atteinte médiastinale ou hilaire, généralement homolatérale, et est détectable chez 8 à 10% des malades. Des atteintes isolées du parenchyme pulmonaire, ou maladie de Hodgkin pulmonaire primitive, sont exceptionnelles (1%). Dans cette série, les adénopathies abdominales profondes étaient présentes chez 33,3% des patients, et une atteinte médiastinale chez 66,7%, des données qui diffèrent significativement de celles rapportées dans la littérature. L'étude mentionne également des cas de présentation avec des signes neurologiques (paraplégie et troubles sphinctériens) chez 3,3% des patients, liés à des métastases osseuses ou une infiltration épidurale. Un cas spécifique détaille une splénectomie effectuée suite à une splénomégalie multinodulaire après une régression initiale des lésions spléniques.
2. Signes Généraux et Classification
Les signes généraux (fièvre, sueurs nocturnes, perte de poids) sont considérés comme importants pour le diagnostic et la classification de la maladie selon les stades A ou B. Leur présence est généralement associée aux poussées ganglionnaires, mais peut aussi précéder toute manifestation apparente, nécessitant une recherche de localisations profondes. Leur taux est particulièrement élevé dans les pays en voie de développement (jusqu'à 85%). La classification d'Ann Arbor, basée sur l'extension anatomique de la maladie (stades I à IV), a longtemps guidé la stratégie thérapeutique. Cependant, l'utilisation de critères cliniques a conduit à l'adoption de la classification de Cotswolds, intégrant un facteur 'X' pour les atteintes ganglionnaires volumineuses (masses > 10 cm ou atteinte médiastinale avec un rapport M/T > 0,35). Cette classification distingue également les stades III1 (limités) et III2 (étendus).
3. Imagerie et Diagnostic
La tomodensitométrie (TDM) est mentionnée comme un examen d'imagerie utile pour visualiser l'extension de la maladie, notamment l'atteinte pulmonaire. Cependant, la Tomographie par Émission de Positons (TEP) au fluorodésoxyglucose (FDG) est présentée comme l'outil d'imagerie de référence pour la prise en charge des lymphomes, offrant une sensibilité et une résolution supérieures aux examens de médecine nucléaire conventionnelle. Elle est particulièrement utile pour la surveillance post-thérapeutique, permettant de différencier les masses résiduelles actives des fibroses, notamment dans le thorax, où l'absence d'hyperfixation suggère une nature cicatricielle. La scintigraphie au gallium 67 est également mentionnée, mais la TEP-FDG est jugée supérieure en termes de sensibilité et de spécificité.
III.Traitement et Surveillance du Lymphome de Hodgkin
Le traitement du LH repose principalement sur la chimiothérapie, avec l'ABVD (Doxorubicine, Bléomycine, Vinblastine, Dacarbazine) comme protocole standard. Des protocoles intensifs comme le BEACOPP sont utilisés dans les cas plus avancés. L'immunothérapie explore des approches ciblées, notamment les lymphocytes T spécifiques au VEB et les anticorps bispécifiques anti-CD30/CD16. La radiothérapie peut être utilisée en complément. La surveillance post-thérapeutique comprend des consultations régulières (tous les 3 mois la première année, puis moins fréquemment), des analyses sanguines (hémogramme, VS), et des examens d'imagerie (radiographie thoracique, TDM, TEP-FDG) pour détecter d'éventuelles rechutes. Le problème des masses résiduelles après traitement nécessite une distinction entre cicatrices fibreuses et maladie persistante, la TEP-FDG offrant une meilleure précision que la scintigraphie au gallium 67.
1. Chimiothérapie et Protocoles de Traitement
Le traitement du lymphome de Hodgkin repose principalement sur la chimiothérapie. L'ABVD (Doxorubicine, Bléomycine, Vinblastine, Dacarbazine) est le protocole standard international de première ligne. Des protocoles de chimiothérapie hebdomadaire, comme le protocole Stanford V (Chlorméthine, Doxorubicine, Vinblastine, Vincristine, Bléomycine, Étoposide, Prednisone), administré sur 12 semaines et suivi d'une radiothérapie des atteintes initiales volumineuses, ont été développés. Pour les stades IIB avec atteinte médiastinale volumineuse et les stades disséminés, le protocole BEACOPP renforcé (Bléomycine, Étoposide, Adriamycine, Cyclophosphamide, Oncovin, Procarbazine, Prednisone) et sa variante BEACOPP-14, basés sur le concept de dose-intensité maximale tolérée, sont utilisés. D'autres protocoles de polychimiothérapie existent, le choix étant guidé par le meilleur rapport efficacité/toxicité. Des études comparant l'ABVD à des protocoles MOPP/ABVD alternés ou MOPP/ABV hybrides ont montré une équivalence en termes de taux de rémission complète, de rechute, de survie sans rechute et de survie globale.
2. Immunothérapie et Perspectives
L'expression d'antigènes viraux par les cellules tumorales, notamment l'implication du virus Epstein-Barr, a conduit à explorer des approches d'immunothérapie. Le document mentionne plusieurs stratégies : l'administration de lymphocytes T EBV-spécifiques (autologues ou allogéniques) dans une optique de thérapie cellulaire adoptive ; une immunothérapie à base d'anticorps bispécifiques anti-CD30 et anti-CD16 (en cours d'essai) ; une radio-immunothérapie ; et enfin, la recherche fondamentale sur des molécules inhibant l'hyperactivation de la voie NF-kB. Ces approches, combinées ou non à la chimiothérapie, visent à améliorer l'efficacité du traitement et à réduire les effets secondaires.
3. Surveillance Post thérapeutique et Masses Résiduelles
Après le traitement du lymphome de Hodgkin, une surveillance régulière est essentielle pour détecter d'éventuelles rechutes ou complications. Le protocole recommandé inclut des consultations fréquentes pendant les premières années (tous les 3 mois pendant la première année, puis tous les 6 mois), des analyses sanguines (hémogramme, Vitesse de Sédimentation), et une radiographie thoracique en cas d'atteinte médiastinale initiale. Une TDM est nécessaire pour confirmer la rémission complète, tandis qu'une TDM supplémentaire n'est pas systématiquement recommandée sauf en cas de maladie résiduelle. La TEP-FDG est considérée comme supérieure à la TDM et à la scintigraphie au gallium 67 pour évaluer la présence de masses résiduelles actives après le traitement, permettant de distinguer les masses fibreuses cicatricielles de la maladie persistante. Le document souligne un problème de suivi, limitant la connaissance de l'évolution à long terme de la maladie, insistant sur l'importance de la sensibilisation des patients et des praticiens pour améliorer la prise en charge.
