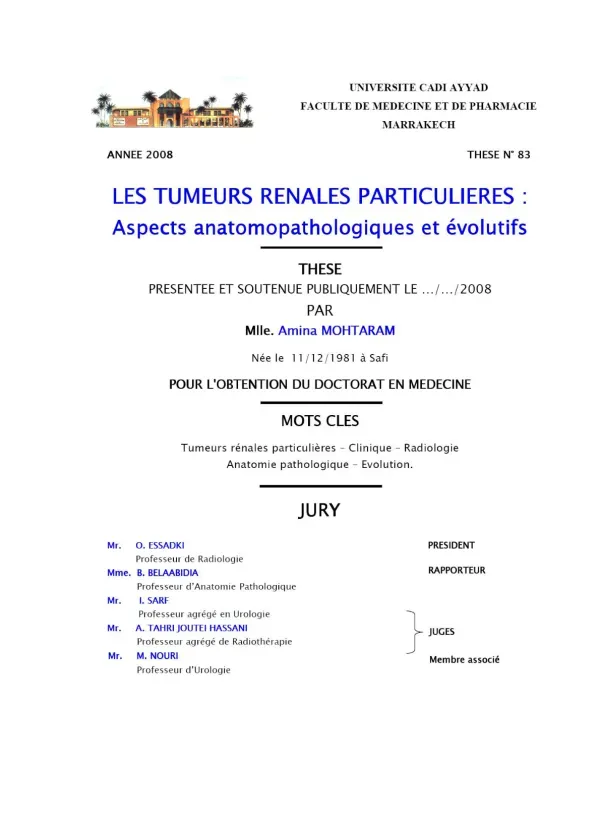
Aspects Anatomopathologiques et Évolutifs des Tumeurs Rénales Particulières
Informations sur le document
| École | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech |
| Spécialité | Médecine |
| city | Marrakech |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 3.55 MB |
- tumeurs rénales
- anatomopathologie
- médecine
Résumé
I. Tumeurs Rénales Bénignes Angiomyolipomes et Adénomes Oncocytaires
Ce document étudie les aspects anatomopathologiques et évolutifs de différentes tumeurs rénales, en se concentrant sur les tumeurs bénignes et malignes. Concernant les tumeurs bénignes, l’angiomyolipome, une tumeur mésenchymateuse fréquente, est caractérisé par sa composante graisseuse visible en TDM (hypodensité entre -10 et -30 UH). Le traitement dépend de la taille et de la symptomatologie; les tumeurs <4cm asymptomatiques nécessitent une surveillance régulière. L’adénome oncocytaire, quant à lui, se présente comme une masse bien limitée, homogène, et son traitement, même pour les tumeurs >4cm, privilégie la chirurgie conservatrice si possible. L'imagerie (échographie, TDM, IRM) joue un rôle crucial dans le diagnostic différentiel.
1. Définition et Fréquence des Tumeurs Bénignes Rénales
L'angiomyolipome est présenté comme la tumeur bénigne mésenchymateuse rénale la plus fréquente, représentant 2 à 3% des tumeurs rénales chez l'adulte. Bien qu'il n'existe pas de définition universelle, ces tumeurs sont considérées comme rares, ne constituant que 10% des tumeurs rénales de l'adulte. L'angiomyolipome provient de cellules épithélioïdes périvasculaires se différenciant en cellules fusiformes, adipeuses et vasculaires. Il est souvent asymptomatique, mais peut causer de l'hématurie et, dans certains cas graves, une hémorragie rétropéritonéale menaçant le pronostic vital. Ces informations soulignent la nécessité d'un diagnostic précis et d'une surveillance appropriée en fonction de la taille et de la symptomatologie de la tumeur.
2. Imagerie de l Angiomyolipome et de l Adénome Oncocytaire
L'imagerie médicale joue un rôle crucial dans le diagnostic des tumeurs rénales bénignes. Pour l'angiomyolipome, la tomodensitométrie (TDM) est particulièrement utile, révélant une hypodensité négative caractéristique (entre -10 et -30 UH, avec un seuil maximal de -15 UH) correspondant à la composante graisseuse de la tumeur. Cependant, il est important de noter que d'autres tumeurs peuvent présenter des aspects similaires à la TDM, nécessitant parfois un recours à l'IRM pour un diagnostic différentiel plus précis (lipomes atypiques, liposarcomes ou adénocarcinomes avec hémorragie tumorale). L’échographie est aussi employée. Concernant l'adénome oncocytaire, son aspect à l'échographie et à la TDM varie selon sa taille (<3cm ou >3cm), avec des caractéristiques moins spécifiques pour les plus petites tumeurs. Pour les adénomes plus importants (>3cm), une plage centrale hypoéchogène (cicatrice fibreuse) et une vascularisation radiaire à l'échodoppler peuvent être observées.
3. Traitement des Angiomyolipomes et des Adénomes Oncocytaires
La prise en charge thérapeutique des angiomyolipomes dépend de plusieurs facteurs, notamment la taille de la lésion et la présence ou l’absence de symptômes. Les angiomyolipomes asymptomatiques de 4cm ou moins nécessitent une surveillance par échographie ou TDM tous les 6 mois. Pour les lésions plus importantes, le traitement est plus controversé. Des auteurs privilégient l'embolisation à la chirurgie, surtout en cas de lésions multiples. D'autres facteurs doivent être pris en considération, comme la présence de sclérose tubéreuse de Bourneville, l'activité physique du patient ou son désir de procréation. En ce qui concerne les adénomes oncocytaires, compte tenu de leur caractère bénin, une chirurgie conservatrice est privilégiée tant qu'elle est techniquement possible, même pour des tumeurs supérieures à 4 cm. Une néphrectomie totale est envisagée uniquement si nécessaire, la voie laparoscopique étant préférable. Une surrénalectomie n'est en général pas requise, sauf cas spécifiques (tumeurs >8cm, localisation polaire supérieure, ou anomalies surrénales détectées au scanner).
II. Carcinome Rénal Types Histologiques et Aspects Cliniques
L'étude porte également sur divers types de carcinomes rénaux malins, dont le carcinome papillaire (types 1 et 2, avec des implications pronostiques différentes), le carcinome chromophobe (souvent hypovascularisé), le carcinome des tubes collecteurs de Bellini (tumeur infiltrante volumineuse), et le carcinosarcome (très agressif). La symptomatologie est variable, avec des lombalgies, de l'hématurie et des masses palpables. Le diagnostic repose sur l'imagerie (TDM notamment, permettant de mettre en évidence des caractéristiques spécifiques pour chaque type de tumeur) et l'analyse histopathologique après néphrectomie totale élargie (NTE), souvent le traitement de choix pour les carcinomes rénaux. Des techniques comme la ponction biopsie rénale peuvent aider au diagnostic préopératoire mais restent imparfaites.
1. Types Histologiques des Carcinomes Rénaux
L'étude explore plusieurs types histologiques de carcinomes rénaux malins. Le carcinome papillaire est mentionné, avec une distinction entre les types 1 et 2, ayant des implications pronostiques différentes. Le type 1, représentant 75% des cas, est caractérisé par de petites cellules basophiles formant une seule assise cellulaire, et une forte corrélation avec une multifocalité. Le type 2 est associé à des tumeurs de haut grade. Le carcinome chromophobe est décrit comme une masse hypo ou isoéchogène, souvent hypovascularisée. Le carcinome des tubes collecteurs de Bellini est présenté comme une tumeur infiltrante et volumineuse, souvent associée à des remaniements nécrotico-hémorragiques. Enfin, le carcinosarcome est évoqué comme un type tumoral très agressif, caractérisé par des cellules anaplasiques et fusiformes, riches en atypies cytonucléaires et mitoses. L'étude mentionne aussi le carcinome rénal juvénile, lié à des translocations chromosomiques spécifiques (t(X;1) et t(X;17)), influençant son agressivité et son pronostic. Ces différents types histologiques mettent en évidence la complexité des carcinomes rénaux et la nécessité d'un diagnostic précis pour une prise en charge optimale.
2. Aspects Cliniques et Imagerie des Carcinomes Rénaux
Sur le plan clinique, la plupart des cas étudiés (onze sur douze) présentaient des symptômes, les lombalgies étant les plus fréquentes, suivies de l'hématurie et de la présence d'une masse palpable. Un seul cas a été diagnostiqué fortuitement lors d'un examen de contrôle. L’imagerie joue un rôle crucial dans le diagnostic et la caractérisation des tumeurs. L'étude mentionne l'utilisation de l'échographie abdominale et de la tomodensitométrie (TDM) abdominale. La TDM apporte des informations cruciales sur la taille, la localisation et l’aspect des tumeurs. Des caractéristiques spécifiques à la TDM sont décrites pour différents types de carcinomes rénaux. Par exemple, l'angiomyolipome montre une hypodensité caractéristique liée à sa composante graisseuse. L'urographie intraveineuse est également mentionnée, notamment pour l'évaluation du rein controlatéral, bien que sa sensibilité et sa spécificité soient limitées, surtout pour les petites tumeurs (<3 cm).
3. Diagnostic et Difficultés Diagnostiques
Le diagnostic des carcinomes rénaux repose sur l'analyse histopathologique, souvent effectuée après néphrectomie totale élargie (NTE). Dans l'étude, la NTE a été réalisée pour la plupart des carcinomes, sauf un cas où la tumeur était inextirpable. Une biopsie tumorale a été pratiquée dans un cas pour établir le diagnostic. L'étude met en lumière les difficultés du diagnostic préopératoire, notamment la difficulté de différenciation entre certains types histologiques sur la seule imagerie. L'exemple de l'adénome oncocytaire, dont l'aspect scanographique peut ressembler à celui d'un carcinome conventionnel, illustre ce point. Une ponction biopsie rénale est envisagée pour améliorer le diagnostic préthérapeutique, mais n'a pas été pratiquée dans cette série d’étude. Le diagnostic différentiel, notamment entre adénome oncocytaire et carcinome chromophobe, reste un défi en raison de la similitude possible de leurs aspects à l'imagerie. La subjectivité dans l'interprétation des résultats histologiques (ex: grade de Fuhrman) est également soulignée comme une source potentielle de discordance entre les observations et la littérature.
III. Traitement et Pronostic des Carcinomes Rénaux
Le traitement des carcinomes rénaux est principalement chirurgical (NTE, parfois avec surrénalectomie ou lymphadénectomie), mais la chimiothérapie et l'immunothérapie peuvent être utilisées dans certains cas (métastases). Le pronostic varie considérablement selon le type histologique et le stade de la maladie. Le carcinome papillaire de type 1 présente généralement un meilleur pronostic que le type 2. Le carcinome chromophobe a un bon pronostic, tandis que le carcinosarcome et le carcinome rénal juvénile (lié à des translocations chromosomiques spécifiques, comme t(X;1) et t(X;17)) ont un pronostic plus incertain et sont souvent plus agressifs. Des facteurs pronostiques incluent la taille tumorale, le grade de Fuhrman, la présence de métastases et les anomalies génétiques. La classification TNM est utilisée pour la stadification.
1. Traitement Chirurgical des Carcinomes Rénaux
La néphrectomie totale élargie (NTE) est le traitement principal pour la majorité des carcinomes rénaux dans cette étude. Onze des douze cas ont subi une NTE, parfois associée à une surrénalectomie (quatre cas, notamment pour les lésions polaires supérieures ou de grande taille >8cm) ou une lymphadénectomie (deux cas, pour la classification TNM et la prédiction du pronostic). La lymphadénectomie reste controversée, son utilité en termes d’amélioration de la survie n'étant pas clairement établie dans cette étude. L'absence de néphrectomie partielle ou de tumorectomie, même pour des tumeurs localisées ou d'apparence bénigne, souligne une approche thérapeutique radicale dans cette série. Un cas particulier a nécessité une intervention d'aller-retour en raison d'une tumeur inextirpable adhérente à l'aorte et à la veine cave inférieure. Cette approche radicale reflète les incertitudes diagnostiques et la volonté d’éviter toute récidive, même pour des tumeurs de petite taille.
2. Chimiothérapie et Immunothérapie
La chimiothérapie classique n'a pas démontré d'efficacité significative pour les carcinomes rénaux dans la littérature. Des résultats plus prometteurs ont été rapportés avec l'association gemcitabine-fluorouracil, avec un taux de réponse de 17% et une survie globale de 12,5 mois. Les associations de chimiothérapie avec des réverseurs du gène MDR se sont avérées décevantes jusqu’à présent. Cependant, une chimiothérapie adjuvante avec des poisons du fuseau (vincristine, paclitaxel) pourrait montrer une sensibilité accrue dans le cas de carcinomes rénaux juvéniles. Concernant l'immunothérapie, l'interféron alpha et l'interleukine 2 sont les traitements de référence pour le cancer rénal métastatique. L'interféron alpha seul a montré un bénéfice de survie. Une combinaison des deux cytokines pourrait améliorer la survie sans progression, mais uniquement chez les patients ayant un bon état général, une seule localisation métastatique et un intervalle supérieur à un an entre la tumeur primitive et les métastases.
3. Pronostic et Facteurs Prognostiques
Le pronostic des carcinomes rénaux varie considérablement selon le type histologique. Le carcinome papillaire de type 1 présente un meilleur pronostic que le type 2. Le carcinome chromophobe a généralement un bon pronostic. En revanche, le carcinosarcome et le carcinome rénal juvénile lié à la translocation t(X;17) ont un pronostic plus réservé et montrent un comportement plus agressif. Dans cette étude, l'évolution a été marquée par un recul moyen de 9,5 mois pour deux cas de carcinome papillaire et une récidive locorégionale pour un autre cas. Un cas de carcinome papillaire de type 1 a présenté une récidive un an après la néphrectomie totale. Un cas de carcinosarcome a été diagnostiqué au stade métastatique avec un décès post-opératoire. Les autres patients ont été perdus de vue. La taille tumorale, le grade de Fuhrman, la présence de métastases et les anomalies génétiques (telles que les translocations chromosomiques) constituent des facteurs importants dans la prédiction du pronostic et influencent la stratégie thérapeutique.
