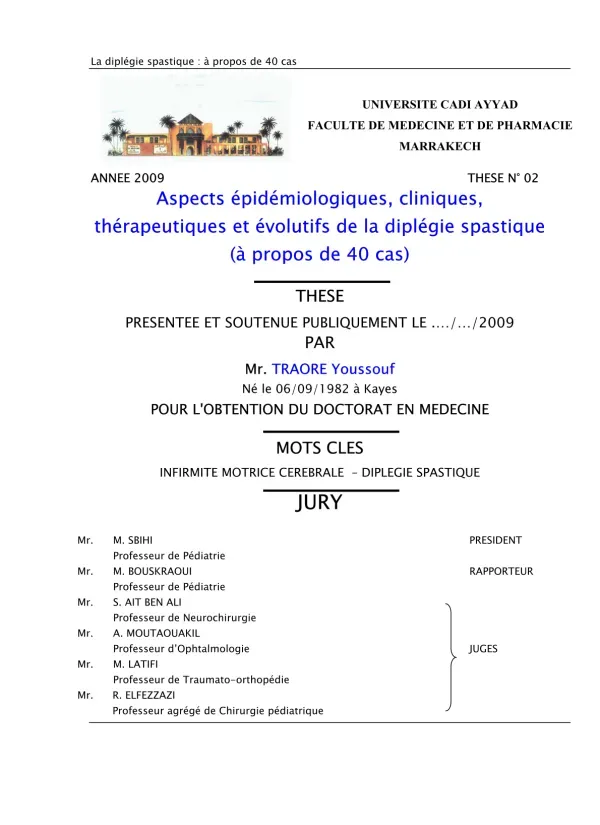
Aspects Épidémiologiques et Cliniques de la Diplégie Spastique
Informations sur le document
| Auteur | Traoré Youssouf |
| instructor/editor | M. SBIHI, Professeur de Pédiatrie |
| school/university | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech |
| subject/major | Médecine |
| Type de document | Thèse |
| city_where_the_document_was_published | Marrakech |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 1.55 MB |
- diplégie spastique
- médecine
- épidémiologie
Résumé
I.Clarification Nosologique de la Diplégie Spastique
Cette section clarifie la terminologie entourant l'infirmité motrice cérébrale (IMC) et la diplégie spastique, soulignant les différences entre les définitions française (IMC) et anglo-saxonne (cerebral palsy ou CP). L'étude souligne l'absence de consensus international sur la classification et les critères d'inclusion, ce qui rend difficile la comparaison des données épidémiologiques. La variabilité dans la définition de l'âge de la maturité cérébrale et le seuil de gravité de la déficience motrice affectent la prévalence rapportée. Différentes formes cliniques de diplégie spastique sont décrites, notamment l'athétose et la rigidité type parkinsonien.
1. Définitions divergentes de l IMC et de la diplégie spastique
La section aborde la difficulté de définir précisément l'infirmité motrice cérébrale (IMC) et la diplégie spastique, soulignant la divergence entre les terminologies française et anglo-saxonne. Alors que la France utilise principalement le terme d'IMC, suivant la classification de Tardieu, la terminologie anglaise privilégie « cerebral palsy » (CP). Le texte souligne que ces deux termes ne désignent pas des groupes équivalents de déficiences motrices chez l'enfant, mettant en avant des approches nosologiques distinctes. L'utilisation d'autres termes, comme le syndrome de Little pour décrire la diplégie spastique, est également mentionnée, illustrant la complexité de la classification. Cette absence d'uniformité terminologique entraine des difficultés dans la comparaison des études épidémiologiques internationales.
2. Imprécisions des critères diagnostiques de la cerebral palsy CP
L'étude critique l'imprécision de la définition de la cerebral palsy (CP) concernant deux points essentiels : l'âge jusqu'auquel le cerveau est considéré comme immature et la gravité de la déficience à prendre en compte. Le choix de l'âge de maturité cérébrale est qualifié d'arbitraire et dicté par des considérations pratiques, l'exemple de l'Australie (5 ans) étant cité. Cette imprécision conduit à inclure des déficiences motrices liées à des traumatismes crâniens postnataux, non considérés dans les études sur l'étiologie pré, péri ou postnatale des CP. Concernant la gravité, le seuil minimal varie selon les types d'enregistrement (prise en charge, crédits disponibles…), et certains parents peuvent éviter le diagnostic de CP pour des raisons psychologiques ou sociales. Cette variabilité dans les critères rend difficile l'évaluation précise de la prévalence et de la sévérité de la pathologie.
3. Conséquences des imprécisions diagnostiques sur la recherche étiologique
Les imprécisions diagnostiques affectent la recherche étiologique, risquant de biaiser les résultats en reflétant les hypothèses admises a priori. L'inclusion de cas limites pose problème, et le manque d'arguments de certitude peut mener à l'exclusion des cas les moins sévères, minimisant la prévalence de l'IMC et majorant la gravité apparente des déficiences observées. A l'inverse, les progrès en obstétrique et en pédiatrie facilitent l'identification de l'étiologie des déficiences motrices, modifiant potentiellement le nombre de cas étiquetés IMC sans variation réelle de la prévalence. L'étude souligne que la classification actuelle entraine des variations diagnostiques en fonction des données recueillies et de l'expérience des professionnels de santé.
4. Description de formes cliniques spécifiques de la diplégie spastique
La section décrit brièvement deux formes cliniques spécifiques de diplégie spastique : l’athétose et la rigidité de type parkinsonien. L’athétose est caractérisée par des mouvements involontaires aux extrémités des membres, même en l’absence d’effort postural, résultant d’une atteinte du système extrapyramidal. La rigidité de type parkinsonien, quant à elle, est décrite comme peu fréquente dans l’IMC, observée principalement aux membres supérieurs. Cette description de formes cliniques spécifiques ajoute à la complexité nosologique de la diplégie spastique et souligne la nécessité d’une approche diagnostique détaillée.
II.Profil Épidémiologique de la Diplégie Spastique à Marrakech
Une étude rétrospective a été menée à Marrakech, au CHU Mohammed VI, sur 40 dossiers d'enfants atteints de diplégie spastique entre août 2003 et décembre 2007. L’étude montre que la diplégie spastique ne représentait que 9,55% des cas d'IMC dans cet échantillon. Les principaux facteurs de risque identifiés sont la souffrance néonatale (47,5% des cas), les grossesses non suivies, et la prématurité (20%). 55% des enfants étaient d'origine urbaine. L'âge moyen des patients était de 7 ans, avec un sex-ratio de 1,3. Près de la moitié des enfants provenaient de milieux ruraux ou périurbains. L'étude a également mis en lumière l'absence de statistiques nationales fiables sur l'épidémiologie de l'IMC au Maroc.
1. Méthodologie et échantillon de l étude
L'étude, menée au service de Pédiatrie A du CHU Mohammed VI de Marrakech, est une étude rétrospective descriptive et analytique portant sur 40 dossiers d'enfants suivis pour diplégie spastique sur une période de 4 ans et 4 mois (août 2003 à décembre 2007). L'analyse a été réalisée à partir des archives du service, en utilisant une fiche d'exploitation préétablie. Il est important de noter que cette étude se concentre spécifiquement sur la diplégie spastique à Marrakech et ne prétend pas représenter l'ensemble de la population marocaine atteinte d'infirmité motrice cérébrale (IMC). L'échantillon est limité à 40 dossiers, ce qui pourrait influencer la généralisation des résultats. L'absence de statistiques nationales fiables sur l'épidémiologie de l'IMC au Maroc est soulignée dès l'introduction.
2. Prévalence de la diplégie spastique à Marrakech et origine géographique des patients
L'étude révèle que la diplégie spastique ne représentait que 9,55% des cas d'IMC observés au sein de l'échantillon. Concernant l'origine géographique des enfants, 55% étaient d'origine urbaine, tandis que près de la moitié (45%) provenaient de milieux ruraux ou périurbains. Cette distribution géographique soulève des questions quant à l'accès aux soins et la qualité de suivi des grossesses en milieu rural. L'étude suggère que le manque de suivi prénatal et les conditions d'accouchement précaires en milieu rural pourraient contribuer à une sous-estimation de la prévalence de la diplégie spastique dans ces zones, mettant en avant l'importance de la prévention.
3. Analyse des facteurs de risque de la diplégie spastique
L'étude identifie la souffrance néonatale (47,5% des cas), les grossesses non suivies, et la prématurité (20%) comme les principaux facteurs de risque associés à la diplégie spastique dans l'échantillon étudié. Les résultats concernant la prématurité sont comparés à ceux d'autres études (Tang-Wai et al., Tournay et Paillard, Kulak et al.), soulignant des pourcentages de prématurés plus élevés dans ces études (57%, 80%, et 54,6% respectivement). La différence est expliquée par l'absence d'unité de réanimation néonatale spécialisée à Marrakech, limitant la survie des grands prématurés et diminuant ainsi l'incidence de la diplégie spastique. D'autres facteurs, comme la grande multiparité (12,5% des cas) et l'hypotrophie à la naissance (5% des cas), sont également mentionnés, mais leur impact reste à approfondir.
4. Données démographiques et caractéristiques de l échantillon
L'âge moyen des patients inclus dans l'étude est de 7 ans. Le sex-ratio est de 1,3, indiquant une légère prédominance masculine. Ces données démographiques, combinées à l'origine géographique des patients, fournissent un contexte important pour l'interprétation des résultats de l'étude. L'étude souligne à nouveau l'absence de données nationales complètes sur l'épidémiologie de la diplégie spastique au Maroc, ce qui rend difficile une comparaison robuste avec d'autres contextes. La spécificité de l'échantillon à Marrakech, ainsi que la période d'étude limitée, doivent être prises en compte pour l'interprétation et la généralisation des résultats.
III.Manifestations Cliniques et Complications Orthopédiques
Cette partie détaille les manifestations cliniques de la diplégie spastique, telles que la spasticité, l’hypotonie axiale, le déficit de force musculaire des membres inférieurs, et les anomalies ophtalmologiques (strabisme présent dans 83,3% des cas). L'épilepsie a été observée chez 35% des enfants, principalement sous forme de crises généralisées. Des complications orthopédiques ont été constatées chez 40% des enfants, liées à un diagnostic tardif et un manque de traitement adéquat. L’étude décrit également les différents types de marche observés chez les enfants atteints de diplégie spastique.
1. Manifestations neurologiques principales de la diplégie spastique
L'étude décrit les manifestations cliniques principales de la diplégie spastique chez les enfants suivis. La spasticité et l’irritation pyramidale (réflexes ostéotendineux vifs et signe de Babinski) étaient présentes chez 87,5% des enfants. Un déficit de force musculaire des membres inférieurs a été observé chez 95% des enfants. Une hypotonie axiale était présente chez 17,5% des enfants, et une légère hypertonie des membres supérieurs a été notée chez 12,5% des cas. L'âge des enfants au diagnostic variait, avec 67,5% des enfants âgés de 0 à 6 mois et 32,5% entre 9 et 18 mois. Ces résultats sont comparés aux données de la littérature et montrent une concordance générale.
2. Fréquence de l épilepsie et description des crises convulsives
L'étude porte également sur la fréquence de l'épilepsie associée à la diplégie spastique. L’épilepsie a été observée chez 35% des enfants de l’étude, un taux comparable aux données de la littérature (incidence ne dépassant pas 27%). Dans cette cohorte, les crises généralisées étaient les plus fréquentes (64,29%), suivies des crises partielles secondairement généralisées (21,43%). Un cas de syndrome de West et un cas de crises partielles ont été enregistrés. Ces observations confirment la relation entre la diplégie spastique et l’épilepsie, précisant la typologie des crises observées chez les enfants de l'étude.
3. Anomalies ophtalmologiques et troubles visuo praxiques
La section met en évidence la fréquence des anomalies ophtalmologiques chez les enfants atteints de diplégie spastique. Dans cette étude, des signes ophtalmologiques étaient présents dans 45% des cas, avec une forte prédominance du strabisme (83,3%). Ce taux est légèrement supérieur aux données rapportées dans la littérature (70% de strabisme selon Fazzi et al.), mais souligne l’importance de dépistage ophtalmologique régulier chez les enfants atteints de diplégie spastique. L’étude mentionne également les troubles visuo-praxiques, souvent sous-estimés, mais ayant un impact important sur la vie quotidienne et la réussite scolaire de ces enfants.
4. Complications orthopédiques et analyse des types de marche
L'étude relève la présence de complications orthopédiques chez 40% des enfants. Ceci est attribué à un diagnostic tardif et à un manque de traitement approprié. La section décrit les différents types de marche observés chez les enfants atteints de diplégie spastique, se référant à la classification de Rodda et Graham (cinq types de marche, dont « true equinus », « jump gait », « apparent equinus » et « crouch gait »). L’analyse des types de marche permet de mieux comprendre les conséquences fonctionnelles de la diplégie spastique et d'adapter les traitements et l'appareillage orthopédique. L’absence d’appareillage chez les enfants de cette étude est aussi mentionnée, due à un manque de moyens et de soutien associatif.
IV.Imagerie Cérébrale et Diagnostic
L'imagerie cérébrale, réalisée tardivement chez 35% des enfants, a révélé une prédominance de l'atrophie cortico-sous-corticale (35,71%). L'échographie transfontanellaire (ETF) est présentée comme examen de dépistage de choix chez les prématurés. L'étude discute de la relation entre les anomalies de l'IRM, l'âge gestationnel et la leucomalacie périventriculaire (LMPV), notant des résultats variables dans la littérature concernant l'association entre la LMPV et la diplégie spastique.
1. Imagerie cérébrale et résultats dans l étude
Cette section décrit les résultats de l'imagerie cérébrale réalisée sur les enfants de l'étude. Il est important de noter que l'imagerie cérébrale n'a été effectuée que chez 35% des enfants, et avec un certain retard. Dans 42,85% des cas, l'imagerie cérébrale s'est avérée normale. La lésion la plus fréquemment observée était l'atrophie cortico-sous-corticale, représentant la principale anomalie détectée chez les enfants ayant subi une imagerie cérébrale. La faible proportion d'examens réalisés et le retard dans leur mise en place limitent l’interprétation des résultats et soulignent la nécessité d'une prise en charge plus précoce et systématique pour une meilleure évaluation de l'atteinte cérébrale.
2. L échographie transfontanellaire ETF comme examen de dépistage
L’étude présente l’échographie transfontanellaire (ETF) comme examen de dépistage de choix chez les nouveau-nés prématurés. L’ETF permet une exploration précise des régions ventriculaires et périventriculaires. Elle est recommandée de manière systématique chez les prématurés d'âge gestationnel inférieur ou égal à 32 semaines d'aménorrhée (SA), entre la 2ème et la 6ème semaine de vie. En revanche, son apport est moindre chez les nouveau-nés à terme. Cette recommandation souligne l’importance d’un dépistage précoce pour une prise en charge adaptée des prématurés à risque de diplégie spastique.
3. Relation entre anomalies de l IRM âge gestationnel et leucomalacie périventriculaire LMPV
La section explore la relation entre les anomalies observées en IRM, l'âge gestationnel, et la leucomalacie périventriculaire (LMPV). Plusieurs études citées (33, 63, 69, 70) montrent une corrélation entre les anomalies de l'IRM, notamment la LMPV et les porencéphalies, et la prématurité. Cependant, les résultats concernant l'association entre LMPV et diplégie spastique varient selon les études, avec des taux de LMPV chez les enfants diplégiques allant de 18% (Shevell et al.) à 80% (Koeda et al.), Miller et al. rapportant quant à eux une association non significative. Cette variabilité met en lumière la complexité de la relation entre les anomalies de l'IRM et la diplégie spastique.
4. Protocole d examens ophtalmologiques et rééducation oculomotrice
La section détaille un protocole d'examens ophtalmologiques réguliers pour le dépistage précoce des anomalies visuelles associées à la diplégie spastique. Un examen complet à 4 semaines de vie (poursuite horizontale, nystagmus optocinétique) est recommandé, suivi d'examens à 6 mois (ajout de la poursuite verticale), 18 mois (poursuite d'une pendule), et 2 ans (enregistrement oculographique si anomalies persistantes). Ce protocole vise à détecter les anomalies de poursuite oculaire, les réponses nystagmiques ou les troubles du champ visuel. En cas d'anomalies persistantes, une rééducation oculomotrice peut être envisagée. L’importance du suivi ophtalmologique régulier est soulignée en raison de l’impact crucial de la fonction visuelle sur le développement de l'enfant.
V.Profil Thérapeutique et Prise en Charge
La prise en charge de la diplégie spastique est multidisciplinaire et nécessite une collaboration étroite entre médecins, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, et la famille. Le traitement vise à maîtriser la spasticité (avec des traitements tels que le baclofène et la toxine botulinique), améliorer la fonction motrice, et prévenir les complications secondaires. L'importance de la kinésithérapie, des orthèses, et de l'ergothérapie est soulignée, ainsi que les défis liés à l'accès aux soins, particulièrement en milieu rural (45% des enfants dans l'étude étaient d'origine rurale ou périurbaine). L'étude souligne aussi les difficultés psychologiques pour les familles face à la gravité de la pathologie et les défis d'intégration scolaire et sociale.
1. Approche globale et multidisciplinaire de la prise en charge
La prise en charge de la diplégie spastique est présentée comme une approche globale et multidisciplinaire, impliquant des aspects médicaux, psychologiques, familiaux et éducatifs. Une étroite collaboration entre les différents acteurs est essentielle. Le texte souligne l'importance d'une gestion précoce des anomalies primaires liées à la lésion cérébrale pour éviter les lésions secondaires (rétractions, déformations osseuses) et limiter le développement de mécanismes de compensation. La maîtrise précoce de la spasticité est identifiée comme une clé de l'efficacité du traitement. Le rôle actif de la famille dans le choix et la mise en œuvre de la prise en charge est également mis en avant, l'absence de participation familiale rendant tout projet thérapeutique impossible.
2. Rôle de la kinésithérapie et limites de son efficacité prouvée
La kinésithérapie est considérée comme un élément essentiel de la prise en charge, malgré l'absence de preuves scientifiques irréfutables quant à son efficacité. Elle permet un suivi régulier de l'enfant, l'apprentissage fonctionnel, la prévention des rétractions et sensibilise les parents aux problèmes de leur enfant. L'étude souligne que la kinésithérapie est un outil parmi d'autres et ne doit pas être le centre des préoccupations. Il est important d'évaluer objectivement ses résultats et de peser ses effets positifs par rapport à son impact potentiel sur la vie de l'enfant et de sa famille. Dans le cadre de cette étude, tous les enfants étaient suivis en kinésithérapie.
3. Traitements médicamenteux baclofène et toxine botulinique
Le baclofène, agissant sur les récepteurs GABA béta, est mentionné comme traitement de la spasticité. L'administration intrathécale, bien qu'efficace, présente un taux de complications locales important et un coût élevé. L'administration orale est plus courante mais peut entrainer une diminution de la vigilance à forte dose. La toxine botulinique, quant à elle, a démontré son efficacité dans le traitement des pieds équins (50 à 61% des cas), bien que les injections soient interrompues chez près de 75% des enfants (formation d'anticorps, fibrose musculaire). Des études sont en cours pour optimiser le rythme d'administration de la toxine.
4. Ergothérapie rôle de la famille et défis liés à l accès aux soins
L'ergothérapie est présentée comme un élément important de la prise en charge, particulièrement pour les anciens prématurés. Elle vise l'éducation thérapeutique du geste des membres supérieurs et son transfert vers des activités fonctionnelles. Le texte met en lumière l'importance de l'intégration des aspects dynamiques de la vie psychique et des spécificités du fonctionnement cognitif dans la prise en charge pluridisciplinaire. Le rôle actif de la famille est réaffirmé, avec un avertissement contre la surprotection et l'abandon affectif ou thérapeutique. L'accès aux soins est souligné comme un défi majeur, notamment en milieu rural (45% des enfants de l'étude étaient d'origine rurale ou périurbaine), où les transports sont coûteux et les structures thérapeutiques adéquates rares. L'absence d'appareillage pour les enfants de l'étude illustre ces difficultés d'accès aux ressources.
5. Aspects psychologiques et évolution à long terme
La section aborde les aspects psychologiques de la prise en charge, en particulier les difficultés vécues par les familles durant la deuxième année de vie de l'enfant, marquée par la prise de conscience de la gravité de la pathologie et les incertitudes concernant l'avenir (marche, scolarisation). A l’adolescence, l’insertion sociale pose de nouveaux défis. La kinésithérapie d’entretien doit être adaptée aux besoins réels de l'enfant. L'étude mentionne le manque d'informations sur l'évolution à long terme de la diplégie spastique et le manque de communication entre les services de pédiatrie et les services pour adultes. Dans l’échantillon étudié, plus de la moitié des enfants (52,63%) ont montré une amélioration, tandis que 15,79% sont restés dans un état stationnaire et 15,79% ont connu une aggravation.
VI.Conclusion et Perspectives
La diplégie spastique, une forme fréquente d'IMC, pose des défis importants au Maroc, notamment en raison de l'insuffisance des soins et du diagnostic tardif. L'étude met l'accent sur l'importance de la prévention (suivi de grossesse, amélioration des conditions d'accouchement), et d'une prise en charge précoce et multidisciplinaire pour optimiser la réhabilitation motrice. Les résultats de l'étude soulignent la nécessité d'une politique d'orientation et de prise en charge plus efficace pour les enfants handicapés au Maroc. Une amélioration a été constatée chez plus de la moitié des enfants suivis dans l'étude (52,63%).
1. Nécessité d une prise en charge précoce et multidisciplinaire
La conclusion souligne l'importance cruciale d'une prise en charge précoce et multidisciplinaire de la diplégie spastique pour optimiser la réhabilitation motrice. L’étude met en évidence la complexité de cette prise en charge, impliquant une collaboration étroite entre différents professionnels de santé et la famille. Le diagnostic précoce est essentiel pour éviter les complications orthopédiques et fonctionnelles à long terme. L'absence de traitement adéquat et un diagnostic tardif sont identifiés comme des facteurs aggravants des complications orthopédiques observées dans l'étude. Une intervention précoce est donc présentée comme garante d'une meilleure réhabilitation.
2. Importance de la prévention et défis liés au contexte marocain
L'étude met l'accent sur l'intérêt de la prévention, notamment au Maroc où les conditions sanitaires peuvent être défavorables. Le suivi des grossesses, la médicalisation de l'accouchement, et l'amélioration des conditions de prise en charge des nouveau-nés souffrants sont présentés comme des axes importants de la prévention. Au Maroc, la prématurité arrive en troisième position des facteurs de risque de diplégie spastique, après la souffrance néonatale et les grossesses non suivies. Le manque de ressources et l'accès limité aux soins en milieu rural, affectant 45% des enfants de l'étude, constituent des freins importants à une prise en charge optimale. L’absence d’une politique d’orientation et de prise en charge des enfants handicapés est également soulignée comme un facteur limitant.
3. Résultats de l étude et perspectives futures
L'étude a révélé une amélioration chez plus de la moitié (52,63%) des enfants suivis, un état stationnaire chez 15,79%, et une aggravation chez 15,79%. Ces résultats mettent en perspective la variabilité de l'évolution de la diplégie spastique. La conclusion souligne le manque de connaissances sur l'évolution à long terme et le besoin de meilleures communications et d'une meilleure transition entre les services de pédiatrie et les services pour adultes. L'augmentation de la fréquence de la diplégie spastique, liée à l’amélioration de la survie des prématurés dans les pays développés et à des conditions sanitaires défavorables dans les pays en développement comme le Maroc, est confirmée. L'étude appelle à une recherche plus approfondie sur l'épidémiologie et l'évolution à long terme de la diplégie spastique au Maroc afin d'améliorer la prise en charge.
