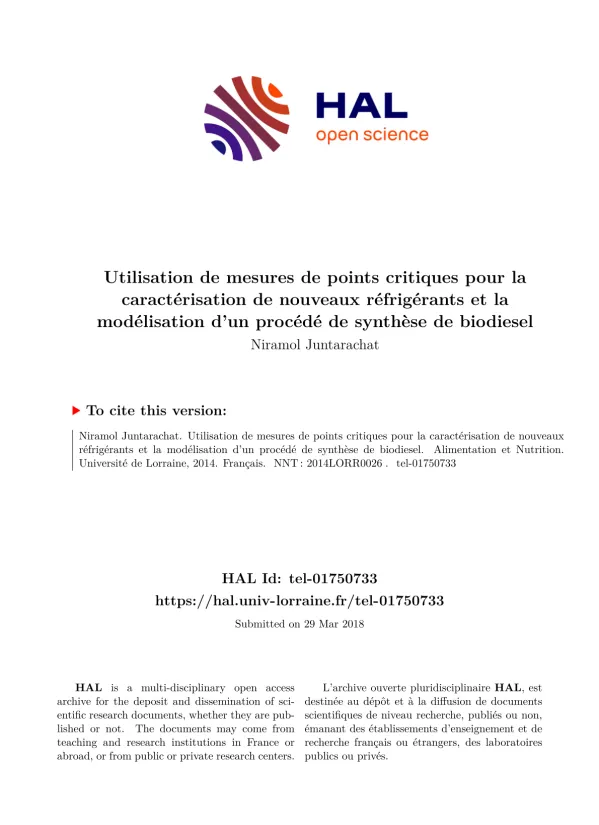
Caractérisation des Réfrigérants et Modélisation de la Synthèse de Biodiesel
Informations sur le document
| Auteur | Niramol Juntarachat |
| instructor/editor | Jean-Noël Jaubert (directeur de thèse) |
| school/university | Université de Lorraine |
| subject/major | Génie des Procédés et des Produits |
| Type de document | Thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 5.05 MB |
- réfrigérants
- biodiesel
- points critiques
Résumé
I.Comportements de Phases des Systèmes Binaires et Point Critique
Cette étude explore les équilibres de phases dans les mélanges binaires, notamment les équilibres liquide-vapeur (ELV) et liquide-liquide (ELL), en lien avec le point critique. L'analyse se base sur la règle des phases de Gibbs pour déterminer la variance du système. Différentes configurations de diagrammes de phases sont présentées, incluant des systèmes azéotropiques (azéotropie positive et négative). L'historique du concept de point critique, de la première observation par Cagnard de la Tour jusqu'aux travaux d'Andrews, est brièvement rappelé. Les diagrammes de type I et VI selon la classification de Van Konynenburg et Scott sont décrits, soulignant l'importance du lieu des points critiques (critique liquide-vapeur (LV) et critique liquide-liquide (LL)) pour la caractérisation des systèmes. L'existence de points critiques terminaux (PCTI et PCTS) dans les diagrammes de type VI est détaillée.
1. Définition des Mélanges Binaires et Variables Intérieures
La section commence par définir un mélange binaire comme un système à deux constituants, pouvant exister sous différents états multiphasiques : équilibre liquide-vapeur, liquide-liquide, ou liquide-liquide-vapeur. La distinction entre variables extensives (dépendantes de la quantité de matière) et variables intensives (indépendantes de la quantité de matière, telles que l'enthalpie (h), l'entropie (s), l'énergie interne (u), l'énergie libre de Gibbs (g), la capacité calorifique à pression constante (cp), la capacité calorifique à volume constant (cv), la température (T), la pression (P), le volume spécifique (v), etc.) est établie. Les variables intensives des phases ne sont pas toutes indépendantes ; elles sont liées par l'équation d'état et les relations d'équilibre de phases. La règle des phases de Gibbs détermine le nombre de variables intensives indépendantes dans un système donné. La variance (v), ou nombre de degrés de liberté, représente le nombre de variables intensives qu'il faut fixer pour définir complètement l'état intensif de chaque phase en équilibre. La règle de Gibbs est exprimée en fonction du nombre de constituants (C), du nombre de phases (φ) et du nombre de relations supplémentaires (r), incluant des relations liées à l'azéotropie ou à un état critique.
2. Superposition des Régions d Équilibre Liquide Liquide et Liquide Vapeur
L'étude se penche ensuite sur la superposition des régions d'équilibre liquide-liquide (ELL) et liquide-vapeur (ELV) dans les diagrammes de phases des mélanges binaires. La figure 5 illustre différentes combinaisons observées expérimentalement, montrant l'interaction entre les domaines ELV et ELL. Plusieurs configurations sont décrites, résultant de la rencontre d'un diagramme ELV avec un phénomène d'azéotropie positive ou négative, et d'un diagramme ELL. L'une de ces configurations (un comportement azéotropique négatif combiné à un équilibre liquide-liquide) est particulièrement rare, avec seulement trois mélanges binaires mentionnés dans la littérature : acide acétique + triéthylamine, chlorure d'hydrogène + eau et bromure d'hydrogène + eau. Cette analyse souligne la complexité des interactions entre les différents équilibres de phases dans les mélanges binaires et la diversité des diagrammes de phases possibles.
3. Historique et Définition du Point Critique
L'historique du concept de point critique est présenté, en commençant par les observations de Cagnard de la Tour en 1822, qui a mis en évidence l'existence d'une limite à la dilatation d'un liquide volatil au-delà de laquelle il devient vapeur, quelle que soit la pression. Les travaux de Faraday en 1823 ont approfondi la compréhension de ces résultats expérimentaux, suggérant que le point de Cagnard de la Tour représente non seulement la disparition de l'état liquide, mais aussi un point où le liquide et sa vapeur ne forment plus qu'une seule phase. Les contributions de Mendeleev en 1860, avec son expérience de chauffage dans un tube capillaire observant la disparition du ménisque, et surtout celles d'Andrews en 1869, démontrant la continuité entre les états liquide et gazeux, ont consolidé la définition du point critique, introduisant les concepts de température critique et de pression critique. Cette partie historique contextualise l'importance du point critique dans l'étude des équilibres de phases.
4. Classification des Diagrammes de Phases Types I et VI
La section détaille la classification des diagrammes de phases selon Van Konynenburg et Scott. Les diagrammes de type I sont les plus simples, caractérisés par une ligne critique liquide-vapeur (LV) continue, bornée par les points critiques des deux corps purs. La forme de cette ligne peut varier, présentant parfois un extremum en pression (souvent un maximum) ou en température (souvent un minimum). Ce type de diagramme est typique des mélanges binaires dont les constituants sont de même nature chimique et de taille similaire. Les diagrammes de type VI, absents de la classification initiale de Van der Waals, sont semblables aux diagrammes de type I pour le lieu des points critiques liquide-vapeur (LV). Ils se distinguent par la présence, à basse température, d'un lieu des points critiques liquide-liquide (LL) dont la pression ne tend pas vers l'infini. Cette ligne LL débute sur un point critique terminal inférieur (PCTI) et se termine sur un point critique terminal supérieur (PCTS), délimitant une boucle d'immiscibilité liquide-liquide. Une ligne triphasique (LLV) relie le PCTI et le PCTS. Cette description met en lumière la diversité des comportements de phase possibles dans les mélanges binaires, et la complexité de leur modélisation.
II.Méthodes de Mesure des Propriétés Critiques
Deux méthodes principales de détermination des propriétés critiques sont comparées : la méthode statique, basée sur l'observation de la disparition et réapparition de l'interface liquide-vapeur dans un récipient fermé, et la méthode dynamique, utilisant une cellule de mesure ouverte avec un débit variable pour minimiser la décomposition thermique des substances. L'utilisation d'un appareil synthétique-dynamique, développé par ARMINES (École Nationale Supérieure des Mines de Paris), permet la mesure des propriétés critiques (température critique et pression critique) de substances pures et de mélanges multi-composants. Les limites de l'appareil sont de 673 K et 20 MPa pour la méthode dynamique et 493 K et 20 MPa pour la méthode statique.
1. Méthode Statique pour la Détermination des Propriétés Critiques
La méthode statique repose sur l'observation directe de la disparition et de la réapparition de l'interface liquide-vapeur dans un récipient fermé à volume constant. Elle nécessite un chargement de fluide dont la densité est proche de la densité critique et une agitation efficace. Le récipient est chauffé jusqu'à la disparition de l'interface, puis refroidi jusqu'à sa réapparition. Ces changements d'état permettent de déterminer le point critique. Pour les substances thermiquement instables, la température critique diminue avec le temps de mesure tandis que la pression critique augmente à cause de la décomposition thermique. Une extrapolation des valeurs mesurées au temps zéro est nécessaire pour obtenir les valeurs critiques réelles. Les appareils utilisés varient selon plusieurs critères : le type de récipient, la technique de chargement de l'échantillon, la méthode de chauffage, et la technique de détermination de la composition. Cette méthode, bien que précise pour certaines substances, présente des limites pour les composés sensibles à la décomposition thermique.
2. Méthode Dynamique pour les Composés Thermiquement Instables
La méthode dynamique, initialement proposée par Roess, est une alternative pour déterminer les propriétés critiques des composés thermiquement instables. Elle est basée sur l'observation de la disparition et de la réapparition du ménisque, mais dans une cellule de mesure ouverte. Le fluide traverse la cellule avec un débit variable, minimisant le temps de résidence et limitant la décomposition à haute température. Malgré cet avantage, cette méthode consomme une grande quantité de fluide. Des améliorations ont été apportées par Teja et al. pour réduire la taille de l'équipement et le temps de résidence. Initialement appliquée aux alcanes, aux acides carboxyliques et à d'autres composés, cette méthode a subi de nombreuses modifications pour améliorer notamment la partie attractive des équations d'état. Les équations de Redlich-Kwong-Soave et de Peng-Robinson, largement utilisées en industrie, constituent des exemples d'équations d'état modifiées. Bien que nécessitant peu de données expérimentales pour les corps purs, ces équations ont des limitations, notamment pour le calcul des densités liquides et pour les fluides polaires. Malgré les améliorations, la représentation de l'enveloppe de phases liquide-vapeur au voisinage du point critique reste difficile.
3. Appareil Synthétique Dynamique d ARMINES
L'étude utilise un nouvel appareil synthétique-dynamique développé par ARMINES (École Nationale Supérieure des Mines de Paris) pour mesurer les propriétés critiques (température et pression critiques) de substances pures et de mélanges multi-composants. Cet appareil fonctionne en mode statique ou dynamique. La méthode dynamique, grâce à un temps de résidence court, permet de déterminer le point critique de substances susceptibles de se décomposer thermiquement, mais nécessite une grande quantité de matière. La méthode statique, au contraire, nécessite peu de substance, mais est limitée par la décomposition thermique éventuelle. Les limites de température et de pression sont respectivement 673 K et 20 MPa pour la méthode dynamique, et 493 K et 20 MPa pour la méthode statique. En mode dynamique, l'agitateur magnétique est retiré car la circulation du fluide assure une agitation efficace, contrairement au mode statique où il est indispensable, limitant la température de fonctionnement à 493 K (température maximale supportée par l'agitateur).
III.Système Acétone Chloroforme Azéotrope Critique Négatif
L'étude porte sur le système binaire acétone + chloroforme, connu pour présenter un azéotrope négatif à basse température et pression. L'objectif est d'étudier le comportement de ce système à haute température et pression pour confirmer ou infirmer l'existence d'un azéotrope critique négatif. Les données expérimentales obtenues sont comparées à celles de la littérature (Kuenen et Robson, Campbell et Musbally), révélant des divergences importantes. Le modèle PPR78 est utilisé pour corréler les résultats expérimentaux et prédire le lieu des points critiques. L'intersection éventuelle entre le lieu des points critiques et la courbe de vaporisation du chloroforme est analysée comme condition nécessaire pour l'existence d'un azéotrope critique.
1. Azeotropie Négative Acétone Chloroforme à Basse Température et Pression
Le système binaire acétone (1) + chloroforme (2) est reconnu pour présenter un azéotrope négatif à basses températures et pressions, selon de nombreuses études expérimentales et théoriques. Les pressions azéotropiques et les pressions de vapeur des composants purs montrent une bonne cohérence interne à différentes températures. Des mesures de l'équilibre de phase par Röch et Schröder (15-55°C) et Campbell et Musbally (100-180°C) indiquent un déplacement de la composition azéotropique vers une plus forte concentration en chloroforme avec l'augmentation de la température. Ces résultats expérimentaux concordent bien avec les modélisations de Kamath et al. Cependant, l'existence de l'azéotrope à hautes températures et pressions reste peu documentée. Campbell et Musbally ont constaté la persistance de l'azéotrope jusqu'à 180°C, mais Kuenen et Robson ont suggéré sa disparition avant d'atteindre le point critique, invoquant une réaction chimique entre le chloroforme et le mercure de leur appareillage. Ce manque de données fiables à haute température et pression motive la présente étude.
2. Détermination Expérimentale des Points Critiques et Comparaison avec la Littérature
L'étude détermine expérimentalement les points critiques du système acétone + chloroforme sur toute la gamme de composition, en utilisant la méthode dynamique et un appareillage synthétique-dynamique. Les données obtenues sont comparées aux données de la littérature, notamment celles de Kuenen et Robson, et de Campbell et Musbally. De fortes différences sont observées avec les données de Kuenen et Robson, probablement dues à une réaction chimique parasite dans leur appareillage. Cependant, un bon accord est trouvé avec les données de Campbell et Musbally. Le modèle PPR78 est utilisé pour corréler les données expérimentales et prédire le lieu des points critiques. Le modèle prédit avec précision le lieu des points critiques, excepté à fortes concentrations en chloroforme où les pressions critiques expérimentales sont légèrement inférieures aux valeurs prédites.
3. Analyse du Lieu des Points Critiques et Prédiction d un Azéotrope Critique Négatif
L'analyse du lieu des points critiques expérimentaux montre une courbe continue et monotone sans minimum de pression ni maximum de température, pour le mélange acétone + chloroforme. Le modèle PPR78 prédit également un locus critique continu, sans intersection avec la courbe de vaporisation du chloroforme, ce qui n'est pas prédictif d'un azéotrope critique. L'obtention d'un azéotrope critique négatif nécessiterait une intersection entre le locus critique et la courbe de vaporisation du chloroforme. Les données expérimentales obtenues dans cette étude semblent imposer une contrainte sur la courbe de vaporisation du chloroforme prédite par le modèle PPR78. Une comparaison avec les données de la littérature concernant la courbe de vaporisation du chloroforme confirme la précision du modèle PPR78, sauf pour les hautes températures. Cette étude fournit pour la première fois des données expérimentales précises à hautes températures et pressions permettant de conclure sur l'existence d'un azéotrope critique négatif.
IV.Comportement de Phases dans la Production de Biodiesel par Voie Supercritique
L'étude thermodynamique vise à optimiser un procédé de fabrication de biodiesel par éthanolyse supercritique, incluant du CO2 comme cosolvant. La connaissance des équilibres de phases des mélanges (éthanol, esters éthyliques, glycérol, CO2) est cruciale pour déterminer les conditions opératoires optimales (température, pression, rapport molaire éthanol/huile) permettant d'obtenir un rendement élevé. L'impact de la présence d'eau sur le rendement est mentionné. Des données expérimentales et des modèles prédictifs, comme le modèle PPR78, sont utilisés pour caractériser le comportement de phase de systèmes binaires contenant du CO2 et des esters éthyliques (acétate, propanoate, butanoate, etc.). Le modèle PPR78 est utilisé pour corréler les données et déterminer l’importance des paramètres d’interaction binaire (kij).
1. Intérêt de la Thermodynamique pour l Optimisation de la Production de Biodiesel Supercritique
L'étude porte sur la production de biodiesel par éthanolyse supercritique de lipides, un procédé exploratoire utilisant le dioxyde de carbone comme cosolvant pour réduire la sévérité des conditions opératoires et améliorer le bilan exergétique grâce à une unité de cogénération. L'étude thermodynamique des mélanges impliqués est une étape préliminaire indispensable pour le dimensionnement et l'optimisation énergétique du procédé. Elle permet de déterminer les conditions opératoires (température, pression, rapport molaire éthanol/huile) assurant à la fois le débit et la pureté requis. La compréhension de l'équilibre de phases est essentielle, notamment pour opérer dans la région monophasique afin d'obtenir un rendement de production optimal. Les molécules de dioxyde de carbone et d'éthanol sont considérées comme des groupes élémentaires dans cette étude. L'objectif est d'utiliser des données expérimentales pour affiner les modèles prédictifs de l'équilibre des phases.
2. Étude des Équilibres de Phases pour les Systèmes Binaires Impliqués
Une revue bibliographique souligne le besoin de données concernant le comportement de phases, particulièrement à hautes températures et pressions, pour les systèmes impliquant l'éthanol, les esters éthyliques et le glycérol. L'étude des systèmes binaires contenant de l'éthanol et un ester éthylique révèle une abondance de données à basses températures et pressions, mais une pénurie de données à hautes températures et pressions. De même, l'analyse des systèmes binaires CO2 et ester éthylique montre des données disponibles pour les esters à courte et moyenne chaîne, mais des informations limitées pour les esters à longue chaîne. La nécessité de modèles thermodynamiques prédictifs, notamment ceux basés sur le concept de contribution de groupe, est mise en avant. Ces modèles permettent une estimation rapide des propriétés thermodynamiques sans mesures préliminaires, mais requièrent des données expérimentales de haute qualité pour leur paramétrage. La complémentarité des mesures expérimentales et des modèles prédictifs est donc soulignée.
3. Modélisation avec le Modèle PPR78 et Comparaison avec les Données Expérimentales
Le modèle PPR78, qui combine l'équation d'état de Peng-Robinson avec une méthode de contribution de groupe, est utilisé pour prédire le comportement de phase des mélanges impliquant du CO2 et des esters éthyliques. La définition d'un nouveau groupe pour la fonction ester (O-C=O) est nécessaire pour améliorer la précision du modèle. Une base de données expérimentale est constituée, incluant des valeurs VLE de la littérature et des valeurs critiques mesurées expérimentalement dans cette étude. Des incohérences dans certaines données de la littérature ont conduit à leur exclusion. Le système CO2 + acétate d'éthyle est modélisé séparément, en considérant la molécule comme un groupe unique. La modélisation PPR78 est comparée aux données expérimentales pour des systèmes binaires CO2 + esters éthyliques saturés et insaturés, révélant une bonne capacité de prédiction du comportement subcritique, mais une moins bonne précision pour le comportement critique. Les résultats mettent en évidence la complémentarité des approches expérimentales et modélisations pour une meilleure compréhension du processus supercritique de production de biodiesel.
V.Comportement de Phases des Réfrigérants Alternatifs
Face aux préoccupations environnementales liées aux réfrigérants traditionnels, l'étude examine le comportement de phase de nouveaux réfrigérants, notamment les hydrofluoro-oléfines (HFOs) tels que le R1234yf et le R1234ze(E). L'objectif est d'évaluer les propriétés thermodynamiques et les équilibres de phases de mélanges binaires de ces HFOs avec d'autres réfrigérants (HFCs, réfrigérants naturels). La recherche de solutions moins inflammables, par l'utilisation de mélanges, est mise en avant. Le modèle PPR78 est également utilisé pour prédire le comportement de phase de ces systèmes.
1. Contexte et Nécessité de Réfrigérants Alternatifs
L'étude aborde la problématique des réfrigérants traditionnels, notamment les chlorofluorocarbures (CFC), les hydrochlorofluorocarbures (HCFC) et les hydrofluorocarbures (HFC), dont le potentiel de déplétion ozonique (PDO) et le potentiel de réchauffement global (PRG) sont élevés. Le Protocole de Montréal et la réglementation européenne sur les gaz fluorés (F-gas) imposent des limites strictes sur ces substances, poussant les industries de la réfrigération et de la climatisation à rechercher des solutions alternatives. Le dioxyde de carbone (CO2), réfrigérant naturel, est une alternative prometteuse, mais présente des inconvénients comme une pression de fonctionnement plus élevée et une efficacité thermodynamique moindre. Les hydrofluorooléfines (HFO), tels que le R1234yf et le R1234ze(E), sont présentés comme une nouvelle génération de réfrigérants avec un PDO nul, un PRG très faible et une durée de vie atmosphérique courte. Cependant, leur inflammabilité pose des défis.
2. Propriétés Thermophysiques des HFO et Étude des Mélanges Binaires
Plusieurs propriétés thermophysiques des HFO R1234yf et R1234ze(E) ont été largement étudiées ces dernières années : pressions de vapeur, propriétés critiques, comportements PvT et PρT, capacités calorifiques spécifiques, densités et viscosités. Des méthodes prédictives ont également été développées. Cependant, l'inflammabilité modérée des HFO, avec une faible marge entre les limites d'inflammabilité inférieure et supérieure, limite leur utilisation. Pour pallier à cela, l'étude des mélanges binaires d'HFO avec d'autres réfrigérants (HFC ou réfrigérants naturels) est envisagée comme une solution prometteuse alliant performances et respect de l'environnement. Depuis 2012, des études sur le comportement de phases de systèmes binaires contenant des HFO et un autre réfrigérant se sont multipliées, notamment des mélanges de R1234yf avec des HFC et des réfrigérants naturels, ainsi que des mélanges de R1234ze(E) avec des HFC.
3. Manque de Données et Modélisation du Comportement de Phases
Une revue bibliographique met en évidence un manque de données d'équilibre vapeur-liquide (ELV) pour ces systèmes binaires, surtout à hautes températures et pressions. C'est pourquoi les points critiques de ces systèmes ont été mesurés à l'aide d'un appareillage synthétique-dynamique utilisant la méthode dynamique. L'applicabilité du modèle thermodynamique PPR78, combinant l'équation d'état de Peng-Robinson et une méthode de contribution de groupe, est étendue aux systèmes contenant des esters. Ce modèle a montré une grande précision dans la prédiction du comportement de phase des systèmes CO2 + ester éthylique. Cependant, pour les systèmes contenant de l'éthanol et un ester éthylique, le comportement de phase est corrélé en considérant chaque molécule comme un seul groupe, en raison de la polarité moléculaire et des interactions. L'étude suggère des mesures futures de données ELV pour le système CO2 + biodiesel pour tester les capacités prédictives du modèle PPR78, et mentionne d'autres modèles comme SAFT et CPA pour améliorer la corrélation des données expérimentales.
