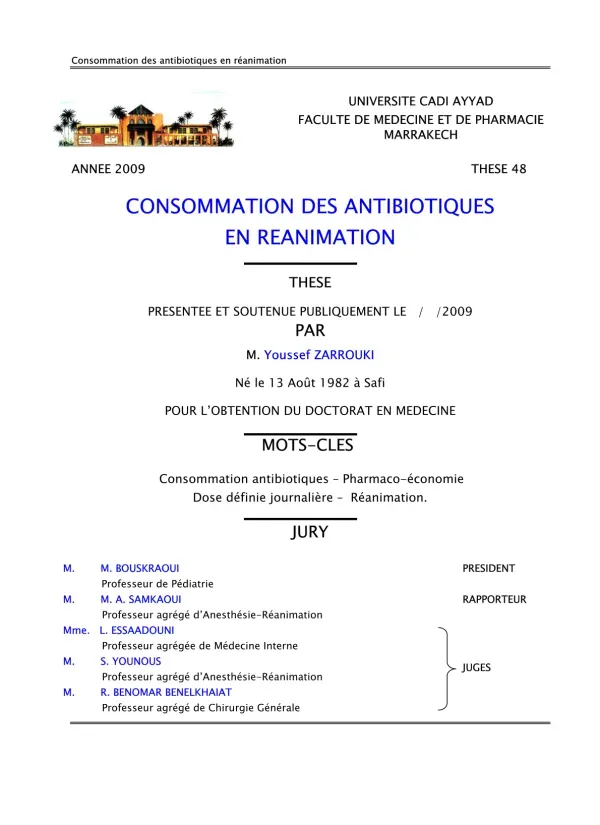
Consommation des Antibiotiques en Réanimation
Informations sur le document
| Auteur | Youssef Zarrouki |
| École | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech |
| Spécialité | Médecine |
| Lieu | Marrakech |
| Type de document | Thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 1.76 MB |
- Antibiotiques
- Réanimation
- Pharmaco-économie
Résumé
I.Consommation d antibiotiques en réanimation médico chirurgicale à l hôpital Ibn Tofail de Marrakech
Cette étude rétrospective, menée sur deux ans (2007-2008) au service de réanimation médico-chirurgicale de l'hôpital Ibn Tofail (CHU Mohammed VI, Marrakech), analyse la consommation d'antibiotiques dans ce service de 10 lits. L'objectif principal est d'évaluer la consommation en doses définies journalières (DDJ ou DDD) par famille et molécule, selon la classification ATC de l'OMS, afin d'identifier les antibiotiques les plus utilisés et d'évaluer leur impact sur le budget hospitalier et le développement de la résistance aux antibiotiques. L'étude porte sur tous les patients hospitalisés durant cette période. Des données démographiques et cliniques ont été recueillies à partir des registres d'admission et des dossiers médicaux.
1. Cadre de l étude
L'étude, menée au service de réanimation médico-chirurgicale de l'hôpital Ibn Tofail du CHU Mohammed VI à Marrakech, est une étude rétrospective portant sur deux années, 2007 et 2008. Ce service de réanimation compte 10 lits. L'étude vise à déterminer la consommation d'antibiotiques chez tous les patients hospitalisés durant cette période. Les données démographiques sont collectées à partir des registres d'admission, tandis que les données cliniques proviennent des dossiers médicaux archivés. La consommation d'antibiotiques est exprimée en doses définies journalières (DDJ ou DDD), conformément aux normes de l'OMS, utilisées comme outil de comparaison et non comme recommandations posologiques. Il est important de noter que certaines DDJ diffèrent significativement des posologies réellement utilisées en pratique. La classification thérapeutique anatomique de l'OMS guide l'expression de la consommation, décomposée en familles, sous-familles et molécules.
2. Méthodologie de collecte et de conversion des données
Le nombre de doses d'antibiotiques délivrées au service de réanimation par la pharmacie de l'hôpital, pour chaque voie d'administration, a été collecté. Ces données brutes ont ensuite été converties en doses définies journalières (DDJ), correspondant à la posologie quotidienne de référence pour un adulte de 70 kg, selon les normes internationales et le programme européen de surveillance de la consommation des antibiotiques (ESAC). L'unité de mesure DDJ/1000 JH (journées d'hospitalisation) permet des comparaisons entre pays, entre établissements de santé, entre services au sein d'un même hôpital, et au sein d'un même service d'une année sur l'autre. Cette méthode standardisée permet une analyse précise de la consommation d'antibiotiques et facilite les comparaisons avec d'autres études.
3. Architecture du service de réanimation
L'unité de réanimation de l'hôpital Ibn Tofail est organisée en trois zones distinctes : administrative (bureaux médicaux, secrétariat, salle de réunion, vestiaires et toilettes), d’hospitalisation (10 chambres de 24 m², chacune équipée d'un lit, d'un lavabo, de la climatisation, d'un respirateur, de prises murales pour les gaz médicaux, d'aspirateurs et de monitorage multimodal), et technique (pharmacie, salle de matériel, bureau de l'infirmier major et salle de garde). Cette description précise de l'infrastructure permet de contextualiser l'étude et de mieux comprendre les conditions de prise en charge des patients et de la gestion des médicaments. La description détaillée des chambres de réanimation fournit des informations importantes concernant l’environnement et les équipements disponibles pour les patients.
4. Coût direct des antibiotiques consommés
Les données sur le coût direct des antibiotiques sont extraites des registres du service de pharmacie de l'hôpital Ibn Tofail. Le prix unitaire utilisé correspond au prix d'achat de l'hôpital. Le coût mentionné représente uniquement le coût direct de l'antibiothérapie, excluant les autres coûts associés aux soins. Ce chapitre fournit des données quantitatives essentielles sur le coût de l'antibiothérapie au sein de l'unité de réanimation. Cette information est cruciale pour l'évaluation de la performance économique du service et la nécessité de rationaliser les dépenses.
5. Évaluation de la consommation des antibiotiques en réanimation et facteurs influençant la prescription
L'évaluation de la consommation d'antibiotiques est présentée comme un premier pas vers une utilisation plus rationnelle. L'étude souligne la complexité du lien entre l'exposition aux antibiotiques et le développement de la résistance bactérienne, insistant sur les risques d'une surprescription ou d'une prescription inadaptée. L'antibiothérapie représente une part importante des budgets pharmaceutiques hospitaliers, notamment en réanimation, et constitue une menace pour l'écologie bactérienne. Le comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN), récemment créé, joue un rôle crucial dans l'audit de la consommation. Les patients en réanimation présentent souvent des pathologies sévères nécessitant des associations d'antibiotiques à forte posologie. La présence de comorbidités, comme le diabète ou l'immunodépression, augmente le risque de complications infectieuses. Les unités de réanimation sont particulièrement exposées à la sélection de germes multi-résistants, ce qui limite les options thérapeutiques et peut justifier l'utilisation de posologies élevées.
II.Profil de la Consommation d Antibiotiques et Bactéries Multirésistantes BMR
Les résultats révèlent un coût direct annuel d'environ un million de dirhams pour l'antibiothérapie dans le service. Les bêta-lactamines et les fluoroquinolones sont les familles d'antibiotiques les plus prescrites. La pneumopathie acquise sous ventilation mécanique (PNAVM) représente la principale indication de l'antibiothérapie. L'étude souligne le lien entre la consommation élevée d'antibiotiques et l'émergence de bactéries multirésistantes (BMR) telles que le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM), Pseudomonas aeruginosa et Acinetobacter baumannii, mettant en lumière les défis liés à la gestion des infections nosocomiales et à la nécessité de stratégies de prescription plus raisonnées pour préserver l'efficacité des antibiotiques et limiter l’apparition de résistance aux antibiotiques.
1. Consommation globale d antibiotiques et coût
L'étude révèle une consommation annuelle d'antibiotiques importante au service de réanimation, chiffrée à un million de dirhams. Le coût moyen par journée d'hospitalisation s'élève à 323,9 dirhams, un chiffre supérieur à la moyenne de 470 dirhams observée dans une étude pharmaco-économique française portant sur 750 services de réanimation. Bien que des variations existent entre les unités, l'étude marocaine met en évidence une dépense significative liée à l'antibiothérapie. Il est crucial de noter que ces coûts sont influencés par le prix d'achat unitaire des antibiotiques, qui peut varier considérablement d'un centre à l'autre. Les unités de réanimation représentent une part importante de la consommation globale de médicaments et produits pharmaceutiques au sein des hôpitaux. La conciliation entre les objectifs thérapeutiques et les aspects économiques est un enjeu majeur, le rapport coût/efficacité étant un critère primordial pour les prescripteurs.
2. Familles d antibiotiques les plus utilisées
Les données indiquent que les bêta-lactamines et les fluoroquinolones sont les familles d'antibiotiques les plus fréquemment prescrites dans le service de réanimation. Une comparaison avec les résultats d'études menées dans des services de réanimation en France (Dijon et Besançon) montre des similitudes dans les tendances, avec une prédominance des bêta-lactamines. Cependant, des variations sont observées pour les aminosides et les glycopeptides, soulignant la diversité des pratiques et des contextes. Cette information sur les antibiotiques les plus utilisés sert de base pour une analyse plus approfondie des choix thérapeutiques et de leur impact, tant sur le plan clinique qu’économique. L'analyse de ces données doit prendre en considération la spécificité du contexte local, les particularités des infections rencontrées et la sensibilité des bactéries.
3. Principales indications de l antibiothérapie et sites infectieux
La pneumopathie acquise sous ventilation mécanique (PNAVM) constitue la principale indication d'antibiothérapie dans le service étudié, représentant 56 % des infections traitées. Les infections urinaires (12 %) et les infections neuroméningées (9,5 %) suivent en importance. Une comparaison avec les données d'une étude tunisienne montre des similarités pour les infections respiratoires et urinaires, mais une différence notable concernant les infections neuroméningées, probablement due à une activité neurochirurgicale et neurotraumatologique plus importante à Marrakech. La surveillance des infections urinaires, souvent liées à un sondage, est jugée discutable en raison de la difficulté à distinguer infection et colonisation. La prévention repose principalement sur l'utilisation de systèmes de sondage urinaire fermés. Le programme de surveillance des infections nosocomiales doit cibler les infections cliniquement significatives, évitant la surveillance systématique des colonisations.
4. Bactéries Multirésistantes BMR
Le développement continu de nouvelles résistances bactériennes est un problème majeur, accentuant la nécessité d'une adaptation régulière des traitements antibiotiques. La pression de sélection due à l'utilisation d'antibiotiques et la transmission croisée entre patients sont des facteurs clés dans l'émergence des bactéries multirésistantes (BMR). La surveillance des BMR est complexe, nécessitant une surveillance en temps réel avec un retour d'information rapide. La faisabilité est un défi, le laboratoire de microbiologie jouant souvent un rôle central dans l'alerte. Les stratégies de surveillance doivent cibler les BMR les plus prévalentes au sein du service pour optimiser les ressources. Parmi les cibles prioritaires figurent le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM), les entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre étendu, et les souches multirésistantes de Pseudomonas aeruginosa et Acinetobacter baumannii. La maîtrise de la dissémination des BMR est essentielle en raison des risques d'échec thérapeutique, d'allongement de l'hospitalisation, et de coûts supplémentaires.
III.Facteurs Influençant la Prescription d Antibiotiques et Stratégies de Rationalisation
Plusieurs facteurs contribuent à la consommation d’antibiotiques, notamment la sévérité des pathologies, les infections nosocomiales liées à des dispositifs invasifs (sondage urinaire, voies veineuses centrales, etc.), et la présence de comorbidités chez les patients en réanimation. L’étude souligne l’importance d’une antibiothérapie adaptée et la nécessité d’une surveillance accrue des BMR. Des stratégies pour rationaliser l’utilisation des antibiotiques sont proposées, incluant une meilleure sélection des molécules en fonction du site infecté, un suivi rigoureux des infections, une rotation des antibiotiques, le respect des mesures d'hygiène, et l'intégration d'une approche multidisciplinaire impliquant les réanimateurs, les infectiologues, les pharmaciens et les microbiologistes pour optimiser la prise en charge des infections et lutter contre la résistance aux antibiotiques.
1. Facteurs contribuant à la consommation élevée d antibiotiques
Plusieurs facteurs expliquent la consommation importante d'antibiotiques en réanimation. La sévérité des pathologies infectieuses chez les patients admis, souvent atteints de maladies graves nécessitant des traitements antibiotiques combinés à forte posologie, joue un rôle majeur. De plus, les comorbidités fréquentes (diabète, immunodépression, corticothérapie à hautes doses) augmentent la susceptibilité aux infections et nécessitent des interventions antibiotiques plus agressives. L'utilisation de dispositifs invasifs (sondages urinaires, voies veineuses centrales, cathéters, intubation) augmente le risque d'infections nosocomiales, favorisant la prescription d'antibiotiques. La pression de sélection de germes multi-résistants aux concentrations minimales inhibitrices élevées réduit les options thérapeutiques, menant à des posologies plus fortes et à des associations d'antibiotiques. Le manque d'études nationales sur la consommation d'antibiotiques en réanimation souligne un manque de sensibilisation chez les médecins à l'importance de l'évaluation de cette consommation, essentielle pour les démarches de qualité et d'accréditation.
2. Stratégies pour une meilleure gestion de l antibiothérapie
Pour une utilisation plus rationnelle des antibiotiques, plusieurs stratégies sont proposées. Une meilleure prescription doit considérer l'effet thérapeutique, les conséquences économiques et l'impact sur l'écosystème bactérien. Un groupe de travail multidisciplinaire (service de réanimation, CLIN, microbiologie, pharmacie, cliniciens) est recommandé pour une approche synergique. Limiter le nombre de classes d'antibiotiques utilisées, réduire la durée des traitements et mettre en place une rotation des antibiotiques pourraient être bénéfiques, notamment pour la PNAVM (pneumopathie acquise sous ventilation mécanique), infection la plus fréquente. Le respect des bonnes pratiques d'hygiène est essentiel pour réduire les contaminations exogènes. Le choix optimal d'un antibiotique est complexe, nécessitant des connaissances approfondies sur les bactéries, les antibiotiques et leurs mécanismes de résistance. Une approche multidisciplinaire impliquant pharmaciens, bactériologistes, infectiologues et réanimateurs est préconisée pour optimiser les stratégies d'antibiothérapie.
3. Approches diagnostiques et thérapeutiques
Des stratégies cliniques et microbiologiques sont décrites pour améliorer le diagnostic et le traitement des infections. La stratégie clinique repose sur l’identification des signes cliniques de pneumopathie à l'aide de scores. La stratégie microbiologique implique l'analyse d'un prélèvement, qui peut être invasif ou non. Pour réduire les coûts et les risques associés à la fibroscopie bronchique, des techniques de prélèvement moins invasives (lavage broncho-alvéolaire, brosse télescopique protégée, aspiration endotrachéale, prélèvement distal protégé) sont envisagées, offrant des résultats similaires pour des valeurs seuils de cultures quantitatives comparables. La rotation des antibiotiques apparaît comme une approche prometteuse pour diminuer l'incidence des infections nosocomiales sévères, notamment celles causées par des bactéries à Gram négatif multirésistantes. Cette rotation consiste à limiter la prescription d'un antibiotique ou d'une classe, puis à la réintroduire ultérieurement. L'étude met en lumière l'importance de la collaboration multidisciplinaire pour optimiser le choix et l'utilisation des antibiotiques.
IV.Comparaison avec d autres études et conclusions
La consommation d'antibiotiques à l'hôpital Ibn Tofail est comparée à des études françaises (Dijon et Besançon), révélant des différences dans les profils de consommation. L’étude conclut sur la nécessité d'une meilleure surveillance de la consommation d'antibiotiques, d'une approche plus raisonnée de la prescription pour prévenir le développement de résistance aux antibiotiques et pour limiter les coûts liés à l'antibiothérapie en réanimation. La mise en place d'un programme de surveillance des infections nosocomiales et la collaboration entre différents services hospitaliers sont essentielles pour améliorer la qualité des soins et optimiser la gestion des ressources.
1. Comparaison avec les études françaises
Les résultats de cette étude marocaine sont comparés à ceux d'études françaises réalisées à Dijon et Besançon. L'étude de Dijon a révélé une consommation annuelle d'antibiotiques en réanimation adulte oscillant autour de 1200 DDJ/1000 JH, les bêta-lactamines étant les molécules les plus prescrites (environ 700 DDJ/1000 JH), avec une tendance à l'augmentation. Les céphalosporines ont montré la plus forte augmentation de prescription. Pour les quinolones, une tendance à l'augmentation est également observée, bien que des variations importantes soient notées. L'étude de Besançon montre des résultats similaires, avec les bêta-lactamines et les fluoroquinolones en première et deuxième positions, mais les glycopeptides devancent les aminosides. Ces comparaisons internationales permettent de contextualiser les données marocaines et d'identifier les similitudes et les différences dans les pratiques de prescription d'antibiotiques en réanimation.
2. Conclusions et perspectives
L'étude souligne la nécessité d'une meilleure surveillance de la consommation d'antibiotiques en réanimation au Maroc, compte tenu du coût important et du risque accru de résistance bactérienne. Le manque de données disponibles dans la littérature justifie la réalisation de cette recherche, qui contribue à l’identification de points critiques et propose des mesures correctives pour une meilleure gestion de l'antibiothérapie. Les résultats mettent en évidence la nécessité d'une approche plus raisonnée de la prescription, incluant la limitation des classes d'antibiotiques utilisées, la réduction de la durée des traitements et la mise en place d'une rotation des antibiotiques. Le respect des bonnes pratiques d'hygiène est également primordial pour réduire les contaminations exogènes. La mise en place de l'indicateur « consommation antibiotique » dans le tableau de bord des infections nosocomiales permettra un suivi plus précis et une meilleure comparaison des données à l'avenir. Une collaboration multidisciplinaire est essentielle pour optimiser la gestion des antibiotiques en réanimation.
