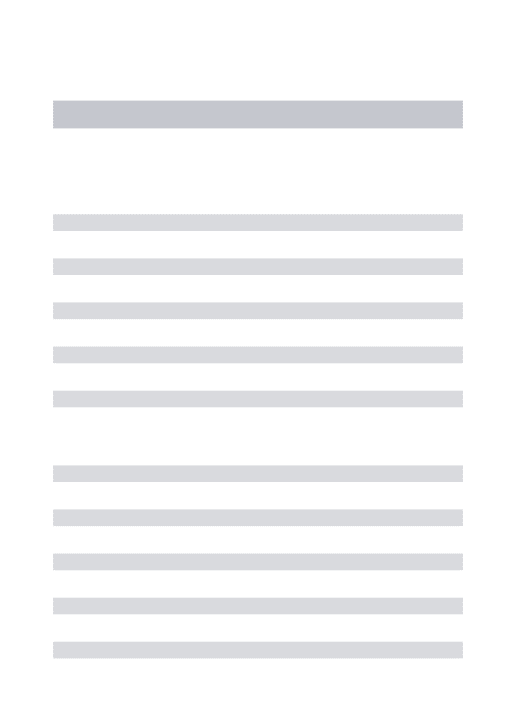
Détection des Parasites Intestinaux chez les Enfants à Marrakech
Informations sur le document
| Auteur | Mme. Meriam Benzalim |
| instructor | M. SBIHI, Professeur de Pédiatrie |
| École | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech |
| Spécialité | Médecine |
| Type de document | Thèse |
| Lieu | Marrakech |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 1.36 MB |
- Parasites intestinaux
- Pédiatrie
- Prévalence
Résumé
I.Parasitoses intestinales chez les enfants au CHU Mohammed VI de Marrakech
Cette étude, menée au service de pédiatrie A du CHU Mohammed VI de Marrakech, a analysé la prévalence des parasitoses intestinales chez 412 enfants. L'objectif principal était d'évaluer la présence de différents parasites, notamment des protozoaires (Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica, Blastocystis hominis) et des helminthes, et d'identifier les facteurs de risque associés, tels que les conditions d'hygiène, l'accès à l'eau potable, et le statut socio-économique des familles. Des méthodes de diagnostic standard, incluant l'examen microscopique des selles (méthodes directe, Ritchie simplifiée et Kato) et le test au scotch, ont été utilisées. L'étude s'est déroulée au sein d'un service de pédiatrie disposant de 34 lits et recevant plus de 2000 enfants par an.
1. Contexte et problématique des parasitoses intestinales
L'étude souligne le caractère endémique des parasitoses intestinales au Maroc, particulièrement chez les enfants. Ces infections parasitaires sont considérées comme un indicateur du niveau de développement socio-économique. Les enfants sont un groupe à risque en raison des difficultés à maintenir une hygiène efficace à leur âge et des conséquences sanitaires graves, notamment la malnutrition, l'anémie et le retard de croissance. L'OMS estimait en 2002 près de 3,5 milliards de personnes infestées par des parasites intestinaux et environ 450 millions atteintes de maladies parasitaires du tractus digestif. L'amibiase, causée par Entamoeba histolytica, est la troisième cause de mortalité par maladies parasitaires dans le monde. Le document met en lumière l'importance de cette problématique de santé publique, particulièrement au sein de la population pédiatrique marocaine. L'étude se déroule dans le contexte d'un service de pédiatrie A au sein du CHU Mohammed VI de Marrakech, un hôpital important avec une forte affluence d’enfants, dépassant 2000 par an, basé sur le bilan de 2009. Ce cadre permet une analyse significative de la prévalence des parasitoses intestinales dans une population spécifique.
2. Méthodologie de la recherche Collecte des données
La collecte de données a impliqué un consentement éclairé des parents. Un prélèvement d'échantillons de selles fraîches a été réalisé, si possible lors de la consultation, sinon les parents recevaient un pot stérile pour le recueil à domicile. En cas de difficultés, un écouvillonnage rectal était effectué. Un scotch test anal a été pratiqué systématiquement sur chaque enfant participant à l'étude. Cette approche méthodologique vise à assurer une collecte d'échantillons la plus complète possible, tenant compte des réalités pratiques et des difficultés potentielles liées à la collecte d'échantillons de selles chez les jeunes enfants. Le recueil des données incluait également un questionnaire pour déterminer l'impact de facteurs socio-démographiques, hygiéniques et socio-économiques sur la prévalence des parasitoses. La combinaison de méthodes de prélèvement et d'un questionnaire permet une analyse multidimensionnelle du problème des parasitoses intestinales.
3. Rappel de parasitologie et modes de transmission
Le document rappelle que le tube digestif humain peut être colonisé par divers parasites, protozoaires ou helminthes. Le cycle de transmission est souvent lié au péril fécal. La transmission peut être directe (anus-bouche via les ongles) comme dans le cas de l'oxyurose, ou indirecte par ingestion de kystes ou d'œufs présents dans l'eau, les aliments ou le sol contaminés (amibiase, ascaridiose). La géophagie, particulièrement fréquente chez les jeunes enfants dans les zones endémiques, constitue une voie de contamination importante. L'ingestion de poussière contenant des œufs de parasites est également une possibilité. Cette partie rappelle les mécanismes de transmission des parasites intestinaux et souligne l'importance du contexte environnemental et des pratiques hygiéniques dans la propagation de ces infections. L'information présentée ici permet de contextualiser les résultats de l'étude en soulignant les multiples voies de contamination possibles.
4. Moyens de diagnostic utilisés dans l étude
Le diagnostic des parasites intestinaux repose sur des examens biologiques basés sur la connaissance des cycles parasitaires et des voies d'excrétion (œufs, kystes, larves). L'examen des selles, macroscopique et microscopique (examen direct entre lame et lamelle), est la méthode principale. Des techniques de concentration, comme les méthodes de Ritchie simplifiée et Kato, améliorent la détection des parasites. Dans certains cas, des techniques de concentration spécifiques, telle que la technique de Baerman pour l'anguillulose, sont nécessaires. L'endoscopie digestive haute et basse peut être utile, mais ses indications sont limitées aux infections parasitaires invasives, permettant la réalisation de biopsies. La répétition de l'examen des selles sur plusieurs jours est recommandée pour augmenter la sensibilité du diagnostic. Des méthodes complémentaires comme le tubage duodénal ou l'entérotest peuvent être utilisées dans les cas de forte suspicion.
5. Description des différents parasites identifiés
L'étude a identifié plusieurs parasites. Giardia intestinalis, un flagellé, était le protozoaire le plus prédominant. Entamoeba histolytica, la forme pathogène hématophage, était présente à un taux inférieur. Blastocystis hominis, un protozoaire cosmopolite, a également été détecté. Chilomastix mesnili et Entamoeba coli, considérés comme non pathogènes, ont aussi été trouvés. La description morphologique et le cycle de vie de certains parasites comme Giardia intestinalis et Entamoeba histolytica sont détaillés, incluant les formes kystiques et trophozoïtes. L'amibiase, une infection causée par Entamoeba histolytica, peut évoluer vers des formes plus graves, notamment l'amibiase hépatique, une complication extra-intestinale fréquente, due à l'embolisation de l'amibe par voie portale. Le cycle de vie des oxyures (Enterobius vermicularis) est également expliqué, soulignant l’auto-infestation facilité par la ponte d'œufs embryonnés au niveau de la marge anale. L'absence de Taenia saginata est liée aux habitudes alimentaires locales et au faible pouvoir d'achat des familles.
6. Facteurs associés à la prévalence parasitaire
L’étude explore divers facteurs liés à la prévalence parasitaire. L'âge est un facteur déterminant, l'infestation débutant dès le premier mois de vie et augmentant avec l'âge, atteignant un pic entre 4 et 6 ans. Le milieu de vie (périurbain > urbain > rural) joue un rôle, lié à des conditions d'hygiène précaires. Une association entre portage parasitaire et retard de croissance staturale n’est pas statistiquement significative (p=0,1). L'allaitement maternel exclusif semble protecteur contre Giardia intestinalis. La diversification alimentaire précoce est corrélée à une augmentation de la prévalence. L'accès à l'eau potable n'est pas un facteur significativement protecteur dans cette étude, contrairement à certaines conclusions d'autres recherches. La présence d'un système de collecte des ordures ménagères est associée à une prévalence plus faible, mais pas de manière significative. De même, le revenu familial, la taille de la famille et la promiscuité semblent jouer un rôle, mais sans significativité statistique.
7. Conclusion et perspectives
L'étude révèle une prévalence élevée de parasitoses intestinales au CHU Mohammed VI de Marrakech, dominée par les protozoaires. Les facteurs socio-économiques et les conditions d'hygiène semblent influencer la prévalence, même si certaines associations ne sont pas statistiquement significatives. Les résultats soulignent l'importance de stratégies de prévention axées sur l'éducation sanitaire, l'amélioration de l'hygiène, et la lutte contre le péril fécal. L'étude suggère la nécessité de poursuivre les recherches pour mieux comprendre les interactions complexes entre les facteurs de risque et la prévalence des parasitoses intestinales dans la région de Marrakech. Des analyses plus approfondies, incluant une analyse plus détaillée des données, permettront de mieux cibler les interventions de santé publique.
II.Méthodes de diagnostic des parasitoses intestinales
Le diagnostic des parasitoses intestinales repose principalement sur l'examen parasitologique des selles, incluant l'examen macroscopique et microscopique direct, ainsi que des techniques de concentration (mentionnées dans le document original). L'endoscopie digestive peut être utilisée dans certains cas spécifiques, mais son rôle reste limité dans le diagnostic courant des parasites intestinaux. Le test au scotch est considéré comme la méthode la plus efficace pour le diagnostic de l'oxyurose.
1. Examen parasitologique des selles
L'examen des selles constitue la méthode principale de diagnostic des parasitoses intestinales. Il comprend un examen macroscopique, permettant d'observer les caractéristiques des selles (aspect, couleur, consistance, odeur), et un examen microscopique. L'examen microscopique direct, réalisé entre lame et lamelle à partir d'un échantillon de selles fraîches, permet une observation immédiate des parasites. Cependant, la faible concentration de parasites dans les selles peut rendre cette méthode peu sensible. Pour pallier cette limitation, des techniques de concentration sont utilisées pour réunir les éléments parasitaires dans un plus petit volume, facilitant leur identification microscopique. Plusieurs méthodes de concentration existent, et le choix de la méthode dépend de l'orientation clinique et du type de parasite suspecté. L'étude mentionne l'utilisation des méthodes de Ritchie simplifiée et Kato pour la concentration des éléments parasitaires dans les selles. La répétition de l'examen des selles à plusieurs jours d'intervalle est recommandée pour augmenter la sensibilité du test, compte tenu des périodes coprologiquement muettes.
2. Techniques de concentration des éléments parasitaires
Les techniques de concentration des éléments parasitaires sont essentielles pour augmenter la sensibilité du diagnostic microscopique des selles. Ces techniques visent à concentrer les œufs, kystes, larves ou formes végétatives des parasites dans un faible volume de liquide, permettant une meilleure visualisation au microscope. Le document détaille une technique spécifique consistant à diluer les selles dans de l'eau formolée à 10%, à tamiser la solution, à ajouter un volume égal d'éther, à émulsionner par agitation vigoureuse, puis à centrifuger à 1500 tours/minute. Le culot obtenu, contenant les éléments parasitaires, est ensuite examiné au microscope. L'étude souligne que de nombreuses méthodes de concentration existent, et qu'aucune méthode seule ne permet de détecter tous les types de parasites. Le choix de la méthode dépend donc de l'orientation clinique et des parasites suspectés. L'utilisation de techniques de concentration spécifiques, comme la technique d'extraction des larves de Baerman pour le diagnostic d'anguillulose, est également mentionnée.
3. Diagnostic endoscopique et autres méthodes
Bien que l'examen parasitologique des selles soit la méthode de diagnostic principale, l'endoscopie digestive peut être utilisée dans certains cas. L'endoscopie haute peut permettre la découverte fortuite de nématodes adultes ou de larves dans la paroi gastrique (ex : anisakiase). Cependant, son utilisation pour la recherche de certains parasites comme les microsporidies, les cryptosporidies ou Giardia reste discutable. L'endoscopie basse a des indications restreintes, principalement pour réaliser des biopsies rectales ou coliques dans le diagnostic d'amibiase invasive ou de bilharziose évolutive. Le document mentionne également d'autres méthodes complémentaires, telles que le tubage duodénal en cas de forte suspicion de giardiase avec des examens de selles négatifs. L'entérotest, consistant à ingérer une capsule contenant un fil qui est ensuite retiré et analysé, permet de mettre en évidence des trophozoïtes dans les cas de suspicion de giardiase. Le test au scotch est spécifiquement mentionné comme la meilleure méthode pour le diagnostic d’oxyurose en raison de la localisation de ponte des œufs des Enterobius vermicularis au niveau de la marge anale.
III.Résultats et prévalence des parasites
Les protozoaires étaient les parasites les plus fréquents dans cette étude, représentant 56,88% des cas. Giardia intestinalis était le protozoaire le plus prédominant (3,64%), suivi de Entamoeba histolytica (1,7%). D'autres parasites comme Blastocystis hominis, Chilomastix mesnili, et Entamoeba coli ont également été identifiés, mais à des taux inférieurs. La prévalence globale des parasitoses intestinales était élevée, avec des variations comparées à d'autres études menées au Maroc (ex : Rabat, Kenitra) et à l'international (ex : Turquie, Sénégal, Brésil). La prévalence variait selon plusieurs facteurs socio-économiques et sanitaires.
1. Prédominance des protozoaires
L'étude a révélé une prédominance des protozoaires parmi les parasites intestinaux identifiés chez les 412 enfants. Ces protozoaires, fortement liés à une mauvaise hygiène des mains et au péril fécal, représentaient 56,88% de l'ensemble des parasites détectés. Ce résultat est cohérent avec d'autres études, bien que celles-ci rapportent des proportions parfois plus élevées (76,91% selon Khales, 97,05% selon Jemaaoui), la différence pouvant s'expliquer par l'absence de test systématique à la recherche d'oxyures dans ces études précédentes. À l'inverse, une étude menée en Turquie a montré une prévalence beaucoup plus faible (15%). Cette variation souligne la diversité des résultats obtenus selon les contextes géographiques et méthodologiques. La comparaison avec d'autres études au Maroc (41,2% à Rabat selon Amal) et à l'international (56,62% au Sénégal selon Ndir, 57,06% à Tiflet selon Aokbi, 88,8% à Kenitra selon Tchiche, 77,2% au Brésil) met en lumière la variabilité de la prévalence des parasitoses intestinales.
2. Prévalence de Giardia intestinalis et Entamoeba histolytica
Parmi les protozoaires, Giardia intestinalis présentait la prévalence la plus élevée (3,64%), affectant un enfant sur six parmi ceux parasités. Cette prédominance est confirmée par d'autres études (Amal à Rabat, Ayadi en Tunisie, Tchiche à Kenitra), même si les taux rapportés sont généralement plus élevés (19,5%, 12,59%, 23% respectivement). Cette différence pourrait être expliquée par l'émission irrégulière des formes kystiques de Giardia intestinalis, la fragilité des formes végétatives, le degré d'infestation et le nombre d'examens parasitologiques réalisés. Concernant Entamoeba histolytica, la prévalence était plus faible (1,7%), représentant un tiers des amibes isolées. Des prévalences similaires ont été rapportées en Turquie et en Tunisie (1,1% et 2,5% respectivement), tandis qu'Amal a rapporté un taux de 4,1% à Rabat. La prévalence de Giardia intestinalis et d' Entamoeba histolytica est donc variable selon les études et les contextes géographiques, ce qui souligne l'importance des facteurs environnementaux et socio-économiques.
3. Autres parasites et comparaison avec d autres études
Outre Giardia intestinalis et Entamoeba histolytica, d'autres parasites ont été identifiés, notamment Blastocystis hominis, dont la prévalence était similaire à celle rapportée par Pinel à Grenoble, mais absent dans d'autres études (Adou Bryn, Diouf, Estéfano Alves). La prévalence de Blastocystis hominis est variable et dépend des méthodes diagnostiques et du niveau d'hygiène. Les parasites non pathogènes, Chilomastix mesnili et Entamoeba coli, étaient également présents, avec des prévalences comparables à d'autres études en Tunisie et en Turquie. L'absence de Taenia saginata est expliquée par les habitudes alimentaires locales et le faible pouvoir d'achat des familles. L'étude observe une augmentation de l'infestation parasitaire avec l'âge, confirmant les observations d'autres auteurs (Diouf, Faye et coll., Ayadi). Les enfants des régions périurbaines présentaient une prévalence plus élevée (29,4%) que ceux des milieux urbains (23,7%) et ruraux (22,8%), probablement en raison de conditions d'hygiène plus précaires.
IV.Facteurs de risque et impact socio économique
L'étude a exploré l'impact des facteurs socio-économiques et hygiéniques sur la prévalence des parasitoses intestinales. Bien que certaines associations n'aient pas été statistiquement significatives (accès à l'eau potable, ramassage des ordures), les résultats suggèrent un lien entre un faible niveau socio-économique, un manque d'hygiène (péril fécal, hygiène des mains), la promiscuité, et une prévalence plus élevée de parasites intestinaux. L'âge et la scolarisation sont aussi des facteurs importants. Des facteurs de protection potentiels, tels que l'allaitement maternel exclusif et la possession d'un réfrigérateur, ont également été étudiés.
1. Impact de l accès à l eau potable
L'étude a examiné le lien entre l'accès à l'eau potable et la prévalence des parasitoses intestinales. Les résultats ont montré que les enfants ayant accès à l'eau potable étaient moins parasités que ceux n'y ayant pas accès. Cependant, cette différence n'était pas statistiquement significative (p = 0,6). Cette observation contraste avec certaines études qui rapportent une association significative entre l'accès à l'eau potable et une diminution de la prévalence des parasitoses, notamment en milieu urbain. L'étude de Laamrani, menée dans les provinces de Béni Mellal, Tiznit et Taounat, ne montre pas d'association significative sauf en milieu urbain de Taounat où l'eau potable semble avoir un effet protecteur. La non-significativité statistique dans cette étude pourrait être due à plusieurs facteurs, notamment la qualité de l'eau même si elle est du robinet, ou à d'autres facteurs confondants qui pourraient masquer l'effet protecteur de l'accès à l'eau potable. Il est important de noter que même l'eau du robinet, si elle n'est pas correctement traitée ou manipulée dans des récipients souillés, peut être une source de contamination.
2. Système de ramassage des ordures et hygiène du milieu
L'étude a également analysé l'influence d'un système public de ramassage des ordures ménagères sur la prévalence parasitaire. Elle a observé une prévalence plus faible (10,5%) chez les enfants bénéficiant d'un tel système, comparativement à ceux n'en bénéficiant pas (19%). Cependant, cette différence n'était pas statistiquement significative (p = 0,26). Ces résultats sont en partie corroborés par l'étude de Laamrani, qui montre une association entre un système de ramassage public et des taux de prévalence plus bas, mais sans effet protecteur significatif sauf pour le milieu urbain de Tiznit. L'absence de significativité statistique suggère que, bien que l'hygiène du milieu joue un rôle, d'autres facteurs interviennent dans la transmission des parasites intestinaux. L'étude ne permet pas de conclure à un effet protecteur direct du système de ramassage des ordures, d'autres aspects de l'hygiène du milieu devant être considérés.
3. Revenu familial et facteurs socio économiques
L'impact du revenu familial sur la prévalence parasitaire a été étudié. Bien qu'aucune association statistiquement significative n'ait été trouvée dans cette étude (p = 0,5), d'autres travaux ont démontré un lien entre un faible niveau socio-économique et une prévalence plus élevée de parasitoses. Selon Ndir, les enfants de bas niveau socio-économique sont plus fréquemment parasités. D'autres études montrent une diminution de la prévalence des helminthes avec l'augmentation du revenu du père. Ces résultats suggèrent que le faible niveau économique et le revenu modeste des parents constituent des facteurs de risque pour les parasitoses intestinales, même si cette relation n'est pas apparue significative dans cette étude particulière. Des facteurs tels que l'accès à une alimentation de qualité, à des soins médicaux et à une meilleure hygiène, liés au statut socio-économique, peuvent influencer la prévalence des infections.
4. Possession de biens et facteurs liés au mode de vie
La possession de certains biens dans le foyer a été analysée en relation avec la prévalence parasitaire. Paradoxalement, la possession d'une télévision était associée à une prévalence plus élevée, contrairement à l'hypothèse initiale que la télévision pourrait favoriser l'éducation sanitaire. La scolarisation s'est avérée être un facteur exposant à l'infestation parasitaire (27,9% des enfants scolarisés vs 3,6% des non scolarisés, p < 0,01), probablement due à la promiscuité et aux jeux en collectivité. Une fratrie importante (plus de 2 enfants) était également liée à une plus forte prévalence (p = 0,07), de même que la promiscuité (nombre élevé de personnes dans le foyer et faible nombre de pièces). La possession d'un réfrigérateur était associée à une prévalence plus faible, mais sans significativité statistique. La réfrigération des aliments est un facteur important en matière d'hygiène alimentaire, réduisant le risque d'infestation parasitaire.
