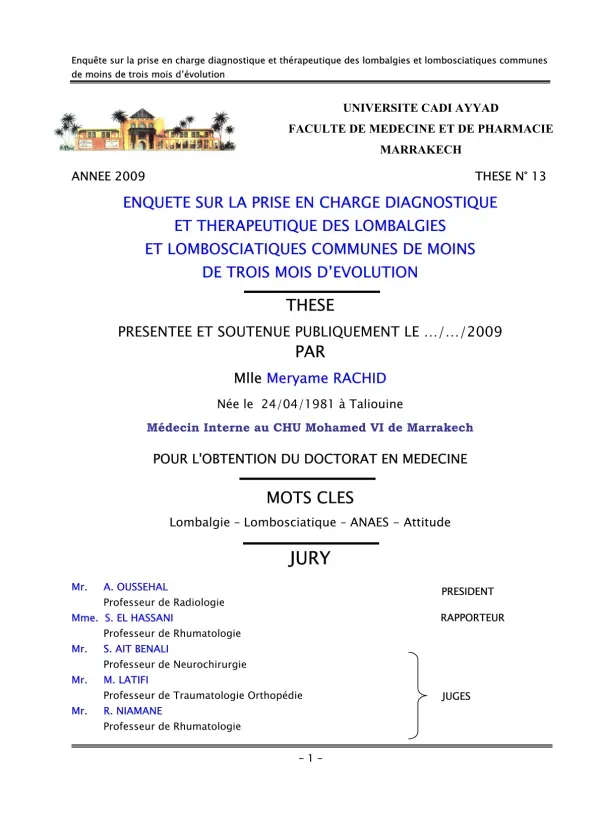
Enquête sur la prise en charge des lombalgies et lombosciatiques
Informations sur le document
| Auteur | Mlle Meryame Rachid |
| École | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Marrakech |
| Spécialité | Médecine |
| Lieu | Marrakech |
| Type de document | Thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 1.72 MB |
- Lombalgie
- Médecine
- Recherche
Résumé
I.Imagerie dans le diagnostic de la lombalgie et de la lombosciatique
Cette étude examine l'utilisation de l'imagerie (radiographie, IRM, scanner) dans le diagnostic des lombalgies et lumbosciatiques aiguës. Les recommandations de l'ANAES soulignent qu'une imagerie précoce n'est généralement pas nécessaire dans les 7 premières semaines d'évolution, sauf en cas de suspicion de lombalgie symptomatique ou d'urgence. Plusieurs études citées (JAMA 1997, JAMA 2000, BMJ 2001) confirment une surutilisation de la radiographie lombaire, sans amélioration significative des résultats cliniques. La corrélation entre les résultats de l'imagerie et la clinique est faible; la présence d'une hernie discale, par exemple, ne prédit pas forcément une sciatique. L'accent est mis sur l'importance de l'interrogatoire et de l'examen clinique pour le diagnostic de sciatique.
1. Recommandations de l ANAES et utilisation de l imagerie
Selon les recommandations de l'ANAES, les examens d'imagerie (radiographie, IRM, scanner) ne sont pas systématiquement nécessaires dans les lombalgies et lombosciatiques aiguës de moins de 7 semaines d'évolution. Cette approche est justifiée par l'absence de corrélation directe entre les résultats d'imagerie et l'évolution clinique de la douleur. L'imagerie est seulement indiquée en cas de suspicion de lombalgie symptomatique ou d'urgence, ou si le traitement choisi (manipulation, infiltration) nécessite d'écarter une pathologie spécifique. L'absence d'amélioration clinique peut justifier un recours plus précoce à l'imagerie, selon un accord professionnel. L'étude souligne que l'imagerie n'est pas essentielle pour une relation médecin-patient de qualité, et que l'objectif principal du patient est l'amélioration de la douleur et de la fonction, ce qui passe par une information claire et précise de la part du praticien.
2. Études sur l utilisation de la radiographie lombaire
Plusieurs études, dont une étude canadienne publiée dans le JAMA en 1997, ont évalué l'impact des recommandations sur la prescription d'examens radiologiques pour les lombalgies aiguës. Les résultats montrent une persistance d'une prescription excessive de radiographies lombaires, même après la publication des recommandations. Une autre étude dans le nord de l'Illinois (JAMA 2000) a révélé que 25% des praticiens utilisent systématiquement la radiographie, et 16% le scanner ou l'IRM. Une étude du BMJ en 2001, menée à Nottingham, confirme que la prescription précoce de radiographies lombaires n'améliore pas l'évolution ou la satisfaction du patient. Ces études mettent en évidence une inadéquation entre les recommandations et la pratique courante, soulignant la nécessité d'une information plus ciblée et d'une meilleure évaluation de l'efficacité des examens d'imagerie.
3. Relation entre imagerie clinique et diagnostic de sciatique
Le document met en avant la faible corrélation entre les résultats de l'imagerie et les symptômes cliniques. La présence d'une hernie discale, visible à l'imagerie, ne signifie pas systématiquement la présence de sciatique (20 à 30% des sujets sans antécédents de sciatique présentent des anomalies discales). Une étude de Karppinen et al. n'a pas trouvé de corrélation entre l'intensité des symptômes et les images IRM, sauf pour le signe de Lasègue. Le diagnostic de sciatique repose principalement sur l'interrogatoire et l'examen clinique, l'imagerie ayant des limites dans la mise en évidence d'un conflit radiculaire. L'imagerie n'est pas indispensable pour une relation médecin-patient de qualité; la satisfaction du patient passe avant tout par une information claire sur sa pathologie et une prise en charge adéquate de sa douleur.
II.Prise en charge thérapeutique des lombalgies et lombosciatiques
Le traitement des lombalgies et lumbosciatiques aiguës repose principalement sur le contrôle de la douleur. L'ANAES recommande l'utilisation d'antalgiques, d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et de décontracturants musculaires (grade B). Le repos au lit prolongé n'est pas recommandé; le maintien d'une activité compatible avec la douleur est préférable. Une enquête auprès de 800 médecins généralistes (IMS-DOREMA) montre une prescription fréquente d'antalgiques, d'AINS et de myorelaxants. L’étude révèle un écart entre les recommandations et la pratique concernant le repos au lit et l'utilisation d'examens d'imagerie.
1. Recommandations de l ANAES pour le traitement de la douleur
Les recommandations de l'ANAES pour la prise en charge thérapeutique des lombalgies et lombosciatiques aiguës privilégient le contrôle de la douleur. Pour ce faire, elles indiquent l'utilisation d'antalgiques, d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et de décontracturants musculaires (grade B). Il est important de noter qu'aucune étude n'a évalué l'efficacité de l'association de ces traitements. Concernant le repos au lit, l'ANAES ne recommande pas sa prescription systématique, considérant que la poursuite des activités habituelles, dans la limite de la douleur, est souhaitable (grade B). La reprise de l'activité professionnelle se fait en concertation avec le médecin du travail. L'étude souligne l'importance de prendre en compte les facteurs psychologiques et socioprofessionnels qui peuvent influencer l'évolution de la douleur vers la chronicité (grade B).
2. Pratiques courantes et données de l IMS DOREMA
Une enquête menée à partir de la base de données IMS-DOREMA, incluant un panel de 800 médecins généralistes français, révèle les pratiques courantes en matière de prescription. Les résultats montrent que les antalgiques, les AINS et les myorelaxants sont prescrits respectivement dans 53%, 73% et 75% des cas. Cette information met en perspective les recommandations de l'ANAES avec la réalité de la pratique médicale courante, soulignant des divergences potentielles quant à l'approche thérapeutique. L'écart entre les recommandations et la pratique est particulièrement évident concernant la prescription du repos au lit, avec un tiers des praticiens qui continuent à prescrire un repos strict contrairement aux recommandations.
3. Infiltrations rachidiennes et autres modalités thérapeutiques
Les infiltrations rachidiennes de corticoïdes, bien que couramment utilisées (65% des rhumatologues dans une enquête française), restent sujettes à controverse. Les infiltrations épidurales sont très utilisées, et les études ouvertes montrent un effet positif dans environ 65% des cas. Cependant, les études randomisées ne démontrent pas une supériorité d'une voie d'injection sur les autres et n'ont pas mis en évidence une réduction du recours à la chirurgie ou un retour au travail plus rapide. Bien que l'effet antalgique à court terme semble confirmé, aucune étude ne prouve une efficacité à long terme, notamment dans les lombalgies aiguës de moins de 3 mois. D'autres infiltrations (périradiculaires, articulaires postérieures) sont mentionnées, avec des résultats variables et un manque de données pour certaines indications.
III.Infiltrations et autres traitements
Les infiltrations rachidiennes de corticoïdes sont couramment utilisées, bien que leur efficacité à long terme reste débattue. Les infiltrations épidurales montrent un effet antalgique à court terme pour les lumbosciatiques, mais leur impact sur le recours à la chirurgie ou le retour au travail n'est pas prouvé. Des études ont également exploré l'efficacité des infiltrations périradiculaires et articulaires postérieures, avec des résultats mitigés. L'étude souligne l'importance d'une prise en charge globale, incluant l'éducation du patient et la promotion d'une bonne hygiène vertébrale.
1. Infiltrations rachidiennes de corticoïdes efficacité et controverses
Les infiltrations rachidiennes de corticoïdes sont utilisées depuis plus de 50 ans dans le traitement des lombosciatiques. De nombreuses études ouvertes montrent un effet favorable dans environ 65% des cas. Une enquête d'opinion auprès de services de rhumatologie français indique que 65% des médecins interrogés incluent ces infiltrations dans le traitement de base de la lombosciatique. Cependant, cette pratique est controversée à l'ère de la médecine basée sur les preuves, car l'efficacité à long terme et le manque d'études contrôlées posent question. Les infiltrations épidurales et périradiculaires de corticoïdes ont été mieux étudiées dans le cadre de la lombosciatique discale, mais leur efficacité à long terme reste à prouver. Pour les lombalgies seules, il y a un manque d'études contrôlées spécifiques.
2. Infiltrations épidurales efficacité à court terme et limites
Les infiltrations épidurales de corticoïdes sont très utilisées, avec plusieurs voies d'injection possibles (interépineuse, sacrée, sacrococcygienne), l'interépineuse étant la plus fréquente. Bien que les études ouvertes suggèrent un bon résultat dans environ 65% des cas, une revue de 13 études randomisées de 1998 conclut à un effet significatif sur la douleur pendant 3 à 6 semaines. Cependant, aucune étude n'a prouvé une réduction du recours à la chirurgie ou un retour au travail plus rapide. L'efficacité à long terme, particulièrement pour les lombalgies aiguës de moins de 3 mois, n'est pas démontrée. Ces infiltrations semblent avoir un effet antalgique à court terme pour les poussées douloureuses des lombalgies chroniques, mais non pour les lombalgies aiguës.
3. Autres types d infiltrations et recommandations
Les infiltrations périradiculaires ont un effet symptomatique à court terme bien établi, mais l'efficacité à long terme est modérée. Leur impact sur le recours à la chirurgie reste à confirmer. Elles ne sont pas un traitement de première intention. Les infiltrations articulaires postérieures semblent avoir un effet antalgique chez certains patients atteints de lombalgies résistantes au traitement de première intention. Les infiltrations épidurales peuvent soulager temporairement la douleur dans les poussées des lombalgies chroniques, mais ne constituent pas le traitement principal. Enfin, les infiltrations intradurales sont déconseillées en raison de leur risque et du manque de données prouvant leur efficacité.
IV.Cas Cliniques et Diagnostic Différentiel
L'étude présente plusieurs cas cliniques illustrant des situations complexes, comme la distinction entre lombalgie commune et lombalgie symptomatique (spondylodiscite, métastases osseuses, tuberculose). L'enquête évalue la capacité des médecins à identifier les signes d'alerte (« red flags ») et à poser un diagnostic différentiel approprié. Les résultats montrent des variations dans la prise en charge, notamment concernant le diagnostic de spondylodiscite et la gestion de la douleur intense, avec un sous-diagnostic de situations graves dans certains cas.
1. Cas clinique illustrant une spondylodiscite lombaire
Un cas clinique décrit une patiente de 70 ans présentant une diarrhée fébrile dix jours avant l'apparition de douleurs lombaires et d'une radiculalgie au membre inférieur droit (topographie S1). L'examen révèle une fièvre à 38,2°, une raideur lombaire importante (indice de Shober à 11 cm, distance dos-sol à 45 cm). La majorité des praticiens interrogés ont correctement diagnostiqué une spondylodiscite lombaire sur la base de ces éléments cliniques (diarrhée fébrile et raideur). Cependant, 17% des praticiens n'ont pas envisagé ce diagnostic, soulignant une difficulté à identifier les signes d'alerte dans la pratique quotidienne, particulièrement chez les médecins généralistes (seulement 63,5% de diagnostic correct dans ce groupe).
2. Cas clinique explorant une lombosciatique symptomatique sur métastase osseuse
Un autre cas clinique présente un patient de 65 ans souffrant d'une lombosciatique aiguë atypique (non impulsive à la toux), non améliorée par un traitement antalgique et AINS sur deux semaines. Des symptômes associés (dysurie, pollakiurie nocturne, épisodes de rétention urinaire) orientent vers une tumeur prostatique et des métastases osseuses. La majorité des praticiens (85,7%) ont identifié la suspicion de métastase osseuse. Cependant, seuls 20% ont préconisé un renforcement du traitement médical, soulignant un possible manque de prise en charge adéquate de la douleur dans ce contexte. L'IRM est identifiée comme l'examen d'imagerie le plus performant pour le diagnostic de métastases osseuses.
3. Cas clinique suggérant une origine tuberculeuse de la lombosciatique
Un cas clinique concernant une patiente de 40 ans, infirmière dans un centre de diagnostic spécialisé de tuberculose, souffrant d'une lombosciatique S1 résistante au traitement médical, illustre les difficultés diagnostiques. Des signes associés (anorexie, asthénie, raideur rachidienne) évoquent une origine tuberculeuse. L'identification de cette origine nécessite une investigation plus approfondie, car le diagnostic de certitude repose sur la mise en évidence du bacille de Koch. L'étude souligne l'importance d'évaluer l'ensemble des signes cliniques (antécédents, début progressif, amaigrissement) pour orienter le diagnostic vers une spondylodiscite tuberculeuse. Les lésions peuvent même s'aggraver durant le traitement.
4. Étude rétrospective sur les pratiques diagnostiques et thérapeutiques
Une étude rétrospective dans un dispensaire universitaire a analysé la prise en charge de 183 patients atteints de lombalgie aiguë par rapport aux recommandations. L'étude a conclu à un décalage entre les recommandations et les pratiques concernant les examens complémentaires, soulignant la nécessité d'évaluer l'impact de la sur- ou sous-utilisation de ces examens sur le diagnostic et les résultats cliniques. Cette étude, ainsi que l'enquête principale, confirme un décalage notable entre les recommandations et les pratiques concernant la recherche de signes d'alerte (red flags) et les conseils d'hygiène vertébrale, notamment pour le diagnostic de lombalgies symptomatiques.
V.Résultats de l enquête au Maroc Région de Marrakech
Une étude transversale menée entre février 2006 et septembre 2007 auprès de 140 praticiens (médecins généralistes, internes, rhumatologues, neurochirurgiens, traumatologues, neurologues) à Marrakech (région de Tensift el haouz) a évalué la concordance entre les pratiques des médecins et les recommandations de l'ANAES concernant la prise en charge des lombalgies et lumbosciatiques aiguës. 42% des médecins ont surutilisé les examens radiologiques; 57% ont prescrit des antalgiques, AINS et myorelaxants. L'étude révèle un décalage significatif entre les recommandations et les pratiques concernant l'imagerie, le repos au lit et la prise en charge de la douleur intense. La prévalence des lombalgies au Maroc est estimée à 15,32%.
1. Méthodologie et participants de l enquête
L'étude transversale, réalisée entre février 2006 et septembre 2007 dans la région de Marrakech (Tensift el haouz, Maroc), a évalué les pratiques des médecins concernant la prise en charge des lombalgies et lombosciatiques aiguës. L'enquête a impliqué 140 praticiens: 63 médecins généralistes, 52 internes, 9 rhumatologues, 7 neurochirurgiens, 6 traumatologues et 3 neurologues, issus des secteurs public et privé. Un questionnaire, basé sur les recommandations de l'ANAES et structuré en 8 cas cliniques, a été utilisé pour collecter les données. La prévalence des lombalgies au Maroc est estimée à 15,32%, soulignant l'importance de cette étude pour comprendre les pratiques locales.
2. Résultats concernant l imagerie médicale
L'analyse des réponses révèle une surutilisation significative de l'imagerie médicale en phase précoce des lombalgies et lombosciatiques. 42% des médecins ont prescrit abusivement des examens radiologiques, ce qui diverge des recommandations de l'ANAES. Ce constat confirme les résultats d'études internationales qui mettent en lumière une surprescription d'examens d'imagerie, sans amélioration notable des résultats cliniques. L'étude marocaine souligne donc un écart important entre les recommandations et la pratique, nécessitant des interventions pour améliorer la prescription appropriée de l'imagerie médicale.
3. Résultats concernant la prescription médicamenteuse et autres aspects
Concernant la prescription médicamenteuse, 57% des médecins ont prescrit des antalgiques, AINS et myorelaxants. L'étude a également mis en évidence des divergences par rapport aux recommandations de l'ANAES concernant la prise en charge des lombosciatiques hyperalgiques (seul un tiers des praticiens ont opté pour un traitement immédiat aux morphiniques) et le repos au lit (un tiers des praticiens continuent à prescrire le repos strict). La reconnaissance des formes symptomatiques des lombalgies était globalement satisfaisante. Cependant, l'étude révèle un décalage concernant la recherche de signes d'alerte et les conseils d'hygiène vertébrale, confirmant les résultats d'une étude de 1992 (J Gen Intern Med).
