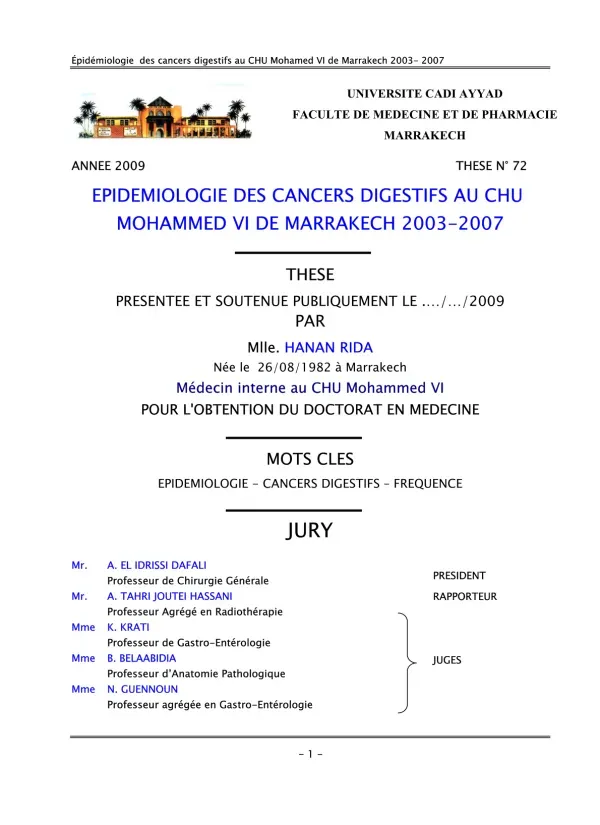
Épidémiologie des cancers digestifs au CHU Mohammed VI de Marrakech (2003-2007)
Informations sur le document
| Auteur | Hanan Rida |
| École | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Marrakech |
| Spécialité | Médecine |
| Type de document | Thèse |
| Lieu | Marrakech |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 2.50 MB |
- Épidémiologie
- Cancers digestifs
- Médecine
Résumé
I.Épidémiologie des Cancers Digestifs au Maroc Focus sur Marrakech
Cette étude rétrospective, menée au service d’oncologie radiothérapie de Marrakech entre 2003 et 2007, analyse 440 cas de cancers digestifs prouvés histologiquement. Elle révèle une prévalence significative de certains types de cancers, soulignant des variations par rapport aux données internationales. Le cancer colorectal est le plus fréquent (35,68% des cas), suivi du cancer de l’estomac (33,86%). D'autres cancers digestifs, tels que le carcinome hépatocellulaire (CHC), le cancer de l’œsophage, le cancer du pancréas, le cancer du canal anal, et le cancer du grêle ont également été étudiés, révélant des fréquences et des caractéristiques épidémiologiques spécifiques à la région de Marrakech et au Maroc, notamment des différences d’incidence et de répartition selon l’âge et le sexe par rapport aux pays occidentaux. L'étude met en lumière le besoin de recherches supplémentaires sur les facteurs de risque de ces cancers au Maroc.
1. Méthodologie de l étude et contexte Marrakchi
L'étude rétrospective, menée de 2003 à 2007 au service d'oncologie radiothérapie de Marrakech, a analysé 440 cas de cancers digestifs confirmés histologiquement. L’objectif principal était d'étudier l'épidémiologie des cancers digestifs dans cette région du Maroc, en comparant les résultats avec les données disponibles à l'échelle internationale et nationale. Tous les cas de cancers primitifs de l'appareil digestif ont été inclus, à l'exception des carcinomes hépatocellulaires diagnostiqués uniquement selon les critères de la conférence de Barcelone EASL 2000 chez les patients cirrhotiques. Le choix de Marrakech comme lieu d'étude est pertinent compte tenu des observations préalables suggérant une fréquence plus élevée de certains cancers digestifs dans cette région, par rapport à d’autres régions du Maroc (ex: Casablanca) ou à des registres internationaux. L'étude, menée dans un service hospitalier spécifique, présente des limitations en termes de généralisation à l'ensemble de la population marocaine. Néanmoins, elle fournit des informations précieuses sur la réalité épidémiologique locale.
2. Fréquence et types de cancers digestifs à Marrakech
Les cancers digestifs représentaient 12,62% de l'ensemble des cancers diagnostiqués durant la période étudiée. Le cancer colorectal était le plus fréquent (35,68%), suivi du cancer de l'estomac (33,86%). Les cancers des voies biliaires (8,86%), de l'œsophage (8,18%), du canal anal (5%), du pancréas (3,64%), du foie (3,64%) et du grêle (1,14%) ont également été observés. Ces fréquences diffèrent légèrement de celles rapportées dans les registres occidentaux, maghrébins et même celui de Casablanca, avec une possible surestimation de certains cancers (canal anal chez les hommes) à Marrakech par rapport aux autres études. Cette différence souligne la nécessité de comparer les données avec prudence, compte tenu des limites méthodologiques de l'étude (données issues d'un seul service hospitalier). L’étude souligne l'importance des cancers colorectaux et gastriques dans la région, ainsi que la fréquence particulière du cancer du canal anal chez les hommes.
3. Comparaison avec les données internationales et nationales
Les données de l'étude marrakchie sont comparées aux données internationales et nationales. L'incidence mondiale des cancers digestifs est plus élevée que celle observée à Marrakech (74,2 pour 100 000 hommes et 34,2 pour 100 000 femmes vs 13,85% et 11,25% respectivement dans l'étude). L'étude d'Aiterraisse, menée à Marrakech, avait rapporté une fréquence plus élevée de cancers digestifs, mais la comparaison directe est difficile en raison des différences méthodologiques (étude hospitalière vs registre de population). Des différences sont également soulignées concernant la fréquence du cancer des voies biliaires (plus élevé à Marrakech, Algérie et Tunisie) et du cancer du canal anal (plus élevé chez les hommes à Marrakech). La comparaison avec les données françaises (25% des cancers chez les hommes et 23% chez les femmes en 1995) souligne les différences épidémiologiques entre les contextes géographique et culturel. Ces variations nécessitent des investigations supplémentaires pour identifier les facteurs contributifs.
4. Considérations sur la santé publique
L'étude met en évidence l'importance des cancers digestifs comme problème de santé publique au Maroc, notamment à Marrakech. La fréquence élevée de certains cancers, notamment le cancer colorectal et le cancer de l'estomac, ainsi que le diagnostic souvent tardif, soulignent la nécessité de développer des stratégies de prévention et de dépistage précoce. Le diagnostic tardif, mis en évidence par le stade avancé des tumeurs lors du diagnostic (ex: plus de 90% des cancers colorectaux étaient classés T3 ou T4), a un impact significatif sur le pronostic et la survie des patients. La comparaison avec les données internationales, notamment concernant le diagnostic précoce des cancers colorectaux dans les pays occidentaux, met en perspective les défis liés à l'accès aux soins et aux ressources de dépistage au Maroc. L’étude insiste sur le besoin d’investissements dans la recherche, la sensibilisation et l’amélioration des services de santé pour lutter contre ces cancers.
II.Cancer Colorectal au Maroc Incidence et Caractéristiques
L’étude confirme le cancer colorectal comme le cancer digestif le plus fréquent à Marrakech, avec une incidence et une répartition selon l’âge différentes de celles observées dans les pays occidentaux. Une proportion significative de patients (plus de 90%) présentaient des stades avancés (T3 ou T4), indiquant un diagnostic souvent tardif. L’adénocarcinome lieberkühnien est le type histologique prédominant. L’étude souligne la nécessité d'améliorer les stratégies de dépistage et de diagnostic précoce pour améliorer le pronostic.
1. Prévalence du cancer colorectal à Marrakech
L'étude révèle que le cancer colorectal est le cancer digestif le plus fréquent à Marrakech, représentant 35,68% des 440 cas étudiés. Cette prévalence importante souligne la nécessité d'une attention particulière portée à ce type de cancer dans la région. Bien que le pronostic des formes localisées soit favorable, l'étude met en lumière un diagnostic souvent tardif. En effet, plus de 90% des patients étaient classés T3 ou T4, indiquant une extension importante de la tumeur au moment du diagnostic. Cette observation contraste avec la situation dans les pays occidentaux, où le dépistage et la surveillance permettent un diagnostic plus précoce. L'âge moyen au diagnostic dans l'étude était de 57 ans, avec une prédominance des patients âgés de plus de 60 ans (42,95%), tandis que les patients de moins de 40 ans constituaient 10,73% des cas, un taux plus élevé que celui observé dans les pays occidentaux (moins de 8%). Cette différence d'incidence selon les groupes d'âge mérite une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs de risque potentiels spécifiques au contexte marocain.
2. Type histologique et stade tumoral
L'adénocarcinome constituait le principal type histologique retrouvé dans l'étude, avec une prédominance de l'adénocarcinome lieberkühnien (environ 95% des cas). D'autres types histologiques, tels que les adénocarcinomes mucineux et les adénocarcinomes en cellules en bague à chaton, ont été observés, mais en proportions moins importantes. Le stade anatomopathologique au diagnostic est un facteur pronostique majeur. Seulement 9,56% des patients étaient classés T1 ou T2 (stade localisé), tandis que plus de 90% étaient classés T3 ou T4 (stade avancé). De plus, 58,6% des patients présentaient un envahissement ganglionnaire et 26,75% avaient des métastases d'emblée. Ces données indiquent un diagnostic souvent tardif, probablement lié à l'absence de stratégies de dépistage systématiques comme celles mises en place dans les pays occidentaux. Cette situation met en évidence le besoin urgent d'améliorer les stratégies de dépistage et de diagnostic précoce pour améliorer le pronostic du cancer colorectal à Marrakech et au Maroc.
3. Variations géographiques et facteurs de risque
L'incidence du cancer colorectal présente de grandes variations géographiques. Il est plus fréquent en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande, et moins fréquent en Europe, au Japon, en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique. Les pays industrialisés présentent les incidences les plus élevées, mais celles-ci ont tendance à se stabiliser ou à diminuer, contrairement aux pays en développement où une augmentation est observée, probablement en raison des changements des habitudes alimentaires et du vieillissement des populations. L'incidence chez les jeunes de moins de 40 ans est faible dans les pays occidentaux (moins de 8%), mais plus élevée dans certains pays du Moyen-Orient (15 à 35%). Plusieurs hypothèses ont été proposées, notamment la susceptibilité génétique et la jeunesse de la population générale. Cette étude, menée à Marrakech, met en évidence une incidence plus élevée chez les jeunes (10,73%) par rapport aux pays occidentaux, soulignant la nécessité d'investigations supplémentaires pour identifier les facteurs de risque spécifiques à cette région.
III.Cancer de l Estomac au Maroc Diagnostic et Pronostic
Le cancer de l’estomac occupe la deuxième position en fréquence dans cette étude marrakchie. L’adénocarcinome est le type histologique majoritaire. Une forte proportion de cas (90,44%) étaient classés T3 et T4 au moment du diagnostic, témoignant d’un diagnostic souvent tardif, impactant significativement le pronostic. L’âge moyen au diagnostic est de 57 ans, avec une prévalence plus importante chez les hommes (sex-ratio 3,65). Des différences d’incidence sont notées par rapport aux données internationales, nécessitant une analyse plus approfondie des facteurs de risque.
1. Fréquence et type histologique du cancer de l estomac à Marrakech
Dans cette étude marrakchie, le cancer de l'estomac occupe la deuxième place en termes de fréquence parmi les cancers digestifs, représentant 33,86% des cas. L’adénocarcinome est le type histologique prédominant, constituant 93,28% des cas de cancer gastrique, conformément aux données de la littérature qui rapportent une prévalence d'environ 90%. Les autres types histologiques, tels que le carcinome épidermoïde, les tumeurs carcinoïdes et les GIST (tumeurs stromales gastro-intestinales), étaient présents mais en faible nombre. L'âge moyen au diagnostic était de 57 ans, avec une forte prédominance dans la tranche d'âge supérieure à 60 ans (42,95%), mais avec une proportion significative de patients de moins de 40 ans (10,73%), plus importante que dans les pays occidentaux. Une nette prédominance masculine a été observée, avec un sex-ratio de 3,65 (106 hommes pour 43 femmes).
2. Diagnostic et stade tumoral du cancer gastrique
Malgré une diminution de son incidence mondiale ces dernières années, la mortalité liée au cancer de l'estomac demeure élevée. L'étude de Marrakech révèle un diagnostic tardif de ce cancer dans la population étudiée. En effet, une très forte proportion des patients (90,44%) présentaient des cancers classés T3 et T4 au moment du diagnostic, indiquant une extension locale importante de la tumeur. De plus, 58,60% des patients avaient un envahissement ganglionnaire et 26,75% présentaient des métastases d'emblée. Ces résultats concordent avec d'autres études, comme celle de Fayçal et al. [18] qui rapportaient des pourcentages similaires de stades avancés. La non spécificité des signes cliniques contribuent au diagnostic tardif. Au Japon, grâce à un dépistage actif par fibroscopie, la survie à 5 ans est bien meilleure (autour de 50%) qu'ailleurs (environ 20%). Le retard diagnostique observé à Marrakech met en évidence le besoin d'améliorer le dépistage et le diagnostic précoce.
3. Comparaison internationale et implications pronostiques
L'incidence du cancer de l'estomac varie considérablement selon la géographie. Elle est la plus élevée au Japon, suivie de la Chine, de l'Amérique du Sud et de l'Europe de l'Est. L'Europe occidentale et l'Amérique du Nord ont un risque moyen, tandis que l'Afrique a un risque faible. L'Agence Internationale de Recherche sur le Cancer a rapporté une large variation d'incidence, de 7,5 pour 100 000 habitants chez les Blancs américains à 95,5 pour 100 000 habitants chez les hommes à Yamagata au Japon. Jusqu'à la fin des années 1980, il s'agissait de la première cause de mortalité liée au cancer dans le monde, mais son incidence a diminué depuis. L'âge moyen au diagnostic est généralement autour de 70 ans chez les hommes et 75 ans chez les femmes. L'étude de Marrakech montre un âge moyen de 57 ans, avec une proportion plus importante de jeunes patients (10,73% de moins de 40 ans) comparée aux pays occidentaux (2,1% en Australie). Ce retard au diagnostic influence négativement le pronostic, soulignant le besoin d’améliorer les stratégies de prévention et de dépistage précoce au Maroc.
IV.Autres Cancers Digestifs à Marrakech Données Clés
L’étude présente également des données sur d’autres cancers digestifs, notamment le CHC, le cancer de l’œsophage, le cancer du pancréas, et le cancer du canal anal. Pour ces cancers, l’étude a révélé des fréquences variables par rapport aux données internationales, soulignant des aspects épidémiologiques spécifiques au contexte marocain. L'étude note une incidence plus élevée du cancer du canal anal chez les hommes à Marrakech par rapport aux autres registres nationaux et internationaux. Le diagnostic tardif et le pronostic défavorable pour plusieurs de ces cancers constituent des défis importants pour la santé publique au Maroc.
1. Cancer des voies biliaires à Marrakech Incidence et pronostic
Le cancer des voies biliaires occupait le 4ème rang des cancers digestifs dans cette étude marrakchie, représentant 8,86% des cas. Une fréquence plus élevée a été observée chez les hommes. Cette prévalence est comparable à celle observée en Algérie et en Tunisie, mais diffère des données de Casablanca et des pays occidentaux, où il est moins fréquent. Le pronostic est défavorable, comme le souligne le taux de mortalité élevé au Japon (11,5/100 000 chez les hommes et 13,2/100 000 chez les femmes). Dans l'étude de Marrakech, il prédomine chez les femmes (sex-ratio de 1,5) et après 65 ans, avec une augmentation exponentielle de l'incidence à partir de 40 ans. L'étude a colligé seulement 3 cas de cancers des voies biliaires extra-hépatiques, soit 7,7% des cas, suggérant une potentielle sous-estimation de ce type de cancer dans l'étude.
2. Cancer de l œsophage à Marrakech Épidémiologie et facteurs pronostiques
Le cancer de l'œsophage représentait 8,18% des cancers digestifs dans l'étude. Contrairement à une prédominance masculine observée dans de nombreux pays développés (sex-ratio de 5 à 10), l'étude de Marrakech ne révèle pas de différence significative entre les sexes (sex-ratio de 1). L'âge avancé est un facteur déterminant, avec 52,7% des patients âgés de plus de 60 ans. Le carcinome épidermoïde et l'adénocarcinome sont les types histologiques les plus fréquents, le carcinome épidermoïde étant plus répandu. L'incidence de l'adénocarcinome est en augmentation exponentielle dans les pays industrialisés (environ 20% par an). Dans l'étude, aucun cas de cancer de l'œsophage classé T1 n'a été observé, et seulement 16,66% étaient classés T2, illustrant un diagnostic souvent tardif. Le pronostic du carcinome épidermoïde est sujet à débat, les études récentes suggérant un pronostic plus défavorable que l'adénocarcinome.
3. Cancer du canal anal à Marrakech Une particularité régionale
Le cancer du canal anal, bien que rare à l'échelle internationale (1,5% aux États-Unis), représente 5% des cancers digestifs dans cette étude marrakchie. Cette fréquence est plus importante que dans d’autres registres, notamment ceux de Casablanca, Alger et Marrakech chez les hommes, bien que légèrement inférieure chez les femmes. Le carcinome épidermoïde prédomine (86,36% des cas) dans cette étude, issu de l'épithélium malpighien du canal anal ou de la jonction anorectale. L'adénocarcinome représente une minorité (13,64%). La littérature indique une incidence plus élevée chez les femmes dans la population générale, tandis que les hommes homosexuels et les personnes séropositives présentent un risque accru. Le diagnostic tardif (22,73% T2 et 36,36% T4, avec un envahissement ganglionnaire présent chez 63,64%), illustre la nécessité de stratégies de dépistage et de sensibilisation spécifiques.
4. Cancer du pancréas et cancer du grêle à Marrakech Données limitées mais significatives
Le cancer du pancréas, relativement rare (3,64% dans l'étude), présente un pronostic défavorable. Sa distribution géographique est hétérogène, avec des zones à forte incidence (Asie du Sud-Est et Afrique) et d'autres à faible incidence (Europe et États-Unis). Dans cette étude marrakchie, l'adénocarcinome représentait 81,25% des cas, les tumeurs neuroendocrines constituant 12,5%. Le diagnostic tardif est prédominant (25% localisés, 25% localement avancés, et 50% métastatiques d’emblée), probablement sous-estimé du fait de l'absence de confirmation histologique pour certains cas. Concernant le cancer du grêle (1,14% des cancers digestifs dans l'étude), son incidence est plus élevée chez les Maoris de Nouvelle-Zélande et plus faible en Afrique et en Asie. Dans l'étude marrakchie, le cancer du grêle survenait plus précocement, avec 60% des patients de moins de 40 ans et une prédominance masculine. Le nombre limité de cas pour ces deux cancers nécessite des études plus approfondies.
