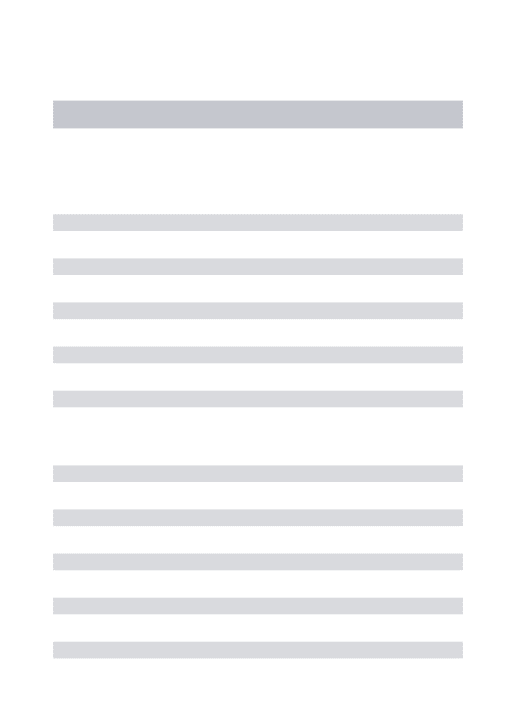
Étude des Kystes Hydatiques du Foie et leurs Complications dans les Voies Biliaires
Informations sur le document
| Auteur | Mlle. Imane Oukheir |
| École | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech |
| Spécialité | Médecine |
| Lieu | Marrakech |
| Type de document | Thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 3.64 MB |
- kystes hydatiques
- voies biliaires
- chirurgie
Résumé
I.Épidémiologie du Kyste Hydatique du Foie au Maroc
L'échinococcose, et plus spécifiquement le kyste hydatique du foie (KHF), est une maladie endémique au Maroc, particulièrement fréquente dans les régions rurales et liée au contact avec les chiens. Des études rétrospectives, comme celle menée au Centre Hospitalier Universitaire MOHAMMED VI de Marrakech entre 2005 et 2009, confirment sa persistance. Cette étude a examiné 201 patients opérés pour KHF, dont 44 cas de rupture kystobiliaire (soit 21,89%), soulignant l'importance de cette complication. La contamination se produit par ingestion d'œufs d' Echinococcus, souvent par contact direct avec les chiens (86,3% des cas dans l'étude de Marrakech).
1. Prévalence et Endémicité de l Hydatidose au Maroc
Le document souligne que l'hydatidose, et plus précisément le kyste hydatique du foie (KHF), est une maladie endémique au Maroc, dont la fréquence a longtemps été sous-estimée. Des données historiques, bien que fragmentaires, indiquent une présence significative du kyste hydatique, avec des variations régionales. Le Maroc atlantique est plus affecté que le Maroc présaharien. Une étude sur les saisies d'abats dans les abattoirs municipaux entre 1986 et 2004 montre que l'importance de la maladie n'a pas diminué, bien que ces chiffres ne reflètent pas l'incidence réelle. L'étude mentionne des estimations antérieures : en 1948, P. Faure rapportait un cas de kyste hydatique pour 10 hernies inguinales ou 7 appendicectomies dans quatre grands hôpitaux marocains. En 1949, J. Faure estimait au moins un cas par an pour 30 000 habitants dans une zone de Marrakech. En 1951, Chenebault a noté 21 kystes hydatiques pulmonaires certains et 20 probables sur 87 500 sujets examinés radiologiquement. Globalement, ces données historiques, malgré leurs limitations, indiquent une prévalence importante et inégale du kyste hydatique à travers le Maroc.
2. Cycle de Vie du Parasite et Modes de Transmission
Le cycle de vie du parasite Echinococcus implique un hôte intermédiaire (souvent le mouton) qui ingère des œufs embryonnés excrétés par les chiens. L’embryon traverse la paroi intestinale, migre vers le foie par la veine porte, ou plus rarement, vers les poumons ou d'autres organes par la circulation sanguine. L'homme est un hôte accidentel, se contaminant par ingestion directe d'œufs (contact avec des chiens) ou indirecte (eau, légumes contaminés). L'hydatidose est principalement une maladie rurale, liée au contact étroit avec les animaux et leurs excréments. L'étude de Marrakech, menée au CHU Mohammed VI, a retrouvé une notion de contact avec les chiens chez 86,3% des 44 patients atteints d'une rupture kystobiliaire dans son étude portant sur 201 cas de KHF. Cette observation met en lumière le rôle important de ce vecteur de transmission dans le contexte marocain.
3. Étude Rétrospective sur les Ruptures Kystobiliaires à Marrakech
Une étude rétrospective, menée au service de chirurgie viscérale du CHU Mohammed VI de Marrakech entre janvier 2005 et décembre 2009, a analysé 44 cas de rupture du KHF dans les voies biliaires parmi 201 patients opérés pour un KHF. Cela représente une fréquence de 21,89%. L’étude comportait 23 femmes et 21 hommes, avec un âge moyen de 38,6 ans. 57% des patients étaient d'origine rurale. L'objectif de l'étude était de mieux comprendre les éléments diagnostiques préopératoires de la rupture du KHF dans les voies biliaires, de préciser le traitement chirurgical et d'identifier la technique opératoire la plus adaptée. Les données recueillies mettent en évidence l'importance de la rupture kystobiliaire comme complication du KHF et la nécessité d'une meilleure compréhension de sa prise en charge chirurgicale dans ce contexte.
II.Diagnostic du KHF et de la Rupture Kystobiliaire
Le diagnostic du KHF repose sur l'imagerie médicale, principalement l'échographie, complétée parfois par un scanner. L'échographie a révélé des signes directs de rupture kystobiliaire dans 43,1% des cas de l'étude de Marrakech. Cependant, le diagnostic définitif de rupture kystobiliaire se fait souvent en peropératoire. La présence de cholestase (observée chez 12 patients dans l'étude marrakchie) associée à des anomalies échographiques constitue un signe présomptif de rupture.
1. Imagerie Médicale Echographie et Scanner
Le diagnostic du kyste hydatique du foie (KHF) et de sa complication, la rupture kystobiliaire, repose en grande partie sur l'imagerie médicale. L'échographie est l'examen de première intention. Dans l'étude menée à Marrakech, l'échographie a permis de visualiser des signes directs de rupture kystobiliaire dans 43,1% des cas. Cependant, l'échographie n'est pas toujours suffisante pour établir un diagnostic définitif, notamment pour localiser précisément la fistule biliaire. Le scanner (TDM) est utilisé en complément de l'échographie, lorsque celle-ci est non concluante. Dans l'étude marrakchie, la TDM, réalisée chez 18 patients, a permis de diagnostiquer une rupture du KHF dans 33% des cas. Il est important de noter que, selon le texte, le diagnostic de certitude de la rupture kystobiliaire n'est obtenu qu'en peropératoire par un examen minutieux de la cavité kystique.
2. Biomarqueurs et Examens Biologiques
En plus de l'imagerie, des examens biologiques peuvent contribuer au diagnostic de la rupture kystobiliaire. La recherche d'une cholestase, caractérisée par une élévation des phosphatases alcalines, de la gamma-glutamyl-transférase et de la bilirubine, est essentielle. La présence d'une cholestase associée à des anomalies échographiques suggère une rupture du KHF dans les voies biliaires, mais il est crucial d'écarter d'autres causes d'obstruction biliaire (lithiase, tumeur, etc.). L'étude de Marrakech a constaté une cholestase chez 12 patients sur l'échantillon étudié. Le dosage des enzymes de cytolyse (SGPT et SGOT) permet d'évaluer la fonction hépatique, un élément important dans le bilan préopératoire. Cependant, il faut insister sur le fait que la présence de ces marqueurs n'est pas spécifique à la rupture kystobiliaire. Le diagnostic final reste principalement basé sur l'imagerie et la confirmation peropératoire.
3. Examens Complémentaires et leurs limites
Des examens complémentaires, tels que la splénoportographie, étaient autrefois utilisés pour évaluer l'impact du kyste sur le tronc porte. Cependant, le document souligne que ces techniques sont devenues obsolètes face à l'avènement de l'échographie, de l'angio-scanner et de l'IRM, qui fournissent des informations plus complètes et précises, notamment pour visualiser et caractériser la communication entre le kyste et les voies biliaires. Ces techniques plus modernes permettent rarement de prouver une communication par opacification du KHF et ne peuvent éliminer formellement une fissuration kysto-vasculaire. Le diagnostic reste donc primordialement établi par l'échographie, le scanner si nécessaire, et surtout confirmé en peropératoire via l'examen direct de la cavité kystique.
III.Traitement Chirurgical du KHF et de ses Complications
Le traitement du KHF, notamment en cas de rupture kystobiliaire, est principalement chirurgical. Plusieurs techniques existent, allant de méthodes conservatrices (comme la résection du dôme saillant, largement utilisée dans l'étude de Marrakech) à des approches plus radicales (hépatectomie partielle). Le choix de la technique dépend de la localisation, de la taille du kyste, de la présence de fistules et de l'état du patient. La cholangiographie peropératoire joue un rôle crucial dans la planification et la réalisation de l'intervention. L'utilisation de scolicides (agents antiparasitaires) pour stériliser la cavité kystique est également un aspect important du traitement. La coeliochirurgie est une option possible pour les kystes non compliqués, mais une conversion à une laparotomie peut être nécessaire.
1. Traitement du Parasite et de la Cavité Kystique
Le traitement chirurgical du kyste hydatique du foie (KHF) commence par la stérilisation et l'évacuation du parasite. Ceci implique la protection de la cavité péritonéale, l'aspiration du contenu kystique à l'aide d'un trocart de Devé, l'extraction de la membrane hydatique et des vésicules filles. Le périkyste est ensuite ouvert, nettoyé avec une solution scolicide, et débarrassé des vésicules filles exogènes. Plusieurs scolicides sont mentionnés, incluant le cétrimide, l'éthanol, et d'autres, avec des recommandations pour minimiser leur toxicité en réduisant la concentration et le temps d'exposition. Après l'élimination du parasite, le traitement de la cavité résiduelle est entrepris. Des méthodes conservatrices, laissant la cavité en place, sont comparées à des méthodes radicales impliquant son exérèse. Le choix dépend du volume, du nombre, et de la topographie du kyste, ainsi que des moyens disponibles.
2. Techniques Chirurgicales Approches Conservatrice et Radicale
Le document décrit plusieurs techniques chirurgicales pour le traitement du KHF, notamment en cas de rupture kystobiliaire. La résection du dôme saillant (intervention de Largot) est la méthode la plus utilisée, particulièrement dans les pays à forte endémie. Elle consiste en une périkystectomie partielle, limitée à la partie du kyste faisant saillie. Bien que simple, elle peut laisser une cavité résiduelle, nécessitant un drainage externe. Des méthodes radicales, comme l'hépatectomie partielle, sont également mentionnées, mais considérées comme disproportionnées à la bénignité de la maladie dans certains cas. D'autres techniques, comme le cathétérisme permettant une déconnexion kystobiliaire par drainage biliaire et cavitaire divergents, sont décrites. Le choix de la technique dépend de facteurs comme la taille, la localisation du kyste, l'existence de fistules biliaires, et la disponibilité des ressources.
3. Voies d Abord Chirurgical et Cholangiographie
L'accès au kyste hydatique peut se faire par laparotomie médiane sus-ombilicale, plus facile pour les kystes du foie gauche, mais plus difficile pour le foie droit. La coeliochirurgie (chirurgie laparoscopique) est une option pour les kystes non compliqués, antérieurs et non volumineux. Cependant, les difficultés opératoires, notamment le risque de fuite de liquide hydatique et l'accessibilité limitée, peuvent conduire à une conversion en laparotomie. La cholangiographie peropératoire est essentielle pour visualiser les voies biliaires, préciser les rapports du kyste avec les voies biliaires, identifier la présence et la localisation de fistules, et détecter les obstacles sur la VBP. Elle permet un meilleur contrôle des éléments vasculo-biliaires et facilite la gestion des fistules biliaires d'accès difficile. Cette technique est décrite comme étant sans risque de choc anaphylactique ou de dissémination péritonéale.
4. Gestion des Fistules Bilio kystiques et Désobstruction de la VBP
La gestion des fistules biliaires est un aspect crucial du traitement chirurgical du KHF, surtout en cas de rupture kystobiliaire. L’identification de l’orifice fistuleux peut nécessiter une exploration minutieuse du périkyste. La cholangiographie peropératoire est utile pour identifier les fistules et les obstacles sur les voies biliaires. La désobstruction de la voie biliaire principale (VBP) est importante pour éviter une hyperpression des voies biliaires qui pourrait compromettre la cicatrisation des fistules. Différentes techniques de drainage et de remodelage canalaire sont envisagées, selon la taille et la localisation de la fistule. Le drainage par drain de Kehr peut être utilisé pour assurer une liberté de la VBP, permettre des cholangiographies postopératoires et gérer les fuites biliaires. La préservation de la VBP est un objectif constant dans le traitement chirurgical des ruptures du KHF.
IV.Complications Postopératoires du Traitement du KHF
Les complications postopératoires peuvent inclure des accidents hémorragiques, des infections (suppurations cavitaires), des fuites biliaires (cholérragies), et des réactions anaphylactiques. La prévention et la prise en charge de ces complications nécessitent une technique chirurgicale précise, un drainage approprié, et une surveillance postopératoire rigoureuse. L'étude de Marrakech souligne l'importance de ces complications, soulignant le besoin d'une approche chirurgicale adaptée pour chaque cas de KHF.
1. Complications Peropératoires
Le document mentionne plusieurs complications pouvant survenir pendant l'intervention chirurgicale du KHF. Le choc anaphylactique est une complication grave pouvant résulter d'une absorption systémique du liquide hydatique lors de fuites ou de ruptures accidentelles du kyste. Ce choc, lié à une réaction d'hypersensibilité de type I, est souvent brutal et sans signes prémonitoires, rendant le diagnostic difficile. Les accidents hémorragiques constituent une autre complication potentielle, dont l'incidence dépend de l'étendue de la destruction du parenchyme hépatique, du type d'intervention chirurgicale (conservatrice ou radicale), et de la proximité du kyste avec les gros vaisseaux. Un saignement important peut mettre le pronostic vital en jeu, notamment après la ponction du kyste, avec un possible décollement des membranes obturant une brèche kysto-vasculaire. La gestion de ces complications nécessite une préparation minutieuse, un contrôle hémodynamique rigoureux et une disponibilité immédiate de ressources pour la transfusion sanguine.
2. Complications Postopératoires Fuites Biliaires et Suppurations
Parmi les complications postopératoires, les cholérragies (fuites biliaires) peuvent survenir. Elles se manifestent par un écoulement de bile à travers l'orifice de drainage ou la plaie chirurgicale. Leur persistance impose la recherche d'un obstacle sur la voie biliaire principale (VBP), soulignant l'intérêt d'un drainage biliaire externe par drain de Kehr. La suppuration cavitaire est une autre complication fréquente, survenant particulièrement dans les kystes du dôme hépatique après une chirurgie conservatrice avec un drainage insuffisant. Elle se traduit par de la fièvre postopératoire et un écoulement purulent ou louche contenant des débris hydatiques. Le traitement repose sur l'antibiothérapie, la prolongation du drainage, et l'irrigation-lavage de la cavité résiduelle. Une ponction échoguidée peut être nécessaire dans certains cas. Une surveillance attentive de la température postopératoire, la recherche d'une douleur de l'hypochondre droit, et une hyperleucocytose sont les signes à surveiller.
V.Traitement Médical Adjuvant
Un traitement médical adjuvant, utilisant des médicaments comme l'albendazole, peut être nécessaire après la chirurgie pour prévenir les récidives. Cependant, il est important de surveiller les effets secondaires potentiels, notamment l'hépatotoxicité. L'efficacité du traitement médical varie, et une surveillance à long terme est nécessaire pour évaluer la viabilité du kyste et prévenir les récidives.
1. Médicaments utilisés et Efficacité
Après la chirurgie du kyste hydatique, un traitement médical adjuvant est souvent nécessaire pour prévenir les récidives. Le document mentionne l'utilisation d'albendazole (ABZ) et de mébendazole (MBZ). Le taux de réponse à l'albendazole est de 75%, alors qu'il est inférieur à 50% avec le mébendazole. L'efficacité dépend de la durée du traitement, avec un délai d'observation prolongé (modifications échographiques en moyenne entre 9 et 18 mois). Une surveillance échographique prolongée (plus de 5 ans) est recommandée pour évaluer le taux de récidive. Le jeune âge du patient et la récente apparition du kyste sont des facteurs prédictifs d'une bonne réponse au traitement.
2. Surveillance et Effets Secondaires
La surveillance du traitement médical est cruciale en raison des effets secondaires potentiels. Une hépatotoxicité, se manifestant par une élévation des transaminases, est observée dans 15% des cas. Une surveillance régulière des transaminases et de la gamma GT est donc nécessaire. Une augmentation des transaminases inférieure à trois fois la normale justifie une réduction de la dose du médicament, tandis qu'une augmentation supérieure à trois fois la normale impose l'arrêt du traitement et une consultation hépatologique. Le document souligne l'importance de la surveillance à long terme pour détecter les récidives et gérer les effets secondaires, assurant ainsi l'efficacité et la sécurité du traitement.
