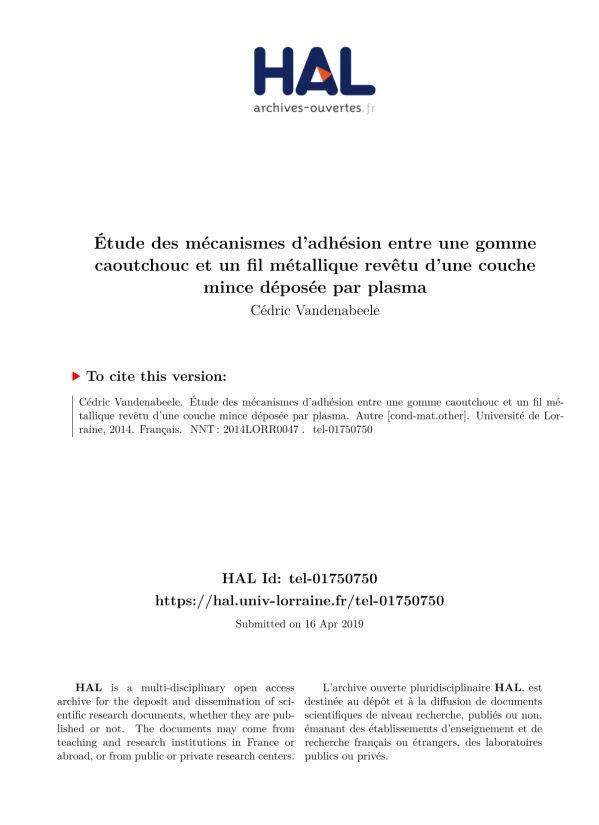
Étude des Mécanismes d'Adhésion entre Gomme Caoutchouc et Fil Métallique
Informations sur le document
| Auteur | Cédric Vandenabeele |
| École | Université de Lorraine |
| Spécialité | Physique des plasmas et application |
| Lieu | Nancy |
| Type de document | Thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 15.27 MB |
- adhésion
- gomme caoutchouc
- plasma
Résumé
I.Amélioration de l adhésion Caoutchouc Acier Revue de l état de l art
Cette étude explore des méthodes alternatives au revêtement laitonné traditionnel pour améliorer l'adhésion entre le caoutchouc et le fil d'acier dans les pneus. Le laiton, composé de cuivre et de zinc, forme une interface d'adhésion avec le caoutchouc via la création de sulfure de cuivre et de sulfure de zinc pendant la vulcanisation. Cependant, l'ajout de cobalt dans la formulation du caoutchouc améliore significativement cette adhésion, en modifiant la cinétique de croissance des couches d'oxydes et de sulfures. Des études ont démontré que des revêtements à base de zinc et de cobalt offrent une adhésion comparable, voire supérieure, au laiton, avec une meilleure résistance à la corrosion. L'objectif est de trouver un procédé plus économique et performant.
1. Architecture du pneumatique et nécessité d une forte adhésion
L'étude débute par une présentation de l'architecture d'un pneumatique, soulignant la nécessité d'une forte adhésion entre le caoutchouc et les matériaux de renforcement, notamment les câbles en acier. L'acier brut n'adhérant que très peu au caoutchouc, des traitements de surface sont nécessaires. Le laiton, alliage de cuivre et de zinc, est mentionné comme un traitement efficace, formant une interface d'adhésion robuste avec la gomme. Cette section établit le contexte industriel et les enjeux liés à l'adhésion caoutchouc-acier, posant les bases pour l'exploration de solutions alternatives.
2. Mécanismes d adhésion dans le revêtement laitonné et rôle des additifs
Cette partie détaille les mécanismes d'adhésion mis en jeu dans le système traditionnel du revêtement laitonné. La formation d'une couche de sulfure de zinc (ZnS) à la surface du laiton, via une conversion partielle de l'oxyde de zinc (ZnO), est identifiée comme un facteur clé. La migration des ions cuivre est freinée par la couche de ZnS, mais une couche de sulfure de cuivre (CuxS) se forme rapidement par la suite. Le rôle crucial des additifs, notamment les sels de cobalt, est mis en évidence. Ces additifs, incorporés dans la couche d'oxyde de zinc, augmentent la conductivité électrique tout en diminuant la vitesse de diffusion du zinc, conduisant à une couche de ZnO plus fine et améliorant l'adhésion. L'ajout de cobalt modifie la structure et la réactivité du ZnS, le rendant plus efficace pour assurer une liaison durable entre le laiton et le caoutchouc. Cependant, une utilisation excessive de cobalt peut nuire à l'intégrité du caoutchouc et accélérer la dézincification.
3. Alternatives au laiton Revêtements ZnCo et autres approches
L'étude explore des alternatives au revêtement laitonné, notamment les revêtements ZnCo (zinc-cobalt). Des travaux antérieurs ont montré que des revêtements ZnCo (avec une faible teneur en cobalt, autour de 0,5%) permettent d'obtenir une excellente adhésion, comparable voire supérieure au laiton, et une meilleure résistance à la corrosion. Néanmoins, des défis liés au tréfilage de ces alliages et à la fatigue du caoutchouc ont été rencontrés. Des recherches plus approfondies ont mis en évidence la formation d'une fine couche liante de ZnS à l'interface. L'analyse des mécanismes d'adhésion dans ces revêtements ZnCo révèle que le cobalt influence la réaction du zinc avec le soufre, favorisant la formation de ZnS et améliorant la résistance au vieillissement. Cette section souligne la possibilité de remplacer le laiton par des solutions plus performantes et moins coûteuses.
4. Bilan de l état de l art et perspectives Vers le dépôt plasma
L'analyse de la littérature révèle la possibilité de créer une adhésion solide entre l'acier et le caoutchouc sans le laiton, en utilisant des revêtements spécifiques et en optimisant la formation de la couche de sulfure de zinc. Cependant, la compréhension des mécanismes d'adhésion reste incomplète et parfois contradictoire, l'adhésion impliquant potentiellement une ou deux interfaces distinctes. Le rôle crucial du cobalt, malgré ses inconvénients, est réitéré. Finalement, l'étude justifie la recherche d'une approche alternative : le dépôt plasma, qui promet un meilleur contrôle sur la composition et la structure des couches minces et un coût de production réduit. Cette section conclut la revue de la littérature en proposant une nouvelle voie de recherche basée sur le dépôt plasma.
II.Dépôt Plasma Une approche innovante pour l adhésion Caoutchouc Acier
Cette recherche propose l'utilisation du dépôt plasma à pression atmosphérique comme technique de revêtement du fil d'acier pour optimiser l'adhésion au caoutchouc. Le procédé utilise du dichlorométhane comme précurseur, créant une fine couche mince organochlorée. L’étude compare différentes techniques de dépôt plasma (PVD, CVD, PECVD), soulignant les avantages du dépôt plasma à pression atmosphérique pour le dépôt de matériaux thermolabiles comme les polymères. Des analyses par XPS, TOF-SIMS, et MEB sont utilisées pour caractériser la morphologie et la composition chimique de la couche déposée.
1. Techniques de dépôt plasma État de l art et choix du procédé
La section introduit les différentes techniques de dépôt plasma existantes, posant les bases pour le choix de la méthode employée dans l'étude. Elle mentionne le dépôt physique en phase vapeur (PVD), le dépôt chimique en phase vapeur (CVD) et le dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma (PACVD ou PECVD). Le PVD, bien que précis, est limité en termes de matériaux utilisables et exige un vide poussé. Le CVD, plus simple, nécessite des températures élevées, excluant les matériaux thermolabiles. Le PECVD, quant à lui, permet de travailler à des températures plus basses, mais requiert toujours un environnement à basse pression. L'étude justifie le choix du dépôt plasma à pression atmosphérique pour sa compatibilité avec les polymères et sa simplicité relative. Cette section explique le pourquoi du choix du procédé de dépôt plasma à pression atmosphérique pour son application au revêtement du fil d’acier.
2. Dispositif expérimental pour le dépôt plasma
Cette partie décrit le dispositif expérimental utilisé pour le dépôt plasma. Un réacteur est schématisé, composé d'un système de déroulement du fil d'acier, d'un tube en quartz contenant la décharge plasma, d'une électrode haute tension et d'une contre-électrode connectée à la masse. L'utilisation du Téflon pour certaines parties est justifiée pour éviter les décharges parasites. Le système d'injection du précurseur (dichlorométhane), un système de nébulisation (Sonaer®), est détaillé. Le choix du Sonaer® est justifié par la faible pression de vapeur du squalène (précurseur initialement envisagé), permettant un contrôle précis de la quantité de dichlorométhane injecté. La description du dispositif expérimental est cruciale pour la reproductibilité de l'expérience et la compréhension des conditions de dépôt.
3. Étude du dépôt statique Influence des paramètres opérationnels
Cette section analyse les propriétés du dépôt statique obtenu avec du dichlorométhane dans une décharge d'argon. L'étude examine l'évolution de l'épaisseur et de la composition chimique (concentration en chlore) de la couche mince en fonction de la position dans la décharge et de la puissance incidente. À faible puissance (10 W), un profil d'épaisseur constant est observé, indiquant un excès de précurseur. À puissance plus élevée (50 W), le profil d'épaisseur devient décroissant, suggérant une consommation plus importante du précurseur. Des variations de la teneur en chlore sont également notées à 50 W, imputables à une homogénéité moins bonne du dépôt. L'analyse par EDX, dont la profondeur de pénétration est supérieure à l'épaisseur de la couche, est explicitement mentionnée. Cette analyse permet de comprendre l'impact des paramètres de puissance sur la qualité et la cohérence du dépôt.
4. Morphologie du dépôt et figures de Lichtenberg
Cette partie décrit l'observation de la morphologie de la couche mince, notamment l'apparition de figures de Lichtenberg dans certaines conditions. Ces figures, résultant de la diffusion d'espèces chargées, indiquent une interaction entre le plasma et la couche mince, avec des modifications structurelles locales. Une analyse des coupes transversales met en évidence des dommages à la couche aux endroits impactés par des streamers. L'évolution de la morphologie en fonction de l'épaisseur du dépôt et du temps de traitement est présentée, montrant une transition vers une structure plus dégradée au-delà d'une certaine épaisseur, suggérant une mauvaise cohésion. L'observation des figures de Lichtenberg et de la structure du dépôt à différentes épaisseurs renseigne sur la qualité et la durabilité du dépôt.
5. Analyse spectroscopique IR et implications chimiques
L'analyse par spectroscopie infrarouge (IR) est utilisée pour étudier la composition chimique de la couche mince. Une comparaison des spectres à différentes puissances révèle une augmentation du rapport entre les intensités des pics correspondant aux liaisons C=C et C-H avec l'augmentation de la puissance. Ceci suggère une diminution de la concentration d'hydrogène dans la couche, favorisant la formation d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et une structure plus proche du graphite. La faible teneur en chlore observée est expliquée par la formation d'espèces chlorées volatiles. La présence d’hydrocarbures insaturés, issue de la décomposition du dichlorométhane, est mentionnée comme un élément important pour la vulcanisation future. Cette analyse chimique précise la composition de la couche mince et sa potentialité pour assurer l'adhésion.
III.Caractérisation du Dépôt et Optimisation des Paramètres
L'analyse des dépôts statiques et dynamiques montre que l'épaisseur et la composition chimique de la couche mince organochlorée varient en fonction de la puissance du plasma et de la position le long de l'électrode. Une puissance élevée peut entraîner la formation d' hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et une diminution de la teneur en hydrogène, modifiant ainsi les propriétés de la couche. L'optimisation des paramètres du dépôt plasma vise à obtenir une couche homogène, sans défauts majeurs, et une forte adhésion au substrat. L’étude des figures de Lichtenberg met en évidence les interactions entre le plasma et le dépôt.
1. Étude du dépôt statique Épaisseur et composition chimique
L'étude commence par la caractérisation du dépôt statique, c'est-à-dire sans déplacement du substrat, afin de comprendre l'évolution des conditions de dépôt. L'épaisseur et la composition chimique (principalement carbone et chlore) de la couche sont analysées en fonction de la position dans la zone de décharge et de la puissance appliquée (10W et 50W). À 10W, un profil d'épaisseur constant est observé, avec une concentration en chlore également constante. Ceci suggère un dépôt en excès de précurseur. À 50W, le profil d'épaisseur est légèrement décroissant, avec des variations plus importantes de la concentration en chlore, indiquant une consommation accrue du précurseur et une moins bonne homogénéité du dépôt. L'analyse par MEB (microscopie électronique à balayage) et EDX (spectroscopie de rayons X dispersive en énergie) permet de mesurer l'épaisseur et la composition élémentaire relative. L’analyse des profils obtenus apporte des informations importantes sur l’influence de la puissance du plasma sur l’épaisseur et la composition de la couche mince déposée.
2. Morphologie du dépôt et figures de Lichtenberg Impact des paramètres
L'étude de la morphologie de la couche mince révèle des inhomogénéités structurelles liées à la puissance et au temps de traitement. À haute puissance, l'apparition de figures de Lichtenberg est observée, indiquant des impacts localisés d'espèces chargées et des dommages importants à la couche. L'analyse de coupes transversales montre une rugosité accrue et des zones endommagées aux endroits où les streamers ont frappé la surface. L'étude montre également que le caractère isolant de la couche dépend de son épaisseur et de sa composition. Au-delà d'une certaine épaisseur, de fortes dégradations et une transition dans la croissance de la couche, avec la superposition de deux structures distinctes ou des fractures, sont observées, soulignant le besoin d'optimiser les paramètres de dépôt pour obtenir un revêtement de qualité.
3. Analyse spectroscopique infrarouge IR Composition et structure de la couche
Une analyse spectroscopique infrarouge (IR) est réalisée pour étudier la structure chimique de la couche mince. La comparaison des spectres à différentes puissances met en évidence une diminution de la concentration d'hydrogène dans la couche lorsque la puissance augmente. Ceci suggère une transition vers une structure plus proche du graphite, avec la formation d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). La faible teneur en chlore observée est expliquée par la volatilité de certaines espèces chlorées formées dans la décharge. La présence d'hydrocarbures insaturés est identifiée comme un facteur important pour la vulcanisation ultérieure. L’analyse IR permet de déduire les changements structurels en fonction de la puissance du plasma, conduisant à une meilleure compréhension de la chimie de la couche mince.
IV.Prétraitement du Fil d Acier et Tests d Adhésion
Un prétraitement plasma est utilisé pour nettoyer et préparer la surface du fil d'acier zingué avant le dépôt. L’effet de différents prétraitements plasma (Ar, Ar/O2) sur la force de rupture du fil est évalué. Le prétraitement Ar/O2 peut causer une fragilisation du fil due à l'oxydation de la surface et à la formation de porosité. Des tests d'adhésion sont réalisés après vulcanisation, en utilisant différentes techniques pour séparer le fil du caoutchouc. L'analyse de l'interphase par TEM et TOF-SIMS révèlent la formation de structures de type ZnwOxHyClz à l’interface, ainsi que la présence de fragments d'accélérateurs. L’étude montre l'impact crucial du prétraitement et du dépôt plasma sur l'adhésion.
1. Prétraitement plasma Effet de l argon et de l argon oxygène
L'étude examine l'impact de deux types de prétraitement plasma sur le fil d'acier zingué : un plasma d'argon pur et un mélange argon/oxygène (Ar/O2). L'objectif est de préparer la surface du fil pour le dépôt ultérieur de la couche mince. Un prétraitement prolongé (environ une minute) est effectué à 50W pour le Ar/O2 et pour l'argon pur. L'analyse XPS (spectroscopie photoélectronique X) révèle une concentration plus importante en oxyde de zinc après le prétraitement Ar/O2, possiblement due à l'oxydation du zinc. Une contribution autour de 532 eV est plus importante pour le prétraitement Ar, suggérant une plus grande concentration en hydroxyde de zinc. Cependant, il est important de noter que l'XPS analyse uniquement les premiers nanomètres de la surface, et que ces résultats peuvent être influencés par des facteurs comme l'élimination de la contamination carbonée. La différence de traitement entraine une différence d'échauffement du fil avec une différence de l'ordre de 30K pour une puissance incidente de 50W.
2. Fragilisation du fil d acier et identification des facteurs déterminants
Des mesures de la force de rupture du fil d'acier après les prétraitements révèlent une fragilisation significative après exposition au plasma Ar/O2. Pour identifier les facteurs responsables de cette fragilisation, des expériences supplémentaires sont menées. L'augmentation de la température seule (test en four à 650K) ne suffit pas à expliquer la fragilisation. De même, l'exposition à un plasma d'argon pur à haute puissance, reproduisant l'échauffement du prétraitement Ar/O2, ne provoque pas de fragilisation significative. En conclusion, c'est la présence d'oxygène dans le plasma qui est le facteur déterminant de la fragilisation, probablement due à une oxydation externe de la surface du fil, conduisant à la formation de pores et de fissures (porosité Kirkendall).
3. Analyses de l interphase et mécanismes d adhésion
L'étude de l'adhésion entre la couche mince et le fil d'acier utilise différentes méthodes d’analyse. Des tests d'adhésion sont menés après vulcanisation du fil enrobé dans du caoutchouc. Des analyses par MEB (microscopie électronique à balayage) et SIMS (spectrométrie de masse d'ions secondaires) sont effectuées sur des fils prétraités et non prétraités. L'observation MEB montre une structure plus compacte et plus fissurée après le prétraitement Ar/O2, tandis que le SIMS révèle une oxydation externe et une porosité accrue du fil après ce prétraitement. L'analyse TOF-SIMS (spectrométrie de masse d'ions secondaires par temps de vol) de l'interface après vulcanisation (avec un papier filtre pour isoler le fil) identifie des structures de type ZnwOxHyClz et des fragments d'accélérateurs, indiquant une possible sulfuration du zinc similaire à celle du cuivre dans le laiton. Cette analyse permet d'approfondir la compréhension des mécanismes d'adhésion.
4. Tests d adhésion et comparaison avec le laiton
Des tests d'adhésion sont réalisés sur des fils d'acier zingués prétraités et revêtus de la couche mince, puis enrobés dans le caoutchouc. La force d'adhésion obtenue est comparée à celle mesurée avec des fils d'acier laitonnés. Pour des tests plus représentatifs d'un usage industriel, cinq fils sont enrobés simultanément dans la gomme. Les résultats montrent que la force d'adhésion obtenue avec le nouveau procédé plasma est supérieure à la force de rupture du fil d'acier, atteignant 90 à 95% de celle obtenue avec le laiton. L'étude explore différentes méthodes de récupération des fils du caoutchouc, utilisant l'azote liquide, des solvants ou un papier filtre. L’étude conclut en comparant l’adhésion obtenue avec le nouveau procédé à celle du procédé traditionnel utilisant le laiton.
V.Résultats et Conclusion
Les résultats montrent que le procédé de dépôt plasma permet d'obtenir une adhésion supérieure à la force de rupture du fil d'acier, comparable à celle obtenue avec le laiton. L’efficacité du procédé est confirmée par des tests sur plusieurs fils simultanément, atteignant 90-95% de l’adhésion du laiton. L’étude précise les mécanismes d'adhésion, suggérant un rôle clé de la couche de sulfure de zinc et de la structure poreuse des îlots ZnwOxHyClz. Le dépôt plasma offre donc une alternative prometteuse au revêtement laitonné pour une amélioration de l'adhésion dans la fabrication de pneus, avec un potentiel important d'applications industrielles.
1. Effet du prétraitement sur la force de rupture du fil d acier
L'étude explore l'influence du prétraitement plasma sur la résistance mécanique du fil d'acier zingué. Deux types de prétraitement sont comparés : un plasma d'argon pur et un plasma Ar/O2 (argon/oxygène). Des mesures de force de rupture montrent une fragilisation significative du fil après le prétraitement Ar/O2, alors qu'un prétraitement à l'argon pur n'a que peu d'impact, même à forte puissance. Des tests complémentaires, consistant à chauffer des échantillons dans un four à 650K, montrent que l'augmentation de température seule ne suffit pas à expliquer la fragilisation observée. L'analyse par SIMS (Spectrométrie de Masse d'Ions Secondaires) révèle une oxydation plus importante de la surface du fil après le prétraitement Ar/O2, expliquant probablement la fragilisation par la formation de porosité (porosité de Kirkendall).
2. Analyses de surface après prétraitement et dépôt XPS et SIMS
L'analyse XPS (spectroscopie photoélectronique X) montre une différence dans la composition de surface après les prétraitements Ar et Ar/O2. Le prétraitement Ar/O2 conduit à une concentration plus élevée en oxyde de zinc, suggérant une oxydation superficielle accrue. La présence d’une plus grande quantité d’hydroxyde de zinc est notée après le prétraitement à l’argon pur. L'analyse SIMS (spectrométrie de masse d'ions secondaires) est également utilisée pour étudier les profils de profondeur des éléments. Cette technique confirme l'oxydation superficielle plus importante avec le plasma Ar/O2. L’étude conclut que la fragilisation du fil d’acier zingué est principalement due à la présence d’oxygène dans le prétraitement plasma, ce qui conduit à la formation d’oxydes de zinc et/ou de fer à la surface du fil.
3. Tests d adhésion et analyse de l interface après vulcanisation
Des tests d'adhésion sont effectués après vulcanisation pour évaluer l'efficacité du procédé de dépôt plasma. Sept échantillons pour chaque condition de prétraitement sont utilisés : deux sans revêtement et cinq revêtus d'une couche mince organochlorée. La force d'adhésion est mesurée et comparée à la force de rupture du fil. Dans certains cas, la force d'adhésion dépasse la force de rupture du fil. L'analyse de l'interface après vulcanisation, effectuée avec un papier filtre pour isoler l'interface, utilise la technique TOF-SIMS (spectrométrie de masse d'ions secondaires par temps de vol). Cette analyse révèle la présence de structures de type ZnwOxHyClz et de fragments d'accélérateurs, suggérant une réaction de sulfuration du zinc. Des observations MEB révèlent la présence d'îlots composés de ZnwOxHyClz, dont la taille et la distribution varient en fonction du traitement.
4. Conclusion sur l adhésion et comparaison avec le laiton
Les résultats montrent que le prétraitement et le dépôt plasma permettent d'obtenir une adhésion supérieure à la force de rupture du fil d'acier, comparable à celle obtenue avec le laiton. Un test final, consistant à enrober simultanément cinq fils traités et cinq fils laitonnés, confirme l'efficacité du procédé plasma, avec une adhésion comprise entre 90 et 95% de celle du laiton. Bien que l'objectif industriel initial soit atteint, la compréhension exacte des mécanismes d'adhésion reste partielle, impliquant potentiellement une interface unique ou deux interfaces distinctes. La formation du sulfure de zinc semble jouer un rôle crucial dans l’adhésion, mais principalement par sa géométrie et sa structure particulière. Le procédé plasma offre ainsi une alternative prometteuse, efficace et économiquement viable au procédé laitonné traditionnel.
