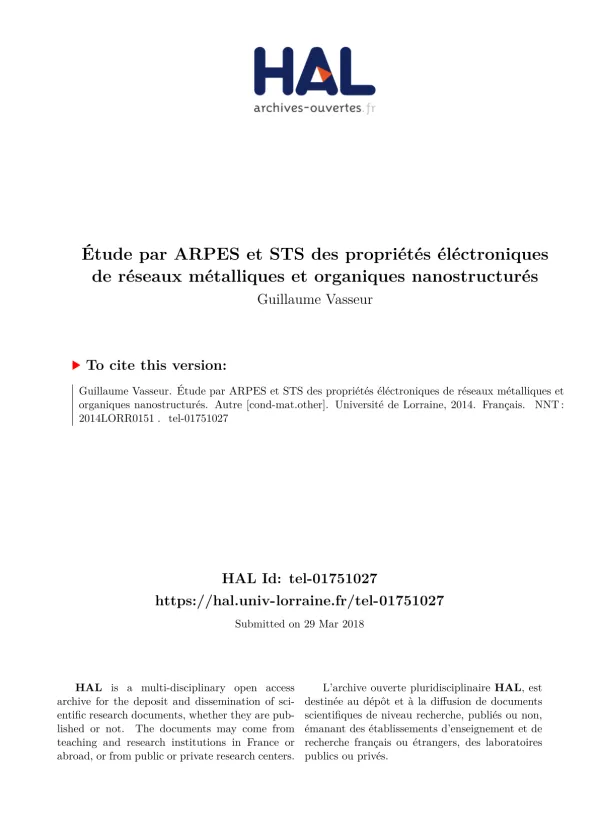
Étude des Propriétés Électroniques des Réseaux Métalliques et Organiques Nanostructurés
Informations sur le document
| Auteur | Guillaume Vasseur |
| École | Université de Lorraine |
| Spécialité | Physique |
| Lieu | Nancy |
| Type de document | thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 8.47 MB |
- physique
- nanostructures
- réseaux métalliques et organiques
Résumé
I.Étude des états de Shockley et leur utilisation pour sonder les potentiels de surface
Ce travail explore les états de Shockley, des états électroniques de surface, comme sondes pour caractériser les perturbations de surface. L’analyse de la dispersion de ces états, notamment par ARPES, permet de déterminer les potentiels induits par des impuretés ou des reconstructions périodiques, comme démontré pour la monocouche d’Ag/Cu(111) présentant une sur-structure (9x9). La méthode développée permet d’extraire des informations quantitatives sur le potentiel 2D à partir des gaps observés aux points M et K de la zone de Brillouin. Des travaux précédents sur Ag(111) et Au(23,23,21) illustrent l’approche unidimensionnelle. Les nanotechnologies bénéficient directement de cette compréhension fine des surfaces.
1. États de Shockley comme sondes de potentiels de surface
La première partie de l'étude se concentre sur l'utilisation des états de Shockley comme outils pour sonder le potentiel ressenti par les électrons à proximité de la surface. Ces états, connus pour leur grande sensibilité aux perturbations, permettent d'analyser l'impact d'impuretés localisées ou de structures périodiques, telles que les reconstructions de surface. Dans le cas de perturbations localisées, la diffusion de l'état de surface crée des ondes stationnaires de densité électronique mesurables par spectroscopie tunnel. L'analyse de ces oscillations permet d'extraire des paramètres quantitatifs, tels que les coefficients de réflexion et de transmission. Pour des perturbations périodiques, l'apparition de nouvelles conditions de Bragg modifie la dispersion des états de Shockley, créant des gaps en bordure de la nouvelle zone de Brillouin. Ce phénomène est observé sur la vicinale d'Au (23,23,21), permettant de déduire un potentiel perturbatif 1D. L'étude s'étend ensuite aux systèmes bidimensionnels.
2. Étude du potentiel 2D induit par la reconstruction triangulaire d une monocouche d Ag Cu 111
L'étude détaillée du potentiel 2D généré par la reconstruction triangulaire d'une monocouche d'Ag/Cu(111) est présentée. Cette interface, caractérisée par une sur-structure (9x9) avec un motif triangulaire, résulte de dislocations périodiques dans le plan de cuivre sous la couche d'argent, relaxant la contrainte due au désaccord paramétrique. La reconstruction induit un potentiel périodique ressenti par les électrons de l'état de Shockley, entraînant l'ouverture de gaps aux points de haute symétrie de la nouvelle zone de Brillouin. Ces gaps, mesurés précisément par ARPES, permettent d'accéder aux parties réelles et imaginaires des premières composantes de Fourier du potentiel 2D. L'utilisation de faibles dépôts d'alcalins déplace l'état de Shockley vers les hautes énergies de liaison, augmentant le nombre de gaps accessibles à la photoémission. Des considérations générales de symétrie permettent de comprendre le lien entre la morphologie de la couche et la structure de bande. Un modèle d'électrons presque libres, utilisant quelques ondes planes, décrit la dispersion et permet une estimation quantitative du potentiel.
3. Analogie avec un interféromètre de Fabry Pérot et exemples précédents
Une analogie est établie entre le comportement des électrons de l'état de Shockley dans un système constitué de deux marches monoatomiques parallèles et un interféromètre de Fabry-Pérot en optique. Les multiples réflexions des électrons sur les marches conduisent à une succession d'états confinés en fonction de l'énergie, observable en STS. L'étude théorique détermine l'impact du déphasage et du coefficient de réflexion des marches sur la densité locale d'états (LDOS). Le coefficient de réflexion influence la largeur spectrale, tandis que le déphasage modifie la position en énergie. La comparaison avec des données expérimentales permet de déduire les valeurs du coefficient de réflexion (r=0.35) et du déphasage (φ=π) pour Ag(111). Des études antérieures, notamment celles de C. Tournier-Colleta sur le confinement dans des nanopyramides d’Ag sur Cu(111) et de C. Didiot et coll. sur la vicinale d’Au(23,23,21), soulignent l'intérêt des états de Shockley pour sonder les interactions électron-phonon et les potentiels 1D induits par des reconstructions de surface.
II.Croissance et propriétés électroniques de polymères organiques obtenus par couplage d Ullmann
La seconde partie se concentre sur la croissance et les propriétés électroniques de nanostructures organiques, en particulier le poly-para-phénylène (PPP), synthétisé par couplage d'Ullmann à partir de 1,4-dibromobenzène (DBB) et 1,4-diiodobenzène (DIB) sur une surface de Cu(110). L'étude, menée en collaboration entre l'Institut Jean Lamour (Nancy, France), le Centre Energie Matériaux Télécommunications (Varennes, Canada) et l'Istituto di Struttura della Materia (Rome, Italie), utilise ARPES et STS pour caractériser la délocalisation des électrons π et déterminer le gap HOMO-LUMO. L'influence du taux de recouvrement sur la morphologie des couches est également examinée, révélant des phases organométalliques intermédiaires avant la formation du PPP. La formation de nanorubans de graphène à partir de molécules similaires est mentionnée comme un exemple des applications potentielles des nanotechnologies.
1. Synthèse du poly para phénylène PPP par couplage d Ullmann
Cette section détaille la synthèse de nanostructures organiques covalentes, notamment le polymère unidimensionnel poly-para-phénylène (PPP), via la réaction de couplage d'Ullmann. L'étude se concentre sur l'utilisation de 1,4-dibromobenzène (DBB) et 1,4-diiodobenzène (DIB) comme précurseurs. Ce travail est une collaboration entre l'Institut Jean Lamour (Nancy, France), le Centre Energie Matériaux Télécommunications (CMT-INRS) à Varennes (Canada), et l'Istituto di Struttura della Materia (ISM) à Rome (Italie). Chaque institution apporte son expertise: l'IJL en spectroscopies électroniques de basse énergie (spectroscopie tunnel et photoémission UV résolue en angle), le CMT-INRS dans la polymérisation de monomères précurseurs halogénés sur substrats métalliques, et l'ISM dans les techniques de spectroscopie haute énergie (XPS, XPD, EELS). Le but principal est d'analyser les propriétés électroniques des différentes phases synthétisées, en mettant l'accent sur la délocalisation des électrons π dans le PPP. Des études théoriques par DFT sont en cours pour compléter les résultats expérimentaux.
2. Caractérisation des propriétés électroniques du PPP par ARPES et STS
L'étude utilise ARPES (spectroscopie de photoémission résolue en angle) et STS (spectroscopie à effet tunnel) pour caractériser les propriétés électroniques du poly-para-phénylène (PPP) formé. L'ARPES révèle l'existence de deux bandes dispersives quasi-unidimensionnelles séparées par un gap HOMO-LUMO de 1.15 eV, entièrement situé sous le niveau de Fermi. Le STS permet d'étudier la délocalisation des électrons π et confirme les résultats de l'ARPES. La forte dépendance de la morphologie des couches en fonction du taux de recouvrement est mise en évidence. Les résultats obtenus, récents à l'époque de l'écriture du mémoire, ouvrent de nombreuses questions, notamment sur les mécanismes de croissance et les interactions entre les molécules et le substrat. Des études théoriques complémentaires, notamment par DFT, sont nécessaires pour une meilleure compréhension.
3. Influence du taux de recouvrement et formation de phases organométalliques
L'influence du taux de recouvrement sur la croissance et la structure du système est examinée. Pour des faibles taux de couverture, la formation d'une phase organométallique est observée. Des images STM haute résolution révèlent une super-périodicité et des dislocations dans la structure. Des études par XPS et NEXAFS confirment la nature organométallique de la phase. Le recuit à haute température (500 K) provoque la polymérisation et la formation de chaînes unidimensionnelles de PPP. La comparaison avec d'autres systèmes de la littérature permet d'émettre des hypothèses sur les mécanismes réactionnels et la structure atomique des phases intermédiaires. Pour des taux de couverture proches de la saturation, une nouvelle phase organométallique coexiste avec la phase non saturée. La diffraction LEED permet une identification simple de la reconstruction de surface même sans STM. La formation de chaînes de polymère unidirectionnelles, alignées dans la direction [1,-1,0] est constatée à des températures supérieures à 500 K, avec un changement d'orientation d'environ 35° par rapport à la phase organométallique.
III.Caractérisation du poly para phénylène PPP synthétisé sur Cu 110
L'analyse par ARPES et STS du poly-para-phénylène (PPP) révèle une dispersion des électrons π fortement anisotrope, principalement dans la direction parallèle aux chaînes. Le matériau présente un caractère métallique unidimensionnel avec un faible gap HOMO-LUMO (1.15 eV). Des comparaisons avec des résultats théoriques (DFT) et des données expérimentales de la littérature (notamment une étude de Wang et coll. sur Cu(111)) éclairent l'influence de l'interaction avec le substrat sur la structure de bande et la position des niveaux d'énergie par rapport au niveau de Fermi. La faible distance polymère-surface (2.2 Å) suggère une forte hybridation des états électroniques. L'influence du type d'halogène (DBB vs DIB) sur la géométrie d'adsorption et les propriétés électroniques est également discutée. Les études futures porteront sur la compréhension de l'hybridation et le rôle de l'halogène.
1. Structure de bande du poly para phénylène PPP ARPES et STS
Cette section détaille l'analyse des propriétés électroniques du poly-para-phénylène (PPP) synthétisé sur une surface de Cu(110) à l'aide des techniques ARPES et STS. L'ARPES permet de mesurer la structure de bande des états π sur une large gamme d'énergies (environ 7 eV sous le niveau de Fermi). Les résultats montrent une dispersion fortement anisotrope, principalement dans la direction parallèle aux chaînes de polymère, suggérant un faible couplage inter-chaînes. Un gap HOMO-LUMO de 1.15 eV est mesuré, situé entièrement sous le niveau de Fermi, conférant un caractère métallique unidimensionnel au polymère. La STS, quant à elle, fournit des informations sur les états LUMO, et l'étude de leur confinement en fonction de la longueur des chaînes permet de reconstruire la dispersion pour un polymère infini. Le bas de la bande LUMO se situe dans les états occupés, à environ 400 meV sous le niveau de Fermi, confirmant le caractère métallique. L'analyse de la forme du haut de la bande permet de déterminer le vecteur d'onde caractéristique du sommet de la dispersion et la masse effective des électrons.
2. Comparaison avec les modèles théoriques et données de la littérature
Les résultats expérimentaux sont comparés aux modèles théoriques, notamment le modèle de Hückel et les calculs DFT. Le modèle de Hückel, bien que simple, ne reproduit pas précisément l'amplitude du gap HOMO-LUMO. Les calculs DFT, en revanche, offrent une meilleure estimation du gap (0.9 eV contre 1.15 eV expérimentalement), et reproduisent fidèlement le caractère métallique du polymère. Une comparaison avec une étude de S. Wang et coll. (2011) sur un polymère de PPP similaire, mais déposé sur Cu(111), révèle des différences significatives dans la position de la bande LUMO par rapport au niveau de Fermi. Ces différences suggèrent un rôle majeur de l'interaction entre le polymère et le substrat, notamment en termes d'hybridation des états électroniques et de transfert de charge, influencés par la surface Cu(111) ou Cu(110) et la quantité de brome présente.
3. Discussion de l hybridation et de l influence du substrat
Une discussion approfondie porte sur l’hybridation des états électroniques du polymère avec ceux du substrat de Cu(110). La faible distance (2.2 Å) séparant le polymère du dernier plan atomique du cuivre suggère une forte interaction. Cette hybridation pourrait expliquer le transfert de charge et la réduction du travail de sortie, contribuant à l'injection d'électrons dans les états LUMO et au faible gap HOMO-LUMO observé. La différence entre les résultats obtenus et ceux de l'étude de Wang et coll. sur Cu(111) souligne l'importance du type de surface utilisé. L'influence du type d'halogène (DBB vs DIB) est également abordée, mais son effet est difficile à dissocier de celui du substrat compte tenu des différences géométriques d'adsorption. Des calculs de densité d'états en fonction de la distance polymère-surface sont envisagés pour une meilleure compréhension. Le caractère métallique unidimensionnel du polymère, observé expérimentalement, représente une propriété particulièrement intéressante pour les applications.
