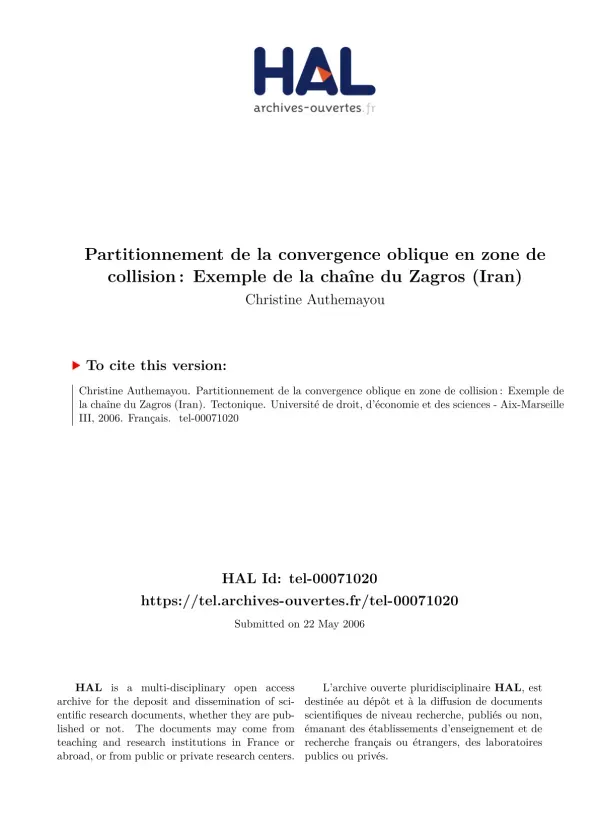
Partitionnement de la Convergence Oblique en Zone de Collision : Étude de la Chaîne du Zagros
Informations sur le document
| Auteur | Christine Authemayou |
| instructor | Olivier Bellier, Professeur, Université Paul Cézanne |
| École | Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Centre Européen de Recherche et d’Enseignement en Géosciences de l’Environnement |
| Spécialité | Sciences de la Terre |
| Type de document | Thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 61.82 MB |
- Géologie
- Tectonique
- Convergence oblique
Résumé
I.Les Failles Décrochantes dans les Zones de Collision du Zagros
Cette étude se concentre sur le rôle des failles décrochantes dans l'accommodation de la convergence oblique au sein de la ceinture de plis et chevauchements du Zagros, en Iran. L'analyse porte sur deux failles majeures: la Main Recent Fault (MRF), orientée NW, et la faille de Kazerun (KF), orientée N. L'objectif est de comprendre comment la déformation transpressive est partitionnée entre ces structures et les plis longitudinaux du Zagros. Des études de cinématique des failles, basées sur l'analyse structurale multi-échelle via un Système d'Information Géographique (SIG) et l'interprétation d'images SPOT, permettent de documenter l'évolution géométrique et cinématique de ces failles. Des analyses de données paléomagnétiques (mentionnées mais moins développées) et des mesures de taux de glissement à l'aide de la datation cosmonucléide (36Cl) et U/Th sur des marqueurs géomorphologiques (terraces alluviales, cônes de déjection) sont essentielles à la compréhension de l'évolution tectonique.
Des études antérieures de Talebian et Jackson (2002) suggèrent un taux de glissement élevé le long de la MRF. Cependant, cette étude précise l'âge du début du glissement le long de la MRF au Pliocène, en interaction avec la KF et son rôle comme rampe latérale dans la distribution de la déformation. Le modèle d'évolution cinématique proposé met en avant une réorganisation du réseau de failles au Pliocène, avec une transition d'une déformation principalement transpressive à une déformation partitionnée le long de la MRF.
1. Caractéristiques des failles décrochantes en zones de collision
Cette section introduit les failles décrochantes, distinguant les failles transformantes (limites de plaques) des failles coulissantes intraplaques. L'accent est mis sur l'importance des failles coulissantes dans les zones de collision pour comprendre la cinématique globale des chaînes de montagnes. L'étude examine leurs caractéristiques cinématiques et mécaniques, posant les bases pour l'interprétation des données du Zagros. Un point clé est l'explication du partitionnement du champ de contraintes transpressif sur une faille verticale plutôt qu'une faille inclinée, en invoquant le principe de minimisation de l'énergie dissipée. Pour des roches élastiques, une faille verticale est plus favorable car elle minimise la friction. Pour des roches à rhéologie plastique, des comportements similaires, mais non identiques sont attendus. La localisation de ces failles est liée à la réactivation de zones de faiblesse préexistantes, héritées de différentes phases tectoniques antérieures: zones de suture, fracturation de marges passives, schistosité régionale, ou anciennes failles décrochantes. L'étalement gravitaire des chaînes de montagnes, processus influençant également la formation et l'activation de failles décrochantes, est abordé, soulignant la complexité des mouvements de blocs crustaux et les rotations possibles, en lien avec des exemples comme le système de failles de San Andreas. Enfin, la section explore la cinématique des rampes obliques latérales et leur implication dans la déformation compressive et les rotations de blocs, ainsi que l'accommodation de la déformation transpressive via des failles à mouvement inverse et décrochant, et l’organisation en structures en fleur.
2. Paramètres du partitionnement et exemples
Cette partie explore les paramètres contrôlant le degré de partitionnement de la déformation dans les zones de convergence oblique. L'angle α entre le vecteur de mouvement et la faille joue un rôle majeur: plus α est faible, plus le partitionnement est important. Le degré de partitionnement dépend aussi de l'angle entre la faille et l'axe de contrainte principal compressif. McKenzie et Jackson (1983) suggèrent que le partitionnement est le mécanisme le plus simple pour accommoder une convergence oblique. L'étude cite des exemples de zones de subduction intra-océanique où le partitionnement est bimodal, avec la composante normale accommodée par la subduction et la composante décrochante par une faille parallèle à la limite de plaque, comme la faille de Sumatra. La section détaille les mécanismes du partitionnement de la déformation, en soulignant l'influence de facteurs géométriques et rhéologiques. Des modèles analogiques, intégrant une rhéologie plastique, ont permis de déterminer le rôle de l’angle α sur le degré de partitionnement, un angle critique devant être atteint pour que le partitionnement s’active. Le degré de partitionnement est également fonction de l’angle entre la faille et l’axe de contraintes principal instantané compressif.
II.Cadre Géodynamique et Déformation Active du Zagros
Le Zagros, une chaîne de montagnes du Moyen-Orient, subit une convergence oblique dextre entre les plaques Arabique et Eurasienne. Le vecteur de convergence fait un angle d'environ 45° avec la direction de la chaîne. La MRF, qui suit une direction NW, joue un rôle crucial dans l'accommodation de la composante décrochante de cette convergence oblique. La KF intervient quant à elle dans la distribution de la déformation vers le sud de la chaîne, agissant comme une rampe latérale. L'étude intègre des données GPS pour quantifier les vitesses de convergence actuelles et les mécanismes au foyer des séismes, afin de mieux comprendre la répartition de la déformation. La Formation d'Hormuz, une couche d'évaporites, influence la déformation et permet la migration du front du Zagros vers le sud. Les vitesses de convergence estimées par Vernant et al. (2004) sont intégrées à l'analyse.
1. Histoire géodynamique du Zagros
Cette section explore l'histoire géodynamique de la ceinture de plis et chevauchements du Zagros, située sur la marge nord de la plaque Arabique en Iran. Elle est décrite comme un prisme d'accrétion continental de direction NW-SE, formé par la collision Arabie-Eurasie depuis le Miocène. La convergence relative entre les plaques Arabie et Eurasie est oblique (environ 45°), ce qui influence fortement la déformation. La structure de la chaîne est principalement caractérisée par des plis et des chevauchements longitudinaux. L'étude mentionne des phases antérieures à la collision, notamment l'ouverture de la Paléotéthys au Paléozoïque inférieur, la formation du craton Arabique et le dépôt d'évaporites (sel d'Hormuz d'environ 2 km d'épaisseur). Un soulèvement, possiblement lié à l'orogenèse hercynienne, est mentionné, ainsi que l'amplification de la déformation au Pliocène. L'âge précis de l'initiation de la collision reste débattu, variant selon les auteurs entre le Crétacé supérieur et le Miocène supérieur. Cette incertitude est liée à la difficulté de localiser et de dater précisément la déformation au nord-est de la chaîne, entre une phase d'obduction au Crétacé supérieur et la propagation du plissement du Miocène supérieur au Pliocène. Malgré ces incertitudes, la vitesse et la direction de déplacement de l'Arabie par rapport à l'Eurasie semblent relativement constantes depuis 56 Ma, contrairement à l'Afrique qui ralentit à partir de 19.6 Ma, la différence étant accommodée par l'ouverture de la Mer Rouge. Des références à des travaux de Stöcklin (1968), Falcon (1974), Berberian et King (1981), Hessami et al. (2001a), McQuarrie et al. (2003), Joffe et Garfunkel (1987) sont incluses.
2. Déformation active et failles décrochantes majeures
Cette section se concentre sur la déformation active du Zagros et le rôle des principales failles décrochantes. Les mesures GPS indiquent une convergence Arabie-Eurasie d'environ 21 mm/an à 50°E, augmentant vers l'est en raison de la position du pôle de rotation de l'Arabie. Le raccourcissement dans le Zagros est orienté N-NNE (environ 7 ± 2 mm/an), oblique par rapport à la direction de la chaîne. Les mécanismes au foyer des séismes indiquent un partitionnement de cette obliquité: glissement inverse le long des chevauchements longitudinaux et glissement décrochant dextre sur la Main Recent Fault (MRF). La plupart des séismes sont peu profonds (<20 km). La MRF, une faille décrochante dextre majeure, est presque continue de l'Anatolie orientale à environ 51°E. Elle contribue, avec les failles d'Anatolie orientale et septentrionale, à l'enfoncement de l'Eurasie au Caucase et à la rotation anti-horaire de la plaque Arabique (Reilinger et al., 1997; Talebian et Jackson, 2002). Au sud-ouest de la MRF, les failles inverses montrent des vecteurs de glissement normaux à la direction de la chaîne, suggérant un partitionnement complet de la convergence oblique sur la MRF au moins dans la zone instrumentale. Cependant, le déplacement horizontal et le taux de glissement sur la MRF restent sujets à débat. Des études précédentes de Talebian et Jackson (2002) et Authemayou et al. (soumis) proposent respectivement un taux de glissement intégré de 10-17 mm/an et une origine au Pliocène pour le glissement latéral droit le long de la MRF.
3. La Formation d Hormuz et les niveaux de décollement
Cette partie décrit le rôle de la Formation d'Hormuz, une épaisse couche d'évaporites, dans la tectonique du Zagros. Cette formation, située au toit du socle, constitue un niveau de décollement majeur dans le Zagros oriental (région du Fars). La présence des évaporites induit une tectonique salifère avec fluage et diapirisme, influençant la géométrie arquée de la ceinture de plis et chevauchements dans la région du Fars (Stöcklin, 1968; Talbot, 1998; Sherkati et Letouzey, 2004; Molinaro et al., 2005a). L'extrusion latérale du sel est contrôlée par des systèmes de failles N-S (Kent, 1979; Bahroudi et Koyi, 2003). D'autres niveaux de décollement intermédiaires existent dans les formations triasiques, crétacées supérieures, éocènes et miocènes, observés via les puits de forages et les profils sismiques (Bahroudi et Koyi, 2004; Alavi, 2004; Sherkati et Letouzey, 2004; Sepehr et Cosgrove, 2004). La région est divisée en trois domaines: l'arc du Fars, l'arc du Lorestan et la zone de Dezful-Izeh, chacun présentant des caractéristiques morphologiques et stratigraphiques distinctes, influençant la propagation du front topographique vers le sud. La répartition de la déformation et des niveaux de décollement est hétérogène, liée à la présence des évaporites et à la géométrie des failles.
III.Géométrie et Cinématique des Failles Principales
L'analyse structurale met en lumière la géométrie complexe de la MRF et de la KF. La KF est constituée de trois segments nord-sud, dont les extrémités sud sont incurvées. L'étude détaille les relations géométriques et cinématiques entre ces failles et les plis et chevauchements du Zagros. Elle met en évidence un modèle en éventail des failles, suggérant une redistribution du glissement de la MRF vers les structures longitudinales via la KF. Des estimations de rejet fini sont obtenues grâce à des observations de terrain, et des analyses d'images satellitaires SPOT et modèle d'élévation numérique (MNE). L'étude des stries de glissement sur les plans de faille permet de reconstituer l'histoire de la déformation et de déterminer les régimes de contrainte. Les travaux d'Authemayou et al. (2005) sur la segmentation de la KF sont aussi intégrés.
1. Géométrie de la Faille de Kazerun KF
Cette section décrit la géométrie de la Faille de Kazerun (KF), une faille décrochante dextre majeure du Zagros central. La KF est constituée de trois zones de failles nord-sud de longueur équivalente (~100 km), présentant des tracés similaires avec une orientation générale N170-180°E. Leurs terminaisons sud sont incurvées vers le sud-est, se divisant en ramifications (splays) connectées à des chevauchements et anticlinaux orientés NW. Les flancs des plis sont systématiquement renversés près de la KF, indiquant une augmentation du glissement inverse et/ou une réactivation des rampes en direction de la faille. Au sud-sud-ouest de Khormuj, la courbure d'un grand anticlinal côtier suggère une prolongation cachée, orientée nord, du segment sud de la KF jusqu'à la côte. L'analyse de la géométrie de la KF met en évidence une complexité structurale, liée à la présence de plis et chevauchements, et à une évolution tectonique polyphasée. La détermination du rejet latéral total est rendue difficile par cette complexité, notamment l’évolution contrastée des plis de part et d’autre de la faille, contrôlée par des variations importantes de faciès sédimentaires, des réactivations hors séquence et la synchronicité des mouvements de plissement et de décrochement. Néanmoins, les segments décrochants N-NNW de la KF centrale semblent avoir fonctionné principalement comme une faille transcurrente, avec un rejet latéral droit minimum estimé à 8 km. Des références à Authemayou et al. (2005) et Sherkati et Letouzey (2004) sont incluses.
2. Géométrie et Cinématique de la Main Recent Fault MRF
Cette section décrit la géométrie et la cinématique de la Main Recent Fault (MRF), une autre faille majeure du Zagros. La MRF est une faille décrochante dextre orientée NW, qui traverse les nappes et structures transpressives du Pliocène inférieur. Son extrémité sud-est se connecte à l'extrémité nord de la KF. L'étude souligne la formation d'un modèle en éventail de failles à l'échelle de l'orogène, composé de la MRF, de la KF et d'un réseau de failles de direction N-NNW héritées du socle. Ce modèle en éventail permet la redistribution du glissement de la MRF vers les failles inverses et les plis longitudinaux du Zagros, agissant comme une terminaison en queue de cheval de la MRF. L’âge du glissement le long de la MRF est interprété comme débutant au Pliocène. L'étude mentionne que la Formation Hormuz a facilité la distribution du glissement et permis la migration vers le sud du front du Zagros, agissant comme une zone de faible résistance facilitant l’extrusion. L'étude relève que ce modèle cinématique diffère des modèles classiques observés aux terminaisons de grandes failles décrochantes, notamment à cause d’un couplage latéral et vertical perturbé par les évaporites de la Formation d’Hormuz. Des rotations anti-horaires et horraires sont observées, compliquant le modèle classique en queue de cheval. La référence à Authemayou et al. (2005) est présente.
3. Analyse de la Cinématique des Failles
Cette section détaille la méthodologie utilisée pour analyser la cinématique des failles, c'est-à-dire l'étude de leurs mouvements gouvernés par les états de contrainte. L'analyse des stries de glissement (tectoglyphes) sur les miroirs de faille permet de déterminer les vecteurs de glissement et de reconstituer l'histoire de la déformation. La coexistence de plusieurs familles de stries indique des phases tectoniques successives, analysées par une méthode d'inversion numérique pour déterminer le tenseur des contraintes. Cette méthode, basée sur les travaux de Carey (1979) et Mercier et Vergely (1999), vise à trouver le tenseur de contraintes qui minimise l'écart entre les vecteurs de glissement théoriques et les stries mesurées. L'étude distingue plusieurs épisodes de glissement le long des failles MRF, KF et faille de Semirom. L'analyse des stries permet de distinguer un régime de faille inverse précédant le régime décrochant actuel, tous deux associés aux mêmes directions des axes de contrainte principaux. Ceci indique un changement de régime de contrainte plutôt qu'une simple rotation des plans de faille. L'approche utilisée permet de distinguer et de séparer des familles distinctes de stries, compatible avec deux principaux épisodes de glissement, en combinant l'analyse de terrain (relations de recoupement), et un contrôle numérique entre les stries et les états de contraintes.
IV.Quantification des Taux de Glissement et Modèle Cinématique
L'estimation des taux de glissement sur la MRF et la KF est effectuée à partir de décalages tectoniques de marqueurs géomorphologiques (cours d'eau, cônes alluviaux, terrasses). La méthode utilise la datation cosmonucléide (36Cl) et la datation U/Th sur les carbonates afin de déterminer l'âge des surfaces déplacées. L'analyse fournit des estimations des vitesses de glissement pour la période récente (Quaternaire). Ces résultats sont intégrés dans un modèle cinématique qui explique la réorganisation du réseau de failles au Pliocène et la transition d'un régime de déformation transpressive vers un régime avec une partition de la déformation le long de la MRF. La contribution de la Formation d'Hormuz dans la distribution du glissement est soulignée. Les résultats obtenus concernant les taux de glissement sur la MRF et la KF mettent en évidence une diminution du glissement de la MRF vers l'extrémité SE de la KF. Des résultats de Yamini-Fard et al. (en cours) et Bachmanov et al. (2004) contribuent à cette analyse.
1. Méthodes de quantification des taux de glissement
Cette section détaille les méthodes utilisées pour quantifier les taux de glissement le long des failles étudiées, notamment la Main Recent Fault (MRF) et la Faille de Kazerun (KF). L'objectif est d'estimer les vitesses de déplacement horizontal pour la période du Néogène récent et du Quaternaire. La méthodologie repose sur l'identification et la datation de décalages tectoniques de dépôts quaternaires. Différents types de marqueurs géomorphologiques sont utilisés pour évaluer les déplacements: marqueurs linéaires (réseau de drainage, crêtes, limites de formations géologiques) et marqueurs surfaciques ou volumiques (surfaces d'abandon de terrasses alluviales, cônes de déjection, glacis). L'étude se concentre sur les terrasses alluviales et les cônes de déjection. L'âge des dépôts est déterminé par la méthode de datation des cosmonucléides (36Cl), basée sur la mesure de l'exposition à la radiation cosmique, et, dans un cas test, par la méthode U/Th sur des carbonates détritiques. Cette dernière méthode date la formation de la calcrète recouvrant les surfaces, ce qui ne correspond pas exactement à la fin de la mise en place des cônes. La combinaison de ces deux méthodes de datation apporte des contraintes sur l'âge des surfaces géomorphologiques étudiées. L'analyse des décalages apparents des cours d'eau tient compte des effets de la topographie, de la déflexion initiale du réseau et des processus de capture. Il est important de noter que l'extension du drainage en amont de la faille peut être limitée par la topographie. La mesure du décalage vertical est également abordée, avec des précautions à prendre pour les surfaces courbes des cônes alluviaux, en considérant la diffusion morphologique, les dépôts de pente et le rebond. Des références à Tricart (1947), Bourdier (1958), Schumm (1986), Bull (1991, 1990), Gabert (1984), Gaudemer et al. (1989), Huang (1993), Peltzer et al. (1988), Avouac et Tapponnier (1993), Gaudemer et al. (1995), Regard et al. (2005), Hsu et Pelletier (2004), et Alonso-Zarza et al. (1998) sont mentionnées.
2. Résultats et interprétation des taux de glissement
Cette section présente les résultats de la quantification des taux de glissement sur la MRF et la KF. Le taux de glissement moyen sur la MRF est estimé entre 5 et 7 mm/an sur les 140 000 dernières années, indiquant un partitionnement complet de la convergence le long de cette faille. Pour la KF, les taux sont de 4 mm/an pour le segment nord, 2,5 à 3 mm/an pour la zone centrale, et négligeables pour le segment sud. Ces résultats sont cohérents avec une distribution du glissement vers le sud, de la MRF vers les failles inverses et les plis du Zagros via la KF, avec une diminution du glissement de l'extrémité sud-est de la MRF vers l'extrémité sud-est de la KF. L'étude compare ces résultats avec des estimations précédentes, notamment celles de Talebian et Jackson (2002) qui avaient documenté un rejet horizontal cumulé de 50 km le long de la MRF, impliquant un taux de glissement de 10 à 17 mm/an. La différence est discutée en considérant plusieurs facteurs: le glissement possible sur des failles précurseurs à la MRF avant le Pliocène, une sous-estimation de l'âge de la Formation Baktiari, et une éventuelle diminution du taux de glissement sur la MRF depuis le Pliocène. L’étude mentionne la nécessité de travaux supplémentaires pour préciser le taux de glissement au Quaternaire en analysant le déplacement de caractéristiques géomorphologiques datées. Des références à des travaux de Talebian et Jackson (2002), Bachmanov et al. (2004), Authemayou et al. (2005), et Yamini-Fard et al. (2003, en cours) sont présentes. Les causes possibles du réarrangement tectonique au Pliocène sont débattues, avec les hypothèses de Westaway (2003) concernant la crise de salinité messinienne et celle d'Allen et al. (2004) sur le déplacement du raccourcissement crustal. L'hypothèse du détachement de la plaque lithosphérique Arabique et du soulèvement thermique du plateau iranien (Molinaro et al., 2005b) est également mentionnée.
3. Modèle cinématique et implications
Cette section présente un modèle cinématique intégrant les résultats obtenus sur les taux de glissement et la géométrie des failles. L'activation de la MRF au Pliocène a entraîné une réorganisation du réseau de failles et un changement cinématique de la ceinture de plis et chevauchements, passant d'une déformation principalement transpressive à une déformation avec partitionnement du glissement le long de la MRF. Ce changement est accompagné d'un changement de régime de contrainte régional, passant d'un régime de faille inverse à un régime décrochant dextre. La KF, dans le cadre cinématique actuel, accommode une partie du glissement transféré de la MRF et agit simultanément comme une rampe latérale. Avant l'activation de la MRF, la KF était probablement déjà une rampe latérale. Une grande partie du glissement latéral droit de la MRF est transmise au modèle en éventail de failles depuis le changement cinématique du Pliocène, ce modèle permettant la distribution du glissement vers la ceinture de plis et chevauchements par les terminaisons des failles décrochantes. La Formation Hormuz a facilité cette distribution du glissement et la migration vers le sud du front du Zagros. La géométrie et les relations géométriques et cinématiques du modèle en éventail avec la portion sud-est de la MRF suggèrent que la KF et les failles associées sont des failles de second ordre organisées comme une terminaison de type « queue de cheval » de la MRF (Authemayou et al., 2005). Cependant, ce modèle diffère des modèles classiques en raison d'un découplage latéral et vertical introduit par les évaporites de la Formation Hormuz, conduisant à des rotations dans le système.
