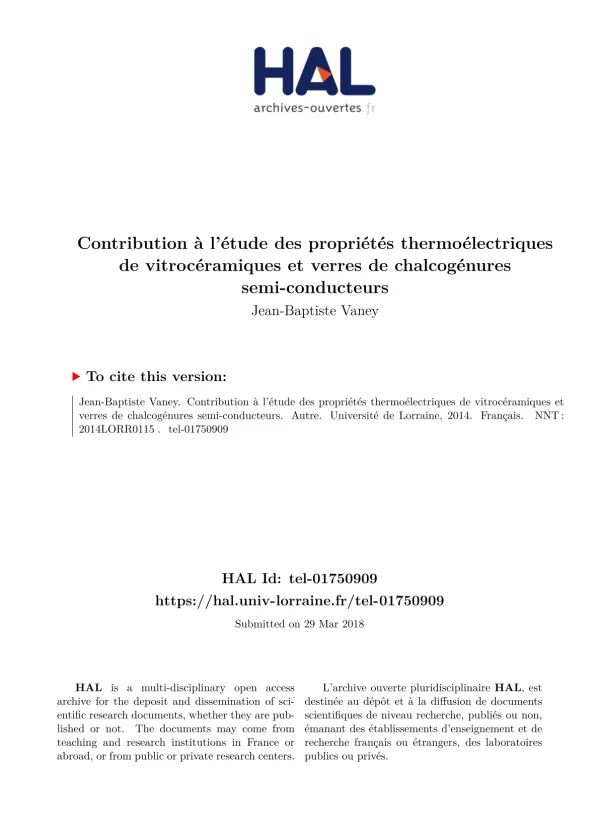
Étude des Propriétés Thermoélectriques des Vitrocéramiques et Verres de Chalcogénures
Informations sur le document
| Auteur | Jean-Baptiste Vaney |
| École | Université de Lorraine |
| Spécialité | Énergie, Mécanique et Matériaux (EMMA) |
| Type de document | Thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 11.39 MB |
- propriétés thermoélectriques
- vitrocéramiques
- chalcogénures semi-conducteurs
Résumé
I. Conductivité Thermique des Verres de Chalcogénures Mécanismes de Diffusion des Phonons
Cette section explore les mécanismes influençant la conductivité thermique des verres de chalcogénures. À basse température (T << θD, température de Debye), la conductivité varie selon une loi en T⁻³, principalement due à l'interaction des phonons de basse énergie avec les surfaces de l'échantillon. À haute température (T >> θD), la conductivité suit une loi en T⁻¹, dominée par les processus Umklapp (interactions phonon-phonon). La diffusion des phonons aux joints de grains, un mécanisme de type Rayleigh, est aussi crucial, affectant particulièrement les phonons de basse fréquence et offrant une voie pour diminuer la conductivité thermique sans impacter significativement les propriétés électriques, jusqu'à des tailles de grains de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres. Des techniques de nanostructuration et de frittage comme le Spark Plasma Sintering (SPS) permettent de contrôler la microstructure et d'optimiser davantage la conductivité thermique.
1. Comportement de la conductivité thermique à basse température
A basse température, soit T << θD (température de Debye), la conductivité thermique varie proportionnellement à T⁻³. Cette dépendance est expliquée par la vitesse constante des phonons et leur libre parcours moyen (l) également constant. À ces basses températures, seuls les phonons de basse énergie (longueurs d'onde élevées) sont excités et interagissent principalement avec les surfaces de l'échantillon. Ce comportement contraste avec celui observé à haute température, où les mécanismes de diffusion sont différents.
2. Comportement de la conductivité thermique à haute température
En revanche, à haute température (T >> θD), la chaleur spécifique (Cv) tend vers la valeur classique de 3R, prédite par la loi de Dulong et Petit. La vitesse de groupe des phonons reste constante, et donc la conductivité thermique (κ) dépend exclusivement du libre parcours moyen (l). À haute température, la diffusion des phonons est dominée par les processus Umklapp, des interactions phonon-phonon qui ne conservent pas la quasi-impulsion. Comme le nombre de phonons augmente linéairement avec la température, la probabilité d'interaction phonon-phonon est proportionnelle à T, ce qui conduit à un libre parcours moyen variant comme l'inverse de la température (l ∝ T⁻¹). Ainsi, la conductivité thermique de réseau suit une loi en T⁻¹.
3. Diminution de la conductivité thermique par diffusion aux joints de grains
La diffusion des phonons aux joints de grains est un autre mécanisme important, de type diffusion Rayleigh, dépendant fortement de la fréquence des phonons (ω⁴). Il est particulièrement efficace pour les phonons de haute fréquence mais moins pour ceux de basse fréquence. Or, ces phonons de basse fréquence, prédominants autour et au-dessus de la température de Debye, sont fortement affectés par les joints de grains. Ce mécanisme permet de réduire significativement la conductivité thermique dans les solutions solides. L'intérêt de cette approche réside dans le fait que les propriétés électriques du matériau restent quasiment inchangées jusqu'à des tailles de grains de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres, limite au-delà de laquelle on atteint le libre parcours moyen des porteurs de charge. Des études sur des composés comme PbTe ont démontré une réduction de la conductivité thermique de réseau d'environ 12%. Le contrôle de la microstructure, notamment par des techniques de synthèse de nanopoudres et des procédés de densification modernes comme le Spark Plasma Sintering (SPS), permet une optimisation poussée de la conductivité thermique, même si à très petite taille de grains, des effets électroniques et thermoélectriques peuvent aussi apparaitre.
II. Propriétés Thermoélectriques des Verres de Chalcogénures
Cette partie examine les propriétés thermoélectriques des verres de chalcogénures, notamment leur pouvoir thermoélectrique élevé (généralement positif, indiquant une conduction majoritaire par trous) et sa relation avec la structure de bandes. La présence de défauts intrinsèques, tels que les paires de valence alternées (VAP), influence fortement le type de porteurs majoritaires et le coefficient Seebeck. L'effet du chalcogène (S, Se, Te) sur les propriétés de transport électrique (résistivité et pouvoir thermoélectrique) est discuté, ainsi que l'impact du dopage avec des métaux comme Cu ou Ag. La substitution de Cu par Ag, par exemple, modifie les énergies d'activation de la conductivité et la mobilité, affectant ainsi le facteur de mérite ZT.
1. Pouvoir Thermoélectrique Élevé et Conduction par Trous
Les verres de chalcogénures se distinguent par un pouvoir thermoélectrique particulièrement élevé, supérieur à 1 mV/K à température ambiante pour la plupart des composés étudiés (alors que peu de matériaux dépassent cette valeur). Ce pouvoir thermoélectrique est, dans la majorité des cas, positif. Cette caractéristique indique une conduction électronique majoritairement véhiculée par des trous. La structure de bandes électroniques, déterminée près du niveau de Fermi, explique ces observations. La présence de défauts intrinsèques au sein du verre joue un rôle crucial dans la définition de cette structure de bandes et donc des propriétés thermoélectriques.
2. Rôle des Défauts et des Paires de Valence Alternées VAP
Le signe positif du pouvoir thermoélectrique dans les verres de chalcogénures, témoignant d'une conduction majoritaire par trous, s'explique par la présence de défauts. Les paires de valence alternées (VAP) sont mises en avant. Par exemple, un défaut C³⁺ peut mener à la production d'un défaut C³⁰ et d'un trou dans la bande de valence, réaction irréversible. À l'inverse, un défaut C⁻¹ produit un électron dans la bande de conduction, réaction réversible. L'instabilité du défaut C³⁰ favorise la création de trous, expliquant la prédominance de la conduction par trous. Même les défauts C¹⁰, bien qu'instables, contribuent à cette conduction par leur électron non apparié dans la bande de paires non liantes. Ces défauts affectent la densité d'états près du niveau de Fermi, influençant directement le pouvoir thermoélectrique.
3. Influence du Chalcogène et du Dopage
La nature du chalcogène (S, Se, Te) affecte significativement les propriétés électriques des verres de chalcogénures. En descendant dans la table périodique, les liaisons chalcogènes perdent leur caractère covalent au profit d'un caractère métallique. Cette transition influence la stabilité du verre et sa résistivité. Les verres plus covalents sont généralement plus stables et plus résistifs. Le dopage métallique (Cu, Ag) modifie également le pouvoir thermoélectrique. Dans les systèmes Cu-As-Te ou Cu-Ge-Te, le pouvoir thermoélectrique diminue de manière monotone avec l'augmentation du dopant, une observation liée à la diminution de l'énergie d'activation et de la mobilité. Cependant, certains métaux de transition peuvent agir comme des double-accepteurs, décalant le niveau de Fermi et modifiant le pouvoir thermoélectrique, comme observé pour le Mn dans certains verres.
4. Substitution du Cuivre par l Argent
L'argent (Ag), situé une période en dessous du cuivre (Cu) dans le tableau périodique, est étudié comme substitut dans les verres Cu₂₅As₁₅Te₆₀. L'objectif est d'ajuster les propriétés thermoélectriques. Si l'Ag n'améliore pas la stabilité thermique et les propriétés électriques de manière significative par rapport au Cu, son effet sur l'augmentation du pouvoir thermoélectrique, différent de celui du Cu, est étudié. La substitution de Cu par Ag dans le système Cu₂₅₋ₓAgₓAs₁₅Te₆₀ (x = 5, 10) est analysée. La variation de la température de transition vitreuse (Tg) et du critère de stabilité thermique (ΔT) est étudiée en fonction de la teneur en Ag, ainsi que l'impact sur les propriétés de transport électronique. Un transport ionique associé à l'Ag est suspecté.
III. Méthodes de Synthèse et de Caractérisation
Cette section détaille les méthodes de synthèse des verres de chalcogénures, notamment la trempe classique et l'ultra-trempe (laminage), réalisées à l'Institut Charles Gerhardt de Montpellier. L'Institut Charles Gerhardt est un acteur important pour la synthèse des verres par trempe classique (avec des limitations de diamètre du tube) et ultra-trempe sur roue (vitesse radiale variable entre 10 et 50 m/s). Le Spark Plasma Sintering (SPS) est présenté comme une technique rapide de densification des poudres. Des techniques de caractérisation comme la diffraction des rayons X (DRX) pour vérifier l'état amorphe, l'analyse calorimétrique différentielle (DSC), et l'analyse flash laser (LFA) pour déterminer la chaleur spécifique et la diffusivité thermique, sont décrites. L'utilisation d'un dispositif LFA Netzsch à l'IJL-Nancy est mentionnée.
1. Synthèse par Trempe Classique
La synthèse de verres par trempe classique consiste à fondre des éléments purs en quantité stœchiométrique dans une ampoule de quartz scellée sous vide. L'ampoule est ensuite trempée dans de l'eau froide pour un refroidissement rapide. Cette méthode, bien que produisant un lingot massif, présente des inconvénients liés au diamètre du tube, limitant la capacité de vitrification. Les synthèses par trempe classique décrites dans ce travail ont été réalisées à l'Institut Charles Gerhardt à Montpellier. Une procédure plus détaillée inclut l'éjection d'un filet de liquide en fusion sur une roue en cuivre tournant à une vitesse radiale contrôlée (10 à 50 m/s), permettant la fabrication de paillettes ou de ruban. L'utilisation d'un four à induction est mentionnée, avec des difficultés pour chauffer certains matériaux très résistifs, problème pallié par recristallisation. Des creusets en quartz sont utilisés, avec un trou de sortie de diamètre variable (0.5, 0.8 ou 1 mm) percé à l'aide d'une perceuse à ultrason.
2. Synthèse par Ultra trempe Laminage
Une seconde méthode d'ultra-trempe, également utilisée à Montpellier, implique le laminage du liquide en fusion entre deux roues en cuivre de plus petit diamètre (~ 2 cm) que dans la méthode précédente. Le dispositif est placé dans une boîte à gants sous atmosphère inerte d'argon. Le matériau est chauffé dans un creuset, situé entre les deux roues espacées de moins d'un millimètre. Cette configuration permet un refroidissement efficace malgré des vitesses de rotation plus faibles (quelques m/s). Un four à induction, plus adapté aux verres résistifs grâce à un sur-creuset en graphite, est utilisé. La surpression est contrôlée manuellement à l'aide d'un tuyau d'argon. Les paillettes obtenues ont une épaisseur comprise entre 45 et ... micromètres.
3. Densification par Spark Plasma Sintering SPS
Contrairement au pressage à chaud, le Spark Plasma Sintering (SPS) chauffe directement la poudre par effet Joule pour la densifier. Bien que le concept date des années 1930, le procédé SPS a été réellement développé à partir des années ... par le groupe d'Inoue. Cette technique est extrêmement rapide, le processus se déroulant en quelques minutes contre plusieurs heures pour le pressage à chaud. Cette rapidité permet de préserver des microstructures fines, idéale pour les matériaux nanostructurés. Dans le contexte de cette étude, le temps de chauffage court limite la cristallisation du verre. La densification est réalisée dans une chambre SPS sous vide, avec un programme de température en deux étapes: une montée rapide (~ ... K/min) suivie d'une seconde partie plus lente. La température de frittage est optimisée autour de Tg + 10 ou 15°C (en tenant compte de la variation de Tg avec la pression). Une isotherme à plus basse température finalise le frittage, jouant le rôle d'un recuit.
4. Caractérisation par Diffraction des Rayons X DRX et autres techniques
La diffraction des rayons X (DRX) est utilisée pour vérifier l'état vitreux des composés. Un diffractogramme de matériau cristallin présente des pics fins et caractéristiques, contrairement à celui d'un matériau vitreux qui montre des formes aplaties et peu marquées. Un verre partiellement cristallisé présentera un mélange des deux types de signaux. Cependant, la DRX ne permet pas la détection de très faibles quantités de phase cristalline ni des domaines nanométriques. D'autres méthodes de caractérisation sont utilisées: la mesure de la masse volumique (ρ) et de la chaleur spécifique massique à pression constante (Cp) est nécessaire pour le calcul de la diffusivité thermique. La méthode flash, utilisant un laser ou une lampe flash, excite thermiquement un échantillon cylindrique, permettant la détermination de la diffusivité thermique. Les modèles de Cowan et Cape-Lehman, incluant des corrections pour la forme de l'impulsion d'énergie, sont utilisés pour l'analyse des données. Un dispositif LFA Netzsch est utilisé à l’IJL-Nancy, avec des porte-échantillons de Ø=10 mm. Les surfaces sont polies avec précision et recouvertes d'une couche de graphite pour limiter les effets de réflexion. La méthode ASTM E 1269 a été employée pour l’extraction de la chaleur spécifique (Cp).
IV. Etude des Verres Cu As Te et leurs Dérivés
L'étude se concentre sur les verres Cu-As-Te, analysant l'influence de la composition sur la stabilité thermique, la conductivité électrique, et le facteur ZT. La cristallisation partielle des matériaux riches en Cu est observée, avec l'identification de phases spécifiques (As₂Te₃, CuTe, Cu₇Te₅). L'analyse par diffraction des neutrons à l'Institut Laue Langevin de Grenoble apporte des informations supplémentaires sur l'évolution de la stabilité thermique. L'impact de la substitution de Cu par Ag est examiné, montrant une modification des propriétés de transport électronique liée aux énergies d'activation et à la mobilité. D'autres systèmes dérivés du ternaire Cu-As-Te sont brièvement étudiés pour élargir le champ des possibles.
1. Etude du Domaine Vitreux Trempe Classique et Ultra trempe
Cette section vise à confirmer le domaine vitreux établi par Borisova [95] pour les verres de chalcogénures. Plusieurs compositions, avec des concentrations en Tellure (Te) constantes à 45%, 55% et 60%, ont été testées, en privilégiant des compositions riches en Cuivre (Cu) pour favoriser la conduction électrique. Des spectres de diffraction X pour la ligne CuₓAs₄₅₋ₓTe₅₅ confirment la cristallisation partielle des matériaux au-dessus de x = 25, avec une cristallisation violente au-delà de cette valeur. Quatre phases différentes sont identifiées: deux phases allotropiques de As₂Te₃ (monoclinique et rhomboédrique métastable) et deux tellurures de cuivre (CuTe orthorhombique et Cu₇Te₅ hexagonal). L'évolution des proportions de phases cristallisées reflète l'évolution des environnements de conformation des éléments. La topologie du réseau (2D, 1D ou 3D) est liée à la connectivité des atomes et affecte les propriétés du matériau, comme la température de transition vitreuse.
2. Caractérisation Structurale des Verres Cu As Te
Des simulations structurales, concordant avec des données expérimentales (diffraction des neutrons et des rayons X, EXAFS), fournissent des informations sur l'ordre à courte et moyenne portée dans les verres Cu-As-Te en fonction de la teneur en Cu. Le facteur de structure S(k) révèle des tendances sur l'ordre à courte portée (premières et deuxièmes sphères de coordination) et l'ordre à moyenne portée (distance d'environ 4-6 Å). Le pré-pic (ou FSDP) du facteur de structure indique l'ordre à moyenne portée. Le décalage des pics vers la gauche dans l'espace réciproque (Å⁻¹) correspond à un allongement des liaisons dans l'espace réel (Å). L'analyse révèle une cristallisation à environ 140°C pour certaines compositions, ce qui dégrade fortement la stabilité thermique (ΔT). Des mesures de diffraction des neutrons en température, effectuées à l'Institut Laue Langevin (ILL) à Grenoble, permettent une analyse fine de l'évolution de la stabilité thermique des verres selon leur composition (CuₓAs₄₀₋ₓTe₆₀ pour x=20 et 24).
3. Influence de la Composition et du Facteur de Mèrite ZT
L'augmentation de la teneur en Cu dans les verres CuₓAs₄₀₋ₓTe₆₀ et CuₓAs₅₅₋ₓTe₄₅ tend à améliorer le facteur de mérite ZT, mais pas toujours de manière monotone. À 30% de Cu, ZT diminue en raison d'une forte détérioration du coefficient Seebeck. La conductivité thermique varie peu entre les échantillons, suggérant que l’état vitreux est le facteur déterminant des propriétés. Les propriétés de transport électrique sont donc plus déterminantes que la composition elle-même pour la performance thermoélectrique. Les valeurs de ZT restent basses (<0.1 même à 375K) pour ces verres, possiblement à cause de la présence de nanocristallites invisibles à la DRX pour les compositions les plus chargées en Cu. La comparaison des résultats avec des composés standards à base de Bi₂Te₃ (ZT proche de 1 à température ambiante) souligne la marge de progression.
4. Substitutions et Autres Systèmes Vitreux
L'étude explore la substitution du Cu par l'Ag dans les verres Cu₂₅₋ₓAgₓAs₁₅Te₆₀. L'Ag, bien que moins performant que le Cu en termes de propriétés électriques et de stabilité thermique, offre un effet différent sur le pouvoir thermoélectrique. L'analyse de l'évolution de Tg et ΔT en fonction de la teneur en Ag est présentée. D'autres systèmes vitreux dérivés du ternaire Cu-As-Te sont étudiés brièvement. Le Cuivre est considéré comme un élément approprié pour diminuer la résistivité électrique tout en conservant une stabilité thermique satisfaisante. L'étude de systèmes dérivés du ternaire Cu-As-Te vise à identifier de nouvelles compositions prometteuses pour la thermoélectricité, en modifiant l'élément non-chalcogène tout en maintenant une quantité importante de Cuivre.
V. Vitrocéramiques et Composites Thermoélectriques
Cette section explore l'amélioration des propriétés thermoélectriques par vitrocéramisation et la création de composites. L'étude de la vitrocéramisation du verre Cu₁₅As₃₀Te₅₅ révèle la formation de phases cristallines et leur impact sur la conductivité électrique et le facteur ZT. Le rôle de la taille des grains et de la percolation de la phase cristalline est souligné. Différentes compositions sont testées (Cu-As-Se-Te) en vue d'optimiser les propriétés. Un modèle prédictif basé sur la théorie des milieux effectifs (TME) est utilisé pour estimer les propriétés des composites (Bi0,4Sb1,6Te3-Si10As15Te75). L'objectif final est d'améliorer le facteur ZT, en particulier proche de la température ambiante.
1. Vitrocéramisation Choix du Verre et Processus SPS
L'étude explore l'amélioration des propriétés thermoélectriques par vitrocéramisation, un processus consistant à cristalliser partiellement un verre. Le choix du verre initial est crucial : il doit être facile à fabriquer de manière reproductible, sans nanocristallites dans la matrice vitreuse (pour éviter de court-circuiter l'étape de nucléation), et présenter une stabilité thermique modérée. Le composé Cu₁₅As₃₀Te₅₅, avec une stabilité thermique ΔT d'environ ... K, est sélectionné pour cette étude. La vitrocéramisation est réalisée par Spark Plasma Sintering (SPS). L'utilisation du SPS est motivée par sa rapidité, mais une stabilité thermique trop élevée peut conduire à une mauvaise densification ou à la fuite du verre hors de la matrice à haute température. La méthode SPS est employée pour réaliser la vitrocéramisation de différents verres, mais si le verre ne cristallise pas suffisamment vite, la viscosité du matériau diminue rapidement avec la température, et le verre peut couler hors de la matrice SPS, non hermétique.
2. Etude de la Vitrocéramisation du Cu₁₅As₃₀Te₅₅
La vitrocéramisation du verre Cu₁₅As₃₀Te₅₅ conduit à la formation de deux phases cristallines allotropiques de As₂Te₃: une phase monoclinique (α-As₂Te₃) et une phase rhomboédrique métastable (β-As₂Te₃). La phase métastable β-As₂Te₃, stable sous pression, est expliquée par la présence de contraintes inhérentes à l'état vitreux, dirigeant initialement la cristallisation vers cette phase avant une transition vers la phase α-As₂Te₃. La cristallisation est non congruente et rapide, débutant aux surfaces de contact entre grains vitreux déformés sous pression au-dessus de Tg. L'observation de dendrites de taille micrométrique à dizaine de microns montre une cristallisation progressive de l'extérieur vers l'intérieur des grains vitreux. L'analyse EDS confirme la composition des phases, montrant l'absence de Cu et un enrichissement en Te dans les dendrites. La composition non stœchiométrique des cristaux, ainsi que la supposée large gamme d'existence du composé As₂₋ₓTe₃₊ₓ (-0.5 < x < 0.5), influence les propriétés électriques du matériau.
3. Amélioration du Facteur ZT par Augmentation de la Granulométrie
Des expériences visent à améliorer le facteur ZT en augmentant la granulométrie de la poudre de verre Cu₁₅As₃₀Te₅₅ par broyage mécanique. Un broyage en jarre d'acier inox à ... rpm pendant ... minutes, avec un ratio billes/poudre de ..., produit une poudre homogène avec des grains de taille inférieure à ... µm. La vitrocéramisation par SPS à ... MPa est stoppée à ... K en raison d'une densification rapide et d'une cristallisation rapide qui se traduit par un déplacement des pistons de la presse. La caractérisation de la pastille (diffractogramme et MEB) montre des agglomérats de phase cristalline orientés et des grains micrométriques participant à la percolation. Cette approche permet d'explorer l'impact de la microstructure sur les propriétés thermoélectriques.
4. Vitrocéramisation dans d autres systèmes et Conclusion
Pour optimiser la vitrocéramisation, deux alternatives sont étudiées: augmenter la teneur en Cu dans le système CuₓAs₄₅₋ₓTe₅₅ et explorer le système Cu₃₀As₁₀Te₆₀₋ᵧSeᵧ issu des études du chapitre IV, en visant la cristallisation de phases Cu₂Se. L'étude de la vitrocéramisation du système CuₓAs₄₅₋ₓTe₅₅ montre que la résistivité électrique diminue fortement avec la cristallisation de Cu₂₇₂Te₂, mais une transition de type de porteurs de charge est observée. La cristallisation d'une phase de type n est destructrice pour le facteur de puissance. En conclusion, la diminution de la résistivité électrique par vitrocéramisation améliore généralement les propriétés thermoélectriques, à condition que la phase cristallisée présente un coefficient Seebeck suffisamment élevé. La cristallisation d'une phase trop métallique est défavorable pour le facteur de mérite ZT.
5. Modèle Prédictif pour les Composites
La modélisation des propriétés thermoélectriques des composites est abordée à l'aide de la théorie des milieux effectifs (TME), introduite par Bruggeman et appliquée par Landauer à la conductivité électrique et par Odelevskii à la conductivité thermique. Le modèle permet de prédire le facteur ZT en fonction du ratio des propriétés des phases constituantes (conductivité thermique, pouvoir thermoélectrique, résistivité) et de la fraction volumique de la phase cristalline. L'analyse montre qu'au-dessus du seuil de percolation, seules les propriétés de la phase cristalline sont déterminantes. L'étude du composite Bi₀.₄Sb₁.₆Te₃-Si₁₀As₁₅Te₇₅ (φc = 40%) montre une distribution multi-échelle de la phase cristalline, avec des agglomérats de taille micrométrique et une texturation, influençant les propriétés de percolation.
