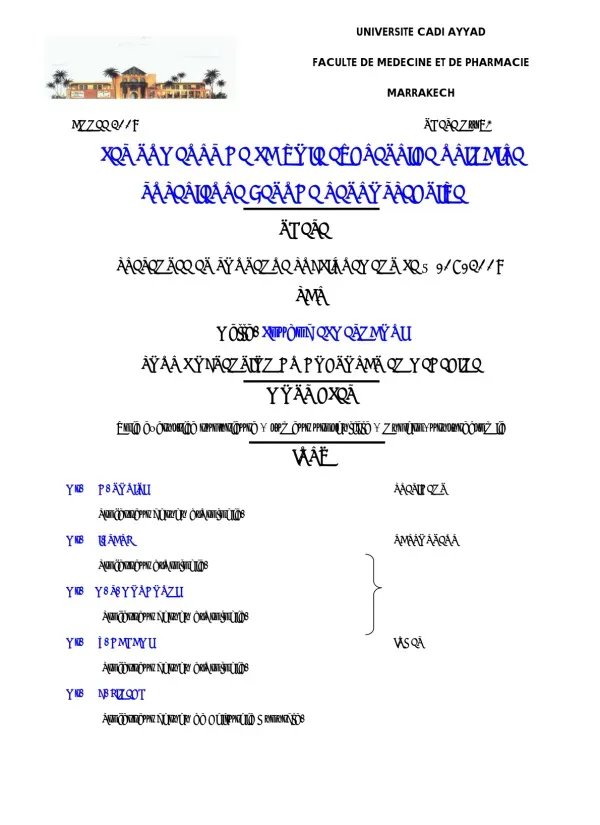
Étude des Tumeurs de la Voie Excrétrice Urinaire Supérieure
Informations sur le document
| Auteur | Melle. Loubna Elmesnaoui |
| École | Unspecified University |
| Spécialité | Médecine |
| Type de document | Thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 2.94 MB |
- tumeurs urinaires
- néphro-urétérectomie
- médecine
Résumé
I.Anatomie et Physiologie des Voies Excrétrices Urinaires Supérieures
Cette section décrit l'anatomie du bassinet et de l'uretère, soulignant leur rôle dans le transport de l'urine. L'importance des propriétés viscoélastiques de la vessie et de l'uretère pour maintenir une pression basse et protéger le rein, notamment en cas d'hyperdiurèse, est mise en avant. Le rôle du système nerveux autonome dans la régulation des contractions urétérales est également abordé, bien que mal connu.
1. Rapports anatomiques du bassinet et de l uretère
Le texte détaille la position anatomique du bassinet rénal, précisant qu'il repose sur l'extrémité inférieure du hile, contre la lèvre postérieure, et se projette à hauteur de l'apophyse transverse de L2. Ses rapports anatomiques sont décrits : en arrière, le muscle psoas, et en avant, la deuxième portion du duodénum à droite et la queue du pancréas à gauche, séparés du bassinet par la graisse pérénale et les fascias périrénaux. Cette description précise permet de comprendre l'environnement anatomique du bassinet et sa relation avec les structures adjacentes, information essentielle pour les interventions chirurgicales et la compréhension de la propagation tumorale potentielle. Le document souligne l'importance du transport de l'urine, estimant qu'avec une diurèse moyenne de 1,5 litre/24h, chaque uretère doit transporter environ 0,5 ml/min, sous une pression inférieure à 10 cm d'eau en dehors des contractions péristaltiques. L'activité des cellules interstitielles myoblastiques, agissant comme un « pacemaker », est évoquée comme le mécanisme régissant l'onde contractile, plus présente au niveau de la jonction pyélocalicielle.
2. Propriétés viscoélastiques et protection rénale
L'importance des propriétés viscoélastiques de la vessie et de l'uretère est mise en évidence. Ces propriétés permettent à la vessie de maintenir une pression basse (inférieure à 15 cm d'eau) lors de son remplissage (compliance), assurant une fonction de réservoir efficace. Le texte souligne que lorsque la pression dépasse 40 cm d'eau, l'uretère est incapable de propulser l'urine dans la vessie, ce qui met en lumière un seuil critique fonctionnel. L'uretère, grâce à ses propriétés viscoélastiques, absorbe les variations de volume urinaire sans modification significative de sa pression interne. Ce mécanisme protecteur est crucial, en particulier en cas d'hyperdiurèse ou d'obstruction, préservant le rein de pressions excessives. Le maintien d'une pression intra-urétérale stable grâce à cette viscoélasticité est un aspect physiologique fondamental pour la fonction rénale et la prévention des dommages rénaux.
3. Rôle du système nerveux autonome
Le rôle du système nerveux dans le fonctionnement des voies excrétrices urinaires supérieures (VES) est abordé, bien que son action ne soit pas parfaitement connue. La présence de fibres nerveuses et de récepteurs cholinergiques et adrénergiques dans l'uretère suggère l'influence du système nerveux autonome, en particulier en situation d'hyperdiurèse. Le texte propose une hypothèse selon laquelle l'augmentation de la fréquence des contractions urétérales en hyperdiurèse serait un mécanisme d'adaptation sympathique, tandis que l'augmentation de l'amplitude des contractions pourrait être un phénomène purement musculaire. Cette section souligne le manque de connaissances approfondies sur le rôle précis du système nerveux dans la régulation du transport urinaire, ouvrant ainsi des perspectives de recherches futures sur ce domaine.
II.Diagnostic des Tumeurs des Voies Excrétrices Urinaires Supérieures TVES
Le diagnostic des TVES, souvent des carcinomes urothéliaux, pose des défis. L'hématurie est un symptôme majeur. L'uroscanner est l'examen de référence pour le diagnostic positif et la stadification, surpassant l'urographie intraveineuse (UIV), notamment en cas de rein muet. La cystoscopie permet de détecter des lésions associées au niveau vésical. L'analyse cytologique des urines peut être utile, particulièrement pour les tumeurs de haut grade, mais sa sensibilité est moins élevée pour les tumeurs de bas grade. Des techniques endoscopiques, comme l'urétéroscopie, permettent des biopsies et parfois des résections.
1. Symptômes et premiers examens
Le diagnostic des tumeurs des voies excrétrices urinaires supérieures (TVES) commence souvent par la détection de symptômes cliniques. L'hématurie, ou présence de sang dans les urines, est le symptôme principal, mentionné dans 83% des cas dans une étude citée. La douleur lombaire est un autre symptôme fréquent (72%), tandis que des signes irritatifs vésicaux sont présents dans 33% des cas. L'échographie est un premier examen utilisé pour la suspicion de TVES, mais sa sensibilité est limitée (22% de suspicion dans l'étude citée). L'étude souligne la difficulté du diagnostic précoce, ce qui met en évidence la nécessité de méthodes diagnostiques plus performantes et la vigilance face aux symptômes récurrents.
2. Imagerie médicale Uroscanner et UIV
L'imagerie médicale joue un rôle crucial dans le diagnostic des TVES. L'uroscanner est présenté comme l'examen de référence, surpassant l'urographie intraveineuse (UIV) en termes de précision et de capacité à visualiser l'extension tumorale. L'uroscanner permet un diagnostic positif et précise l'extension locorégionale et à distance de la tumeur. L'UIV, bien qu'utilisée pendant longtemps, présente des limites, notamment en cas de « rein muet » où le rein ne secrète pas de produit de contraste. Des signes radiologiques caractéristiques sont décrits : dilatation sous-jacente en « entonnoir » pour les localisations urétérales (signe de Bergman), aspects d'amputation calicielle ou de « calice fantôme » pour les localisations calicielles. La difficulté de différencier une volumineuse lésion pyélocalicielle d'une tumeur rénale est également soulignée.
3. Cystoscopie et urétéroscopie exploration endoscopique
La cystoscopie, un examen endoscopique de la vessie, est essentielle pour détecter des lésions vésicales associées aux TVES, fréquentes dans près de la moitié des cas selon l'étude citée. L'urétéroscopie, permettant une exploration directe des uretères, est une technique plus invasive mais fournit des informations cruciales sur la nature et l'extension de la tumeur. La visibilité est un point important : les urines hématiques peuvent réduire la visibilité lors de l'urétéroscopie, surtout avec les appareils souples. Les prélèvements pour analyses cytologiques et histologiques sont obtenus par lavage vésical, urines mictionnelles, ou directement lors de l'endoscopie. La voie percutanée, par pyélographie antérograde, est envisagée pour le prélèvement, mais le risque de dissémination tumorale est mentionné. La ponction-aspiration à l’aiguille fine, sous contrôle échographique ou tomodensitométrique, est possible pour les volumineuses masses tumorales.
4. Cytologie urinaire sensibilité et limites
L'analyse cytologique des urines est une méthode complémentaire au diagnostic des TVES. Sa sensibilité varie en fonction du grade de la tumeur. Pour les tumeurs de haut grade (grades 2 et 3), la cytologie urinaire est souvent positive (85 à 100 %), tandis que pour les tumeurs de bas grade (grade 1), la sensibilité est significativement plus faible (10 à 40 %). Des études citées confirment cette corrélation entre le grade tumoral et la positivité de la cytologie. Les prélèvements pour l'étude cytologique sont obtenus par lavage et brossage urétéral à l'aide d'une solution saline isotonique. La fiabilité de la méthode dépend grandement de la qualité des fragments prélevés. Des complications mineures comme des douleurs transitoires ou de petites hématuries peuvent survenir, mais des infections sévères ou des hémorragies importantes restent rares.
III.Classification et Caractéristiques des TVES
Les TVES sont souvent multifocales (30% des cas), pouvant impliquer plusieurs sites de l'arbre urinaire, avec une atteinte vésicale fréquente. La classification TNM (OMS et UICC) et la classification OMS 2004, intégrant des données moléculaires, sont utilisées pour la stadification. Macroscopiquement, les tumeurs peuvent être végétantes ou infiltrantes, avec des aspects variables à l'imagerie. Le carcinome transitionnel est le type histologique le plus fréquent, suivi du carcinome épidermoïde, de pronostic moins favorable.
1. Multifocalité et extension tumorale
Les tumeurs des voies excrétrices urinaires supérieures (TVES) se caractérisent par une multifocalité significative, touchant 30 % des cas selon le document. Cette multifocalité se manifeste par un développement synchrone ou métachrone de la tumeur sur plusieurs sites de l'arbre urinaire. L'atteinte vésicale est particulièrement fréquente, observée dans la moitié des cas, notamment en région péri-orificielle. L'extension tumorale diffère selon la localisation : l'extension des tumeurs urétérales aux couches profondes est plus rapide que celle des tumeurs pyéliques, en raison de la minceur de la paroi urétérale. Une fois les couches musculaires et adventitielles dépassées, la tumeur envahit le tissu cellulo-adipeux rétropéritonéal, pouvant adhérer aux organes voisins (plexus lombaire, veine cave inférieure, vaisseaux iliaques, vessie, rectum). L'hémorragie, souvent abondante et parfois responsable d'un choc hémorragique ou d'une rétention aiguë d'urine, est un élément important à considérer. Dans certains cas, l'hémorragie peut être minime voire microscopique.
2. Aspects macroscopiques et histologiques
Macroscopiquement, les TVES se présentent sous forme de nodules saillants dans la lumière de la voie excrétrice ou infiltrant la paroi de façon diffuse. Elles ont une consistance dure, une taille variable (1 à 2 cm en général, mais parfois beaucoup plus volumineuses), et une couleur blanchâtre. La surface tumorale montre fréquemment des ulcérations à bords anfractueux, avec un fond bourgeonnant et hémorragique. Histologiquement, le carcinome transitionnel (ou épithélioma paramalpighien) est le type tumoral le plus répandu parmi les tumeurs épithéliales non papillaires (9 %), caractérisé par des cellules de haut grade de malignité et une croissance infiltrante constante. Le carcinome épidermoïde (ou épithélioma malpighien spino-cellulaire métaplasique), observé surtout au niveau du bassinet, représente 5,5 % des cas et est associé à un mauvais pronostic, souvent diagnostiqué tardivement. Le document mentionne également des localisations pyélo-urétérales d'origine lymphomateuse.
3. Classifications des TVES
Depuis la découverte du cystoscope en 1886, plusieurs classifications des TVES ont été proposées. Initialement descriptives, elles se sont progressivement enrichies de critères pronostiques. La classification TNM, adoptée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l'Union Internationale Contre le Cancer (UICC), est la plus utilisée. Elle prend en compte le grade de différenciation cellulaire et le stade d'extension tumorale, des paramètres clés pour l'évaluation du pronostic. Plus récemment, la classification OMS 2004 intègre des données moléculaires pour une meilleure distinction des différents groupes tumoraux et une appréciation plus précise du potentiel de progression. L'évolution des classifications reflète les progrès dans la connaissance de ces tumeurs et l'amélioration des outils diagnostiques et thérapeutiques. L'intégration de la biologie moléculaire permet une meilleure compréhension de la progression tumorale et une meilleure stratification des patients.
IV.Traitement des TVES
Le traitement des TVES dépend du stade et du grade tumoral. La néphro-urétérectomie, souvent par voie lombaire ou iliaque, est l'intervention chirurgicale principale. Des techniques moins invasives, comme la néphro-urétérectomie laparoscopique, sont de plus en plus utilisées pour les tumeurs superficielles et de bas grade. Pour les tumeurs superficielles et non invasives, une urétérectomie segmentaire avec urétéro-urétérostomie ou une résection endoscopique peuvent être envisagées. La chimiothérapie, notamment avec des régimes à base de cisplatine ou de carboplatine, et l’immunothérapie (BCG) peuvent être utilisées, selon le cas. La radiothérapie peut être proposée en adjuvant dans certains contextes.
1. Chirurgie Néphro urétérectomie et alternatives
Le traitement principal des TVES est la néphro-urétérectomie, une intervention chirurgicale impliquant l'ablation du rein et de l'uretère. Cette procédure est souvent réalisée par une double voie d'abord (lombaire et iliaque), comme illustré par une étude sur 18 patients où elle a été effectuée dans 73% des cas. Une approche laparoscopique est également mentionnée, avec une incidence de 6 % dans cette même étude, soulignant l'évolution vers des techniques moins invasives. Pour les tumeurs superficielles, non invasives (grades 1 et 2), une urétérectomie segmentaire avec urétéro-urétérostomie est envisagée si la taille de la lésion ne permet pas une résection ou fulguration endoscopique. L'étude mentionne la possibilité d'une substitution urétérale partielle ou totale par un segment iléal en cas d'exérèse de longs segments de l'uretère. Une simple néphrectomie a été pratiquée dans 11% des cas de l'étude citée, dans le contexte d'une pyonéphrose sur calcul rénal.
2. Approches endoscopiques urétéroscopie et abord percutané
Les approches endoscopiques jouent un rôle important, notamment pour les tumeurs superficielles. L'urétéroscopie permet une résection complète des tumeurs sessiles à l'aide de pinces froides, et des tumeurs pédiculées avec des pinces-paniers. La base d'implantation est traitée par électrocoagulation ou vaporisation laser holmium YAG. Un drainage urétéral est recommandé pour éviter l'œdème postopératoire. L'abord percutané est une autre option, indiqué pour les tumeurs volumineuses ou celles localisées au niveau du calice inférieur, mais il est de plus en plus supplanté par l'urétéroscopie grâce à l'amélioration des urétéroscopes flexibles. L'endoscopie rétrograde, bien que peu compliquée, peut entraîner des sténoses ou des fibroses urétérales (4 à 14 % d'incidence), généralement corrigibles par dilatation endoscopique. Une perforation de l'uretère ou des cavités pyélocalicielles est une complication potentielle (0 à 10,2 % d'incidence).
3. Chimiothérapie et immunothérapie
La chimiothérapie (CTH) et l'immunothérapie sont des options thérapeutiques complémentaires, notamment dans les cas de tumeurs avancées ou métastatiques. Le document mentionne l'utilisation de régimes chimiothérapiques, tels que le MVAC, qui a démontré une efficacité comparable aux traitements pour les tumeurs de la vessie, bien qu'avec une toxicité significative. Des alternatives moins toxiques, comme l'association carboplatine-paclitaxel ou la gemcitabine seule ou associée à la cisplatine, sont également évoquées. L'immunothérapie par BCG (Bacille de Calmette et Guérin) est présentée comme un traitement efficace pour réduire le taux de récidive des tumeurs urothéliales, surtout pour les grades 2 et 3. Avant le traitement au BCG, les urines doivent être stériles, et une pyélographie est réalisée pour vérifier l'absence d'extravasation. Les complications de la chimiothérapie incluent des effets gastro-intestinaux, des mycoses, une neurotoxicité et une altération de la fonction rénale.
4. Radiothérapie et curage ganglionnaire
La radiothérapie est évoquée comme une option adjuvante, notamment après une chirurgie pour les tumeurs de haut grade et/ou localement avancées. Des études rétrospectives suggèrent un bénéfice de la radiothérapie en termes de contrôle local (réduction des récidives à environ 10 %), mais sans impact significatif sur la survie globale. Le curage ganglionnaire, en complément de la néphro-urétérectomie, est discuté, mais les résultats montrent une inefficacité de cette procédure sur la survie des patients présentant un envahissement ganglionnaire, avec un développement fréquent de métastases à distance.
V.Résultats et Pronostic
La survie à 5 ans dépend fortement du stade et du grade de la tumeur. Elle est excellente pour les tumeurs superficielles traitées de manière conservatrice. Le risque de récidive locale est également corrélé au stade et au grade. Une étude rétrospective du CHU Mohammed VI à Marrakech (Janvier 2002 - Décembre 2008) sur 18 patients (12 hommes, 6 femmes, âge moyen 62 ans) a montré que le tabac était un facteur de risque majeur (50% des patients), avec une symptomatologie dominée par l'hématurie (83%) et la douleur lombaire (72%).
1. Survie à 5 ans et facteurs pronostiques
La survie à 5 ans après traitement des TVES est un indicateur pronostique clé. Le document mentionne que la survie à 5 ans est fortement corrélée au grade et au stade de la tumeur. Pour les tumeurs superficielles traitées de manière conservatrice, la survie à 5 ans est excellente. Des chiffres de survie à 5 ans sont cités pour des tumeurs superficielles traitées par différentes méthodes : 84 % pour la néphro-urétérectomie, 80,7 % pour l’urétéroscopie et 80 % pour l’abord percutané. Cependant, ce taux diminue à 47,3 % en cas de tumeur de haut grade ou invasive. L'indication opératoire influence également la survie : la chirurgie de principe présente un taux de survie plus élevé (80 %) que la chirurgie de nécessité (60 %). Le grade et le stade de la tumeur sont donc les facteurs pronostiques majeurs, influençant à la fois la survie et le risque de récidive locale.
2. Risque de récidive locale
Le risque de récidive locale est également étroitement lié au stade et au grade de la tumeur initiale. Pour les tumeurs pT1 et pT2, le risque est relativement faible (10 et 13 % respectivement). Pour les tumeurs de grade I et II, le risque de récidive locale est de 11 % et 9 % respectivement. En revanche, tous les patients présentant des tumeurs de grade III ont développé une récidive durant leur suivi. Il est important de noter qu'un taux de récidive locale pouvant atteindre 60 % a été observé, même pour les tumeurs de grade I, dans le cadre de la chirurgie rénale ouverte conservatrice. Le document souligne que, bien que corrélé au stade et au grade initial, le risque de récidive n'affecte pas directement la survie globale. Cette distinction est importante pour la gestion des patients après le traitement initial.
3. Étude de cas du CHU Mohammed VI de Marrakech
Une étude rétrospective menée au CHU Mohammed VI à Marrakech entre janvier 2002 et décembre 2008 sur 18 patients (12 hommes, 6 femmes, âge moyen de 62 ans) est présentée. Le délai moyen de diagnostic était de 30 mois. Le tabagisme est le principal facteur de risque identifié, présent chez 50 % des patients (nombre moyen de paquet-année : 28). L'hématurie (83 %), la douleur lombaire (72 %) et les signes irritatifs vésicaux (33 %) dominent la symptomatologie clinique. L'échographie a permis de suspecter une TVES dans 22 % des cas, tandis que l'uroscanner a confirmé le diagnostic dans 56 % des cas. L'urographie intraveineuse a révélé un rein muet chez 17 % des patients. La néphro-urétérectomie a été pratiquée chez 78 % des patients (73 % par voie lombaire et iliaque, 6 % par laparoscopie), tandis qu'une néphrectomie simple pour pyonéphrose a été effectuée dans 11 % des cas. Les tumeurs urétérales étaient les plus fréquentes (67 %), et le carcinome urothélial était le type histologique le plus commun (83 %).
