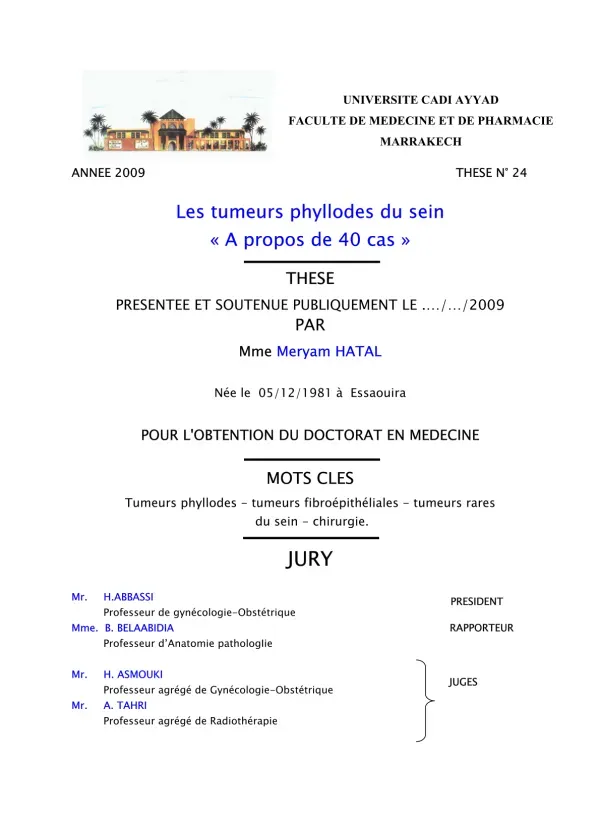
Étude des Tumeurs Phyllodes du Sein : Analyse de 40 Cas
Informations sur le document
| Auteur | Meryam Hatal |
| École | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech |
| Spécialité | Médecine |
| Lieu | Marrakech |
| Type de document | Thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 2.18 MB |
- tumeurs phyllodes
- médecine
- chirurgie
Résumé
I.Embryologie du Sein et Développement des Tumeurs Phyllodes
Le sein, d'origine ectodermique, se développe durant la vie embryonnaire. Sa formation est détaillée, mettant en contexte l'apparition ultérieure des tumeurs phyllodes. La description anatomique de la glande mammaire, incluant les réseaux lymphatiques, est essentielle pour comprendre la propagation potentielle des tumeurs phyllodes malignes. La description du développement de la glande mammaire jusqu'à la lactation met l'accent sur les influences hormonales potentielles dans le développement des tumeurs phyllodes, bien que le rôle hormonal reste incertain.
1. Développement embryonnaire du sein
Le texte décrit le développement embryonnaire du sein comme étant d'origine ectodermique, apparaissant dès la 5ème semaine de vie embryonnaire le long de la ligne mammaire primitive, s'étendant de la région axillaire à la région inguinale. L'épaississement progressif de cette ébauche se poursuit jusqu'à la 7ème semaine, la croissance s'arrêtant ensuite sauf au niveau thoracique, où se forment le mamelon et les canaux galactophores principaux. Cette description embryologique fournit le contexte anatomique fondamental pour la compréhension ultérieure de la localisation et du développement des tumeurs phyllodes. L'origine ectodermique du sein est un point clé de cette section, car elle établit la base tissulaire à partir de laquelle les structures mammaires, y compris celles concernées par les tumeurs phyllodes, se développent.
2. Anatomie de la glande mammaire et drainage lymphatique
La glande mammaire est constituée d'éléments glandulaires regroupés en lobes et enveloppés d'une capsule fibreuse. Sa circonférence antérieure est irrégulière, avec des saillies lamelleuses et des fosses adipeuses. La circonférence postérieure, quant à elle, est plane et repose sur les côtes et le grand pectoral. Un prolongement axillaire de la glande est également mentionné. Le drainage lymphatique est crucial ; les collecteurs convergent de la ligne médiane et de la partie antéro-inférieure du thorax vers l'aisselle. Le réseau lymphatique cutané communique avec les régions voisines (abdomen sus-ombilical, membre supérieur, cou), ce qui souligne les voies de propagation possibles, notamment dans le cas d'un cancer du sein ayant envahi la peau. La description précise du drainage lymphatique est essentielle pour comprendre le potentiel de dissémination des tumeurs phyllodes malignes.
3. Fonctionnement de la glande mammaire et influences hormonales
Le document explique brièvement le fonctionnement de la glande mammaire pendant la grossesse et la lactation. À la fin de la grossesse, les cellules alvéolaires se polarisent pour la production de lait, un processus inhibé par la progestérone jusqu'à l'accouchement. Après l'accouchement, la chute des hormones stéroïdes et l'augmentation de la prolactine stimulent la lactation et l'hypertrophie des cellules alvéolaires. L'ocytocine favorise l'éjection du lait. Bien que le texte mentionne la croissance rapide des tumeurs phyllodes à la puberté et une possible poussée évolutive en périménopause, l'influence hormonale sur le développement des tumeurs phyllodes reste une hypothèse non vérifiée, illustrée par l'absence d'administration hormonale chez une proportion significative de patientes dans certaines études.
II.Histoire et Classification des Tumeurs Phyllodes
Les premières descriptions des tumeurs phyllodes remontent à 1827. Johannes Müller, en 1838, a apporté une description détaillée, bien que le terme initial de « cystosarcomes phyllodes » soit trompeur. La classification histopronostique en trois catégories (bénigne, maligne, intermédiaire ou borderline) est abordée, ainsi que les différentes tentatives de nomenclature et les controverses persistent concernant les critères de distinction entre les différentes formes de tumeurs phyllodes. Le débat sur l'origine des tumeurs phyllodes (transformation d'un fibroadénome préexistant ou survenue de novo) est également présenté.
1. Premières descriptions et terminologie des tumeurs phyllodes
Les premières mentions de tumeurs phyllodes remontent à 1827 par Cumin et Chelius, qui les désignaient comme des « Hydatides kystiques ». Johannes Müller, en 1838, proposa une description plus précise, introduisant le terme de « cystosarcomes phyllodes », une terminologie jugée aujourd'hui trompeuse car ces tumeurs sont rarement kystiques et majoritairement bénignes. Cette première description met en lumière les difficultés historiques de classification et de terminologie entourant ces tumeurs. La description de Müller, bien que pionnière, met en évidence l’évolution de la compréhension de ces lésions, la terminologie initiale s’avérant finalement inadéquate compte tenu de la variabilité du comportement clinique. L'évolution de la terminologie reflète l'approfondissement des connaissances sur la nature et la diversité des tumeurs phyllodes.
2. Classification histopronostique et débats sur la nomenclature
En 1967, Nourris et Taylor proposent une classification histopronostique en trois catégories : bénigne, maligne et intermédiaire (borderline). Le terme « cystosarcome phyllode » étant source de confusion, des propositions de remplacement sont faites, notamment « fibroadénome cellulaire » et « fibrosarcome précanalaire » par Oberman, et « fibroadénome phyllode » et « cystosarcome phyllode » par Blichert-Toffin. Cependant, ces propositions ne prennent pas toujours en compte les formes intermédiaires. L’absence de consensus sur les critères de classification et les propositions de terminologie alternatives soulignent la complexité de ces tumeurs et les défis diagnostiques persistants. La classification en trois catégories reflète la nécessité d’un système permettant de tenir compte de la variabilité du pronostic, mais l’absence d’uniformité dans la définition des critères illustre les limites actuelles de la classification.
3. Théories sur l origine des tumeurs phyllodes
Deux principales théories tentent d'expliquer l'origine des tumeurs phyllodes. La première suppose une transformation à partir d'un fibroadénome préexistant, argumentée par la coexistence fréquente des deux types de tumeurs, leurs similitudes morphologiques, et la présence de plages ressemblant à des fibroadénomes dans certaines tumeurs phyllodes. Michaud propose une évolution temporelle : fibroadénome → tumeur phyllode → sarcome. La seconde théorie postule une survenue de novo dans l'unité lobulaire, par une prolifération fibroépithéliale simultanée. La production d'acide hyaluronique par les fibroblastes est mentionnée comme argument. L'existence de deux théories concurrentes reflète l'incertitude qui persiste concernant les mécanismes précis conduisant au développement des tumeurs phyllodes. Le débat sur l'origine des tumeurs, qu'elle soit une transformation d'un fibroadénome ou une nouvelle formation, reste un domaine actif de recherche, nécessitant des investigations plus approfondies.
III.Diagnostic des Tumeurs Phyllodes du Sein Aspects Cliniques Radiologiques et Histopathologiques
Il n'existe pas de signes cliniques caractéristiques des tumeurs phyllodes. Le diagnostic repose sur un trépied : clinique, radiologique (mammographie, échographie, IRM) et anatomopathologique. La mammographie peut suggérer la présence d'une tumeur phyllode, notamment par la taille et la forme (polycyclique, bords nets et flous), mais aucun caractère n'est pathognomonique. L'IRM, moins utilisée, montre des masses bien limitées à signal élevé en T2. L'étude histopathologique est cruciale pour le diagnostic et le grading (grades 1, 2, 3) des tumeurs phyllodes, déterminant le pronostic et la prise en charge thérapeutique. Des marqueurs tels que p53 et CD117 sont étudiés pour leur potentiel pronostique.
1. Aspects cliniques du diagnostic des tumeurs phyllodes
L'absence de signes cliniques caractéristiques des tumeurs phyllodes rend le diagnostic préopératoire difficile. Elles se présentent le plus souvent sous forme de masses mammaires de volume important, augmentant progressivement de taille et généralement uniques. Des signes inflammatoires sont rarement associés. L'examen clinique révèle souvent une masse de taille significative, parfois avec une peau distendue, luisante, pâle et parcourue d’un fin réseau veineux si la tumeur est volumineuse. Une ulcération cutanée, due à la pression extrême, peut survenir en cas de négligence, contrairement à l'adénocarcinome mammaire où l'invasion cutanée est différente. Le mamelon est généralement normal, mais peut être déprimé, rétracté ou présenter des écoulements. L'absence d'adénopathies palpables est également mentionnée. En conclusion, l'aspect clinique seul est insuffisant pour un diagnostic certain, nécessitant des examens complémentaires.
2. Apports de la mammographie et de l échographie dans le diagnostic
Des études ont exploré la possibilité de prédire la malignité des tumeurs phyllodes à partir de la mammographie. Liberman a constaté une forte probabilité de malignité pour les tumeurs de diamètre supérieur ou égal à 30 mm. Benhassouna a rapporté des tailles moyennes différentes selon le grade des tumeurs phyllodes sur la mammographie (57 mm pour les bénignes, 79 mm pour les intermédiaires et 86 mm pour les malignes). Il a également observé que des bords irréguliers sur la mammographie étaient prédictifs de malignité. Verhaeghe et coll. ont mis en avant l'aspect polycyclique et les contours nets/flous comme des indices radiologiques pour différencier les tumeurs phyllodes des fibroadénomes. Cependant, Foxcroft a montré que seul 28 % des tumeurs phyllodes dans leur série présentaient des bords lobulés. Ces données montrent que les critères mammographiques et échographiques sont indicatifs mais non spécifiques.
3. Imagerie par résonance magnétique IRM et marqueurs biologiques
L'IRM est peu utilisée pour les tumeurs phyllodes du sein. Une étude de Farria, avec 4 cas, décrit des masses bien limitées et un signal d'intensité élevé en T2, avec une prise de contraste rapide. Cette prise de contraste pourrait être liée à une augmentation de l'angiogénèse ou du métabolisme cellulaire. Concernant les marqueurs biologiques, l'expression de p53 et de CD117 (c-kit) est étudiée. Le rôle pronostique de p53 est débattu ; son expression dans le stroma pourrait être utile pour diagnostiquer les tumeurs phyllodes malignes. L'expression de CD117 dans le stroma des tumeurs phyllodes malignes est corrélée à la malignité et à la récidive, ce qui le positionne comme marqueur biologique potentiel. La valeur de ces marqueurs est à explorer plus en profondeur et nécessitent de plus amples recherches pour une meilleure compréhension de leur implication pronostique.
IV.Traitement Chirurgical des Tumeurs Phyllodes et Diagnostic Différentiel avec le Fibroadénome
Le traitement principal des tumeurs phyllodes est chirurgical, consistant en une exérèse large avec des marges de sécurité (au moins 1 cm). La mastectomie est indiquée pour les tumeurs volumineuses ou malignes, ou en cas de récidives. Le diagnostic différentiel avec les fibroadénomes, notamment les fibroadénomes géants, est complexe et repose sur des critères histopathologiques précis (cellularité conjonctive, architecture foliaire). L'étude mentionne les différentes approches chirurgicales (tumorectomie simple, élargie, mastectomie) en fonction de l'âge de la patiente, de la taille de la tumeur et de son grade histologique.
1. Traitement chirurgical des tumeurs phyllodes
Le traitement principal des tumeurs phyllodes est l'exérèse chirurgicale, avec une marge de sécurité de 1 à 2 cm dans le tissu mammaire sain. Des études montrent que cette technique est le traitement de choix pour tous les types de tumeurs phyllodes et réduit considérablement le taux de récidive, à condition que les marges soient d'au moins 1 cm. Chaney a démontré un taux de contrôle local d'environ 90 % avec une exérèse large et des marges négatives. Cependant, l'unanimité n'est pas totale quant à la reprise chirurgicale en cas de tumeurs borderline ou malignes avec des marges insuffisantes : certains préconisent une nouvelle intervention pour diminuer le risque de récidive, tandis que d'autres préfèrent une surveillance étroite si la tumeur est histologiquement bénigne. La mastectomie totale est envisagée pour les tumeurs non résécables, les tumeurs malignes de grande taille, ou les récidives. Plusieurs auteurs n'ont pas observé de différence significative de survie entre l'exérèse large et la mastectomie totale en traitement initial.
2. Indications chirurgicales et choix de la technique
Le choix entre une chirurgie conservatrice (tumorectomie simple ou élargie) et une mastectomie totale dépend de plusieurs facteurs : l'âge de la patiente, la morphologie et la taille de son sein, la taille et les caractéristiques cliniques de la tumeur, le diagnostic préopératoire, l’agressivité de la lésion et le consentement de la patiente. L'examen extemporané des berges d'exérèse permet d'évaluer la qualité de la résection. Dans la série étudiée (40 cas), 33 patientes (20-50 ans) ont bénéficié d'un traitement conservateur (31 tumorectomies simples et 2 élargies), et 4 cas ont nécessité une mastectomie totale. Chez les femmes âgées, une chirurgie radicale est souvent privilégiée. L'évolution des pratiques chirurgicales a vu une tendance vers des traitements conservateurs, même pour les tumeurs phyllodes borderline ou malignes, car les récidives locales ne semblent pas systématiquement liées aux métastases. Cependant, d'autres auteurs rapportent de meilleurs résultats avec un traitement radical.
3. Traitements adjuvants et diagnostic différentiel avec le fibroadénome
La radiothérapie postopératoire peut être indiquée en cas de marges d'exérèse positives, d'atteinte locorégionale, de métastase osseuse, ou pour des tumeurs agressives. En cas de métastases, une chimiothérapie est utilisée, avec des combinaisons de médicaments variables selon les auteurs (cisplatine/doxorubicine, cisplatine/étoposide, vincristine/actinomycine D/5-fluorouracile/cyclophosphamide, isofosfamide/doxorubicine). Le fibroadénome est le principal diagnostic différentiel en raison de similitudes cliniques, radiologiques et histologiques. Le fibroadénome géant pose particulièrement un problème diagnostique. Histologiquement, la distinction entre un fibroadénome (notamment cellulaire) et une tumeur phyllode repose sur des critères précis, notamment le degré de cellularité conjonctive et la présence d'une architecture foliaire, critères qui ne sont pas toujours suffisants. Une attention particulière est portée à éviter les énucléations, en raison du risque accru de récidive.
V.Évolution Récidive et Métastases des Tumeurs Phyllodes
Les métastases des tumeurs phyllodes sont rares, principalement pulmonaires. Le risque de récidive locale est significatif et dépend de plusieurs facteurs, dont le grade histologique, la présence de « stromal overgrowth », et les marges chirurgicales. L'influence de l'âge sur la survenue des métastases reste controversée. Le traitement des métastases fait appel à la chimiothérapie et/ou à la radiothérapie, avec un pronostic souvent sombre. L'étude souligne l'importance de la prise en charge chirurgicale optimale pour minimiser le risque de récidive.
1. Récidives locales des tumeurs phyllodes
Les tumeurs phyllodes, même bénignes, présentent un risque significatif de récidive locale. La fréquence des récidives est variable selon les études et les facteurs de risque ne sont pas complètement élucidés. Certaines études montrent un lien entre le grade histologique et le risque de récidive, les tumeurs de haut grade ayant un risque plus élevé (Lenhard : 40 % pour les malignes, 25 % pour les borderline, 8 % pour les bénignes; Belkacemi : 8 % à 5 ans pour les bénignes, 26 % pour les borderline, 36 % pour les malignes). D'autres études, au contraire, ne trouvent pas de corrélation significative entre le grade histologique et la survenue des récidives. Le texte souligne l'importance de la qualité de la chirurgie initiale, notamment des marges d'exérèse, pour minimiser le risque de récidive. L'absence d’uniformité des résultats entre les études suggère la complexité de la prédiction des récidives et la nécessité d’investigations plus poussées.
2. Métastases des tumeurs phyllodes
Les métastases des tumeurs phyllodes sont rares, mais représentent un risque important, surtout pour les variétés malignes. Les métastases pulmonaires sont les plus fréquentes (60 à 87,5 %, voire 100 % selon Hawkins). Un cas d'ostéoarthropathie hypertrophique (OAH) secondaire à une métastase pulmonaire d'une tumeur phyllode maligne est rapporté (Colinson). Le rôle de l'âge comme facteur de risque est débattu ; certains auteurs n'observent pas d'influence significative, tandis que d'autres constatent un lien avec un âge avancé ou, au contraire, un risque diminué chez les jeunes patientes. Le « stromal overgrowth » et les limites infiltrantes sont identifiés comme des facteurs histologiques de mauvais pronostic et prédictifs de métastases chez plusieurs auteurs, mais Hawkins mentionne une valeur prédictive négative à 100 % pour l'absence de stromal overgrowth. Le pronostic des métastases est sombre, avec une létalité de 80 à 100 % des cas. Le traitement repose sur la chimiothérapie et/ou la radiothérapie, mais leur efficacité reste limitée.
3. Facteurs pronostiques et évolution des tumeurs phyllodes
L'étude des facteurs pronostiques des tumeurs phyllodes est complexe, car la corrélation entre les critères histologiques et le comportement clinique n'est pas toujours fiable. Le « stromal overgrowth » est le facteur histologique le plus souvent cité comme prédictif de mauvais pronostic et de métastases. D'autres facteurs sont mentionnés, comme les marges infiltrantes et un index mitotique élevé. L'influence du grade histologique sur la survenue des récidives est également discutée ; certaines études montrent une corrélation, d'autres non. L'âge de la patiente semble jouer un rôle, mais les données sont contradictoires. L'étude rétrospective mentionnée (40 cas, CHU Mohammed VI de Marrakech) n'a rapporté aucune métastase à distance ni aucun décès durant le suivi, avec 4 récidives locales (10 %), survenues dans tous les grades histologiques. La complexité des facteurs pronostiques souligne la nécessité de recherches supplémentaires.
VI.Étude Rétrospective sur les Tumeurs Phyllodes au CHU Mohammed VI de Marrakech
Une étude rétrospective de 40 cas de tumeurs phyllodes du sein au CHU Mohammed VI de Marrakech (Janvier 2002 - Décembre 2008) est présentée. L'âge moyen des patientes était de 30,7 ans (16-47 ans). Les principales manifestations cliniques étaient des nodules mammaires unilatéraux. Le diagnostic préopératoire était suspecté dans 12,5% des cas en mammographique et 9% en échographie. La répartition histologique était : 75% grade 1, 12,5% grade 2, 12,5% grade 3. Le traitement consistait principalement en des tumorectomies (85%), avec 10% de mastectomies totales. Dix pour cent des patientes ont présenté des récidives locales, sans métastases à distance ni décès durant le suivi.
1. Méthodologie de l étude rétrospective
L'étude rétrospective menée au service d'anatomie pathologique du CHU Mohammed VI de Marrakech porte sur 40 cas de tumeurs phyllodes du sein, colligés sur une période de 6 ans (janvier 2002 - décembre 2008). L'âge des patientes était compris entre 16 et 47 ans, avec une moyenne de 30,7 ans. La principale manifestation clinique était un nodule mammaire unilatéral, dont la taille variait entre 2 et 35 cm de diamètre (moyenne : 7,4 cm). Les signes inflammatoires locaux ou les modifications cutanées étaient rares. Le diagnostic de tumeur phyllode a été suspecté en préopératoire par la mammographie dans 12,5 % des cas et par l'échographie dans 9 % des cas, démontrant les limites de l'imagerie préopératoire. L'examen anatomopathologique a permis de classer les tumeurs : 75 % de grade 1, 12,5 % de grade 2 et 12,5 % de grade 3. Cette étude rétrospective, menée sur une période significative, permet une analyse de la prévalence et des caractéristiques des tumeurs phyllodes dans une population spécifique.
2. Traitement et évolution des patientes
Toutes les patientes ont bénéficié d'une résection chirurgicale. 85 % des cas ont été traités par tumorectomies simples, 5 % par tumorectomies élargies et 10 % par mastectomies totales (dont 3 cas associés à un curage ganglionnaire axillaire). Un traitement adjuvant (chimiothérapie, radiothérapie) a été nécessaire pour 3 cas de tumeurs phyllodes de grade 3. L'évolution a été marquée par 4 récidives locales (10 % des cas), dont 3 ont rechuté une seconde fois. Il est important de noter que les récidives sont apparues quel que soit le grade tumoral, et aussi bien après une tumorectomie qu'après une mastectomie totale. L'absence de métastases à distance et de décès jusqu'à la fin du suivi est également rapportée. Cette analyse des données thérapeutiques et de l'évolution post-opératoire met en évidence l'efficacité des techniques chirurgicales employées, malgré le risque de récidive locale.
3. Résultats de l étude et conclusions
Cette étude rétrospective réalisée au CHU Mohammed VI de Marrakech offre un aperçu des caractéristiques cliniques, histopathologiques et thérapeutiques des tumeurs phyllodes du sein sur une cohorte de 40 patientes. Les résultats montrent une prédominance des tumeurs de grade 1, un taux de récidive locale non négligeable, mais sans métastases à distance ni décès pendant la période de suivi. Le fait que les récidives soient observées indépendamment du grade tumoral et du type de chirurgie souligne la complexité du comportement de ces tumeurs et la nécessité d'un suivi attentif. Les données confirment l'importance de la résection chirurgicale complète et soulèvent des questions concernant les facteurs prédictifs de récidive, qui restent à approfondir pour améliorer la prise en charge des patientes atteintes de tumeurs phyllodes. L'étude met en exergue la nécessité d’une surveillance à long terme pour détecter les récidives.
