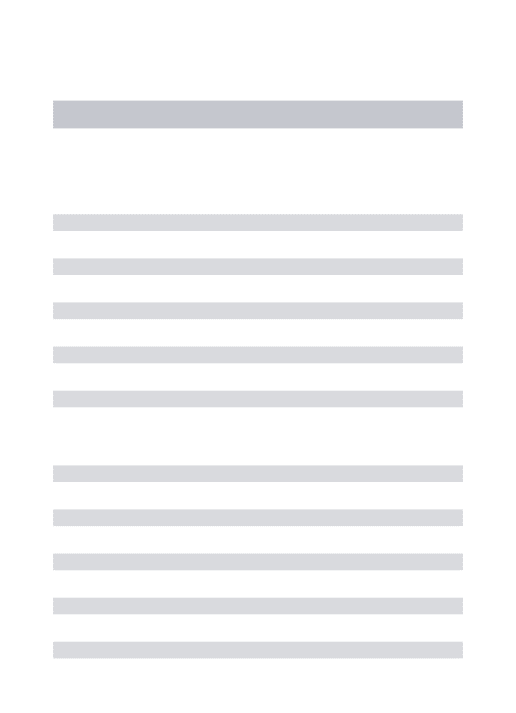
Corrosion atmosphérique des aciers
Informations sur le document
| Auteur | Hadri Faiz |
| school/university | Université Lorraine, Nancy 1 |
| subject/major | Chimie et Physico-Chimie Moléculaires |
| Type de document | Thèse |
| city_where_the_document_was_published | Nancy |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 5.89 MB |
Résumé
I.Mécanismes de la Corrosion Atmosphérique du Fer
Cette thèse explore les mécanismes de la corrosion atmosphérique du fer à long terme. L'étude se concentre sur la caractérisation fine des produits de corrosion (CPC) et leur réactivité électrochimique. L'analyse porte sur la formation de couches épaisses de produits de corrosion comprenant divers oxydes de fer tels que la goethite (α-FeOOH), la lépidocrocite, la magnétite (Fe₃O₄), la maghémite (γ-Fe₂O₃), et la ferrihydrite, ainsi que sur leur distribution spatiale dans la CPC. Des techniques analytiques avancées, dont la diffraction des rayons X (DRX), la spectroscopie Raman, la microscopie électronique à balayage (MEB), et la spectroscopie dispersive en énergie (EDS), sont utilisées pour caractériser ces phases, souvent mal cristallisées. Le comportement électrochimique est étudié via des électrodes à pâte de carbone, permettant d'évaluer la réactivité électrochimique des différents oxydes de fer.
1. Définition et facteurs de la corrosion atmosphérique du fer
La section introduit la corrosion atmosphérique du fer comme un processus électrochimique nécessitant la présence d'oxygène et d'eau (électrolyte). L'humidité relative (HR) joue un rôle crucial, la corrosion débutant généralement au-delà de 60% HR et atteignant son maximum entre 80% et 100% HR. À 100% HR, une couche de 100 µm d'épaisseur peut se former. La description de structures cristallines spécifiques comme la feroxyhyte (structure dérivée de l'hématite, hexagonale compacte avec des plans d'oxygène et des ions Fe³⁺ dans les interstices octaédriques) et l'hématite (constituée de couches d'octaèdres FeO₆ liés par des faces et des arêtes, avec une structure compacte induisant une densité élevée) est fournie. L'équation 4 Fe + 3O₂ + 2H₂O → 4FeOOH illustre la réaction principale de formation d'oxyhydroxyde de fer. Le document souligne l'impact significatif de la corrosion sur la société, détruisant une part importante de la production mondiale d'acier et affectant divers matériaux, soulignant ainsi l'importance de la recherche sur ce phénomène.
2. Caractérisation des produits de corrosion et techniques analytiques
Cette partie détaille la caractérisation des produits de corrosion du fer, en particulier les oxydes et oxyhydroxydes. Elle mentionne les travaux de Lecuire (années 70) utilisant des électrodes à pâte de carbone pour étudier le comportement électrochimique des oxydes de fer en milieu aqueux. L'étude de Lecuire a permis de classifier les oxydes de fer en deux groupes selon le nombre de pics de réduction observés en voltampérométrie. La morphologie, la composition et la structure des substances électroactives influencent fortement les phénomènes électrochimiques observés. La caractérisation des échantillons d'acier doux et patinable soumis à des conditions urbaines révèle souvent une couche de corrosion en deux parties : une couche interne dense principalement composée de goethite, et une couche externe plus fissurée riche en lepidocrocite et potentiellement en akaganenite en présence de chlorures. Des marbrures de magnétite, maghémite et ferrihydrite ou feroxyhyte sont également observées dans la couche interne. L'analyse de ces couches complexes nécessite la corrélation de différentes techniques analytiques. Différentes étapes de la corrosion, notamment l'étape humide caractérisée par une consommation identique de fer et d'oxygène, sont décrites, soulignant un découplage des zones anodiques et cathodiques.
3. Discussion sur le rôle des différentes phases dans le mécanisme de corrosion
La section discute du rôle de chaque phase dans le mécanisme de corrosion atmosphérique du fer, soulignant que ce sujet reste un point de débat scientifique. Historiquement, la lepidocrocite était considérée comme la phase réactive principale, mais des études récentes sur des échantillons anciens montrent une présence plus limitée, sous forme d'îlots. La ferrihydrite et la feroxyhyte sont aussi des phases importantes, susceptibles de se réduire. Les travaux de Monnier montrent que la réduction de la ferrihydrite conduit à un mélange d'hydroxyde ferreux et de magnétite, dont la ré-oxydation forme de la maghémite. La réduction in situ de la maghémite conduit à la formation de magnétite. Ainsi, un cycle oxydation-réduction magnétite-maghémite est identifié dans la couche de produits de corrosion (CPC). La difficulté d'analyse de ces phases, souvent mal cristallisées, nécessite la corrélation de plusieurs techniques analytiques. La thèse de Judith Monnier est mentionnée comme exemple de cette approche.
II.Étude de la Réactivité des Produits de Corrosion
L'étude examine la réactivité électrochimique des produits de corrosion en utilisant l'analyse par voltampérométrie et impédance électrochimique. L'objectif est de comprendre le rôle de chaque phase (goethite, lépidocrocite, magnétite, maghémite, ferrihydrite) dans les mécanismes de corrosion. Des expériences de remise en corrosion avec de l'oxygène 18 (¹⁸O₂) permettent de localiser les sites d'oxydation dans la CPC. Les résultats mettent en évidence l'importance de la cristallinité et de la surface spécifique sur la réactivité des phases. Les analyses révèlent que l'oxydation se produit principalement à l'interface CPC/environnement, impliquant des espèces Fe(II) très réductrices.
1. Techniques électrochimiques pour l étude de la réactivité
L'étude de la réactivité des produits de corrosion utilise principalement des techniques électrochimiques. La voltampérométrie, utilisant des électrodes à pâte de carbone, permet de caractériser la réactivité électrochimique en termes d'intensité des processus de réduction/oxydation. Cependant, l'identification précise des phases impliquées dans des échantillons inconnus reste difficile avec cette méthode seule. Les voltampérogrammes obtenus pour les oxyhydroxydes de fer (FeOOH) montrent un pic de réduction (C₁) et un pic d'oxydation (A₁), attribuables à l'échange électronique entre Fe(III) et Fe(II), bien que la largeur des pics suggère une somme de processus complexes. L'analyse d'impédance électrochimique, complémentaire à la voltampérométrie, permet d'étudier le comportement du système en fonction de la fréquence. Des spectres d'impédance ont été mesurés « à sec » et en milieu aqueux, en utilisant du mercure comme électrolyte. La comparaison de ces mesures permet d'évaluer la capacité de la couche de surface. Dans le cas de la ferrihydrite, un modèle équivalent à trois constantes de temps est proposé pour mieux décrire le système électrochimique complexe.
2. Expériences de remise en corrosion et analyse isotopique
Des expériences de remise en corrosion ont été menées pour étudier la réactivité des produits de corrosion. L'utilisation d'une atmosphère enrichie en oxygène 18 (¹⁸O₂) permet de suivre l'incorporation de l'oxygène dans la couche de produits de corrosion. L'analyse isotopique par NRA (Nuclear Reaction Analysis) révèle un enrichissement en ¹⁸O dans toute la CPC, notamment au niveau de la goethite et des marbrures, confirmant que l'oxydation se produit à l'interface CPC/environnement. L'analyse bibliographique montre que la majorité des études sur les oxyhydroxydes de fer sont réalisées en milieu acide, favorisant un mécanisme de dissolution puis oxydation/réduction. La solubilité de ces phases en milieu acide et la position des pics d'oxydation/réduction suggèrent la présence d'ions Fe³⁺ et Fe²⁺ dissous comme espèces électroactives. De fortes concentrations d'espèces dissoutes peuvent induire la précipitation d'autres phases. La présence d'acide décanoïque détectée par DRX est liée à une diminution du pH de l'électrolyte au voisinage de la surface des grains lors de l'hydratation des oxyhydroxydes.
3. Analyse des faciès de corrosion et conclusions sur la réactivité
L'étude des faciès de corrosion, combinant microscopie optique (MO) et MEB-EDS, révèle la présence d'une couche dense, traversée par des fissures et des marbrures plus claires. Ces marbrures, de composition variable, peuvent être connectées ou non au métal. L'analyse élémentaire indique une présence majoritaire de fer et d'oxygène. L'analyse des échantillons, provenant notamment de semelles et de tubes, identifie trois types de faciès avec des différences dans la cristallinité et la distribution des phases (goethite, lepidocrocite, magnétite, maghémite, ferrihydrite). Les différences de réactivité entre les phases semblent liées à leur cristallinité et leur surface spécifique. L'étude électrochimique permet de caractériser la réactivité électrochimique, mais pas d'identifier les phases dans des échantillons inconnus. Un échantillonnage important est nécessaire pour assurer une étude statistique fiable des résultats.
III.Traitements Inhibiteurs de Corrosion
La thèse explore l'utilisation d'inhibiteurs de corrosion, notamment des dérivés d'acide carboxylique (comme l'acide décanoïque, HC₁₀) et la catéchine, pour protéger le fer contre la corrosion. L’étude évalue l'efficacité de ces traitements sur des poudres de référence (ferrihydrite, maghémite-magnétite) et sur des surfaces corrodées. Des analyses MEB montrent l'impact des traitements sur la morphologie de la surface, avec la formation de couches protectrices. La conversion chimique des poudres en carboxylates de fer inhibe significativement leur activité électrochimique. L'analyse par spectroscopie Raman confirme la présence de ces carboxylates.
1. Types d inhibiteurs et leurs mécanismes d action
La recherche explore l'utilisation d'inhibiteurs de corrosion pour protéger le fer. Les inhibiteurs sont appliqués de manière directe (immersion, pinceau, phase vapeur) ou indirecte (additifs dans les revêtements). Parmi les inhibiteurs minéraux testés pour la conservation du patrimoine, on trouve les chromates, phosphates et silicates, principalement sur des surfaces métalliques saines. Leur action repose sur la formation de complexes de phosphates de fer insolubles sur les sites anodiques. L'étude porte une attention particulière aux monocarboxylates aliphatiques linéaires saturés, dont l'efficacité pour inhiber la corrosion aqueuse de divers métaux (Cu, Fe, Pb, Zn, Mg) en solution neutre et aérée a été démontrée. L'analyse par diffraction des rayons X, spectroscopies IR et XPS montre que la protection résulte de la formation d'un film mince composé de savon et d'hydroxyde du métal traité. La résistance de cette couche protectrice dépend de la longueur de la chaîne carbonée et de la concentration du carboxylate. L'observation de cristaux en fines plaquettes est mentionnée, formés à la surface de cuivre ou dans des piqûres sur du fer en présence de chlorures.
2. Traitements à l acide décanoïque HC₁₀ et autres inhibiteurs
L'étude se concentre sur l'utilisation de l'acide décanoïque (HC₁₀) comme inhibiteur. La conversion de poudres de référence (ferrihydrite, notamment) en carboxylate de fer (FeC₁₀) est étudiée. Les analyses structurales, notamment par microspectrométrie Raman, mettent en évidence la présence de liaisons caractéristiques des carboxylates. L'effet inhibiteur est évalué par microscopie électronique à balayage (MEB), montrant la formation d'agrégats et de plaquettes sur la surface traitée. Des comparaisons sont faites avec des traitements utilisant NaC₁₀ (décanoate de sodium) et de la catéchine, révélant des morphologies de surface différentes. Un traitement de 5 jours dans différentes solutions inhibitrices induit une augmentation de potentiel de plus de 450 mV après 20 jours d'immersion, confirmant la formation d'une couche protectrice. L'acide décanoïque montre l'anoblissement le plus significatif. L'efficacité du traitement à l'acide décanoïque s'étend à d'autres phases comme la goethite et la lepidocrocite, inhibant les processus de dissolution-réduction.
IV.Analyse des Échantillons Archéologiques
L'étude inclut l'analyse d'échantillons archéologiques provenant de la mine de Petite Rosselle. La caractérisation de ces échantillons, combinant des techniques de microscopie optique (MO), MEB-EDS, DRX, et spectroscopie Raman, permet d'identifier les différents faciès de corrosion et de caractériser les produits de corrosion. L'analyse du substrat métallique révèle une faible teneur en phosphore, caractéristique des procédés métallurgiques postérieurs au 19e siècle. Les résultats révèlent la présence d'une couche dense de goethite contenant des marbrures de magnétite et de maghémite, ainsi que de la lépidocrocite localisée en surface. Trois types de faciès ont été identifiés, chacun se caractérisant par une distribution spécifique des oxydes de fer.
1. Caractérisation des échantillons et de leur substrat métallique
L'analyse porte sur des objets archéologiques, dont la provenance précise n'est pas détaillée mais qui sont issus d'une mine (Petite Rosselle est mentionnée). L'étude se concentre sur la caractérisation de la couche de produits de corrosion (CPC) et de la matrice métallique. La microscopie optique (MO) et la microscopie électronique à balayage (MEB) permettent d'observer la morphologie de la CPC, de mesurer son épaisseur (moyenne de 105 µm) et de détecter les hétérogénéités (fissures, pores, marbrures). L'analyse MEB-EDS révèle la présence majoritaire de fer (42 à 82% mas) et d'oxygène (15 à 30% mas) dans la couche dense de produits de corrosion. Concernant le substrat métallique, il s'agit d'aciers hypoeutectoïdes avec une teneur en phosphore inférieure à 0,1%, contenant peu d'inclusions, ce qui suggère des techniques de fabrication postérieures à l'affinage en phase liquide et à la déphosphoration du 19e siècle. L'absence de structures « fantômes » après attaque Oberhoffer confirme la faible teneur en phosphore (<0,1% mas).
2. Identification des faciès de corrosion et des phases présentes
L'analyse identifie différents faciès de corrosion. Un premier type, observé dans les sols, présente de la goethite (α-FeOOH) en contact avec le métal, ainsi que des marbrures de magnétite (Fe₃O₄) et de maghémite (γ-Fe₂O₃). Des fissures de quelques micromètres à quelques dizaines de micromètres sont également observées. Un autre faciès, caractéristique de la corrosion atmosphérique, présente des marbrures composées majoritairement de phases peu cristallisées de ferrihydrite et parfois de maghémite. La lépidocrocite est observée localement en zone externe et près des fissures. L'étude combine des techniques d'analyse complémentaires pour une caractérisation fine : la diffraction des rayons X (DRX) fournit des informations globales sur la structure des phases, la microdiffraction des rayons X (micro-DRX) identifie les phases bien cristallisées à l'échelle micrométrique, et la microspectrométrie Raman (micro-Raman) identifie les phases quel que soit leur degré de cristallinité. Trois types de faciès ont été identifiés, chacun se caractérisant par une distribution spécifique des oxydes de fer.
