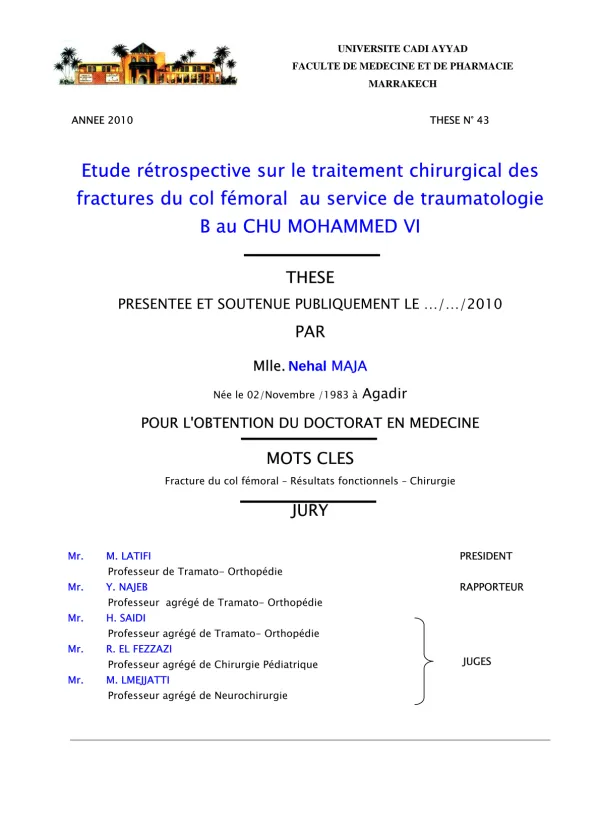
Étude Rétrospective sur le Traitement Chirurgical des Fractures du Col Fémoral
Informations sur le document
| Auteur | Mlle. Nehal Maja |
| École | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech |
| Spécialité | Médecine |
| Lieu | Marrakech |
| Type de document | Thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 2.49 MB |
- Fractures du col fémoral
- Chirurgie orthopédique
- Étude rétrospective
Résumé
I.Rééducation postopératoire après Fracture du Col Fémoral
La rééducation après une fracture du col fémoral débute dès le lendemain de l’intervention chirurgicale, incluant des mobilisations actives et passives. Pour les patients ayant subi une arthroplastie de la hanche, la marche avec appui est possible dès le 3ème jour postopératoire. En revanche, pour ceux traités par ostéosynthèse, l’appui est différé de 3 à 4 mois, jusqu’à consolidation radiologique. L'autonomie préopératoire est un facteur pronostique important, influençant la récupération fonctionnelle post-fracture du col fémoral.
1. Début et nature de la rééducation
La rééducation postopératoire commence dès le lendemain de l'intervention chirurgicale pour les fractures du col fémoral. Elle consiste initialement en une mobilisation active et passive du membre inférieur affecté. Cette approche précoce vise à stimuler la récupération fonctionnelle et à prévenir les complications liées à l’immobilisation prolongée. L'objectif initial est de restaurer progressivement la mobilité articulaire et la force musculaire. Le programme de rééducation est individualisé en fonction de l'état du patient, du type d'intervention chirurgicale (arthroplastie ou ostéosynthèse) et de sa tolérance à l'exercice.
2. Différences de rééducation selon le type d intervention
Une différence notable dans la rééducation se manifeste en fonction du type d'intervention chirurgicale. Pour les patients ayant bénéficié d'une arthroplastie de la hanche, le lever précoce et la marche avec appui sont encouragés dès le troisième jour postopératoire. Cette approche agressive permet une récupération plus rapide de l'autonomie. Cependant, pour les patients ayant subi une ostéosynthèse, l'appui est différé de trois à quatre mois, jusqu'à la consolidation radiologique complète de la fracture. Ceci est nécessaire pour assurer la stabilité de la réparation osseuse et éviter le risque de déplacement ou de non-union. Le protocole de rééducation est donc adapté à la solidité de la fixation osseuse.
3. L autonomie comme facteur pronostique
L'autonomie du patient avant la fracture du col fémoral constitue un facteur pronostique important pour la récupération fonctionnelle et l'évolution postopératoire. Des études citées dans le document montrent une corrélation entre l'autonomie préopératoire et le pronostic à court terme, tant sur le plan vital que fonctionnel. Un tiers des patients autonomes avant la fracture peuvent perdre leur autonomie dans l'année suivant l'intervention. Par conséquent, une évaluation préopératoire précise de l'état d'autonomie est cruciale pour adapter le programme de rééducation et les attentes postopératoires. L'objectif est de maintenir ou de restaurer autant que possible l'autonomie du patient après la chirurgie.
II.Diagnostic de la Fracture du Col Fémoral
Le diagnostic de fracture du col fémoral repose sur l'examen clinique, mettant en évidence une douleur inguinale irradiant à la fesse, une impotence fonctionnelle, et parfois une déformation. L’IRM est l'examen d'imagerie de choix pour confirmer le diagnostic avec précision. Les radiographies standard peuvent être utiles, mais l'IRM évite les faux positifs et faux négatifs.
1. Signes Cliniques de la Fracture du Col Fémoral
Le diagnostic de fracture du col fémoral commence par l'examen clinique. Classiquement, on observe une douleur vive à la hanche, localisée à la région inguinale et irradiant vers la fesse. Cette douleur s'accompagne d'une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur, rendant impossible des mouvements simples comme le salut coxal (lever le talon du lit). Cependant, il est important de noter que les fractures engrenées ou non déplacées peuvent présenter une symptomatologie moins évidente, se manifestant par des douleurs inguinales sans impotence fonctionnelle majeure ni déformation apparente. L’adduction (rapprochement du pied vers la ligne médiane) peut être observée. Il est crucial de souligner le caractère imprudent d’une tentative de mobilisation du patient avant d'avoir formellement exclu une fracture, car cela pourrait aggraver la situation en déplaçant une fracture initialement non déplacée.
2. Imagerie Médicale pour le Diagnostic
L'examen clinique est complété par des examens d'imagerie médicale pour confirmer le diagnostic et préciser le type de fracture. Le scanner osseux peut révéler les traits de fracture avec une bonne sensibilité, mais sa spécificité est moindre par rapport à l'IRM. L’IRM, quant à elle, est présentée comme l’examen de choix pour le diagnostic de fracture du col fémoral. Sa grande précision permet un diagnostic sans faux positifs ni faux négatifs, offrant une information diagnostique de grande fiabilité. Ces examens permettent non seulement de confirmer la présence d'une fracture, mais aussi de déterminer sa localisation exacte, son degré de déplacement et d'autres caractéristiques importantes pour la prise en charge thérapeutique.
III.Traitement de la Fracture du Col Fémoral
Le traitement de la fracture du col fémoral vise à restaurer la fonction pré-fracturaire et à minimiser la dépendance. Le choix entre ostéosynthèse et arthroplastie de la hanche dépend de l'âge du patient, de la stabilité de la fracture (classification de Garden), et de son niveau d'autonomie. La prévention des complications postopératoires, notamment les infections et les thromboses veineuses profondes (TVP), est primordiale. L'utilisation d'antibiotiques prophylactiques et d'héparine est courante. Différentes voies d'abord chirurgicales existent (antérolatérale, postérieure, transglutéale) chacune avec ses avantages et inconvénients en termes de risque de luxation de prothèse.
1. Objectif du traitement de la fracture du col fémoral
Le traitement d'une fracture du col fémoral vise avant tout à permettre au patient de retrouver une fonction similaire à celle qu'il possédait avant la fracture. L'objectif est une récupération rapide de l'autonomie, permettant un retour à domicile dans les meilleurs délais et une dépendance minimale envers les tiers. D'un point de vue socio-économique, un traitement efficace minimise les coûts liés à l'hospitalisation prolongée et aux soins de suivi. Pour ce faire, le traitement doit être le moins invasif possible, permettant une mobilisation précoce et, idéalement, une prise d'appui immédiate. L'approche thérapeutique doit donc concilier l'efficacité de la réparation osseuse avec la minimisation des risques et la préservation de la qualité de vie du patient.
2. Choix thérapeutique Ostéosynthèse vs. Arthroplastie
Le choix entre l'ostéosynthèse et l'arthroplastie de la hanche dépend de plusieurs facteurs. La classification de Pauwels, bien que présentant une variabilité d'interprétation, peut être un facteur pronostique, notamment pour les fractures traitées par ostéosynthèse. Pour les fractures non déplacées traitées de manière conservatrice, l'utilité de cette classification est discutable. L'âge du patient et la stabilité de la fracture, selon la classification de Garden, jouent un rôle déterminant. Chez les patients jeunes et actifs, une arthroplastie permet une récupération fonctionnelle plus rapide avec une prise d'appui immédiate. Chez les patients âgés ou fragiles, une ostéosynthèse peut être privilégiée, même si le risque de pseudarthrose ou de nécrose est présent. Le choix est donc individualisé selon l'état du patient et le type de fracture.
3. Prévention des complications postopératoires
La prévention des complications postopératoires est essentielle. L’administration prophylactique d'antibiotiques à large spectre permet de réduire significativement le risque d'infection postopératoire, diminuant ainsi la durée d'hospitalisation et les coûts associés. La prévention des complications thromboemboliques, telles que les thromboses veineuses profondes (TVP) et les embolies pulmonaires, est également cruciale. Le traitement anticoagulant préventif, souvent par HBPM (héparines de bas poids moléculaire), est initié dès le traumatisme et poursuivi pendant au moins un mois. La surveillance du traitement anticoagulant est assurée par des examens réguliers (taux de prothrombine, INR pour les AVK). L’utilisation de drains aspiratifs est discutée : ils semblent protéger contre la formation d'hématome et les infections, mais un drain non aspiratif augmente le risque infectieux. L’absence de drainage est une alternative envisagée.
IV.Complications après Fracture du Col Fémoral et leur traitement
Les complications postopératoires fréquentes incluent l’ostéonécrose de la tête fémorale, la pseudarthrose, les infections, la luxation de prothèse, et le descellement prothétique. Le taux de ces complications varie selon les études et les techniques chirurgicales employées. La prise en charge de ces complications peut nécessiter des interventions chirurgicales supplémentaires.
V.Résultats Fonctionnels et Suivi
L’évaluation fonctionnelle postopératoire se base sur des scores comme celui de Merle d’Aubigné et Postel. Le recul moyen des patients suivis dans cette étude (réalisée au service de traumato-orthopédie de l’hôpital Ibn Tofail du CHU Mohammed VI de Marrakech entre janvier 2006 et décembre 2008) était de 24 mois. Un seul décès (2,3%) a été constaté, et 13 patients ont été perdus de vue. L’étude a porté sur 64 cas de fractures du col fémoral.
1. Étude et Méthodologie
Cette étude rétrospective a analysé 64 cas de fractures du col fémoral traités au service de traumato-orthopédie de l'hôpital Ibn Tofail du CHU Mohammed VI de Marrakech entre janvier 2006 et décembre 2008. L'objectif principal était d'évaluer les résultats fonctionnels à long terme de la prise en charge de ces fractures. Seuls 23 patients ont pu être revus lors du suivi, avec un recul moyen de 24 mois. Il est important de noter que 13 patients ont été perdus de vue, principalement en raison de difficultés d'accès aux soins (milieu rural) ou de contraintes financières. Ce biais méthodologique doit être pris en compte lors de l'interprétation des résultats.
2. Résultats Fonctionnels et Cotation de Merle d Aubigné et Postel
L'évaluation des résultats fonctionnels a été effectuée à l'aide de la cotation de Merle d'Aubigné et Postel, un système d'évaluation couramment utilisé, qui prend en compte trois paramètres : la douleur, la marche et la mobilité. Chaque paramètre est noté de 0 à 6, permettant ainsi une évaluation quantitative du résultat fonctionnel. L'étude montre une corrélation entre l'âge du patient et les résultats fonctionnels. Chez les sujets jeunes, l'évolution postopératoire est généralement plus favorable que chez les sujets âgés. Dans cette étude, le recul moyen de 24 mois permet une évaluation de l'évolution à moyen terme, mais un suivi plus prolongé serait souhaitable pour une évaluation complète.
3. Taux de Complications et de Mortalité
Le taux de complications était significatif dans cette série. Un cas de sepsis sur matériel, deux cas d'ostéonécrose de la tête fémorale, deux cas de cotyloidite, cinq cas de pseudarthrose, un cas de luxation de prothèse et un cas de descellement prothétique ont été observés. Ces résultats soulignent l'importance de la prévention des complications et d'un suivi rigoureux des patients. Un seul décès a été enregistré (2,3%), survenu deux mois après l'intervention chirurgicale, la cause n'étant pas précisée. Ce faible taux de mortalité doit être interprété avec prudence en raison du nombre important de patients perdus de vue. La mortalité est ainsi sous-estimée.
