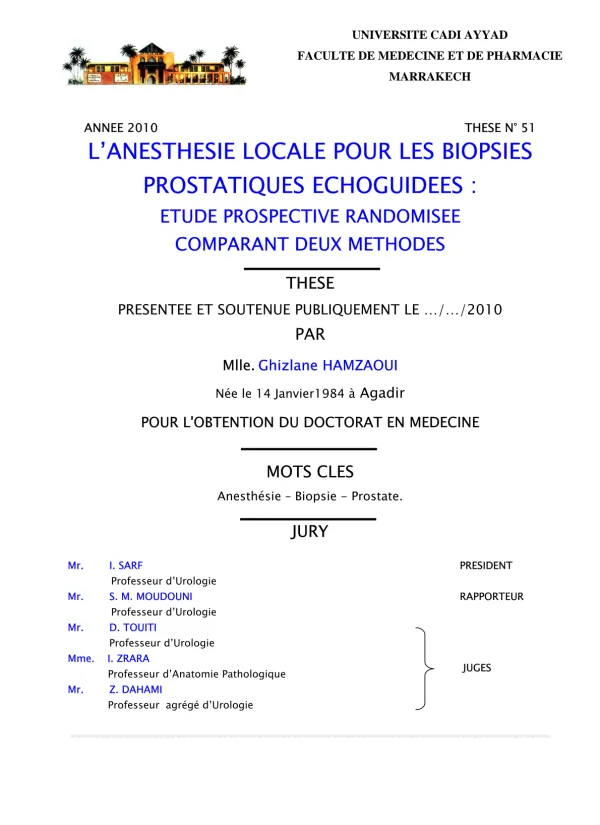
Étude sur l'Anesthésie Locale pour les Biopsies Prostatique Échoguidées
Informations sur le document
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 4.73 MB |
- Anesthésie
- Biopsie
- Prostate
Résumé
I.Biopsie Prostatique Transrectale Échoguidée Inconfort et Anesthésie
Cette étude, menée au CHU Mohammed VI de Marrakech entre novembre 2007 et décembre 2009, porte sur l'évaluation de la douleur lors d'une biopsie prostatique transrectale échoguidée et la comparaison de deux techniques d'anesthésie locale. 60 patients ont été randomisés: un groupe recevant un gel de lidocaïne intrarectal et du tramadol per os, l'autre une infiltration périprostatique de lidocaïne. L'étude montre que l'anesthésie périprostatique (blocage nerveux périprostatique, BNPP) est significativement plus efficace pour réduire la douleur pendant et après la biopsie prostatique comparativement à la technique utilisant le gel de lidocaïne et le tramadol. Des complications comme l'hématurie et la rectorragie sont mentionnées, mais l'étude d'Ecke et al. (336 patients) suggère que la biopsie prostatique transrectale est globalement une procédure à faible morbidité. Le taux de PSA et l'âge ont aussi un impact sur la perception de la douleur.
1. Prévalence de la Douleur et Inconfort liés à la Biopsie Prostatique
La biopsie prostatique transrectale échoguidée, bien qu'étant une procédure standard pour le diagnostic du cancer de la prostate, est souvent associée à une gêne significative pour les patients. Des études antérieures rapportent que 65 à 90% des patients éprouvent un inconfort, allant d'une sensation légère à une douleur intense accompagnée de diaphorèse et même de choc vagal, pouvant interrompre la procédure. Une étude a même révélé que 19% des patients refuseraient une deuxième biopsie sans anesthésie. Malgré cela, la plupart des centres effectuent la procédure sans anesthésie ni analgésie.
2. Étude comparative de deux méthodes d anesthésie
L'étude menée au CHU Mohammed VI de Marrakech visait à comparer l'efficacité de deux méthodes d'anesthésie pour réduire la douleur associée à la biopsie prostatique. Soixante patients ont été randomisés en deux groupes. Le groupe 1 (30 patients) a reçu 2 comprimés de tramadol (50mg) et 10ml de gel de lidocaïne à 2% par voie intrarectale. Le groupe 2 (30 patients) a reçu une injection de 10ml de lidocaïne à 2% dans les régions périprostatiques latérales et apicales (blocage nerveux périprostatique, ou BNPP). La douleur a été évaluée à trois moments : à l'introduction de la sonde (EVA1), pendant la biopsie (EVA2), et 20 minutes après (EVA3) à l'aide d'une échelle visuelle analogique (EVA).
3. Résultats de l étude et comparaison des méthodes d anesthésie
Les résultats montrent qu'il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes concernant l'EVA1 (douleur à l'introduction de la sonde). Cependant, le score moyen de douleur était significativement plus bas dans le groupe 2 (BNPP) pour l'EVA2 et l'EVA3, indiquant une meilleure efficacité du BNPP pour soulager la douleur pendant et après la biopsie. L'analyse multivariée, incluant l'âge, le volume prostatique, le taux de PSA et la présence de cancer, a confirmé que l'anesthésie périprostatique était supérieure à l'association tramadol/gel de lidocaïne intrarectal, surtout pour les patients âgés de moins de 65 ans. Bien que quelques études aient suggéré une plus grande sensibilité à la douleur chez les jeunes patients, cette étude n'a pas confirmé cette tendance au moment de la biopsie avec le BNPP.
4. Complications et morbidité associées à la biopsie prostatique
L'étude discute également des complications et de la morbidité associées à la biopsie prostatique transrectale échoguidée. Des complications mineures telles que l'hématurie (saignements urinaires) et des douleurs mictionnelles ont été observées, mais sans différence significative liée aux méthodes d'anesthésie. Une étude prospective par Ecke et al. (336 patients) a rapporté une faible morbidité, avec peu de complications majeures (rétention urinaire, fièvre). Les complications potentielles incluent également la rectorragie (saignements rectaux), la contamination néoplasique du trajet de ponction (risque faible mais existant), et une augmentation du taux de PSA post-biopsie, observée dans près de 90% des cas. La fréquence et l'importance des complications semblent faibles, renforçant l'idée que la biopsie prostatique est globalement une procédure bien tolérée.
5. Alternatives et considérations sur l anesthésie
Le document mentionne plusieurs alternatives au BNPP pour gérer la douleur de la biopsie prostatique, comme le gel de lidocaïne intrarectal, le tramadol intraveineux ou le diclofénac (voie intramusculaire, suppositoire ou orale), parfois associé à des benzodiazépines. Cependant, aucune étude n'a démontré la supériorité de ces alternatives par rapport au BNPP. L'efficacité du BNPP, bien qu'étant une procédure considérée comme invasive par certains, repose sur l'infiltration des faisceaux neurovasculaires périprostatiques, essentielle pour une anesthésie efficace. Des études, comme celle de Soloway et Obek, ont mis en évidence une réduction significative de l'inconfort et des saignements rectaux avec le BNPP. Malgré cela, des risques de fibrose, d'injection intravasculaire, et une inefficacité potentielle chez des patients ayant subi une RTUP (résection transurétrale de la prostate) sont mentionnés.
II.Anatomie de la Prostate et Rôle des Androgènes dans le Cancer de la Prostate
Le document décrit l'anatomie de la prostate, en particulier les différentes zones: la zone périphérique (ZP), la zone de transition (ZT), et la zone centrale (ZC). Il souligne le rôle des androgènes, notamment la dihydrotestostérone (5-alpha-dihydrotestostérone), dans la croissance et la sécrétion prostatique et leur lien avec le cancer de la prostate (CaP). L'implication de la prostate dans la miction est également abordée, ainsi que la relation entre l'anatomie prostatique et la localisation du cancer de la prostate lors des biopsies. L'importance de la localisation tumorale (ZP vs ZT) pour le diagnostic et la prise en charge est soulignée. Des formes particulières de cancer de la prostate (ADK colloïde, carcinome à petites cellules) sont mentionnées, ainsi que leur impact pronostique.
1. Anatomie Macroscopique de la Prostate
La prostate est décrite comme une glande située dans la partie antérieure du pelvis, entre la symphyse pubienne, le rectum, la vessie et l'aponévrose périnéale moyenne. Sa forme est celle d'un cône aplati, ferme et régulier, mesurant environ 30 mm de hauteur, 40 mm de largeur et 20 mm d'épaisseur chez l'adulte, pour un poids de 20 à 25 g. Cette description anatomique globale sert de base à la compréhension de la localisation des différentes zones prostatiques et de leur implication dans les procédures diagnostiques comme la biopsie.
2. Anatomie Zonale de la Prostate selon McNeal
Les travaux de John McNeal ont permis d'identifier quatre zones distinctes au sein de la prostate. Il y a trois zones glandulaires : la zone centrale (ZC), la zone périphérique (ZP), et la zone de transition (ZT). Une quatrième zone, non glandulaire, est le stroma fibromusculaire antérieur. La zone de transition, représentant seulement 5% du tissu glandulaire, est moins importante chez les jeunes sujets mais s'hypertrophie avec l'âge. La description détaillée de la structure tubulo-alvéolaire avec des plis et des concrétions protéiques (sympexions) fournit des informations cruciales sur l'histologie prostatique et la localisation des lésions.
3. Rôle de la Prostate dans la Miction
L'étude urodynamique par échographie transrectale permictionnelle a démontré un rôle actif de la prostate dans la miction. L'ouverture de l'urètre pendant la miction n'est pas passive mais active, régulée par le tonus adrénergique et le relâchement de la zone fibromusculaire antérieure. Bien que la contribution exacte de la prostate à la continence reste incertaine, elle représente une résistance importante qui se relâche activement pour faciliter le flux urinaire. Cette description de la fonction de la prostate dans le mécanisme mictionnel est importante pour comprendre l'impact des pathologies prostatiques sur les fonctions urinaires.
4. Androgénodépendance du Cancer de la Prostate
L'androgénodépendance du cancer de la prostate (CaP) est bien établie. La présence de récepteurs aux hormones stéroïdes dans le tissu prostatique confirme le contrôle hormonal sur la croissance et la sécrétion prostatique. Le nombre de ces récepteurs est plus élevé dans la zone périphérique (ZP), bien que l'activité de la 5-alpha réductase semble identique dans toute la glande. La 5-alpha-dihydrotestostérone, métabolite actif de la testostérone, joue un rôle principal. Cette information est essentielle dans la compréhension du développement et du traitement du CaP, soulignant l'importance des thérapies hormonales.
III.Diagnostic et Traitement du Cancer de la Prostate
Le diagnostic du cancer de la prostate est basé sur le toucher rectal (TR), le taux de PSA, et la biopsie prostatique. Le document décrit le score de Gleason, utilisé pour évaluer le grade de malignité. Il discute aussi les troubles mictionnels (dysurie, pollakiurie, hématurie) comme symptômes et les différentes options de traitement, incluant la surveillance active, la chirurgie (prostatectomie totale), et la radiothérapie, ainsi que les traitements hormonaux (agonistes de la LH-RH, antiandrogènes, œstrogènes). L'étude souligne l'importance du dépistage, même si la question du dépistage de masse reste débattue. La présence de formes familiales de cancer de la prostate multiplie le risque par 5.
1. Diagnostic du Cancer de la Prostate
Le diagnostic du cancer de la prostate repose sur plusieurs éléments. Le toucher rectal (TR) permet de détecter des anomalies de la prostate. Le dosage du PSA (antigène prostatique spécifique) dans le sang est un marqueur important, un taux élevé indiquant un risque accru. La biopsie prostatique, souvent transrectale et échoguidée, est la procédure de choix pour confirmer le diagnostic. Cette procédure est indiquée en cas d'anomalies au TR ou de taux de PSA élevés. Aux États-Unis, on estime à 500 000 le nombre de biopsies prostatiques réalisées chaque année, soulignant l'importance de cette technique dans le diagnostic du cancer de la prostate. Le document mentionne également le score de Gleason pour évaluer le grade de différenciation des cellules cancéreuses, reflétant l'agressivité de la tumeur. L'hétérogénéité des tumeurs rend parfois l'interprétation du score de Gleason complexe.
2. Symptômes et Évolution du Cancer de la Prostate
Le cancer de la prostate peut se manifester par des symptômes, notamment des troubles mictionnels. Ces troubles incluent la dysurie (difficulté à uriner), la pollakiurie (augmentation de la fréquence des mictions), les impériosités mictionnelles (besoin urgent et fréquent d'uriner), et potentiellement une rétention urinaire. L'hématurie (sang dans les urines), l'hémospermie (sang dans le sperme), et la dysérection sont des symptômes moins fréquents. L'extension du cancer peut se faire vers les espaces périprostatiques et les vésicules séminales, puis métastasées à distance, principalement aux ganglions obturateurs et aux os. La présence d'une forme familiale de cancer de la prostate (trois cas chez des apparentés du premier ou deuxième degré, ou deux cas diagnostiqués avant 55 ans) augmente considérablement le risque, multiplié par cinq.
3. Options Thérapeutiques et Surveillance Active
Le traitement du cancer de la prostate dépend de plusieurs facteurs, notamment le stade du cancer, l'âge du patient et son état de santé général. La surveillance active est une option viable lorsque l'espérance de vie est inférieure à 10 ans ou en cas de comorbidités importantes. Cette approche consiste à surveiller l'évolution du cancer sans traitement actif initial, sauf en cas d'apparition de symptômes. Pour les cancers localisés et un PSA inférieur à 15, la chirurgie (prostatectomie totale) et la radiothérapie sont deux modalités thérapeutiques équivalentes en termes d'efficacité. Pour les patients de moins de 65 ans, la chirurgie présente un avantage. Les traitements hormonaux, utilisant des agonistes de la LH-RH (pour supprimer la production de testostérone), des antiandrogènes et/ou des œstrogènes, sont utilisés pour traiter les cancers métastasés ou en cas d'échec des autres traitements, mais présentent des effets secondaires potentiels. La question du dépistage de masse reste débattue, l'Association Française d'Urologie recommandant actuellement un dépistage individuel pour les hommes de 50 à 75 ans.
IV.Techniques de Biopsie et Complications
Plusieurs techniques de biopsie prostatique sont décrites: la technique transrectale échoguidée, la technique digitoguidée et la technique transpérinéale. Le document détaille les risques et les complications potentielles, incluant les infections, les saignements (hématurie, rectorragie), la contamination néoplasique du trajet de ponction, et l'augmentation du taux de PSA post-biopsie. L'importance de l'antibioprophylaxie pour prévenir les infections est soulignée. L’impact de l’âge et du volume prostatique sur la douleur est aussi discuté.
1. Techniques de Biopsie Prostatique
Le document décrit plusieurs techniques de biopsie prostatique. La biopsie prostatique transrectale échoguidée est la méthode de référence, utilisant une sonde d'échographie transrectale pour guider l'aiguille de biopsie vers les zones suspectes de la prostate. Cette technique a remplacé la biopsie à l'aiguille guidée au doigt, qui ratait plus de 50% des adénocarcinomes. Une autre technique mentionnée est la biopsie transrectale digitoguidée, réalisée sans anesthésie, où l'index guide l'aiguille. L'utilisation de l'échographie transrectale est considérée comme un progrès majeur, améliorant la précision du prélèvement. La biopsie transpérinéale est également mentionnée, mais sans détails spécifiques dans ce passage. La technique et la précision du prélèvement sont cruciales, notamment pour le diagnostic des cancers antérieurs situés dans la zone de transition (ZT), parfois difficiles à détecter par des biopsies postérieures. Des images illustrant les techniques de ponction et la localisation des aiguilles sont fournies, précisant la profondeur de pénétration (23mm) et la taille minimale acceptable des carottes (10mm).
2. Anesthésie Locale pour la Biopsie Prostatique
L'inconfort lié à la biopsie prostatique est accentué par la durée de l'examen, le nombre de biopsies et la zone prostatique ciblée. Plusieurs techniques d'anesthésie locale sont discutées, la plus efficace étant l'injection de lidocaïne à 1% dans l'aire trapézoïdale sous l'apex de la prostate. Cette technique vise à anesthésier les pédicules neurovasculaires inférieurs et supérieurs. L'injection doit être surveillée échographiquement pour éviter une injection intravasculaire. La quantité de lidocaïne varie de 10 à 20 ml. D'autres approches sont mentionnées, comme le blocage nerveux périprostatique (BNPP), popularisé par Soloway en 2000, ainsi que l'utilisation de gel de lidocaïne intrarectal, souvent associé au tramadol par voie orale. Des études ont comparé l'efficacité analgésique de ces différentes approches, soulignant les avantages du BNPP en termes de réduction de la douleur pendant et après la procédure, bien que le BNPP soit considéré par certains auteurs comme une procédure invasive, avec un risque accru d'infection. Des alternatives comme le diclofénac sont également mentionnées mais aucune étude n'a prouvé leur supériorité sur le BNPP.
3. Complications de la Biopsie Prostatique
Le document aborde les complications potentielles liées à la biopsie prostatique. Les complications immédiates comme les saignements, la douleur intense, l'hypersudation ou le choc vagal sont rares. Des complications mineures, plus fréquentes, incluent l'hématurie, les douleurs mictionnelles et la fièvre. Une étude de Ecke et al. (336 patients) souligne la faible morbidité globale de la procédure. Des complications plus graves incluent la rétention urinaire, la rectorragie (saignements rectaux) et la contamination néoplasique du trajet de ponction (1 à 2% des cas), qui peut entraîner un pronostic sévère (100% de mortalité à 3 ans). L'augmentation du taux sérique du PSA après la biopsie est fréquente (près de 90% des cas), revenant à la normale en quelques semaines. L'antibioprophylaxie est recommandée pour prévenir les infections, en particulier chez les patients à risque (diabète, immunodépression).
