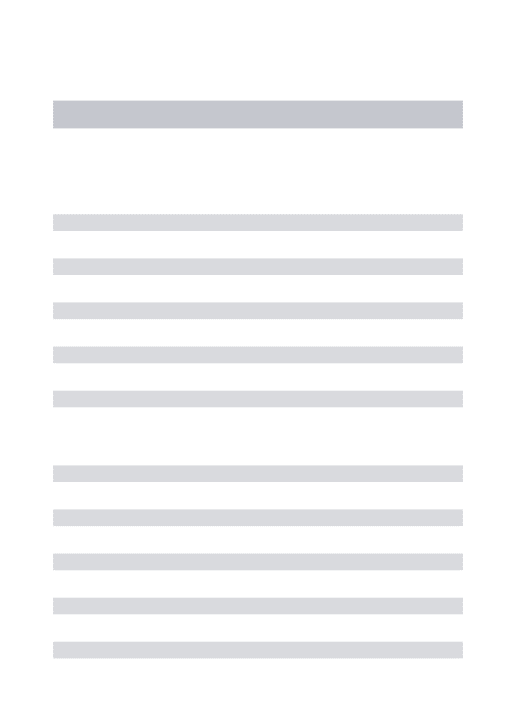
Fiabilité tests maladie cœliaque
Informations sur le document
| Auteur | Katerie Leclerc |
| instructor/editor | Dr Ernest Seidman |
| École | Université de Montréal |
| Spécialité | Nutrition |
| Type de document | Mémoire de maîtrise |
| city | Montréal |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 3.59 MB |
Résumé
I.La Maladie Cœliaque Définition et Facteurs de Risque
La maladie cœliaque (MC) est une entéropathie auto-immune causée par l'ingestion de gluten chez les personnes génétiquement prédisposées. L'inflammation intestinale et l'atrophie villositaire entraînent une malabsorption des nutriments, conduisant à des carences. Les groupes à risque comprennent les personnes atteintes de diabète de type 1 et les proches parents de patients cœliaques. Le diagnostic repose sur une biopsie duodénale, rendant des tests de dépistage non invasifs cruciaux pour identifier les individus nécessitant une biopsie. Des tests sérologiques, tels que les dosages des anticorps anti-transglutaminase tissulaire (anti-tTG) et des anticorps anti-endomysium (EMA), ainsi que les tests d'anticorps anti-gliadine (AAG), sont utilisés pour le dépistage.
1. Définition de la Maladie Cœliaque
La maladie cœliaque est présentée comme une entéropathie auto-immune. Cette définition souligne son caractère auto-immun, impliquant une réaction anormale du système immunitaire contre les tissus du corps. La cause déclenchante est l'ingestion de gluten, une protéine présente dans le blé, l'orge et le seigle. Seules les personnes génétiquement prédisposées développent la maladie. L'ingestion de gluten provoque une inflammation de l'intestin et une atrophie villositaire, endommageant les villosités intestinales responsables de l'absorption des nutriments. Ceci entraîne une malabsorption, responsable de carences nutritionnelles importantes chez les patients atteints. Le texte insiste sur l'importance de tests de dépistage performants et moins invasifs que la biopsie duodénale, le diagnostic de référence, pour identifier plus efficacement les patients cœliaques.
2. Groupes à Risque de Maladie Cœliaque
Le document identifie plusieurs groupes de personnes présentant un risque accru de développer la maladie cœliaque. Parmi ceux-ci, les personnes atteintes de diabète de type 1 sont mentionnées. La présence du diabète de type 1 semble augmenter la probabilité de développer également une maladie cœliaque. De plus, les parents proches (parents, frères et sœurs) des patients cœliaques sont également considérés comme étant à risque plus élevé. L'hérédité joue un rôle important dans le développement de cette maladie auto-immune. Cette prédisposition génétique, combinée à l'exposition au gluten, augmente la probabilité de développer la maladie. La nécessité de tests de dépistage efficaces et précoces est soulignée, afin de diagnostiquer et traiter la maladie cœliaque avant l'apparition de complications sévères liées aux carences nutritionnelles.
3. Nécessité de Tests de Dépistage Non Invasifs
Le texte met en avant l'importance de développer et d'utiliser des tests de dépistage de la maladie cœliaque qui soient à la fois performants et peu invasifs. Actuellement, le diagnostic définitif repose sur une biopsie duodénale, une procédure médicale invasive. La recherche de tests alternatifs, moins contraignants pour le patient, est donc une priorité. Ces tests devraient permettre de sélectionner les individus les plus susceptibles d'avoir une confirmation de la maladie par biopsie, tout en détectant la majorité des cas. L'objectif est d'améliorer le diagnostic précoce et la prise en charge de la maladie cœliaque, permettant un traitement plus rapide et une meilleure qualité de vie pour les patients.
II.Tests de Dépistage de la Maladie Cœliaque
L'étude compare la précision de différentes trousses de dépistage commercialisées pour la MC, notamment les tests anti-tTG (utilisant des substrats de tTG de cobaye et de tTG humaine recombinante) et les tests anti-EMA. L'objectif est d'évaluer leur performance par rapport au test anti-gliadine (AAG), une méthode plus ancienne. L'étude, menée à l'hôpital Sainte-Justine au Québec sur 230 patients (âge moyen 7,1 ans, 60 enfants de moins de 2 ans, 26 diabétiques de type 1), compare la précision, la sensibilité et la spécificité de ces tests. Les résultats indiquent une performance similaire des tests anti-tTG et anti-EMA, supérieures au test AAG.
1. Objectif de l étude et Méthodes
L'étude principale vise à comparer la précision des tests de dépistage de la maladie cœliaque disponibles sur le marché. Elle se concentre sur trois types de tests: les tests anti-transglutaminase tissulaire (anti-tTG), les tests anti-endomysium (anti-EMA), et les tests à base d'anti-gliadine (anti-AAG), ce dernier étant une méthode plus ancienne. Différentes marques commerciales de tests anti-tTG et anti-EMA sont comparées. L'étude prospective a été réalisée à l'hôpital Sainte-Justine au Québec et incluait 230 patients (âge moyen 7,1 ans; 60 enfants de moins de 2 ans; 26 diabétiques de type 1). Chaque patient a subi une biopsie duodénale pour confirmation du diagnostic, et un échantillon sanguin a été prélevé avant la biopsie pour les tests sérologiques. La méthode employée pour les tests anti-AAG a été validée précédemment; des ajustements mineurs ont été effectués sur la procédure pour les tests anti-tTG et anti-EMA afin d'optimiser la réactivité. Les sérums ont été testés en double, contrairement à la méthode de référence qui utilisait quatre exemplaires. L'objectif est d'évaluer la performance des tests (précision, sensibilité, spécificité) dans l'ensemble de la population, ainsi que chez les enfants de moins de deux ans et les patients diabétiques.
2. Comparaison des Tests Anti tTG et Anti EMA
L'analyse se concentre principalement sur la comparaison des tests anti-tTG et anti-EMA, car le test anti-AAG s'est montré globalement moins performant. L'étude a utilisé 8 trousses commerciales différentes pour les tests anti-tTG (utilisant à la fois des substrats de tTG de cobaye et de tTG humaine recombinante) et anti-EMA. La précision globale des tests anti-tTG était supérieure à 95%, et même supérieure à 98% pour les enfants de moins de 2 ans. Cependant, pour les patients diabétiques, la précision des trousses a diminué de manière significative, excepté pour une seule. Il n'y a pas eu de différence significative observée entre les trousses utilisant la tTG humaine recombinante et celles utilisant la tTG de cobaye dans la population globale étudiée. Les performances des tests anti-tTG et anti-EMA étaient semblables en termes de valeurs prédictives positives et négatives, ainsi que de précision globale. L'étude n'a pas constaté de diminution de la précision des tests anti-tTG ou anti-EMA chez les enfants de moins de deux ans. Cependant, la précision était nettement moindre chez les enfants atteints de diabète de type 1.
3. Performance du Test Anti Gliadine AGA
Le test anti-gliadine (AGA) s'est avéré globalement moins précis que les tests anti-tTG et anti-EMA, tant dans la population globale que dans les sous-groupes d'enfants de moins de 2 ans et d'enfants diabétiques. Cette infériorité est mise en évidence par les résultats de l'étude. Cette conclusion souligne l'importance de choisir des tests de dépistage plus performants que le test AGA, particulièrement pour une meilleure détection et un diagnostic plus fiable de la maladie cœliaque. Le texte ne détaille pas les raisons de cette infériorité mais suggère que les tests anti-tTG et anti-EMA sont actuellement préférables pour le dépistage de la maladie cœliaque, notamment en raison de leur meilleure précision et fiabilité.
III.Prévalence et Facteurs de Risque Génétiques
La prévalence de la MC varie selon les populations étudiées. Des études canadiennes et internationales rapportent une prévalence allant de 1/67 à 1/105 dans la population générale, et des prévalences beaucoup plus élevées chez les groupes à risque, notamment les enfants suspectés de MC (jusqu'à 1/6), les diabétiques de type 1 (1/10 à 1/33), et les membres de la famille proche des patients cœliaques (1/5 à 1/25). L'étude mentionne également une possible prédominance féminine. Un rôle majeur des gènes HLA, notamment HLA-DQ2 et DQ8, est mis en évidence, ainsi que l'association avec le gène CTLA-4.
1. Prévalence de la Maladie Cœliaque Variations selon les populations
La prévalence de la maladie cœliaque varie considérablement selon les études et les populations étudiées. Une étude canadienne mentionne une prévalence nord-américaine située entre 1/320 et 1/105, avec des valeurs extrêmes allant jusqu'à 1/53. Ces données sont comparables aux estimations européennes (1/300 à 1/130). Des études spécifiques chez les enfants montrent une prévalence allant de 1/285 à 1/67. La NASPGHAN (Société nord-américaine de gastro-entérologie, hépatologie et nutrition pédiatrique) estime la prévalence chez les enfants de 2,5 à 15 ans entre 1/300 et 1/80. Chez les adultes américains à risque, la prévalence serait de 1/67. Pour les enfants chez qui on suspecte une maladie cœliaque, la prévalence se situe entre 1/22 et 1/6. Une étude sur les populations occidentales à risque en Europe et en Amérique du Nord rapporte une prévalence de 1/90 chez les enfants suspectés. Aux États-Unis, une étude sur une population à risque a trouvé une prévalence de 1/57. En Argentine, une étude sur des couples effectuant des examens prénuptiaux a révélé une prévalence de 1/167. D'autres études, en Italie (1/204 à 1/175), en Turquie (1/77), et au Moyen-Orient (Iran 1/164, Israël 1/157, Syrie 1/66), présentent des variations significatives. Ces différences soulignent la complexité de l'estimation de la prévalence et la nécessité d'études plus spécifiques selon les populations.
2. Prévalence au sein de la Famille Proche et chez les Diabétiques
L'hérédité joue un rôle majeur dans la maladie cœliaque, en particulier l'implication des gènes HLA. La prévalence est donc plus élevée chez les membres de la famille proche. Plusieurs études évaluent la prévalence chez les parents au premier degré entre 1/25 et 1/5, voire jusqu'à 1/10 selon d'autres données. Une étude américaine sur des familles avec au moins deux enfants atteints de MC a observé une prévalence de près de 1/7 chez les parents, 1/5 chez les frères et sœurs, 1/7 chez les enfants et 1/5 pour la parenté au deuxième degré. Un taux de concordance supérieur à 70% a été rapporté chez les jumeaux monozygotes. La prévalence de la maladie cœliaque est également plus élevée chez les enfants atteints de diabète de type 1 (DM1). Des études européennes indiquent une prévalence entre 1/33 et 1/10, alors qu'en Amérique du Nord, elle serait entre 1/23 et 1/13. Une étude compilée a trouvé une prévalence variant entre 1/103 et 1/6, avec une moyenne de 1/22. Des études autrichienne (1/10), anglaise (1/22), franco-canadienne (1/26) et saoudienne (1/20) confirment cette association.
3. Facteurs Génétiques et Prédisposition au Sexe Féminin
L'implication des gènes HLA dans la prédisposition génétique à la maladie cœliaque est mise en évidence. Des études ont également exploré d'autres gènes candidats, tels que CTLA-4 situé sur le chromosome 2q33, associé à la maladie cœliaque et au diabète de type 1. Une étude française a révélé la présence d'un allèle de CTLA-4 chez 82% des patients cœliaques contre 65% dans le groupe contrôle. Certaines études suggèrent une prévalence plus élevée de la maladie cœliaque chez les femmes. Une étude argentine a observé une prédominance féminine de 2:1, tandis qu'une étude américaine rapporte une prédominance de 2,9. Cependant, le document souligne la prudence nécessaire quant à cette observation, car les femmes consultent plus fréquemment les spécialistes pour divers troubles fonctionnels, ce qui pourrait biaiser les résultats. Le document souligne ainsi la complexité des facteurs génétiques et de l'influence du sexe sur la prévalence de la maladie cœliaque.
IV.Manifestations Cliniques et Diagnostic
Les symptômes de la MC varient selon l'âge. Chez les enfants (souvent entre 6 et 24 mois), on observe des retards de croissance, diarrhée chronique, distension abdominale et irritabilité. Chez les adultes, la présentation peut être plus atypique ou même silencieuse, rendant le diagnostic difficile. L'évolution des critères diagnostiques souligne l'importance croissante des tests sérologiques (anti-tTG et EMA) avant la biopsie. L'étude met en lumière la complexité du diagnostic, notamment chez les enfants de moins de deux ans et les patients diabétiques, soulignant la nécessité de tests de dépistage précis.
1. Manifestations Cliniques de la Maladie Cœliaque chez l Enfant et l Adulte
Les manifestations cliniques de la maladie cœliaque varient selon l'âge du patient. Chez les enfants, les symptômes apparaissent généralement entre 6 et 24 mois, après l'introduction du gluten dans l'alimentation. On observe des retards de croissance, une diarrhée chronique, une distension abdominale, une hypotonie musculaire et une irritabilité. Les selles sont volumineuses et nauséabondes en raison de la malabsorption des graisses. L'enfant peut présenter une pâleur et une maigreur importante. Avant le diagnostic, la sévérité des lésions intestinales et la présence de pathologies extra-intestinales permettent de classifier la maladie en trois formes: classique (diarrhée chronique, perte de poids, distension abdominale), silencieuse (absence de symptômes, détectée par dépistage), et atypique (symptômes moins spécifiques). Chez l'adulte, la présentation est souvent atypique ou silencieuse, rendant le diagnostic plus difficile. Même dans les cas asymptomatiques, une atrophie villositaire et des taux élevés d'anticorps (anti-tTG, anti-EMA, anti-gliadine) peuvent être présents. Il est important de noter que la définition de la maladie peut varier d’une étude à l’autre, influençant les résultats de prévalence.
2. Aspect Histologique et Classification de Marsh
La maladie cœliaque, aussi appelée entéropathie au gluten, se caractérise par une atteinte intestinale. Une biopsie duodénale ou jéjunale permet d'observer les anomalies de la muqueuse. On observe un aplatissement de la muqueuse, une hyperplasie des cryptes et une infiltration de la lamina propria par des lymphocytes et des cellules plasmatiques. L'analyse microscopique se concentre sur les lymphocytes intra-épithéliaux (LIE), l'atrophie des villosités et l'hyperplasie des cryptes. Ces critères permettent de classer les échantillons selon la classification histopathologique modifiée de Marsh. Cette classification permet une évaluation de la sévérité de l'atteinte intestinale, influencant le pronostic et la prise en charge du patient. La biopsie duodénale reste la méthode de référence pour le diagnostic de la maladie cœliaque, bien que les tests sérologiques soient de plus en plus importants pour le dépistage.
3. Évolution des Critères Diagnostiques
Les critères diagnostiques de la maladie cœliaque ont évolué. En 1970, les directives de l'ESPGHAN (Société européenne de gastro-entérologie, hépatologie et nutrition pédiatrique) reposaient sur trois phases: aplatissement de la muqueuse à la biopsie, disparition des symptômes sous régime sans gluten (DSG), et réapparition des symptômes après réintroduction du gluten. Les lignes directrices de 2005 diffèrent. Elles privilégient l'identification des individus susceptibles par des tests sérologiques (anti-tTG, anti-EMA), la confirmation de la présence des gènes HLA-DQ2 et DQ8, et la vérification de l'absence de déficit en IgA. Pour les enfants de plus de deux ans avec une biopsie positive répondant bien à la DSG, une deuxième biopsie n'est plus nécessaire. Ces modifications reflètent l'importance croissante des tests sérologiques dans le diagnostic de la maladie cœliaque et visent à simplifier et à rendre le processus diagnostique plus efficace.
V.Gestion de la Maladie et Aspects Socio économiques
Le traitement de la MC repose sur un régime sans gluten à vie. L'adhésion à ce régime est cruciale pour prévenir les complications à long terme, comme les carences nutritionnelles (anémie ferriprive, déficit en vitamines et minéraux), les problèmes de croissance chez les enfants, l'ostéoporose, l'infertilité et les complications de la grossesse. Le coût élevé des aliments sans gluten est aussi mentionné, avec une comparaison entre le Canada et l'Italie concernant la prise en charge financière de ces produits. Au Québec en 2002, le chiffre d'affaires des produits de boulangerie dépassait 828 M$, illustrant l'importance du gluten dans l'alimentation courante.
1. Régime Sans Gluten et Adhésion au Traitement
Le traitement de la maladie cœliaque repose sur l'adoption d'un régime sans gluten (RSG) strict et à vie. L'adhésion à ce régime est cruciale pour prévenir les complications à long terme. Le document mentionne que la compliance au régime sans gluten peut varier. Les patients diagnostiqués lors d'un dépistage de masse (asymptomatiques) ont une compliance plus faible que ceux ayant une présentation classique de la maladie. Certains jeunes ont des difficultés à respecter le régime, notamment en raison de la disparition temporaire des symptômes à l'adolescence. De plus, une faible quantité de gluten ingérée ne provoque pas toujours de symptômes, encourageant certains patients à déroger au régime. Les études sur la compliance sont parfois difficiles à interpréter car la capacité de certains jeunes à se rappeler précisément ce qu'ils ont mangé est limitée. Certaines différences entre l'apport observé et celui rapporté sont intentionnelles, mais la plupart sont fortuites. Des études basées sur les résultats de biopsies seraient plus fiables pour évaluer la compliance au régime sans gluten.
2. Conséquences d un Traitement Inapproprié et Complications
L'absence de traitement de la maladie cœliaque peut entraîner de nombreuses complications. L'anémie ferriprive est l'anomalie la plus fréquente chez les patients non traités, affectant jusqu'à 8% des patients selon une étude américaine. Les taux de ferritine sérique, de folate érythrocytaire et de vitamine B12 sont associés à l'atrophie des villosités. Des carences en protéines, zinc et vitamine A peuvent également survenir. Chez les femmes enceintes non traitées, le risque de bébé de faible poids à la naissance est multiplié par six. Les risques de fausses couches sont également plus élevés, mais reviennent à la normale sous DSG. L'infertilité est plus fréquente, mais certaines études la considèrent comme un facteur de risque plutôt qu'une complication. Le non-traitement augmente le risque de fractures jusqu'à 7 fois. Ces informations soulignent l'importance d'un diagnostic précoce et d'une adhésion rigoureuse au régime sans gluten pour prévenir ces complications.
3. Aspects Socio économiques de la Maladie Cœliaque
La maladie cœliaque a des implications socio-économiques importantes. Le coût élevé des aliments sans gluten est un facteur majeur, car la plupart des produits de boulangerie contiennent du gluten. Le texte donne l'exemple du coût d'un pain à hamburger sans gluten, significativement plus élevé que le pain régulier. En 2002, plus de 828 millions de dollars de produits de boulangerie ont été vendus au Québec. La consommation moyenne de farine de blé par Canadien était de 53 kg la même année. En 1996, les dépenses annuelles moyennes par habitant pour le pain étaient de 54,21 $, et de 250 $ pour les autres produits de boulangerie. Contrairement au Canada, le système de santé italien prend en charge les coûts des aliments sans gluten, soit environ 200$ CAN par mois, ou 2400$ CAN par année. Ces données illustrent l'impact financier de la maladie cœliaque sur les individus et les systèmes de santé.
