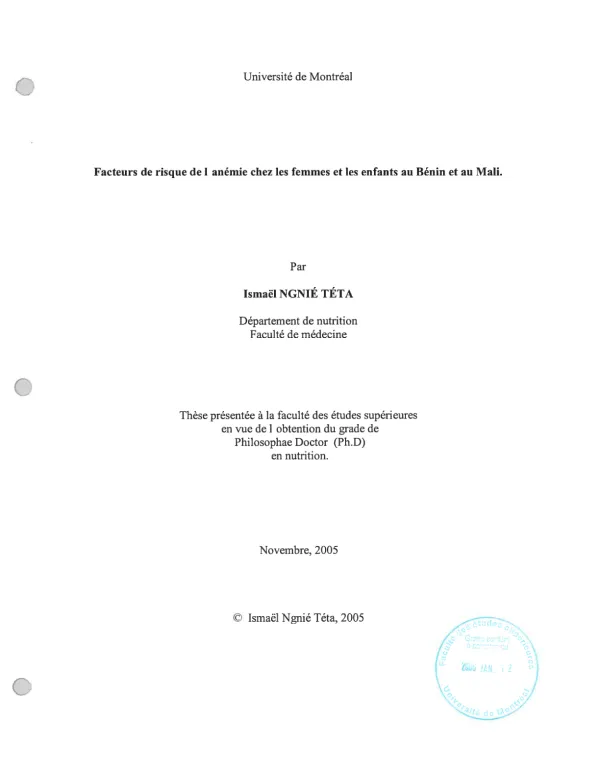
Anémie au Bénin et Mali: Facteurs de risque
Informations sur le document
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 6.89 MB |
Résumé
I.Revue de la Littérature Anémie au Bénin et au Mali
Cette section explore la littérature sur l'anémie maternelle et infantile, notamment la carence en fer, principale cause d'anémie dans les pays pauvres. Elle détaille les conséquences de l'anémie (mortalité maternelle et infantile, impact sur le développement cognitif et la productivité), et les déterminants individuels et contextuels de l'anémie. L'étude souligne l'importance de l'analyse multiniveau en santé publique pour comprendre les facteurs de risque de l'anémie au niveau individuel et communautaire. Des références clés comme l'OMS (2001) et d'autres études sont citées pour étayer les informations sur le métabolisme du fer, les besoins martiaux pendant la grossesse, et le rôle des infections (paludisme notamment) dans la prévalence de l'anémie.
1. Définition de l anémie et de la carence en fer
Cette section introduit la définition de l’anémie, caractérisée par une baisse de l’hémoglobine et une diminution de la masse des globules rouges. Plusieurs origines sont mentionnées : nutritionnelle (carence en fer, folate, vitamine B12), hémolytique (drépanocytose, thalassémie), infectieuse (infections intestinales, paludisme), hémorragique, ou liées à des problèmes de malabsorption. L’OMS définit l’anémie nutritionnelle comme un état d’hémoglobinémie inférieure à la normale dû à une carence en nutriments essentiels. Trois degrés d’anémie sont distingués : légère (10,0 à 10,9 g/dl), modérée (7,0 à 9,9 g/dl), et sévère (inférieure à 7,0 g/dl), avec un seuil de 5,0 g/dl considéré comme très sévère et associé à des risques importants de mortalité maternelle et infantile. La section souligne l'importance de la carence en fer comme cause principale d'anémie dans les pays pauvres, responsable de près de la moitié des cas selon l'OMS (2001). D'autres carences nutritionnelles (folate, vitamine B12, vitamine A) sont également mentionnées comme facteurs prédisposants.
2. Conséquences de l anémie sur la santé et le développement
Cette partie détaille les conséquences de l’anémie sur la santé des populations et le développement socio-économique. Dans sa forme sévère, elle est associée à une augmentation significative de la mortalité maternelle et infantile (Brabin et al., 2001; Ross et Thomas, 1996). L’anémie affecte le développement physique et cognitif des enfants (Scrimshaw et al., 1984; Lozoff, 2000), ainsi que les capacités physiques et la productivité des adultes (Haas et Brownlie, 2001). L'OMS (2001) estime à deux milliards le nombre de personnes anémiées dans le monde, soulignant l'enjeu majeur de santé publique que représente l'anémie, particulièrement chez les jeunes enfants et les femmes en âge de procréer. Les conséquences négatives sur la grossesse et le nouveau-né sont également évoquées, sans plus de détails dans cette section générale.
3. Déterminants individuels et contextuels de l anémie
Cette section explore les facteurs individuels et contextuels influençant le risque d’anémie. Les facteurs individuels incluent les caractéristiques biologiques (âge, sexe), physiologiques (grossesse), et l’état de santé (infections). Les facteurs contextuels englobent l’environnement familial et le milieu de vie, incluant le statut socio-économique, le niveau d’éducation, l’accès à l’eau potable, et le développement communautaire. L’étude mentionne le rôle des infections, notamment le paludisme en Afrique de l’Ouest, dans l’augmentation de la prévalence de l’anémie (Korenromp et al., 2004; Ngnié-Téta et al., 2004). La section prépare le terrain pour l’utilisation de l’analyse multiniveau, qui permet d’évaluer l’influence des facteurs individuels et contextuels sur le risque d’anémie. Elle met l'accent sur la complexité des interactions entre les différents facteurs et la nécessité de les considérer à différents niveaux d'analyse.
4. Utilisation de l analyse multiniveau en santé publique
La dernière partie de la revue de littérature présente l’analyse multiniveau comme une méthode appropriée pour étudier les déterminants de l’anémie. Elle explique que cette approche permet de prendre en compte la variabilité inter-individus et intergroupes (effets aléatoires) et de quantifier la contribution de chaque niveau d’analyse (individuel et communautaire). Des études comparant les résultats d’analyses multivariées classiques et multiniveaux sont citées, soulignant la capacité de l’analyse multiniveau à identifier des facteurs de risque qui pourraient être négligés par les méthodes classiques. En comparant les résultats des analyses multivariées « naïves » à ceux obtenus avec l'analyse multiniveau, la section mentionne que les analyses classiques sous-estiment souvent la variance associée aux effets fixes des variables prédictives, influençant la significativité des effets. La section introduit ainsi logiquement la méthodologie employée dans l’étude.
II.Méthodologie Enquêtes Démographiques et de Santé EDS
L'étude utilise les données des Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS) de 2001 au Bénin et au Mali. Ces enquêtes nationales ont mesuré l'hémoglobinémie de 3125 femmes et 2052 enfants béninois, et de 3787 femmes et 2462 enfants maliens. Environ 65% des femmes et 82% des enfants étaient anémiés. L'analyse comprend des modèles multivariés et multiniveaux pour identifier les facteurs de risque d'anémie légère, d'anémie modérée, et d'anémie sévère, en tenant compte des niveaux individuels et communautaires. La marge d'erreur des enquêtes est inférieure à 5%, attestant de leur fiabilité.
1. Source des données Enquêtes Démographiques et de Santé EDS
L’étude tire ses données des Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS) menées au Bénin et au Mali en 2001. Le programme EDS, déployé dans plus de 80 pays en développement, collecte des données à l’échelle nationale. L’enquête standard comprend trois questionnaires : un questionnaire ménage, un questionnaire individuel pour les femmes en âge de procréer, et un questionnaire communautaire sur l’accès aux services de santé. Macro International, en collaboration avec les ministères de la santé des deux pays, a développé ces questionnaires. La méthodologie détaillée de l’enquête est disponible dans les publications de ORC Macro (1996, 1997). Les données sur l’accès aux services de base (eau, électricité, hygiène) sont uniquement disponibles pour le Bénin dans cette enquête spécifique. Les rapports EDS du Bénin (EDSB-III, 2001) et du Mali (EDSM-II1, 2001) contiennent des informations plus détaillées, y compris les questionnaires spécifiques à chaque pays. L'étude précise que les données utilisées sont les seules données fiables disponibles à l'échelle nationale pour les cinq dernières années précédant l'étude, concernant l'hémoglobinémie des femmes et des enfants.
2. Taille de l échantillon et qualité des données
L’hémoglobinémie a été mesurée chez un échantillon important : 3125 femmes et 2052 enfants au Bénin, et 3787 femmes et 2462 enfants au Mali. Au total, environ 65 % des femmes et 82 % des enfants étaient anémiés. Parmi les anémiés, 60 % des femmes et 25 % des enfants présentaient une anémie légère. La qualité des données est considérée comme bonne. L’erreur de sondage, mesurant la variabilité des réponses d’un échantillon à l’autre, est inférieure à 5 % dans les deux pays. Concernant la qualité des mesures, les erreurs de collecte d’information, d’interprétation, de codage, et de saisie sont jugées minimales grâce à la formation approfondie (quatre semaines) des enquêteurs et enquêtrices. La formation pour les prélèvements sanguins a été assurée par des spécialistes nationaux et des experts du Center for Disease Control américain (CDC) et de ORC Macro. Le protocole détaillé de test d’anémie est publié par Macro International (2000).
3. Limitations des données et analyse multiniveau
Malgré la qualité des données, l’étude mentionne certaines limitations. L’utilisation de données transversales rend difficile l’analyse des facteurs causaux et l’interprétation de la relation entre les facteurs de risque et l’anémie. L’étude mentionne que le biais de sélection est possible car seuls les survivants ont été interviewés. Il est difficile d’évaluer la contribution de l’anémie aux décès des non-survivants. De plus, la compréhension des raisons de la localisation des individus (rural/urbain) est limitée. Il est possible que des personnes ayant des problèmes de santé migrent vers des zones défavorisées. Cependant, l’analyse multiniveau atténue cette limite en isolant les effets individuels des effets de contexte. Malgré ces limites, les données EDS sont considérées comme une source précieuse en raison de leur exhaustivité et de leur représentativité à l’échelle nationale. L’étude utilise des modèles à deux niveaux hiérarchiques (individu et communauté) en raison du faible nombre d'enfants de moins de 5 ans par femme et de femmes par ménage.
III.Résultats Facteurs de Risque d Anémie
Les résultats montrent que l'âge est un facteur de risque d'anémie chez les enfants, particulièrement les plus jeunes (6-35 mois). Chez les enfants béninois, l'âge de l'enfant et le niveau d'éducation de la mère sont associés à l'anémie légère. Au Mali, l'immunisation incomplète est un facteur associé. L'âge, le retard de croissance, et les infections sont associés à l'anémie modérée à sévère dans les deux pays. Chez les femmes, la grossesse est un facteur majeur d'anémie modérée à sévère, tandis que l'accès à une source d'eau potable et le niveau de développement communautaire (Bénin) et la vie en milieu rural (Mali) influent sur l'anémie légère. L'analyse multiniveau révèle que 8% du risque d'anémie modérée à sévère au Bénin et 15% au Mali sont attribuables aux effets de contexte.
1. Facteurs de risque d anémie légère chez les enfants
L'analyse des données EDS révèle des facteurs de risque spécifiques pour l'anémie légère chez les enfants. Au Bénin, l'âge de l'enfant et le niveau d'éducation de la mère apparaissent comme des facteurs significatifs. Plus précisément, les enfants plus jeunes sont plus à risque, et un faible niveau d'éducation maternelle est corrélé à une plus forte prévalence d'anémie légère. En revanche, au Mali, c'est le statut vaccinal qui se distingue comme facteur déterminant de l'anémie légère. Des enfants non complètement vaccinés présentent un risque accru d'anémie légère. Ces résultats suggèrent des différences contextuelles importantes entre les deux pays quant aux déterminants de l'anémie légère, même si l'âge de l'enfant apparaît comme un facteur commun. Ces disparités mettent en évidence l'influence des facteurs socioculturels et des politiques de santé publique sur la prévalence de l'anémie légère chez les enfants.
2. Facteurs de risque d anémie modérée à sévère chez les enfants
Pour les formes plus graves d'anémie (modérée à sévère), les résultats montrent une association significative avec l'âge, le retard de croissance et les infections, et ce dans les deux pays. Les enfants plus jeunes sont à nouveau plus vulnérables. Le retard de croissance est un indicateur fort de malnutrition et de risques sanitaires accrus, également corrélé à l'anémie. Les infections, facteur causal important, aggravent l’état de santé des enfants et augmentent leur susceptibilité à l'anémie. Au Bénin, l'utilisation de moustiquaires et un faible niveau d'éducation maternelle sont également associés à l'anémie modérée à sévère, soulignant l’importance de la prévention du paludisme et de l’éducation parentale. Au Mali, le statut socio-économique et la vie en milieu rural apparaissent comme des facteurs supplémentaires. Ces résultats confirment le rôle important des facteurs individuels et contextuels dans la prévalence de l'anémie modérée à sévère chez les enfants.
3. Facteurs de risque d anémie chez les femmes
L’analyse des données pour les femmes révèle des facteurs de risque spécifiques selon le degré d'anémie et le pays. Au Bénin, l'accès à des sources d'eau potable non protégées et un faible niveau de développement communautaire sont associés à l'anémie légère. Pour l'anémie modérée à sévère, la grossesse et un faible niveau d'éducation constituent des facteurs de risque importants. La grossesse amplifie considérablement le risque d'anémie, notamment à partir du deuxième trimestre. Au Mali, la vie en milieu rural est associée à l'anémie légère. Pour l'anémie modérée à sévère, la grossesse, la taille du ménage (surpeuplement) et le faible statut socio-économique apparaissent comme déterminants majeurs. Ces résultats indiquent l'influence combinée de facteurs liés à la santé, à l'environnement et au statut socio-économique dans le risque d'anémie chez les femmes.
4. Effets de contexte et analyse multiniveau
L'analyse multiniveau, intégrant les effets de contexte, apporte des éclaircissements supplémentaires. Elle révèle que 8 % du risque d'anémie modérée à sévère au Bénin et 15 % au Mali sont attribuables aux effets de contexte (communautaire). Cependant, ces effets contextuels contribuent pour moins de 3 % au risque d'anémie légère. Cela suggère que les facteurs individuels et liés au ménage sont prépondérants dans l'explication de la prévalence de l'anémie légère, tandis que l'influence du contexte communautaire est plus marquée pour les formes d'anémie plus sévères. Cette découverte a des implications importantes pour la planification des interventions de santé publique, indiquant la nécessité d'interventions ciblées à différents niveaux (individuel, communautaire).
IV.Discussion Implications et Recommandations
L'étude met en évidence la forte prévalence de l'anémie au Bénin et au Mali, et identifie des facteurs de risque individuels et contextuels. L'impact des infections (notamment le paludisme) est souligné, avec l'utilisation de moustiquaires comme mesure préventive efficace. L'importance de la lutte contre les infections et de l'amélioration de la santé maternelle, notamment le suivi de la grossesse, sont cruciales. Les résultats suggèrent que des stratégies nationales de lutte contre l'anémie, ciblant les facteurs de risque identifiés, sont nécessaires au Bénin et au Mali. La supplémentation en fer pour les femmes enceintes est recommandée. L’étude souligne que l’anémie modérée à sévère nécessite une attention prioritaire.
1. Importance de la lutte contre les infections et la carence en fer
La discussion souligne l'importance de la lutte contre les infections, notamment le paludisme, comme stratégie majeure pour réduire la prévalence de l'anémie, particulièrement les formes modérées à sévères. L'utilisation de moustiquaires imprégnées est mise en avant comme une méthode préventive efficace. Cependant, l'accès aux moustiquaires reste un défi majeur dans les populations pauvres du Bénin et du Mali, avec des disparités régionales importantes. L'étude rappelle qu'il est nécessaire de combiner la lutte contre les infections avec la lutte contre la carence en fer, par le biais de la supplémentation, la fortification des aliments ou la diversification alimentaire. Malgré l'efficacité démontrée de la lutte contre la malaria pour réduire l'anémie sévère, il est souligné que la prévention de la carence en fer tend à être moins prioritaire dans la planification des interventions en raison des contraintes de ressources et de la nécessité de répondre aux urgences sanitaires les plus immédiates, comme le souligne l'étude de Verhoef et West (2003).
2. Implications des résultats pour la planification des interventions
L'analyse multiniveau a révélé une faible proportion de la variation du risque d'anémie attribuable aux effets de contexte (communautaire), variant entre 2% et 15%. Cela suggère que les facteurs de risque individuels et liés au ménage sont prédominants. Cette observation a des implications importantes pour la planification des interventions : des programmes nationaux, et non spécifiques à chaque région, peuvent être mis en place pour lutter contre l'anémie. L'étude recommande de cibler des interventions sur la lutte contre les infections (vaccination, moustiquaires, hygiène alimentaire) chez les enfants et un suivi adéquat de la grossesse chez les femmes. La faible variation inter-communautaire de la prévalence d'anémie suggère qu'un programme efficace dans une région du pays aurait de fortes chances de succès dans d'autres régions. Cela plaide pour l'établissement de stratégies nationales de lutte contre l'anémie au Bénin et au Mali.
3. Recommandations pour la prévention et le traitement de l anémie
La section conclut en soulignant l'importance de la prévention de l'anémie, en particulier avant la grossesse. Des stratégies durables sont proposées, telles que la fortification des aliments de base, l’éducation des communautés à des régimes alimentaires riches en fer et en nutriments favorisant son absorption, ainsi que des mesures de santé publique pour les anémies non nutritionnelles. Un plaidoyer soutenu auprès des décideurs politiques et des bailleurs de fonds internationaux est jugé indispensable pour mettre en œuvre ces mesures. Cependant, la supplémentation en fer pour les femmes enceintes est considérée comme incontournable pour prévenir et traiter les anémies modérées et sévères durant la grossesse. La discussion met l’accent sur la nécessité de focaliser les efforts sur l’anémie modérée à sévère, en raison de ses conséquences graves sur la santé, tout en reconnaissant l'importance d'améliorer le niveau d’éducation et le statut socio-économique à long terme pour réduire la prévalence de l'anémie légère.
V.Contexte National Bénin et Mali
L'étude se déroule au Bénin et au Mali. Au Bénin (environ 7 millions d'habitants en 2001), 57% de la population vit en milieu rural. L'IDH était de 0.421 en 2002 (161e/177). Au Mali (environ 11 millions d'habitants en 2001), 71% de la population est rurale, avec un taux de fécondité élevé (6,6 enfants par femme en 1999) et un IDH de 0.326 en 2004 (174e/177).
1. Contexte béninois
Le Bénin, pays d’Afrique de l’Ouest, comptait environ sept millions d’habitants en 2001, répartis en douze départements et une cinquantaine d’ethnies. Environ 57 % de la population vivait en milieu rural. Selon le PNUD, en 2002, le Bénin occupait le 161e rang sur 177 pays pour l’Indice de Développement Humain (IDH), avec une valeur de 0,421. L’espérance de vie en bonne santé à la naissance était de 44 ans (OMS, 2003). Le taux de mortalité infantile (moins de cinq ans) était d’environ 166 pour 1000, et 31 % des enfants souffraient de retard de croissance (UNICEF, 2000). Le taux de scolarisation était faible, avec un enfant sur quatre et une fille sur deux hors du système scolaire. Le taux d’analphabétisme était de 74 % chez les hommes et 81 % chez les femmes (UNICEF, 2000). Ces données illustrent le contexte socio-économique et sanitaire défavorable du Bénin, influençant potentiellement la prévalence de l’anémie.
2. Contexte malien
Le Mali, situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, est un vaste pays (1 241 000 km²) dont près de 65 % du territoire est désertique ou semi-désertique. La saison sèche est longue (jusqu’à 11 mois au nord). La population était d’environ 11 millions d’habitants en 2001, dont 71 % en milieu rural. Le taux de fécondité était parmi les plus élevés d’Afrique (6,6 enfants par femme en 1999, Banque mondiale, 2004). L’espérance de vie en bonne santé à la naissance était de 38 ans (OMS, 2002). Le taux de mortalité infantile (moins de 5 ans) était de 233 pour 1000, et 38 % des enfants souffraient de retard de croissance (UNICEF, 2000). Avec un IDH de 0,326 en 2004, le Mali figurait parmi les pays les moins développés (174e/177), devant le Burkina Faso, le Niger et la Sierra Leone (PNUD, 2004). L’accès à l’éducation était limité, principalement concentré en zone urbaine, avec 75 % des adultes et 84 % des femmes analphabètes (FAO, 2002).
Référence du document
- UNAIDS 2004 Report on the global AIDS epidemic (UNAIDS)
