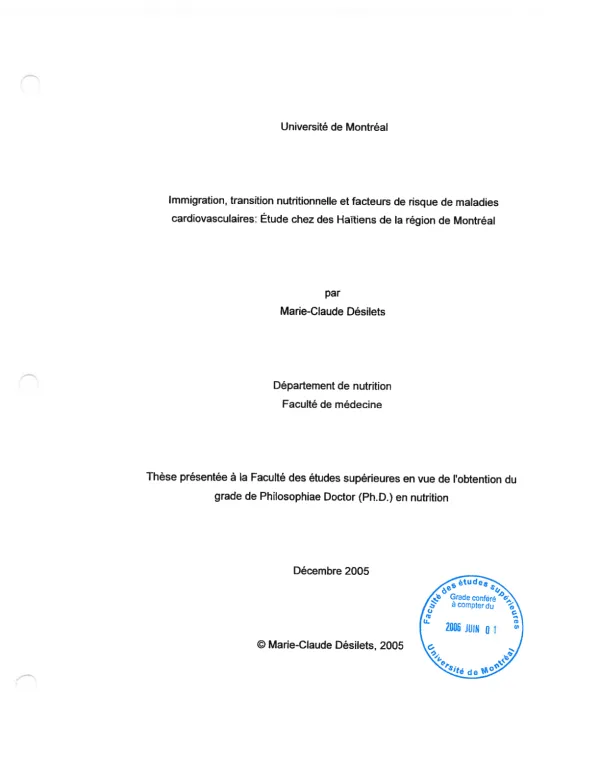
Maladies cardiovasculaires et immigration haïtienne
Informations sur le document
| Auteur | Marie-Claude Désilets |
| École | Université de Montréal |
| Spécialité | Nutrition |
| Type de document | Thèse (Ph.D.) |
| city | Montréal |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 12.93 MB |
Résumé
I.La Transition Nutritionnelle et le Syndrome Métabolique chez les Immigrants Haïtiens à Montréal
Cette étude transversale analyse le lien entre la transition nutritionnelle, le syndrome métabolique (SM) et les maladies cardiovasculaires (MCV) chez les Haïtiens de Montréal, deuxième communauté africaine du Canada après les Jamaïcains. Elle vise à déterminer si la durée de résidence au Québec influence les marqueurs de risque du SM (obésité, hypertension, résistance à l'insuline). Plus de 70 000 Haïtiens résident à Montréal. L'hypothèse principale est que l'adoption progressive d'un régime alimentaire plus athérogène et d'un mode de vie plus sédentaire, suite à la migration, accroît ces risques.
1. Contexte et Justification de l Étude
L'étude porte sur la transition nutritionnelle et son impact sur le syndrome métabolique (SM) et les maladies cardiovasculaires (MCV) chez les immigrants haïtiens à Montréal. La migration des pays en développement vers les pays industrialisés entraîne une occidentalisation de l'alimentation, une sédentarisation, et une augmentation des risques de MCV, regroupées sous le terme de syndrome métabolique. Cette transition nutritionnelle se caractérise par une augmentation de la consommation de lipides, de sucres et de produits animaux, ainsi qu'une diminution de la consommation de fibres et une baisse de la dépense énergétique liée au travail. L'étude se concentre spécifiquement sur la population haïtienne de Montréal, deuxième plus grand groupe d'origine africaine au Canada après les Jamaïcains, car aucune étude n'a encore exploré le lien entre les changements alimentaires et du mode de vie et les marqueurs de risque de MCV (obésité, hypertension, insulino-résistance) chez ce groupe. L'hypothèse principale est que l'augmentation de la durée de résidence au Québec est corrélée à une augmentation des marqueurs de risque du SM, en raison d'une alimentation plus athérogène et d'un mode de vie plus sédentaire. Des différences ethniques entre les personnes d'origine africaine et européenne concernant la résistance à l'insuline et la composition corporelle sont également prises en compte. Une étude nichée comparant des Haïtiens et des Blancs appariés pour l'âge, le sexe et l'IMC est menée pour explorer ces différences ethniques plus en profondeur. L’étude s'inscrit dans un projet plus vaste sur la transition nutritionnelle et les risques de MCV dans les pays en développement et les populations migrantes.
2. La Transition Nutritionnelle Un Phénomène Multifactoriel
La transition nutritionnelle, au cœur de cette recherche, est un processus complexe influençant la santé des populations. Elle est liée à des changements socio-économiques et démographiques importants, souvent observés lors de la transition épidémiologique. Ce processus se manifeste par des modifications des habitudes alimentaires (augmentation de la consommation de graisses, sucres, et aliments transformés, diminution de la consommation de fibres) et une réduction de l'activité physique, notamment liée au travail. L'étude met en lumière l'impact de cette transition chez les populations des pays en développement (PED), surtout en milieu urbain, ainsi que chez les communautés autochtones et les migrants. Des exemples de transitions nutritionnelles dans différents contextes (Chine, Brésil, communautés autochtones) sont présentés pour illustrer la diversité des situations et les facteurs influençant ces changements. L'étude cite des exemples de recherche sur la transition nutritionnelle en Chine, au Brésil et chez les communautés autochtones, soulignant l'augmentation de l'obésité avec l'augmentation du revenu, en particulier en milieu rural. On note aussi l'acculturation des communautés autochtones comme facteur important. La transition nutritionnelle est un processus continu et dynamique difficile à caractériser de façon linéaire. L'impact des changements alimentaires sur la santé n'est pas toujours immédiat, ce qui rend l'analyse plus complexe.
3. Les Populations Migrantes et le Risque Cardiovasculaire
L'étude souligne l'importance de l'étude des populations migrantes dans la compréhension de la transition nutritionnelle et des risques de maladies cardiovasculaires (MCV). Les immigrants haïtiens, formant un groupe significatif à Montréal, constituent une population idéale pour étudier cet impact en raison des changements importants de mode de vie et d'alimentation liés à la migration. L'étude examine la prévalence et le développement des facteurs de risque de MCV chez les Haïtiens de Montréal. Les études antérieures sur les immigrants au Canada montrent des résultats mitigés quant à l’effet « immigrant en santé », certains montrant un meilleur état de santé initial suivi d'une détérioration avec le temps. Les études antérieures sur d'autres groupes d'immigrants (Asiatiques, Européens, etc.) sont mentionnées, soulignant des tendances variables concernant le surpoids et l'obésité en fonction de la durée de résidence au Canada et des facteurs socio-économiques. Le manque d'études longitudinales spécifiques aux populations migrantes et l'absence de données sur l'activité physique et le tabagisme rendent l'interprétation des résultats plus difficiles. Des exemples de populations migrantes dans d’autres pays (Pays-Bas) sont également mentionnés pour mettre en perspective le phénomène. La complexité de l'identification du lieu d'origine des migrants et la nécessité de mesures plus précises pour caractériser la transition nutritionnelle sont aussi soulignées.
II.Résultats Principaux Défiance de l effet immigrant en santé
Contrairement à l'hypothèse de « l'effet immigrant en santé », l'étude n'a pas montré de détérioration des marqueurs de risque du SM avec la durée de résidence au Canada. Un faible niveau socio-économique (NSE) était cependant associé à une augmentation des risques. Une analyse typologique de la consommation alimentaire a révélé que les Haïtiens ayant une alimentation traditionnelle présentaient plus d'anomalies du SM que ceux ayant une alimentation occidentalisée, malgré un meilleur respect des recommandations alimentaires pour la prévention des MCV. L'impact à long terme de l'alimentation occidentalisée chez les jeunes Haïtiens reste à étudier.
1. Absence de l Effet Immigrant en Santé
Les résultats de l'étude remettent en question l'hypothèse de l'« effet immigrant en santé ». Contrairement à ce qui était attendu, aucune détérioration significative des marqueurs de risque du syndrome métabolique (SM) n'a été observée avec l'augmentation de la durée de résidence au Canada. Cette observation contredit les études précédentes suggérant un meilleur profil de santé initial chez les immigrants, suivi d'une dégradation au fil du temps. Le pourcentage de la vie passée au Canada n'était pas significativement lié aux marqueurs du SM, sauf pour des associations positives avec le cholestérol HDL et négatives avec les triglycérides (TG), associations qui disparaissaient lorsqu'on excluait les Haïtiens nés au Canada de l'analyse. Ceci suggère que les facteurs liés à la durée de résidence ne sont pas les seuls déterminants des marqueurs du SM chez les participants. L'étude met en évidence la nécessité de considérer d'autres variables, notamment le niveau socio-économique, pour une analyse plus complète des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires (MCV).
2. Analyse Typologique de la Consommation Alimentaire
Une analyse typologique de la consommation alimentaire a permis de classifier les participants en différents groupes selon leurs habitudes alimentaires. Il est apparu que les Haïtiens ayant une alimentation de type traditionnel étaient plus âgés, avaient passé plus de temps en Haïti, et respectaient davantage les recommandations alimentaires pour la prévention des MCV. Paradoxalement, ce groupe présentait un taux plus élevé d'anomalies du SM que ceux ayant une alimentation occidentalisée, même après ajustement pour l'âge et le sexe. Cette observation souligne la complexité de la relation entre le type d'alimentation et le risque de SM. L'hypothèse est formulée que les effets délétères de l'alimentation occidentalisée chez les jeunes Haïtiens pourraient se manifester plus tard. La méthode d'analyse typologique, basée sur des données d'apports alimentaires quotidiens, a permis de relier le type et la qualité de l'alimentation, mais la recherche note des limites méthodologiques liées à la variabilité des apports alimentaires individuels et la difficulté de comparer les régimes alimentaires traditionnels.
3. Impact du Niveau Socio économique NSE
L'étude met en lumière l'influence du niveau socio-économique (NSE) sur les risques de syndrome métabolique. À l'inverse de la durée de résidence, un faible NSE était associé à une augmentation des marqueurs de risque de MCV. Les résultats suggèrent que les facteurs socio-économiques jouent un rôle déterminant dans la santé des participants, indépendamment de l'adaptation à la société d'accueil. Cette observation met en évidence les défis spécifiques liés à la santé des populations vulnérables, où l'accès aux ressources, à une alimentation saine et à des soins de santé adéquats peut être limité. La complexité des interactions entre les facteurs socio-économiques, le mode de vie, et le risque de MCV est soulignée, nécessitant des études plus approfondies. La recherche met en avant la complexité de l'étude du NSE et des difficultés de classement des personnes inactives (retraités, étudiants, etc.).
III.Comparaison Haïtiens vs Blancs Différences Ethniques dans le SM
Une étude nichée comparant des Haïtiens et des Blancs appariés pour l'âge, le sexe et l'IMC a révélé un meilleur profil lipidique et moins de tissu adipeux viscéral chez les Haïtiens. Cependant, ils présentaient un métabolisme au repos plus faible et une tension artérielle plus élevée, soulignant des différences ethniques importantes dans la manifestation du SM. Ces résultats confirment des observations similaires entre Afro-Américains et Américains Blancs.
1. Résultats de l Étude Nichée Comparaison Haïtiens Blancs
Une étude nichée, comparant un échantillon d'Haïtiens et de Blancs appariés pour l'âge, le sexe et l'indice de masse corporelle (IMC), a révélé des différences significatives entre les deux groupes. Les Haïtiens présentaient un meilleur profil lipidique et une moindre accumulation de tissu adipeux viscéral que les Blancs. Ces résultats sont en accord avec les études comparant les Afro-américains et les Américains blancs. Cependant, les Haïtiens ont montré un métabolisme au repos plus faible et une pression artérielle plus élevée que les Blancs. Ces différences ethniques dans la manifestation du syndrome métabolique (SM) nécessitent une attention particulière dans l'évaluation du risque cardiovasculaire. L'étude souligne la complexité des interactions entre facteurs génétiques et environnementaux, influençant la prévalence du SM dans différents groupes ethniques. Des études plus poussées sont nécessaires pour mieux comprendre ces nuances et adapter les programmes de prévention des maladies cardiovasculaires (MCV) aux réalités de chaque groupe.
2. Différences Ethniques et Facteurs de Risque
Les résultats de l’étude nichée mettent en évidence des différences ethniques significatives dans les facteurs de risque du syndrome métabolique. Alors que les Haïtiens présentaient un profil lipidique plus favorable et moins de graisse viscérale, ils affichaient également un métabolisme basal plus faible et une pression artérielle plus élevée comparativement aux Blancs. Ces observations rejoignent les conclusions d'autres études comparant des populations afro-américaines et blanches, soulignant des particularités ethniques dans la réponse métabolique et la prédisposition aux maladies cardiovasculaires. La résistance à l'insuline et la composition corporelle semblent être des facteurs clés à considérer dans ces différences ethniques. L'étude souligne la complexité de l’interprétation des résultats, compte tenu des interactions possibles entre les facteurs génétiques et environnementaux, ainsi que la nécessité d’approches de prévention spécifiques pour tenir compte de ces variations.
3. Implications pour la Prévention des MCV
Les résultats de cette étude contribuent à approfondir les connaissances sur les différences ethniques dans le syndrome métabolique et ses liens avec les maladies cardiovasculaires (MCV). La découverte de différences significatives entre les Haïtiens et les Blancs, malgré des profils lipidiques plus favorables chez les Haïtiens, souligne l’importance de considérer des paramètres comme le métabolisme au repos et la tension artérielle dans l’évaluation du risque. Ces résultats ont des implications importantes pour le développement de stratégies de prévention ciblées. La faible dépense énergétique au repos et la pression artérielle plus élevée observées chez les Haïtiens nécessitent une attention particulière dans la conception de programmes de prévention du SM adaptés à cette population spécifique. L'étude met l’accent sur la nécessité de renforcer les programmes de prévention des MCV en tenant compte des particularités ethniques et des facteurs de risque spécifiques à chaque communauté culturelle.
IV.Méthodologie Échantillonnage et Collecte de Données
L'étude a porté sur un échantillon aléatoire d'Haïtiens de Montréal âgés de 25 à 60 ans. Une étude nichée a inclus un sous-groupe de 40 Haïtiens et 40 Blancs pour des analyses plus approfondies. La collecte de données comprenait des questionnaires sur l'alimentation (utilisant la méthode validée des rappels alimentaires de 24 heures à passages multiples), le mode de vie, le NSE, et des examens médicaux (prise de sang, tension artérielle, mesures anthropométriques). Les données des sujets Blancs appariés provenaient de la banque de données de l’Enquête des Familles de Québec, Université Laval.
1. Échantillonnage Population d Étude et Critères d Inclusion Exclusion
L'étude a été menée auprès d'un échantillon aléatoire d'Haïtiens résidant dans la région de Montréal, âgés de 25 à 60 ans. Ce choix d'âge permet d'inclure des individus dans la tranche d'âge où le syndrome métabolique est plus fréquent, ainsi que des personnes nées au Canada (deuxième génération). La taille de l'échantillon a été déterminée en fonction de la puissance statistique souhaitée pour détecter des différences significatives dans les marqueurs de risque du syndrome métabolique entre les groupes. Des critères d'inclusion stricts ont été appliqués : les deux parents devaient être d'origine africaine et nés en Haïti. Les individus atteints de maladies cardiaques, rénales, hépatiques, ou endocriniennes, ou sous traitement pour le diabète, les dyslipidémies ou l'hypertension ont été exclus, de même que les femmes enceintes ou allaitantes. Un questionnaire d'évaluation clinique a été administré avant les tests pour s'assurer de l'état de santé apparemment normal des participants. Plus de 70 000 Haïtiens résident à Montréal, selon les données citées. Une étude nichée a été menée avec un sous-groupe de 40 Haïtiens et 40 Blancs appariés selon l’âge, le sexe et l’IMC, tirés de la banque de données de l’Enquête des Familles de Québec (Université Laval). Ceci a permis une comparaison plus approfondie des différences ethniques en ce qui concerne les marqueurs du syndrome métabolique.
2. Collecte des Données Méthodes et Instruments
La collecte de données a reposé sur plusieurs méthodes. Pour l'évaluation de la consommation alimentaire, la méthode validée des rappels alimentaires de 24 heures à passages multiples a été utilisée pour minimiser les biais liés à la mémoire. Cette méthode, comportant cinq étapes distinctes, permet d'obtenir une information complète sur les aliments consommés, en incluant les catégories d'aliments souvent oubliées. Les questions sur les aliments sont basées sur celles de l’enquête NHANES (États-Unis). Des questionnaires ont également recueilli des informations socio-démographiques et économiques, notamment le lieu de naissance, la durée de résidence au Canada, l'histoire migratoire, l'état matrimonial, l'occupation, l'éducation, le revenu, et la composition du ménage. Ces indicateurs socio-économiques ont été utilisés pour évaluer leur rôle sur le développement des marqueurs de risque de MCV. Des informations sur le type d'emploi du père pendant l'enfance ont aussi été collectées. Les questions ont été adaptées de diverses enquêtes, dont l’Enquête Québécoise sur la nutrition, l’Enquête sociale et de santé, et NHANES. Des évaluations cliniques, des prises de sang (incluant un test de tolérance au glucose), et des mesures de la tension artérielle ont complété la collecte de données, effectuées à la Clinique du Médiclub à Outremont. Un pré-test a été réalisé sur 5 sujets pour affiner le questionnaire.
V.Facteurs Socio économiques et Style de Vie
L'étude a exploré l'influence du niveau socio-économique (NSE), incluant l'éducation, le revenu et le statut d'emploi, sur le développement du SM. Elle a également considéré l'impact de facteurs comportementaux tels que l'activité physique et la consommation d'alcool. L'insécurité alimentaire, évaluée par un questionnaire, n'a pas été retenue dans l'analyse finale en raison de difficultés méthodologiques.
1. Niveau Socio économique NSE et Syndrome Métabolique
L'étude explore la relation entre le niveau socio-économique (NSE) et le syndrome métabolique (SM). Un score de NSE a été créé en combinant des indicateurs d'éducation, de revenu, de statut d'emploi et de propriété du logement. Ce score, divisé en tertiles (faible, moyen, élevé), a permis d'analyser son impact sur les marqueurs du SM. L'étude cite des travaux antérieurs montrant que le NSE influence non seulement le risque de maladies cardiovasculaires (MCV) et de SM, mais aussi l'alimentation et les habitudes de vie. L'exposition à des désavantages socio-économiques, tôt dans la vie ou à l'âge adulte, semble être liée à un risque accru de maladies coronariennes. L'étude note des relations complexes entre revenu, éducation et hypertension, variant selon le sexe et la région géographique (ex: comparaison avec des données de la Jamaïque). Des études longitudinales sont nécessaires pour mieux comprendre l'impact du NSE sur le SM et les MCV à long terme. Un score d'insécurité alimentaire, basé sur des questions de monotonie alimentaire, de gêne et de faim, a été créé mais non retenu pour l’analyse finale, en raison de problèmes méthodologiques liés à la normalisation des données et à des résultats contradictoires avec le score de NSE.
2. Autres Facteurs de Style de Vie Activité Physique Consommation d Alcool
L'étude reconnaît l'importance d'autres facteurs de style de vie, tels que l'activité physique et la consommation d'alcool, dans le développement du syndrome métabolique et des maladies cardiovasculaires. Bien que l'étude ait collecté des données sur ces aspects, les résultats concernant l'association entre les habitudes alimentaires et ces facteurs ne sont pas détaillés. Cependant, la recherche cite des études antérieures montrant l'impact positif d'une activité physique régulière sur la sensibilité à l'insuline et la tolérance au glucose, particulièrement pour des activités physiques plus intenses. De même, la consommation modérée d'alcool pourrait être associée à une meilleure sensibilité à l'insuline. La recherche souligne également l'importance d'évaluer ces différents comportements dans les études sur la transition nutritionnelle, reconnaissant que leurs effets peuvent être indépendants ou interactifs avec les facteurs liés à l'alimentation. L'absence de lien significatif entre ces facteurs et les habitudes alimentaires dans l'étude actuelle est mentionnée.
