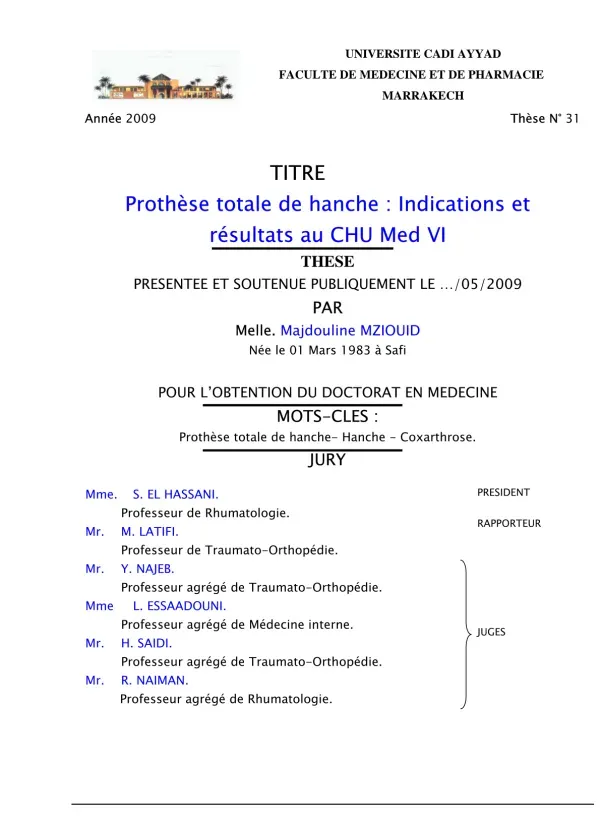
Indications et résultats de la prothèse totale de hanche au CHU Med VI
Informations sur le document
| Auteur | Melle. Majdouline Mziouid |
| École | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech |
| Spécialité | Médecine |
| Lieu | Marrakech |
| Type de document | Thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 11.08 MB |
- Prothèse totale de hanche
- Rhumatologie
- Chirurgie orthopédique
Résumé
I.Durée de vie et échecs des prothèses totales de hanche
Les études cliniques montrent que la durée de vie des implants de prothèse totale de hanche (PTH) est limitée. Le principal motif d'échec est le descellement aseptique, souvent lié à une ostéolyse péri-prothétique. L'amélioration des couples de frottement (métal/polyéthylène, métal/métal, céramique/polyéthylène) est une voie de recherche active pour réduire la production de débris et améliorer la survie des implants.
1. Durée de vie limitée des implants prothétiques
Des études cliniques à long terme ont démontré que la durée de vie des implants prothétiques pour l'arthroplastie totale de hanche est limitée. Bien que les mécanismes précis menant à ces échecs ne soient pas entièrement élucidés, le descellement aseptique apparaît comme la cause principale. Ce descellement est fréquemment associé à une ostéolyse péri-prothétique, une résorption osseuse autour de l'implant. Une fois l'ostéolyse et/ou le descellement établis, une intervention de reprise chirurgicale est généralement nécessaire. Face à ce constat, la recherche s'est concentrée sur la réduction de la production de débris par les surfaces articulaires des prothèses. Ceci passe par le développement et la diversification des couples de frottement disponibles, afin d'optimiser la biocompatibilité et la durabilité des implants. La recherche de matériaux plus résistants à l'usure et de techniques chirurgicales plus précises est donc un enjeu majeur pour prolonger la durée de vie des prothèses et réduire le taux de révisions.
2. Descellement aseptique et ostéolyse péri prothétique mécanismes et conséquences
Le descellement aseptique, en l'absence d'infection, constitue la complication majeure responsable des échecs des prothèses totales de hanche. Ce phénomène est souvent lié à l'ostéolyse péri-prothétique, une réaction inflammatoire de l'os autour de l'implant, provoquée par la libération de particules de débris d'usure provenant du frottement entre les composants de la prothèse (tête fémorale et cupule acétabulaire). Ces particules, issues de l'usure des matériaux constituant le couple de frottement (par exemple, métal/polyéthylène), stimulent une réaction inflammatoire locale qui entraîne la résorption osseuse. L'ostéolyse progressive affaiblit la fixation de l'implant, conduisant finalement à son descellement. La compréhension des mécanismes de l'ostéolyse et du descellement aseptique est essentielle pour développer des stratégies de prévention et de traitement efficaces. Les recherches actuelles explorent différentes approches, notamment l'amélioration des surfaces des implants pour réduire l'usure et la libération de particules, ainsi que le développement de nouveaux biomatériaux plus biocompatibles.
3. Amélioration des couples de frottement pour réduire l usure
Une stratégie majeure pour améliorer la longévité des prothèses totales de hanche consiste à réduire l'usure des surfaces articulaires et ainsi limiter la production de débris responsables de l'ostéolyse et du descellement aseptique. Ceci passe par le développement et l'optimisation des couples de frottement utilisés. Traditionnellement, le couple métal/polyéthylène était largement employé, mais son usure progressive, bien que faible (environ 1/10ème de millimètre par an), conduit à la libération de débris et à un descellement progressif au fil des années (souvent vers la dixième année). Des alternatives ont été développées, notamment les couples métal/métal et céramique/polyéthylène. Le couple métal/métal offre une excellente résistance à l'usure, mais pose des problèmes de réactions immunoallergiques et de libération d'ions métalliques (chrome et cobalt) dans le sang. Le couple céramique/polyéthylène présente une meilleure biocompatibilité, mais son usure reste supérieure à celle du couple métal/métal. Le choix du couple de frottement doit donc se faire en fonction de différents facteurs, notamment l'âge et le niveau d'activité du patient.
II.Indications de l arthroplastie totale de hanche
L'arthroplastie totale de hanche est une intervention courante, indiquée pour la coxarthrose (primitive ou secondaire), les atteintes inflammatoires, tumorales ou traumatiques de la hanche. Elle vise à améliorer la fonction et la qualité de vie des patients. L'étude porte sur 52 PTH réalisées au CHU Mohammed VI, avec une prédominance masculine (59%) et un âge moyen de 46 ans. Les indications principales étaient la fracture du col fémoral (23,9%), la coxarthrose secondaire (26%), la coxarthrose primitive (17,4%), et la coxite (21,4%).
1. L arthroplastie totale de hanche une intervention majeure
L'arthroplastie totale de hanche (ATH) est une intervention chirurgicale courante et efficace, visant à remplacer une articulation endommagée de la hanche. Elle représente l'une des procédures médicales les plus performantes, offrant une amélioration significative de la fonction et de la qualité de vie des patients à court terme. Plus de 500 000 implants sont posés chaque année dans le monde, témoignant de son importance en chirurgie orthopédique. L’ATH est une intervention qui a considérablement évolué au cours des 50 dernières années, offrant une satisfaction croissante aux patients. Son utilisation est largement répandue, car elle permet de traiter efficacement un large éventail de pathologies de la hanche affectant la qualité de vie des patients.
2. Pathologies traitées par l arthroplastie totale de hanche
L'arthroplastie totale de hanche est indiquée pour diverses pathologies affectant l'articulation de la hanche. On retrouve principalement la coxarthrose, qu'elle soit primitive ou secondaire à d'autres affections. La coxarthrose primitive est une forme d'arthrose sans cause identifiable, tandis que la coxarthrose secondaire résulte de facteurs tels que des traumatismes, des maladies inflammatoires (coxite), des affections tumorales ou des malformations congénitales. L’intervention peut donc être envisagée dans une variété de contextes cliniques, et ce, quel que soit l’âge du patient, même si les recommandations initiales de Charnley visaient principalement une population âgée. L'étude présentée comprend 52 arthroplasties totales de hanche réalisées au service de Traumato-orthopédie du CHU Mohammed VI sur une période de 3 ans et demi. Les indications dans cette étude étaient variées : fractures de l'extrémité supérieure du fémur et pseudarthrose du col fémoral (23,9%), coxarthrose secondaire (26%), coxarthrose primitive (17,4%), coxite (21,4%), dont 2 cas infectieux et 8 inflammatoires, et 4 reprises après des interventions précédentes.
3. Une étude de cas au CHU Mohammed VI
Une étude menée au service de Traumato-orthopédie du CHU Mohammed VI a analysé 52 arthroplasties totales de hanche réalisées sur une période de 3 ans et demi. L'étude a porté sur un groupe de 46 patients, avec une prédominance masculine (59%) et un âge moyen de 46 ans. Cette étude de cas permet d'observer les indications et les résultats de l'arthroplastie totale de hanche dans un contexte précis. La majorité des interventions (92%) ont été réalisées sous anesthésie générale. Deux voies d'abord ont été principalement utilisées : la voie postéro-externe de Moore (38,47%) et la voie de Hardinge (30,76%). Le type de prothèse implantée était principalement une Charnley-Kerboull (92%) et, plus rarement, une autoblocante de Muller (8%). Toutes les prothèses étaient cimentées, avec un couple métal/polyéthylène utilisé pour tous les implants. Le positionnement des implants a été jugé de bonne qualité dans l'ensemble de cette série. L'étude souligne la nécessité d'une évaluation personnalisée des indications pour chaque patient, en tenant compte de la symptomatologie douloureuse et du degré de handicap moteur.
III.Techniques chirurgicales d abord de la hanche
Plusieurs voies d'abord sont utilisées pour l'arthroplastie totale de hanche: la voie postéro-externe de Moore (38,47%), la voie de Hardinge (30,76%), et la trochantérotomie. Le choix de la voie d'abord dépend souvent de l'habitude du chirurgien. La technique chirurgicale précise est détaillée, incluant la préparation, l'exposition de l'articulation, et la fixation des composants prothétiques. L'étude note l'utilisation de prothèses cimentées avec un couple métal/polyéthylène dans la majorité des cas.
1. Voies d abord chirurgicales pour l arthroplastie totale de hanche
L'accès à l'articulation de la hanche lors d'une arthroplastie totale nécessite une approche chirurgicale précise. Le document décrit plusieurs voies d'abord couramment utilisées, soulignant la variété des techniques employées selon les chirurgiens et leurs habitudes. Parmi les approches mentionnées, on trouve la voie de Hueter, la voie de Hardinge, la trochantérotomie (largement pratiquée, mais susceptible de problèmes de refixation du grand trochanter), et la voie postéro-externe, considérée comme classique. La chirurgie mini-invasive est également évoquée. Le choix de la voie d'abord ne semble pas corrélé à des caractéristiques spécifiques du patient (âge, poids, taille, antécédents chirurgicaux), de la pathologie ou de la morphologie de la hanche. L’étude du CHU Mohammed VI a utilisé la voie postéro-externe de Moore dans 20 cas (38,47%) et la voie de Hardinge sur 16 hanches (30,76%). La description détaillée de chaque approche, ainsi que les étapes chirurgicales précises (incisions, dissection, exposition de la capsule articulaire), est présentée dans le document, mais une analyse approfondie de chaque technique est réservée à des contenus ultérieurs.
2. Description détaillée d une approche chirurgicale exemples
Le document détaille plusieurs étapes d'une procédure chirurgicale type pour l'arthroplastie totale de hanche, illustrant les techniques utilisées pour l'abord et la préparation de l'articulation. L'abord de l'articulation implique la libération des muscles iliopsoas et la section de la capsule articulaire, pouvant être effectuée en arbalète ou en H couché. La luxation de la tête fémorale se fait à l'aide d'un crochet de Lambotte. L'exposition du cotyle nécessite la mise en place d'écarteurs. Des manœuvres de traction, adduction et rotation externe sont décrites. L'exposition du cotyle et du col fémoral sont détaillées, incluant l'identification des muscles (moyen fessier, piriforme, carré fémoral), la section des tendons et l'utilisation d'écarteurs. La traversée des plans musculoaponévrotiques est décrite en détail, incluant l'incision du fascia lata et la dissociation des fibres du grand fessier. La réparation et la fermeture comportent la réinsertion du lambeau capsulaire avec des points trans-osseux, la suture du fascia lata et du grand fessier. Une capsulotomie en H peut être effectuée, et l'utilisation d'un extracteur fileté est parfois nécessaire pour extraire la tête fémorale.
3. Trochantérotomie et techniques alternatives
La trochantérotomie, une technique consistant à sectionner le grand trochanter pour améliorer l'exposition chirurgicale, est abordée. Bien qu'encore largement utilisée, la refixation du grand trochanter pose des problèmes. Le texte mentionne des approches transmusculaires comme alternatives, préservant la continuité longitudinale du hauban fessier latéral. La description de la trochantérotomie inclut la désinsertion du vaste latéral, l'exposition de la région trochantérienne à l'aide d'écarteurs, et l'ostéotomie à l'aide d'un ciseau. La libération des muscles pelvitrochantériens (petit et moyen fessier, piriforme, jumeaux, obturateurs) est expliquée. La tension de l'obturateur externe peut nécessiter une section et une ligature. La fixation de la trochantérotomie utilise des fils de cerclage et des points trans-osseux. Ces descriptions fournissent un aperçu des techniques chirurgicales employées, mais l'analyse détaillée de ces approches chirurgicales spécifiques est laissée à des sections futures plus approfondies.
IV.Nécrose aseptique de la tête fémorale et traitement
L'ostéonécrose de la tête fémorale (ONTF), ou nécrose aseptique de la tête fémorale, est une cause fréquente de douleur de hanche, souvent traitée par PTH. Les facteurs de risque incluent la corticothérapie, l'alcoolisme, les transplantations d'organes et certaines maladies systémiques. Le diagnostic repose principalement sur l'imagerie. Le traitement peut être médical (antalgiques, décharge) ou chirurgical (forage, ostéotomie, PTH).
1. L ostéonécrose de la tête fémorale ONTF une cause fréquente de douleur de hanche
L'ostéonécrose de la tête fémorale (ONTF), ou nécrose aseptique de la tête fémorale, est une pathologie fréquente entraînant des douleurs à la hanche et un handicap, particulièrement chez des sujets relativement jeunes. Aux États-Unis, elle est à l'origine de 10% des poses de prothèses totales de hanche. La douleur est généralement mécanique, et le diagnostic doit être systématiquement évoqué chez les hommes d'une quarantaine d'années ou, quel que soit le sexe, en présence de facteurs de risque. Ces facteurs incluent notamment la prise de corticoïdes (même à des doses importantes mais brèves), l'alcoolisme, des transplantations d'organes (avec un risque accru lié à la corticothérapie antirejet), le lupus érythémateux systémique (où le rôle de la corticothérapie est également important), la drépanocytose, et la maladie de Gaucher. L'absence d'anomalie biologique spécifique souligne l'importance de l'imagerie médicale pour le diagnostic. Le texte précise qu'il n'existe pas d'anomalie biologique spécifique, le diagnostic reposant exclusivement sur l'imagerie, et que la constitution de l'ONTF se fait précocement, dans les six premiers mois de la corticothérapie, même si les symptômes n'apparaissent que plusieurs mois voire années plus tard.
2. Diagnostic et imagerie de l ONTF
Le diagnostic de l'ostéonécrose de la tête fémorale repose principalement sur l'imagerie médicale. Les radiographies standard peuvent être initialement normales, les anomalies n'apparaissant que plusieurs mois après le début de la nécrose. Ces anomalies, non spécifiques, se traduisent par des plages de clarté et/ou de condensation hétérogènes au sein de la tête fémorale. L'IRM est un examen plus sensible, capable de détecter plus précocement la nécrose grâce à l'identification d'un liseré péri-nécrotique spécifique sur les séquences pondérées en T1 et T2. Ce liseré, observable entre deux à six mois après la formation de la nécrose, précède l'apparition des signes cliniques et radiologiques classiques, offrant ainsi un outil précieux pour le diagnostic précoce. La description des anomalies radiologiques spécifiques à l'ONTF, ainsi que la comparaison des performances diagnostiques de différentes techniques d'imagerie, sont des aspects plus détaillés qui pourraient être abordés dans une section ultérieure plus approfondie.
3. Traitement de l ostéonécrose de la tête fémorale
Le traitement de l'ostéonécrose de la tête fémorale est principalement symptomatique en phase initiale. Les antalgiques sont utilisés pour soulager la douleur. La mise en décharge du membre inférieur peut être nécessaire en cas de douleur aiguë, potentiellement liée à une fracture sous-chondrale, mais son impact sur l'évolution de la maladie reste incertain. Lorsque le traitement médical s'avère insuffisant ou en cas d'évolution défavorable, des interventions chirurgicales sont envisagées. Le texte mentionne le forage cervicocéphalique (avec ou sans greffon osseux), les ostéotomies, et l'arthroplastie totale de hanche (ATH) comme traitements chirurgicaux classiques. L'ATH est actuellement le traitement de référence, mais elle est réservée aux cas nécessitant une intervention majeure en raison de douleurs intenses, d'une limitation fonctionnelle importante, et d'une diminution du périmètre de marche. L’ATH, bien que donnant des résultats remarquables à court terme, peut nécessiter des reprises chirurgicales, notamment chez les patients plus jeunes.
V.Résultats et Complications de la PTH
Dans l'étude du CHU Mohammed VI, 72% des patients ont obtenu un résultat excellent ou très bon à 24 mois. Les complications comprenaient des instabilités hémodynamiques, des effractions cotyloïdiennes, une luxation, une infection, des hématomes, et des infections urinaires. Le descellement aseptique reste la principale cause d'échec à long terme, bien que le suivi de 24 mois soit insuffisant pour une évaluation complète. Le jeune âge de la population étudiée (âge moyen 46 ans) est un facteur de risque pour les descellements.
1. Résultats à 24 mois de l étude du CHU Mohammed VI
Une étude réalisée au service de Traumato-orthopédie du CHU Mohammed VI sur 52 prothèses totales de hanche (PTH) implantées sur une période de 3 ans et demi, a permis d'évaluer les résultats à 24 mois de suivi. Dans cet échantillon de 46 patients (prédominance masculine de 59%, âge moyen de 46 ans), 72% ont obtenu un résultat qualifié d'excellent ou très bon. 10% des résultats étaient bons et 18% mauvais. Il est important de noter que ce recul de 24 mois est insuffisant pour une évaluation complète de la survie à long terme des implants, notamment concernant le descellement aseptique, principal facteur d'échec. Le type de prothèse implantée était essentiellement une Charnley-Kerboull (92%), les prothèses étant cimentées avec un couple métal/polyéthylène. Le positionnement des implants a été jugé de bonne qualité. Le jeune âge moyen de la population étudiée constitue un facteur de risque de descellement à long terme, ce qui suggère la nécessité de recherches plus approfondies sur ce point précis.
2. Complications observées dans l étude
L'étude du CHU Mohammed VI a rapporté plusieurs complications postopératoires. Trois cas d'instabilité hémodynamique ont été observés, ainsi que deux effractions avec effondrement du toit cotyloïdien. Une luxation de prothèse, une infection, cinq hématomes, une cystite et une gastrite ont également été enregistrées. L'analyse détaillée de ces complications, ainsi que leur incidence respective, permettra une meilleure compréhension des facteurs de risque et des stratégies de prévention. Le document mentionne que le descellement aseptique, bien que non pleinement évalué avec un suivi de 24 mois, reste la cause principale d'échec à long terme. Les auteurs mettent en perspective la nécessité d'améliorer les techniques chirurgicales et les biomatériaux utilisés afin de réduire l'incidence de ces complications et d’améliorer la survie à long terme des prothèses.
3. Facteurs influençant la survie des implants et les reprises chirurgicales
L'étude a identifié quatre reprises chirurgicales : deux pour un descellement acétabulaire et deux pour un descellement fémoral. Divers facteurs peuvent influencer la nécessité de reprises, notamment l'âge du patient et le type de couple de frottement utilisé. L'emploi de couples de frottement « dur-mou » est associé à une usure progressive du polyéthylène, alors qu'un couple « dur-dur », possédant d'excellentes qualités tribologiques, améliore la survie des implants, selon les données de Girard (40). Le document souligne également l’impact de la technique chirurgicale, notamment le choix de la voie d’abord. Une voie d’abord qui ne prévoit pas un réamarrage solide de la capsule après section des tendons des muscles pelvitrochantériens prédispose aux luxations de la prothèse. Cependant, aucune corrélation n'a été trouvée entre le choix de la voie d'abord et les caractéristiques du patient, la cause de la coxopathie ou la morphologie préopératoire de la hanche, le choix étant principalement basé sur l'habitude du chirurgien.
VI.Amélioration des implants et techniques chirurgicales
L'amélioration des matériaux (couples de frottement métal/métal, céramique) et des techniques chirurgicales est essentielle pour minimiser les risques de complications et améliorer la survie des implants à long terme. L'utilisation de prothèses non cimentées est évoquée, notamment chez les jeunes patients. La surveillance clinique et radiologique est cruciale pour détecter précocement le descellement aseptique et autres complications.
1. Amélioration des couples de frottement
L'amélioration des prothèses totales de hanche passe par l'optimisation des couples de frottement, afin de réduire l'usure et la production de débris responsables du descellement aseptique et de l'ostéolyse. Le couple métal/polyéthylène, bien que couramment utilisé, présente une usure progressive, conduisant à la libération de débris vers la dixième année. Des alternatives sont explorées, notamment le couple métal/métal, qui offre une excellente résistance à l'usure mais pose des problèmes d'immuno-allergies et de libération d'ions métalliques (chrome et cobalt), contre-indiqué chez les insuffisants rénaux. Le couple céramique/polyéthylène, plus biocompatible, a également été étudié, mais son usure reste supérieure au métal/métal. L'utilisation de têtes en céramique d'alumine (la zircone ayant été abandonnée en raison d'une usure accrue et de risques de rupture) associée au polyéthylène est envisagée, surtout chez les sujets jeunes et actifs. Le choix du couple de frottement doit être adapté aux caractéristiques et aux besoins spécifiques de chaque patient.
2. Prothèses non cimentées et implants de resurfaçage
Le document évoque l'utilisation de prothèses non cimentées comme une amélioration potentielle, particulièrement chez les jeunes patients à risque de descellement. La réintroduction du couple métal/métal a permis le développement d'implants de resurfaçage de deuxième génération, combinant les avantages de têtes prothétiques de gros diamètre avec une meilleure préservation osseuse. Ces implants, où la pièce fémorale est cimentée et le composant acétabulaire est impacté, présentent un traitement de surface favorisant la repousse osseuse directe. Le grand diamètre réduit le risque de luxation. Ils sont particulièrement indiqués en cas de déformation fémorale post-traumatique ou post-chirurgicale. Cependant, la technique chirurgicale est cruciale ; les échecs précoces sont liés à des défauts d'implantation (implantation en valgus de 8° recommandée). Les indications doivent être soigneusement posées (âge, inégalité de longueur des membres, présence de géodes).
3. Amélioration des techniques chirurgicales et surveillance postopératoire
L'amélioration des techniques chirurgicales est un autre axe de progrès pour optimiser les résultats à long terme de l'arthroplastie totale de hanche. Le texte suggère que l'augmentation du diamètre du couple prothétique améliore la mobilité et réduit le risque de luxation, particulièrement intéressant pour les patients actifs. Cependant, cette approche est principalement applicable aux couples métal/métal, en raison des risques d'usure ou de fracture pour le polyéthylène et la céramique. Une surveillance clinique et radiologique rigoureuse est essentielle pour un dépistage précoce du descellement aseptique et autres complications, permettant une prise en charge adaptée. L’étude mentionne une durée moyenne de séjour hospitalier de 17 jours, due à la pratique de garder les patients jusqu'à l'ablation des fils. Enfin, une rééducation précoce, incluant une mobilisation articulaire dès les premiers jours postopératoires, est un élément important de la prise en charge globale du patient.
