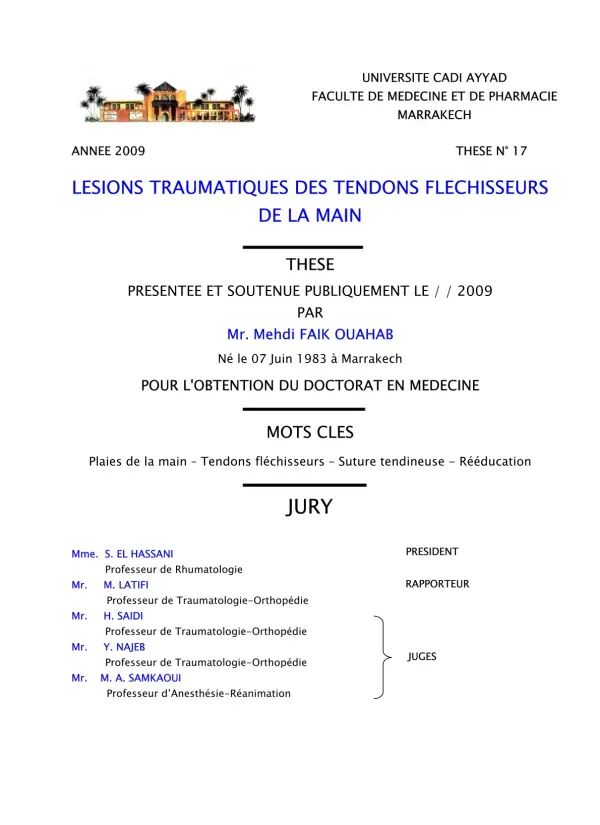
Lesions Traumatologiques des Tendons Fléchisseurs de la Main
Informations sur le document
| Auteur | Mehdi Faik Ouhab |
| instructor/editor | S. El Hassani, Professeur de Rhumatologie |
| École | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech |
| subject/major | Médecine |
| Type de document | Thèse |
| city_where_the_document_was_published | Marrakech |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 3.96 MB |
- médecine
- traumatologie
- tendons fléchisseurs
Résumé
I.Traitement chirurgical des lésions des tendons fléchisseurs de la main
Ce document détaille le traitement chirurgical des lésions des tendons fléchisseurs de la main, axé sur la réparation tendineuse. L'étude porte sur une série de cas où les techniques de Kessler modifiée et de Kleinert ont été principalement utilisées. La majorité des patients étaient des hommes âgés de 20 à 40 ans, les étiologies principales étant les agressions (41,9%), les accidents domestiques (27,2%) et les accidents du travail (19,9%). La zone II était la plus fréquemment touchée (45,2%). Des lésions ostéo-articulaires étaient associées dans 41,6% des cas. Le choix de la technique chirurgicale dépend de la localisation et de la sévérité de la lésion, avec une prédominance pour la suture tendineuse par points de Kessler modifiés (91,42%).
1. Profil des patients et étiologie des lésions
L'étude porte sur une population majoritairement masculine (66,8%), âgée de 20 à 40 ans. Les lésions des tendons fléchisseurs sont principalement causées par des agressions (41,9%), des accidents domestiques (27,2%) et des accidents du travail (19,9%). L'atteinte touche toutes les zones de la main, avec une prédominance pour la zone II (45,2%) selon la classification de la Fédération Internationale des Sociétés de Chirurgie de la Main. Les doigts II, III et V sont les plus fréquemment touchés (entre 24 et 25%). Il est important de noter que des lésions vasculo-nerveuses et ostéo-articulaires associées étaient présentes dans 41,6% des cas. Cette information sur le profil des patients et les causes des blessures est fondamentale pour comprendre le contexte de l'étude et pour adapter les traitements ultérieurement. La prévalence des accidents du travail souligne l'importance de la prévention sur les lieux de travail.
2. Installation du patient et décontamination pré opératoire
La préparation pré-opératoire comprend l'installation du patient en décubitus dorsal, le membre supérieur traumatisé reposant sur une table annexe. Un garrot pneumatique est généralement utilisé à la racine du membre, une bande d'Esmarck ayant été employée dans seulement 4 cas de la série. L'étude mentionne également l'importance de l'interrogatoire précisant la position de la main et des doigts au moment du traumatisme pour guider le diagnostic et le traitement. La variabilité des rapports entre les tendons et les téguments selon le mouvement de flexion-extension est soulignée, avec l'observation que sur un doigt blessé en flexion, la section tendineuse est distale par rapport à l'ouverture cutanée. Cette précision sur les protocoles pré-opératoires permet de comprendre les conditions dans lesquelles les interventions chirurgicales ont été réalisées.
3. Exploration et diagnostic des lésions tendineuses
L'exploration systématique de toute plaie cutanée suspecte est recommandée. L'examen clinique doit rechercher des lésions ostéo-articulaires, même en cas de traumatisme minime, car ces lésions peuvent compromettre le pronostic fonctionnel. Une radiographie systématique de la main est réalisée, avec des incidences spécifiques selon la zone suspectée. L’étude précise les incidences radiologiques appropriées pour les fractures des métacarpiens et des articulations métacarpo-phalangiennes (Brewerton). L'évaluation de la vascularisation est primordiale, par la recherche des pouls radial et cubital, du pouls capillaire, ainsi que par l'observation de la coloration et de la chaleur des doigts. L'atteinte homogène des rayons digitaux est observée, principalement les 2ème, 3ème et 5ème rayons, avec une légère augmentation du côté ulnaire dans plusieurs séries.
4. Techniques chirurgicales de réparation
La réparation idéale doit être effectuée en urgence, ou au plus tard dans les 24-48 heures suivant le traumatisme, avant l'œdème important. Différentes techniques sont décrites pour la récupération des extrémités tendineuses rétractées, incluant l’utilisation de tiges de Silastic ou de prothèses de Hunter. La majorité des auteurs utilisent des fils synthétiques monobrins de calibres 4(0) et 5(0) pour les points principaux. L'utilisation d'aiguilles rondes est privilégiée pour limiter les traumatismes. L'humidification permanente du champ opératoire est essentielle. Plusieurs techniques de suture sont décrites : Kessler (et ses variantes), Tsuge, Bunnel pull-out (pour le T.F.C.P en zone I), et Kleinert (pour 6 cas dans cette étude). L'exérèse de la gaine synoviale est limitée pour prévenir les adhérences. La réparation des poulies A2 et A4 est également discutée, ainsi que les techniques de plastie d'agrandissement.
5. Résultats et analyse des lésions selon les zones topographiques
La majorité des plaies dans cette série sont franches et linéaires (seulement 4 cas de perte de substance cutanée). Une analyse comparative des résultats avec d'autres études (Elliot, Gerard, Langlais, Tropet et Menez) est présentée, montrant des résultats globalement similaires. L’étude constate des résultats inférieurs en Zone II (54,9% de bons et excellents résultats) comparés aux autres zones, soulignant la difficulté de la réparation dans cette région anatomique. La technique de Kessler modifiée est privilégiée pour sa simplicité, rapidité et qualités biomécaniques. L’utilisation de la technique de Kleinert a donné d'excellents résultats pour les lésions simples de type I et IIA. La comparaison des résultats entre différentes techniques de réparation et différentes zones anatomiques permet d'identifier les meilleures stratégies thérapeutiques et de mieux comprendre les facteurs pronostiques.
II.Techniques de réparation des tendons fléchisseurs
Plusieurs techniques de réparation tendineuse sont décrites, incluant les méthodes de Kessler modifiée et Kleinert. La technique de Kessler modifiée est privilégiée pour sa simplicité et sa rapidité. La technique de Kleinert est utilisée pour des lésions moins sévères. L'accent est mis sur une suture fine atraumatique, le respect des vinculums et de la gaine synoviale, ainsi que sur l'importance de l'humidification du champ opératoire. Des techniques pour récupérer les extrémités tendineuses rétractées (utilisation de Silastic, prothèse de Hunter) sont également abordées.
1. Suture des tendons fléchisseurs Techniques de Kessler et Kleinert
Le document détaille les techniques chirurgicales utilisées pour la réparation des tendons fléchisseurs. La technique de Kessler modifiée est largement employée (91,42% des cas) et est appréciée pour sa simplicité et sa rapidité d'exécution. Elle est présentée comme une technique fiable et efficace, offrant de bonnes qualités biomécaniques sans compromettre la qualité des résultats. En revanche, la technique de Kleinert, utilisée dans un nombre plus restreint de cas (2,1%), a montré d'excellents résultats notamment pour les lésions moins sévères de type I et IIA. Le choix entre ces deux techniques semble dépendre de la sévérité de la lésion, la technique de Kessler modifiée étant privilégiée pour une grande partie des cas tandis que la technique de Kleinert est réservée aux cas plus simples.
2. Gestion des extrémités tendineuses rétractées
Face à une rétraction importante du bout proximal du tendon, différentes techniques sont décrites pour récupérer les extrémités tendineuses. Une méthode, proposée par Michon en 1974, utilise une tige de Silastic introduite dans la gaine du tendon pour repérer et extraire l’extrémité proximale. Une approche plus actuelle privilégie un moyen plus simple et atraumatique, utilisant une prothèse de Hunter, un cathéter souple ou une tige de silicone. Ce dispositif vient butter contre le tendon proximal, guidant précisément la contre-incision palmaire pour retirer le tendon. Le choix de la méthode dépendra de la situation spécifique de chaque patient, en considérant la complexité de la lésion et l'état du tendon.
3. Matériels et techniques de suture
La suture des tendons utilise majoritairement des fils synthétiques monobrins résistants et bien tolérés (calibres 4(0) et 5(0) pour les points principaux, 6(0) et 7(0) pour les surjets épitendineux). L’utilisation d'aiguilles rondes, moins agressives pour le tendon que les aiguilles triangulaires, est préconisée. Des loupes grossissantes sont nécessaires pour une manipulation atraumatique et un respect optimal des vinculums et de la gaine synoviale. L'humidification permanente du champ opératoire est recommandée pour faciliter la réparation. D'autres techniques de suture sont mentionnées, comme la technique de Brunelli (suture fixée sur l'extrémité proximale par un nœud coulant) ou le barb-wire de Jennings (pour les plaies distales). Le point de Kessler, bien que moins résistant que des points à passages multiples, reste largement utilisé.
4. Gestion des poulies et de la gaine synoviale
Concernant les poulies, le document souligne l’importance de leur préservation, en particulier les poulies A2 et A4. Une ouverture partielle de ces poulies peut être réalisée si nécessaire pour permettre une course normale de la suture tendineuse. Des techniques de plastie d’agrandissement (en V, Y, ou Ω) peuvent être envisagées. Pour la gaine synoviale, l’exérèse est limitée car elle augmente les adhérences et la réaction cicatricielle. Une suture de la gaine est possible quand les conditions techniques le permettent. La libération chirurgicale des adhérences péritendineuses, entre 3 et 6 mois post-opératoire, est envisagée si nécessaire, après un délai de rééducation.
5. Greffe tendineuse
La greffe tendineuse, réservée aux lésions sévères anciennes et non réparables, est une procédure de moins en moins fréquente. Lorsqu’elle est pratiquée, elle est souvent réalisée en deux temps selon la méthode de Hunter. Cette intervention nécessite la restauration d'au minimum trois poulies digitales en préservant la gaine digitale existante. Le document met en avant le fait que la greffe tendineuse représente une intervention lourde réservée aux cas les plus complexes, et souligne les risques liés à l’acte chirurgical lui-même et à l'immobilisation post-opératoire.
III.Rééducation post opératoire et évaluation des résultats
La rééducation post-opératoire est cruciale pour le succès du traitement. Plusieurs techniques sont présentées, notamment les méthodes de Kleinert (mobilisation active), Duran (mobilisation passive), et Cooney (mobilisation par ténodèse). L'utilisation combinée de ces techniques, ainsi que la technique « place and hold », est discutée. L'évaluation des résultats se base sur le système T.A.M., qui évalue la flexion active des articulations digitales. Les résultats de l'étude montrent de meilleurs résultats dans les zones I, III et V, avec des résultats plus faibles en zone II, reflétant la complexité des lésions dans cette zone. Les résultats globaux sont comparés à d'autres études, confirmant l'efficacité de la technique de Kessler modifiée.
1. Protocoles de rééducation post opératoire
La rééducation post-opératoire est une composante essentielle du traitement des lésions des tendons fléchisseurs. Le document présente plusieurs protocoles. Une immobilisation plâtrée simple, maintenue pendant trois semaines, avec le poignet en légère flexion et inclinaison cubitale, et les articulations en flexion, est mentionnée. Au-delà de la troisième semaine, une rééducation active est initiée. La méthode de Kleinert utilise une mobilisation active en extension avec un retour passif en flexion par élastique durant les quatre premières semaines. La technique de Duran privilégie une mobilisation passive des articulations interphalangiennes, l’attelle maintenant le poignet et les métacarpo-phalangiennes en flexion. La technique de Cooney de la Mayo Clinic exploite le glissement tendineux passif induit par la flexion-extension du poignet. Enfin, la technique « place and hold » est la plus sûre, consistant à fléchir facilement les doigts puis à les maintenir sans forcer dans cette position. Différentes approches sont proposées, soulignant la nécessité d'adapter la rééducation aux spécificités de chaque patient et technique chirurgicale.
2. Mobilisation active précoce et techniques combinées
L’étude souligne l’importance croissante de la mobilisation active précoce au cours des dix dernières années, notamment avec l'utilisation de sutures tendineuses à 4 ou 6 brins. Cette approche augmente le glissement tendineux du fléchisseur profond de 36 % par rapport à une mobilisation passive. L’étude de Chow combine le protocole de Duran avec celui de Kleinert modifié (ajout d'une poulie de réflexion palmaire), obtenant 93 % d’excellents et bons résultats selon la classification de Strickland. Alnot utilise la technique de Duran et l'effet ténodèse, mobilisant chaque articulation du coude aux doigts. L'équipe de l'hôpital universitaire de Genève a adapté un protocole original associant mobilisation active et protocole de Kleinert modifié, obtenant 81 % d’excellents et bons résultats. Cannon et Strickland associent la mobilisation en ténodèse à des exercices de « placé-tenu » avec attelle articulée.
3. Système d évaluation T.A.M. et analyse des résultats
L'évaluation des résultats fait appel au système T.A.M. (Total Active Motion), recommandé en 1976, qui somme les flexions angulaires actives des trois articulations digitales et soustrait les déficits d'extension. Ce système, bien qu’excluant l’action des muscles extrinsèques, est simple, rapide et reflète bien l'action des fléchisseurs en zone II. L'analyse des résultats selon les zones topographiques montre de meilleurs résultats dans les zones I, III et V, avec un résultat plus faible en zone II, soulignant la complexité de la réparation dans cette zone. Les résultats de la série étudiée sont comparés à ceux d'autres études (Elliot, Gerard, Langlais, Tropet et Menez), et se situent dans la même fourchette. L'étude conclut que le point de Kessler modifié est préconisé pour sa simplicité, rapidité et qualités biomécaniques.
