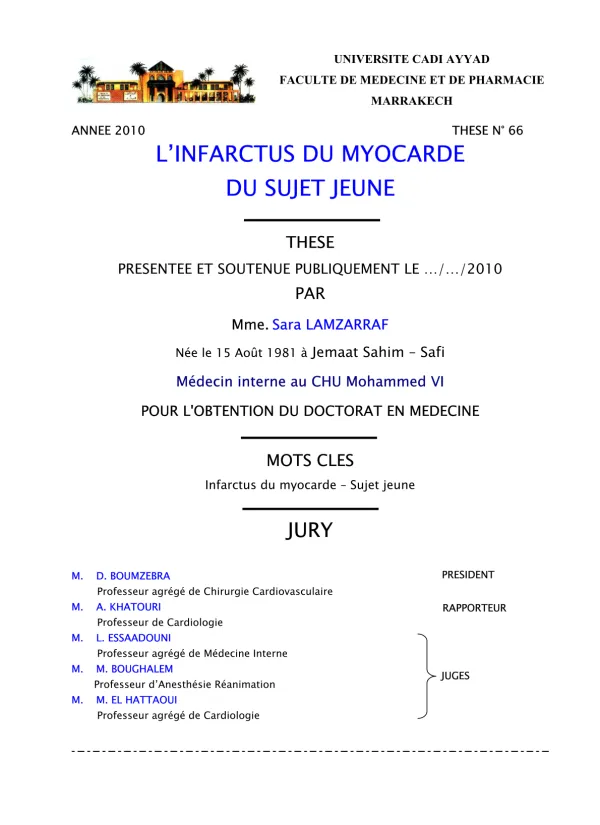
L'Infarctus du Myocarde du Sujet Jeune
Informations sur le document
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 2.20 MB |
- Infarctus du myocarde
- Sujet jeune
- Médecine
Résumé
I.Épidémiologie de l Infarctus du Myocarde IDM chez les Sujets Jeunes
L'infarctus du myocarde chez les sujets jeunes (moins de 45 ans pour les hommes, moins de 55 ans pour les femmes) est un événement rare, représentant 4 à 10% des IDM de tous âges. Cependant, son incidence est en augmentation. Cette étude, menée au CHU MED VI et à l'hôpital militaire Avicenne de Marrakech entre 2005 et 2009, a analysé 30 patients (groupe 1, moins de 45/55 ans) et un groupe témoin (groupe 2, plus de 45/55 ans). Le tabagisme et la dyslipidémie sont des facteurs de risque cardiovasculaire (FRCV) majeurs dans le groupe 1, plus significativement que dans le groupe 2. L'étude de Framingham est mentionnée comme référence, rapportant une incidence plus élevée d'infarctus du myocarde chez les hommes de 30 à 34 ans comparé aux femmes de 35 à 44 ans, avec une augmentation significative après 55 ans. Une histoire familiale de maladie coronarienne est retrouvée chez environ 50% des sujets jeunes, contre 20% des sujets âgés.
1. Prévalence et Incidence de l IDM chez les Jeunes
L'étude souligne la rareté relative, mais l'incidence croissante des infarctus du myocarde (IDM) chez les sujets jeunes, définis comme étant âgés de moins de 45 ans pour les hommes et de moins de 55 ans pour les femmes. Ce sous-groupe représente entre 4 et 10% de tous les cas d'IDM, soulignant son importance malgré sa faible proportion globale. L'étude mentionne l'enjeu économique important lié à cette augmentation de l'incidence. L'IDM constitue souvent la première manifestation de la maladie athéromateuse chez les jeunes, bien que des causes additionnelles soient possibles, telles que des anomalies de l'hémostase ou un spasme coronaire. La comparaison avec les données de l'étude de Framingham est pertinente, car elle révèle une incidence d'infarctus du myocarde sur 10 ans de 12,9‰ chez l'homme (30-34 ans) et de 5,2‰ chez la femme (35-44 ans). Cette incidence est multipliée par neuf entre les tranches d'âge 30-34 ans et 55-64 ans, pour les deux sexes, indiquant une accélération significative du risque avec l'âge. Malgré une prévalence masculine plus importante dans cette tranche d'âge, le pronostic différentiel entre hommes et femmes est le plus marqué chez les jeunes, avec une surmortalité significative chez les femmes.
2. Facteurs de Risque Cardiovasculaire FRCV chez les Jeunes
L'étude met en lumière les facteurs de risque cardiovasculaire (FRCV) prédominants chez les jeunes sujets atteints d'IDM. Le tabagisme et la dyslipidémie émergent comme les FRCV les plus importants dans le groupe des sujets jeunes (67% et 50% respectivement), contrairement au groupe témoin (64% et 27%). Cette différence est statistiquement significative. D'autres FRCV tels que le diabète et l'hypertension artérielle (HTA) sont également présents, mais à des fréquences moins marquées dans le groupe jeune (37% et 13% respectivement) comparativement au groupe plus âgé (39% et 22%). L'étude évoque aussi le syndrome métabolique, défini par une association de facteurs de risque (HTA, hypertriglycéridémie, faible HDL-cholestérol, obésité androïde et hyperglycémie), comme un élément pertinent dans la compréhension du développement de la maladie. Le rôle des lipoprotéines de basse densité (LDL) et de l'apoprotéine B est également mentionné, soulignant leur implication dans le risque athéroscléreux. L'influence des contraceptifs oraux est soulignée, notamment en combinaison avec le tabagisme, multipliant le risque d'IDM par 20 chez les jeunes femmes. Enfin, l'histoire familiale de maladie coronarienne est plus fréquente chez les jeunes ayant subi un IDM (50%), comparée aux sujets âgés (20%), suggérant un rôle potentiel de la prédisposition génétique.
3. Antécédents Familiaux et Prédisposition Génétique
Une analyse approfondie des antécédents familiaux révèle une forte association entre les IDM chez les jeunes et une histoire familiale de maladie coronarienne. Environ 50% des jeunes sujets étudiés ont rapporté des antécédents familiaux d'accidents coronariens (infarctus, angor instable, angor stable ou mort subite avant 60 ans chez un parent du premier degré). Ce chiffre contraste avec celui observé chez les sujets âgés (10 à 30%), indiquant une différence significative. Bien que l'étude n'ait pas trouvé de lien direct entre la sévérité des lésions coronariennes et les antécédents familiaux, elle suggère l'importance de l'interaction entre facteurs environnementaux et prédisposition génétique. L’étude explore également le rôle des polymorphismes génétiques impliqués dans l’hémostase et la thrombose. Bien que l'étude de polymorphismes génétiques chez des patients plus âgés se soit avérée peu concluante, une analyse plus ciblée chez des jeunes patients a montré une association entre le polymorphisme PlA2 et le risque d'infarctus avant 45 ans, notamment chez les fumeurs. Ceci suggère une interaction complexe entre facteurs génétiques et environnementaux dans le développement précoce de la maladie athérothrombotique coronarienne. L'étude évoque aussi le polymorphisme du récepteur monocytaire CD14 comme un facteur associé au risque d'IDM chez les jeunes.
II.Aspects Cliniques et Électriques de l IDM chez les Sujets Jeunes
Dans le groupe 1, l’IDM est inaugural dans 83% des cas, contre 66% dans le groupe 2. La localisation antérieure est plus fréquente dans le groupe 1. L'électrocardiogramme (ECG) est crucial pour le diagnostic, montrant des ondes T géantes, un sus-décalage du segment ST, et l'apparition d'ondes Q de nécrose. La douleur thoracique, souvent atypique chez les jeunes, est le symptôme principal, bien que certains IDM puissent être révélés par d'autres manifestations (insuffisance cardiaque, hypertension). L'effort physique est un facteur déclenchant moins fréquent qu'on pourrait le penser.
1. Aspects Cliniques de l IDM chez les Jeunes
L'étude met en évidence que chez les jeunes, l'infarctus du myocarde (IDM) est souvent inaugural, représentant la première manifestation clinique de la maladie coronarienne dans 60 à 80% des cas, voire 83% dans le groupe d'étude 1 (moins de 45 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes). Ceci diffère significativement du groupe 2 (plus de 45/55 ans) où l'IDM complique souvent des manifestations coronariennes préexistantes (66%). La présentation clinique de l'IDM chez les jeunes est également notable. Bien que la douleur thoracique soit le symptôme principal, elle peut être atypique et difficile à identifier comme un infarctus. Le début est souvent brutal, et l'IDM peut se manifester par d'autres signes que la douleur thoracique : une insuffisance ventriculaire gauche ou globale, une poussée hypertensive, des palpitations, des épigastralgies, un angor syncopal, ou être découvert fortuitement lors d'un électrocardiogramme systématique. L'effort physique est moins souvent un facteur déclenchant que chez les sujets plus âgés. Seul un patient du groupe 1 a présenté un IDM lors d'un effort physique, tandis que 57% des cas du groupe 2 sont survenus au repos. La localisation antérieure de l'infarctus est plus fréquente chez les jeunes (70% dans le groupe 1 contre 55% dans le groupe 2), avec une répartition détaillée incluant des localisations antéro-septales, antéro-septo-apicales, latérales hautes et antérieures étendues.
2. Aspects Électrocardiographiques de l IDM chez les Jeunes
L'électrocardiogramme (ECG) joue un rôle essentiel dans le diagnostic de l'IDM. Dans les deux premières heures suivant le début des symptômes, on observe des ondes T géantes, symétriques et pointues, reflétant une ischémie sous-endocardique. Entre la deuxième et la sixième heure, un sus-décalage du segment ST, englobant l'onde T, indique une lésion sous-épicardique. À partir de la sixième heure, l'apparition d'ondes Q confirme la nécrose myocardique. Le diagnostic d'IDM est basé sur au moins deux dérivations concordantes montrant ces anomalies électriques, avec ou sans signes en miroir. La présence de signes d'accompagnement comme les sueurs, les troubles digestifs ou les lipothymies peut également orienter le diagnostic. Un interrogatoire précis concernant les facteurs de risque cardiovasculaires, les antécédents cardiologiques (angor, IDM, interventions chirurgicales) et l'horaire du début de la douleur est crucial pour la détermination de la stratégie thérapeutique. Il est important de différencier l'IDM d'autres urgences comme la dissection aortique, la péricardite aiguë et l'embolie pulmonaire, notamment afin d'éviter une thrombolyse inappropriée.
III. Coronarographie et Lésions Coronaires
La coronarographie, réalisée chez une partie des patients des deux groupes (9 dans le groupe 1, 14 dans le groupe 2), a révélé une prédominance de lésions coronaires non significatives et monotronculaires dans le groupe 1, contrairement au groupe 2 où les lésions pluritronculaires sont plus fréquentes. L’accès à la coronarographie était limité pour certains patients en raison de contraintes financières. L’atteinte de l’artère interventriculaire antérieure (IVA) est fréquemment observée.
1. Résultats de la Coronarographie chez les Sujets Jeunes et Âgés
L'étude a réalisé des coronarographies sur un sous-ensemble de patients des deux groupes : 9 patients du groupe 1 (moins de 45/55 ans) et 14 patients du groupe 2 (plus de 45/55 ans). L'accès à la coronarographie était limité par les moyens financiers des patients ; elle était réalisée soit d’emblée, soit après un test de viabilité mettant en évidence une ischémie résiduelle. Les résultats montrent une différence significative entre les deux groupes concernant le type de lésions coronariennes observées. Dans le groupe 1, la majorité des coronarographies ont révélé des lésions non significatives ou des lésions monotronculaires. L'atteinte de l'artère interventriculaire antérieure (IVA) était notable parmi les lésions monotronculaires, avec la pose de stents dans certains cas. Une atteinte tritronculaire a également été observée, nécessitant la pose d'un stent au niveau de l'IVA, ainsi qu'un cas de spasme coronaire. En comparaison, le groupe 2 présentait une prépondérance de lésions pluritronculaires, soulignant une différence significative dans la sévérité et l'étendue des lésions coronariennes entre les sujets jeunes et les sujets plus âgés. La fréquence des infarctus avec des coronaires saines ou présentant des sténoses inférieures à 50% est significativement plus élevée chez les jeunes (environ 20%) par rapport aux sujets plus âgés (1 à 5%).
2. Signification des Différences Angiographiques
Les différences observées à la coronarographie entre les groupes 1 et 2 reflètent des particularités de la maladie coronarienne chez les sujets jeunes. La prédominance des lésions monotronculaires et non significatives chez les jeunes suggère un mécanisme physiopathologique différent de celui observé chez les patients plus âgés où les lésions pluritronculaires sont plus fréquentes. L'atteinte monotronculaire, la règle chez plus de 50% des patients jeunes, est significativement différente de celle observée chez les patients plus âgés. Cette différence est corroborée par une meilleure fraction d'éjection ventriculaire gauche chez les jeunes patients après reperfusion. La distribution des lésions est plus équilibrée entre les trois artères coronaires dans les études à grande échelle. Cependant, des études avec des effectifs plus faibles ont parfois montré une prédominance de l'atteinte de l'artère interventriculaire antérieure ou de la coronaire droite. La fréquence élevée d'infarctus à coronaires saines ou sans lésions significatives chez les jeunes (jusqu'à 20%) souligne une caractéristique unique de cette population, contrastant avec la fréquence beaucoup plus faible (1 à 5%) chez les patients plus âgés. L'absence d'études angiographiques permettant d'évaluer simultanément la diffusion et la sévérité de l'athérosclérose limite l'interprétation complète de ces données.
IV.Traitement et Pronostic de l IDM chez les Sujets Jeunes
Le traitement médical conventionnel (HBPM, clopidogrel, bêtabloquants, IEC, statines, dérivés nitrés) est similaire pour les jeunes et les sujets plus âgés, bien que l'angioplastie ou la thrombolyse soit plus utilisée chez les jeunes selon les études PREVENIR1 et PREVENIR2. La mortalité hospitalière est significativement plus basse dans le groupe 1. Le pronostic à court et moyen terme est généralement excellent, mais des facteurs de mauvais pronostic (arythmies, insuffisance cardiaque) augmentent la mortalité et le risque de récidive. Des études supplémentaires sont nécessaires pour évaluer le pronostic à long terme et l'impact d'une prise en charge agressive des FRCV, notamment le tabagisme. La mortalité est paradoxalement plus élevée chez les jeunes femmes que chez les hommes.
1. Traitement de l IDM chez les Sujets Jeunes
Le traitement de l'infarctus du myocarde (IDM) chez les jeunes patients dans cette étude suit les lignes directrices conventionnelles. Un traitement médical anti-ischémique est principalement utilisé, comprenant des héparines à bas poids moléculaire (HBPM), du clopidogrel, des bêtabloquants (ou un inhibiteur calcique bradycardisant en cas de contre-indication aux bêtabloquants ou suspicion de spasme coronaire), des inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC), des statines et des dérivés nitrés. Il n'y a pas de différence majeure dans le traitement médical entre les sujets jeunes et les sujets plus âgés. Cependant, les études PREVENIR1 et PREVENIR2 montrent une utilisation plus fréquente de la reperfusion par angioplastie ou thrombolyse chez les jeunes (63% vs 46%). Les antiagrégants plaquettaires et les IEC sont prescrits aussi souvent chez les jeunes que chez les plus âgés. En revanche, l'utilisation des bêtabloquants et des statines est plus importante chez les patients de moins de 45 ans. De plus, la réadaptation cardiaque est plus fréquente chez les jeunes patients. Les limitations financières des patients ont restreint l’accès à la revascularisation coronarienne, limitant les interventions à l'angioplastie ou à la thrombolyse dans certains cas.
2. Pronostic de l IDM chez les Sujets Jeunes
Le pronostic de l'IDM chez les jeunes patients est généralement excellent à court et moyen terme, avec une mortalité à 30 jours et à 1 an inférieure à 3%, significativement moindre que celle des sujets plus âgés. Même avant le développement des traitements de reperfusion, le pronostic était favorable. Cependant, la présence de facteurs de mauvais pronostic à l'admission (antécédents d'IDM, arythmies, insuffisance cardiaque, dilatation ventriculaire gauche) augmente la mortalité et le risque de récidives d'infarctus à 1 an, justifiant une approche thérapeutique plus agressive. L'étude rapporte une mortalité hospitalière plus basse dans le groupe des sujets jeunes (moins de 45/55 ans) comparé au groupe plus âgé. La mortalité chez les sujets jeunes semble dépendre de l'étendue des lésions coronariennes et de la dysfonction ventriculaire gauche, bien que des études plus approfondies soient nécessaires. Des études prospectives sur 5 ans montrent que les récidives précoces sont liées à une progression rapide de la maladie athérothrombotique coronarienne. Cependant, un point important concerne le pronostic des femmes jeunes, qui présentent une surmortalité précoce après un IDM, notamment avant 50 ans, double de celle des hommes du même âge. Des facteurs comme une plus grande prédisposition génétique, une plus grande réactivité plaquettaire, et une plus forte incidence d'infarctus à coronaires saines sont mis en avant pour expliquer cette différence.
