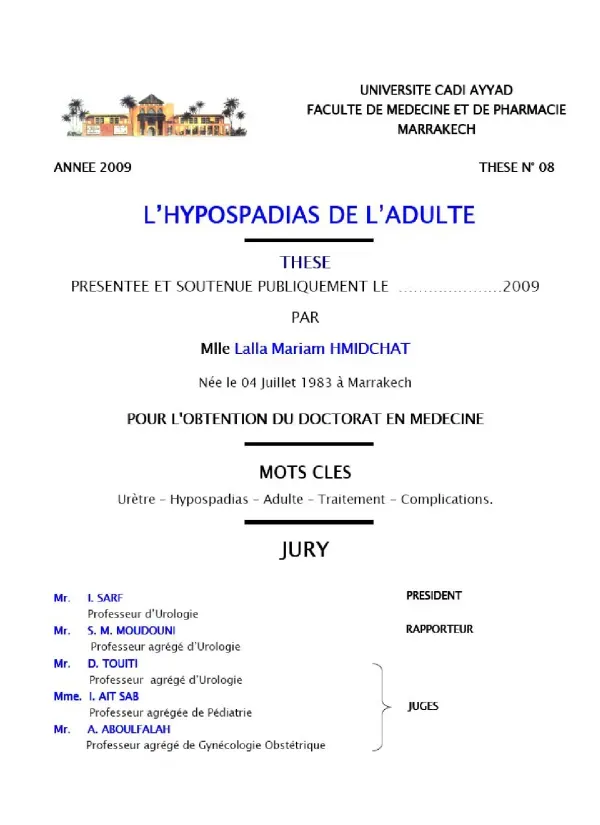
Liste des Professeurs et Serment de la Profession Médicale
Informations sur le document
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 5.64 MB |
- Médecine
- Professeurs
- Serment d'Hippocrate
Résumé
I.Historique des techniques chirurgicales pour l hypospadias
L'histoire de la chirurgie de l'hypospadias est longue et riche. Dès le Xe siècle, Abulcasis proposa une technique de tunnellisation. Des avancées significatives ont suivi au XVIe siècle avec Paré, puis en 1707 avec Dionis. La première classification de l'hypospadias (balanique, pénien, scrotal, périnéal) est due à Etienne Bouisson en 1860. Différentes techniques de réparation, incluant l'utilisation de lambeaux cutanés pour prévenir les sténoses (Maisonneuve, 1859) et la reconstruction urétrale (Nove-Josserand, 1897; Mc Indoe, 1948), ont été développées au XIXe et XXe siècles. Plus de 200 techniques ont été décrites, souvent des variations de quelques interventions principales. Des chirurgiens comme Duplay, Nove-Josserand, Mathieu, Duckett, Edmonds, Byars, Mc Comarck, Humby, Horton et Marschall ont contribué à ces avancées.
1. Techniques Anciennes et Premières Classifications
L'histoire des techniques chirurgicales pour l'hypospadias remonte au Xe siècle avec Abulcasis qui proposa une technique de tunnellisation. Au XVIe siècle, Ambroise Paré suggéra la création d'un canal à travers la verge. En 1707, Dionis décrivit un nouveau procédé de tunnellisation, utilisant une canule de plomb laissée en place jusqu'à cicatrisation complète. Une étape majeure fut franchie en 1860 avec Etienne Bouisson qui proposa la première classification des hypospadias en quatre catégories: balaniques, péniens, scrotaux et périnéaux. Il souligna l'importance du redressement de la verge par incision transversale pour favoriser la reproduction. Même si Aristote avait déjà décrit l'hypospadias avec précision, c'est Claude Galien qui lui donna son nom et proposa un traitement consistant à perforer le gland avec des épines. Aux Ier et IIe siècles, Heliodorus et Antyllus d'Alexandrie décrivirent des variantes anatomiques, les conséquences fonctionnelles et proposèrent les premières techniques chirurgicales, reprises par Paul d'Égine au VIIe siècle. Cette dernière technique, une amputation de la verge jusqu'au niveau du méat hypospade, n'est plus utilisée de nos jours.
2. Développements du XIXe siècle Lambeaux Cutanés et Premières Innovations
Le XIXe siècle marque des avancées significatives. En 1859, Maisonneuve proposa l'utilisation d'un lambeau cutané introduit dans le néo-tunnel pour prévenir les sténoses post-tunnellisation. Cependant, en 1863, Félix Guyon considérait les hypospadias scrotaux comme inopérables et déconseillait l'intervention chirurgicale pour les hypospadias balaniques. Dieffenbach, en 1836, publia un article sur la guérison des fentes congénitales de la verge (hypospadias) dans la Gazette médicale. En Allemagne, en 1868, Thiersch proposa la technique du « lambeau déplacé », reprise avec succès en France par Théophile Anger pour un hypospadias péno-scrotal. Simon Duplay, en 1874, décrivit une procédure en deux temps opératoires utilisant un lambeau cutané recouvert par la peau du fourreau, mais cette technique présentait des inconvénients (fistules, désunions). Duplay la modifia en 1880, et elle fut perfectionnée par Denis Browne et Leveuf en 1949. En 1897, Nove-Josserand réalisa la première reconstruction urétrale par plastie de peau libre, une technique modifiée plus tard par Mc Indoe (1948) et Young et Benjamin. Des chirurgiens comme Edmonds (1913), Ombredanne (1932), et Blair (1933) utilisaient déjà la peau du prépuce pour recouvrir la face ventrale de la verge et le néo-urètre.
3. XXe siècle et au delà Multiplication des Techniques et Approche Uro endocrinienne
Le XXe siècle a vu une prolifération des techniques chirurgicales pour l'hypospadias. Plus de 200 techniques ont été décrites, avec des variations mineures entre elles. Des chirurgiens comme Duplay, Nove-Josserand, Mathieu, Duckett, Edmonds, Byars, Mc Comarck, Humby, Horton et Marschall ont tous contribué, mais aucune technique ne fait l'unanimité. L'approche uro-endocrinienne a permis de mieux comprendre l'étiologie de l'hypospadias et d'améliorer la préparation préopératoire par traitement hormonal pour optimiser la cicatrisation. L’ensemble de ces techniques, bien que nombreuses et variées, représentent finalement des adaptations de 3 ou 4 interventions principales. La recherche de la technique idéale se poursuit.
II.Étiologie et développement embryologique de l hypospadias
L'hypospadias, une malformation congénitale de l'urètre, résulte d'une anomalie du développement embryonnaire masculin. La sécrétion d'hormones androgènes, notamment l'hormone anti-müllérienne (AMH) et la testostérone, est cruciale. Des défauts de fusion des structures urétrales pendant l'embryogenèse, selon le moment où ils surviennent, déterminent la sévérité de l'hypospadias (simple ou complexe). Des facteurs génétiques, impliquant des mutations du gène SRD5A2 (chromosome 2), et endocriniens, liés à la biosynthèse de la 5α-réductase ou aux récepteurs aux androgènes, sont également impliqués. Des perturbateurs endocriniens (pesticides, produits chimiques, phytoestrogènes) peuvent jouer un rôle.
1. Rôle des Hormones Androgènes dans le Développement Embryonnaire Masculin
Le développement du sexe phénotypique interne masculin chez les embryons mâles (46 XY) dépend de la sécrétion et de l'action de deux hormones androgènes: l'hormone anti-müllérienne (AMH) et la testostérone. L'AMH, produite par les cellules de Sertoli dès la 8ème semaine de grossesse, et dépendante d'un gène situé sur le chromosome 19, induit la régression des canaux de Müller. La testostérone, produite à partir de la fin de la 8ème semaine par les cellules de Leydig, est initialement stimulée par l'HCG maternelle puis, à partir de la 12ème semaine, par la LH hypophysaire fœtale. Elle est essentielle au maintien et au développement des canaux de Wolff (épididyme, canaux déférents, vésicules séminales et canaux éjaculateurs). Une défaillance dans la production ou l'action de ces hormones peut perturber le développement normal, contribuant potentiellement à l’apparition d’un hypospadias.
2. Embryogenèse de l Hypospadias et Sévérité de la Malformation
L'hypospadias survient suite à des échecs de fusions des structures urétrales pendant l'embryogenèse masculine. La sévérité de la malformation est considérée comme un continuum. Des échecs de fusion précoces conduisent à des hypospadias sévères ou complexes (périnéaux, scrotaux), tandis que les échecs tardifs résultent en des hypospadias plus simples (balaniques, péniens). Une aplasie de la face ventrale de la verge, souvent en forme de V, est caractéristique, expliquant la coudure fréquemment observée. La compréhension précise du moment de l'échec de la fusion urétrale est donc fondamentale pour déterminer la gravité de l'hypospadias et adapter le traitement.
3. Facteurs Génétiques et Endocriniens dans l Étiologie de l Hypospadias
Des facteurs génétiques contribuent à l'étiologie de l'hypospadias. Des mutations du gène SRD5A2, situé sur le chromosome 2 et responsable de l'activité enzymatique de la 5α-réductase, peuvent perturber la production de dihydrotestostérone, nécessaire au développement du tractus urogénital masculin. Une déficience en 5α-réductase peut se manifester par un hypospadias périnéoscrotal, une cryptorchidie, un sous-développement du scrotum et une hypoplasie prostatique, bien que l'hypospadias puisse être la seule manifestation. Des facteurs endocriniens jouent également un rôle crucial. Les androgènes sont essentiels à la formation de la portion ventrale de l'urètre. Des déficiences dans la biosynthèse de la 5α-réductase ou des anomalies des récepteurs aux androgènes peuvent conduire à l'hypospadias. L’exposition à des perturbateurs endocriniens, tels que certains insecticides, pesticides, fongicides, produits chimiques industriels, substances pharmaceutiques, détergents et composants plastiques, ainsi que des phytoestrogènes, sont également suspectés.
III.Malformations associées et états intersexués
L'hypospadias peut s'associer à d'autres anomalies dans plus de 25% des cas, notamment des malformations du haut appareil urinaire, cryptorchidie, micropénis et hypospadias vulviforme. Près de 20% des hypospadias sévères (scrotal ou périnéal) sont liés à des anomalies chromosomiques, nécessitant un caryotype. Des états intersexués peuvent être considérés lorsque l'hypospadias est sévère et associé à d'autres anomalies génitales, nécessitant un bilan génétique et hormonal approfondi pour déterminer le sexe.
1. Malformations Associées à l Hypospadias
Un examen clinique complet est crucial pour tout patient présentant un hypospadias, car des anomalies anatomiques indépendantes sont présentes dans plus de 25% des cas. Ces malformations concernent souvent le haut appareil urinaire et peuvent s'intégrer dans un syndrome polymalformatif complexe. Une attention particulière doit être portée à la présence d'un hypospadias vulviforme, à une absence de migration testiculaire (unilatérale ou bilatérale), et à un micropénis. L'échographie facilite le bilan du haut appareil urinaire. La fréquence des anomalies associées augmente avec la localisation proximale et postérieure de l'hypospadias. Près de 20% des hypospadias sévères (scrotal ou périnéal) sont associés à des anomalies chromosomiques, rendant la réalisation d'un caryotype indispensable en cas d'anomalie associée. Une surveillance attentive est nécessaire pour détecter toute autre malformation, augmentant ainsi les chances d'un traitement efficace et complet.
2. États Intersexués et Hypospadias
L'hypospadias peut s'inscrire dans le contexte plus large des ambiguïtés sexuelles et de l'intersexualité lorsque sa sévérité est importante (ex: hypospadias périnéal) et qu'il est associé à d'autres problèmes génitaux (cryptorchidie unilatérale ou bilatérale, scrotum bifide ou hypoplasique, micropénis). Dans de tels cas, un bilan anatomique précis de l'urètre (recherche d'une poche vaginale résiduelle) et un bilan génétique et hormonal complet sont nécessaires. La déclaration du sexe et du prénom de l'enfant à l'état civil doit être différée jusqu'à l'établissement d'un diagnostic étiologique précis. Cette démarche est une urgence diagnostique afin d'éliminer une hyperplasie congénitale des surrénales et de déterminer le sexe définitif de l'enfant. Une approche multidisciplinaire et une prise de décision prudente sont essentielles dans ces situations complexes.
IV.Conséquences de l hypospadias et correction chirurgicale
L'hypospadias entraîne un jet urinaire déclive, impactant la vie sociale et psychologique du patient. La chirurgie de l'hypospadias vise la reconstruction urétrale et le redressement éventuel de la verge. L'âge de l'intervention a diminué au cours des dernières décennies, se situant actuellement entre 6 mois et 2 ans. Plus de 210 techniques chirurgicales ont été décrites, témoignant de la complexité de la procédure et de l'absence de technique parfaite. Les techniques utilisent souvent le prépuce, la muqueuse buccale ou vésicale comme greffe. Des complications comme les sténoses et les fistules sont possibles. L'utilisation de lunettes grossissantes ou d'un microscope est recommandée.
1. Conséquences Fonctionnelles et Psychologiques de l Hypospadias
L'hypospadias, caractérisé par un urètre plus court et un méat urétral malpositionné sur la face inférieure de la verge, entraîne des conséquences fonctionnelles et psychologiques. Le jet urinaire est souvent déclive, variant en fonction de la sévérité de la malformation et de la présence d'une « lame brise-jet ». Ceci peut causer des éclaboussures ou obliger le patient à uriner assis, engendrant des inconvénients sociaux et une gêne psychologique importante. Les conséquences psychosociales sont significatives, impactant l'estime de soi et les interactions sociales, surtout chez l'enfant qui peut développer des complexes. L’objectif de la correction chirurgicale est non seulement de résoudre le problème fonctionnel, mais également d'améliorer le bien-être psychologique du patient en lui permettant de vivre une vie normale et sans contraintes.
2. Chirurgie de l Hypospadias Évolution des Pratiques et Âge de l Intervention
Initialement pratiquée pendant l'enfance ou l'adolescence, la chirurgie réparatrice de l'hypospadias a évolué vers une intervention plus précoce. Depuis 30 ans, l'âge de l'intervention a diminué, passant de 5-6 ans dans les années 1970 à une fourchette actuelle de 6 mois à 2 ans (la majorité des interventions se situant entre 12 et 18 mois). Cette évolution est motivée par la meilleure qualité de la peau de la verge chez les jeunes enfants, minimisant les risques de complications postopératoires. Un néo-urètre réalisé à cet âge grandit avec la verge et évite les problèmes de pilosité à la puberté. L'intervention précoce permet également à l'enfant de retrouver une fonction urinaire normale avant l'entrée à l'école, évitant ainsi les problèmes psychologiques liés à la différence. Cependant, la chirurgie de l'hypospadias reste complexe et exigeante, nécessitant une grande dextérité et une attention particulière aux détails techniques.
3. Principes et Défis de la Chirurgie de l Hypospadias
La chirurgie de l'hypospadias est une intervention complexe aux enjeux multiples: urologiques, sexuels, psychologiques et esthétiques. Plus de 210 techniques chirurgicales ont été décrites, témoignant de la difficulté de trouver une solution parfaite. La dextérité du chirurgien est primordiale, et l'humilité est de mise car les complications sont inévitables. L'utilisation de lunettes grossissantes ou d'un microscope est recommandée pour la précision des gestes chirurgicaux. Les sutures doivent être réalisées avec du fil résorbable fin (polydioxanone ou acide polyglycolique) en surjet intradermique inversant, avec une hémostase rigoureuse et un temps opératoire maîtrisé pour éviter l'ischémie. Les progrès des techniques opératoires ont conduit à reconstruire tous les hypospadias, même les formes mineures, soulignant l'importance d'un traitement pour tous les patients.
V.Techniques chirurgicales de l hypospadias chez l adulte
La chirurgie de l'hypospadias chez l'adulte est plus complexe que chez l'enfant en raison de la disparition du prépuce, de la pilosité accrue, du risque infectieux plus élevé et de l'impact des érections. Les taux de complications sont plus importants et leur traitement est plus difficile. Les techniques utilisées incluent les techniques de Duplay, Duckett, Denis-Brown, Mathieu et la greffe de muqueuse buccale ou vésicale. Des études montrent des taux de succès variables selon la technique et la présence de complications telles que les fistules et les sténoses. L'étude porte sur 30 cas d'adultes (17-36 ans) traités dans les CHU Ibn Sina (Rabat) et Mohamed VI (Marrakech) entre 1989 et 2008, avec une prédominance des formes postérieures (47%).
1. Difficultés Chirurgicales Spécifiques à l Adulte
La correction chirurgicale de l'hypospadias chez l'adulte présente des défis spécifiques. L'intervention est plus complexe qu'en pédiatrie en raison de plusieurs facteurs. La disparition habituelle de la réserve de peau préputiale limite les options chirurgicales. La présence d'une pilosité plus abondante augmente le risque infectieux et peut gêner la cicatrisation. Les érections postopératoires, plus fréquentes et intenses, mettent à rude épreuve les sutures et compromettent la réussite de l'intervention. Les taux de complications sont significativement plus élevés chez l'adulte et leur traitement est plus difficile. L'expérience du chirurgien est donc primordiale pour obtenir un résultat satisfaisant et minimiser les risques. Ces difficultés accrues justifient l’importance d'une approche chirurgicale adaptée et personnalisée.
2. Techniques Chirurgicales Utilisées chez l Adulte
Plusieurs techniques chirurgicales sont utilisées pour traiter l'hypospadias chez l'adulte, bien que les choix soient souvent limités par les facteurs mentionnés précédemment. Parmi les techniques mentionnées dans l'étude, on retrouve la technique de Duplay et la technique de Duckett (7 cas chacune), la technique de Denis-Brown et la technique de Mathieu (6 cas chacune), ainsi que la technique de Horton-Devine et la greffe de muqueuse vésicale (2 cas chacune). Le choix de la technique dépendra de la morphologie de l'hypospadias, de l'état de la verge, et de l'expérience du chirurgien. L'urétroplastie, avec ou sans redressement de la verge, est l'objectif principal de ces interventions. Le taux de succès et les complications varient selon la technique utilisée, soulignant la nécessité d’une analyse rigoureuse des résultats et d’un suivi postopératoire attentif.
3. Résultats d une Étude sur l Hypospadias chez l Adulte au Maroc
Une étude rapporte 30 cas d'hypospadias chez des adultes âgés de 17 à 36 ans, suivis dans les services d'urologie des CHU Ibn Sina (Rabat, 1989-1999) et Mohamed VI (Marrakech, 2000-2008). La prédominance des formes postérieures (47%) est notable. Parmi les patients, 14 ont bénéficié d'une urétroplastie avec redressement de la verge, tandis que 16 ont eu une urétroplastie seule. Les techniques utilisées incluent Duplay, Duckett, Denis-Brown, Mathieu, Horton-Devine, et la greffe de muqueuse vésicale. Cette étude, menée au Maroc, fournit des données cliniques précieuses sur la prise en charge de l'hypospadias chez l'adulte dans ce contexte spécifique, permettant de comparer les résultats avec d'autres études internationales. L’analyse des résultats souligne les défis et les complexités associées à la chirurgie de l'hypospadias chez l'adulte.
VI.Aspects psychologiques et suivi post opératoire de l hypospadias
L’impact psychologique de l’hypospadias est important, influençant la vie sociale et sexuelle des patients. Des études ont montré des difficultés relationnelles et une image corporelle négative plus fréquentes chez les patients atteints d'hypospadias, surtout chez les non-opérés. Le suivi post-opératoire doit prendre en compte le risque de sténoses, à traiter rapidement pour éviter des complications urinaires. L'évaluation à long terme et le soutien psychologique sont essentiels pour une meilleure qualité de vie des patients.
1. Impact Psychologique de l Hypospadias
L'hypospadias a des conséquences psychologiques importantes, affectant la vie sociale et sexuelle des patients, particulièrement chez les adultes. Une étude comparant des hommes adultes ayant subi une chirurgie réparatrice d'hypospadias à un groupe témoin ayant subi une cure d'hernie inguinale révèle que l'adaptation psychosociale au quotidien n'est pas significativement différente. Cependant, une inhibition plus forte apparaît dans le domaine intime, impliquant la nudité. Une autre étude, menée sur des recrues italiennes, montre une difficulté accrue à établir des contacts avec le sexe opposé chez les hommes ayant un hypospadias, corrélée à une vision négative de leurs organes génitaux et à un nombre inférieur de premiers rapports sexuels complets. Intéressant, cette difficulté relationnelle était significativement plus importante chez les individus n'ayant jamais subi d'intervention chirurgicale, suggérant que l'hypospadias lui-même, et non seulement la chirurgie, peut perturber le développement psychosexuel. Un soutien psychologique est donc crucial pour les patients.
2. Suivis Postopératoires et Complications
Le suivi postopératoire est essentiel pour la surveillance et la gestion des complications potentielles. Les sténoses urétrales, moins fréquentes grâce à la réduction des anastomoses circulaires, peuvent être traitées par méatotomie pour les sténoses du méat, tandis que les sténoses proximales, plus graves, requièrent une résection-anastomose ou une plastie avec patch. Un dépistage rapide est crucial pour éviter des lésions du haut appareil urinaire causées par des vessies à haute pression. Le suivi inclut la vérification systématique des mictions postopératoires pour détecter toute difficulté ou poussée abdominale. Chez l'adulte, les complications sont plus fréquentes et difficiles à traiter. Une étude nord-américaine a montré que la plupart des patients avaient au moins deux complications après la réparation initiale, notamment des fistules, des chordées résiduelles ou cicatricielles, des diverticules, et des sténoses urétrales. La présence de poils au niveau du méat peut également causer des problèmes, traités efficacement par laser à faible intensité. La disparition de la réserve de peau préputiale et les érections postopératoires rendent la chirurgie plus complexe chez l'adulte.
