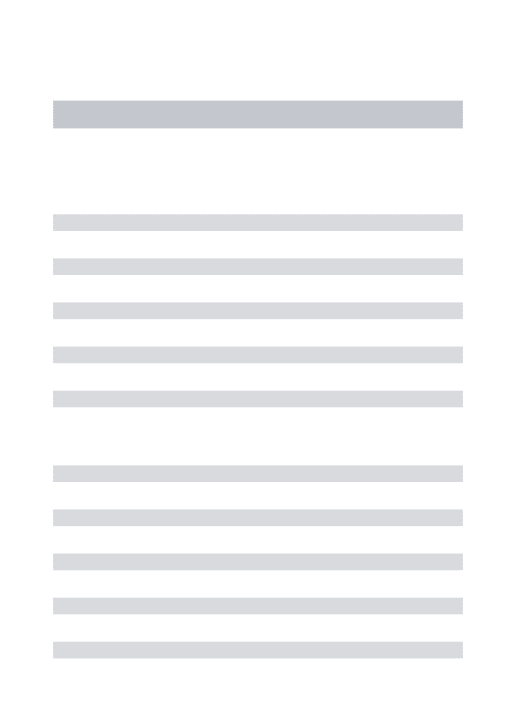
Bioévaluation des sédiments et barrages
Informations sur le document
| Auteur | Fanny Colas |
| school/university | Université de Lorraine |
| subject/major | Ecotoxicité, Biodiversité, Ecosystèmes |
| Type de document | Thèse |
| city where the document was published | Nancy |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 4.31 MB |
Résumé
I.Impacts des Barrages Fil de l Eau sur les Macroinvertébrés et la Contamination des Sédiments
Cette étude examine les effets des barrages fil de l'eau, particulièrement en France (plus de 60 000 barrages, dont 70% sans usage économique avéré), sur la qualité des écosystèmes aquatiques. L'accumulation de sédiments dans les retenues constitue un piège majeur pour les polluants, notamment les métaux lourds et les HAP, transformant ces sédiments en source de contamination. L'objectif principal est d'évaluer l'impact de cette contamination des sédiments sur les communautés de macroinvertébrés, en utilisant une approche basée sur les traits biologiques pour mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes. Deux barrages fil de l'eau dans les Alpes françaises ont été sélectionnés pour cette étude.
1. Contexte et Problématique de la Contamination des Sédiments
L'étude souligne l'importance des barrages fil de l'eau, particulièrement nombreux en France (plus de 60 000, dont 70% sans usage économique avéré), comme facteurs de perturbation des écosystèmes aquatiques. Le rapport de la Commission Mondiale des Barrages (2000) mentionne la construction de 45 000 grands barrages (>15 mètres) fragmentant plus de 60% des rivières mondiales et modifiant les flux sédimentaires. Vörösmarty (2003) estime que les réservoirs stockent 25 à 30% des flux totaux de sédiments vers les océans. En France, outre les 700 barrages supérieurs à 5 mètres, 60 000 seuils et petits barrages (<5 mètres) ont été répertoriés, dont seulement 30% auraient un usage économique avéré (Malavoi et al., 2011). L’accumulation de sédiments dans ces réservoirs, favorisée par la présence d'obstacles à l'écoulement, conduit à une forte rétention des sédiments et à une accumulation de polluants. Les sédiments, forts de leur capacité d'adsorption des métaux et des hydrocarbures (Cairns et al., 1984; Estebe et al., 1997), deviennent ainsi un réservoir et un vecteur de pollutions anthropogéniques, reflétant l'historique des pollutions des bassins versants. Malgré les efforts de régulation, l'héritage du passé persiste dans les sédiments, posant un risque écotoxique latent pour le biote des réservoirs et les écosystèmes en aval. Le colmatage modifie la structure du substrat et les habitats benthiques (Schälchli, 1992; Rehg et al., 2005), altérant les échanges à l'interface eau-sédiment (Turnpenny et Williams, 1980; Richards et Bacon, 1994; Larsen et al., 2011). La remise en suspension des sédiments fins a des effets négatifs sur le biote, notamment l'augmentation des taux de dérive et la réduction de la diversité des populations de macroinvertébrés (Rosenberg et Wiens, 1978; Nuttall et Bielby, 1973; Gray et Ward, 1982; Quinn et al., 1992; Shaw et Richardson, 2001; Bilotta et Brazier, 2008), ainsi qu'une augmentation de la mortalité des poissons (Newcomb et Flagg, 1983; Reynolds et al., 1988) et une réduction de leur croissance (Shaw et Richardson, 2001). La décomposition de sédiments riches en matière organique peut réduire les niveaux d'oxygène dissous, induisant des conditions d'anoxie délétères (Ryan, 1991).
2. Impacts sur les Communautés Benthiques et la Biodiversité
L'étude se concentre sur l'impact des barrages fil de l'eau et de la contamination des sédiments sur les communautés benthiques, en particulier les macroinvertébrés, éléments essentiels du recyclage des nutriments et des réseaux trophiques. Les macroinvertébrés benthiques sont traditionnellement utilisés pour l'évaluation de la qualité des cours d'eau (Rosenberg et Resh, 1993), reflétant l'intégrité écologique et l'impact des polluants (Cain et al., 1992; Gurrieri 1998). Cependant, peu d'études ont examiné l'impact des sédiments contaminés sur les communautés de macroinvertébrés dans les réservoirs fil de l'eau, alors que ces systèmes sont des sites privilégiés d'accumulation de sédiments et de contaminants (Beasley et Kneale 2003). Le manque de connaissances sur les communautés littorales de macroinvertébrés dans ces réservoirs et leur réponse aux niveaux de sédiments et de pollution justifie l'étude. La forte capacité d'adsorption des polluants par les sédiments (Cairns et al., 1984; Chapman, 1990; Estebe et al., 1997) fait de ces derniers une source potentielle de contamination à long terme, par libération de polluants dans la colonne d'eau suite à des variations de la chimie ambiante, de la resuspension des sédiments ou des changements climatiques (Lafont et al., 2007). La contamination historique représente ainsi une menace réelle pour l'intégrité écologique de nombreux écosystèmes aquatiques (Sheppard, 2005; Norris et al., 2007; Johnston et Roberts, 2009). L’étude vise à évaluer la composition fonctionnelle et structurelle des communautés de macroinvertébrés dans les barrages fil de l'eau, l'impact de l'accumulation de polluants sur ces communautés et les échelles et outils les plus efficaces pour le biomonitoring des sédiments contaminés dans de tels environnements.
II.Méthodologie de Biomonitoring et Analyse Spatiale
L'échantillonnage des macroinvertébrés a été réalisé en mai 2008 selon un protocole spécifique, divisant les zones d'accumulation de sédiments en trois parties : « tête », « milieu » et « barrage ». L'analyse spatiale a été menée à trois échelles : transversale (berges et chenal), transversale x longitudinale et par patch (habitats d’érosion, de sédimentation et de végétation). Des indices de diversité (Shannon, Simpson) et de diversité fonctionnelle (Rao) ont été calculés. L'analyse en composantes principales (ACP) a été utilisée pour identifier les différences entre les barrages.
1. Protocole d échantillonnage des Macroinvertébrés
L'échantillonnage des macroinvertébrés, réalisé en mai 2008, a suivi un protocole original pour distinguer les influences des conditions hydrauliques et hydromorphologiques. Les zones d'accumulation de sédiments associées aux barrages fil de l'eau ont été subdivisées en trois zones : « queue » (conditions proches de celles d'une rivière), « milieu » (caractéristiques intermédiaires) et « barrage » (système lentique typique). Les communautés des berges et du chenal ont été échantillonnées séparément. Pour les berges, un filet Surber (maille de 500 μm, surface échantillonnée de 0,05 m²) a été utilisé. Dans le chenal, un dragage à partir d'un bateau a été effectué perpendiculairement à une transectedans chacune des trois zones. Pour chaque transecte, les côtés gauche, central et droit du chenal ont été échantillonnés. Les échantillons ont été conservés dans du formol à 4% sur le terrain, puis transférés au laboratoire pour tamisage, triage et identification au niveau du genre (Tachet et al., 2000), sauf pour les Diptères (famille et tribu), les Oligochètes et les Nématodes (taxons supérieurs). Les individus de chaque taxon ont ensuite été comptés. Pour discriminer les assemblages d'espèces strictement liés aux systèmes de barrages fil de l'eau et évaluer la contribution des stations en amont, les communautés de macroinvertébrés des stations amont ont été échantillonnées selon un protocole normalisé (Multi-Habitat Sampling, norme XP T 90-333, AFNOR 2009) conçu pour répondre aux exigences de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE).
2. Analyse Spatiale et Indicateurs Utilisés
L'analyse des données a été menée à trois échelles spatiales : a) transversale (échantillons regroupés selon leur origine berge ou chenal) ; b) transversale x longitudinale (échantillons regroupés selon les deux facteurs combinés, par exemple berges x queue) ; c) échelle des patches (échantillons regroupés selon le type d'habitat : érosion, sédimentation ou végétation). Pour chaque échelle, trois types d'indicateurs ont été utilisés : indices de structure, assemblages taxonomiques et structure des traits bioécologiques. Ont été calculés : la richesse, l'abondance, la proportion des principaux groupes (EPT, Diptères, Mollusques et Crustacés), les indices de diversité de Shannon et Weaver, l'indice d'équitabilité de Simpson et l'indice de diversité fonctionnelle de Rao (Lavorel et al., 2008 ; de Bello et al., 2009). La diversité fonctionnelle représente les différences globales entre les espèces d'une communauté en fonction de leurs traits. Cet indice a été appliqué à la distribution de catégories au sein de 22 traits décrivant les traits biologiques et écologiques des macroinvertébrés (Usseglio-Polatera et al., 2000). À l'échelle transversale, une analyse en composantes principales (ACP) a été utilisée pour étudier les différences entre les barrages fil de l'eau. L'analyse à l'échelle des patches n'a pas permis de discriminer les effets de la contamination, probablement en raison de la variabilité et de la complexité des communautés de patches, réduisant la sensibilité de la détection des impacts (Donohue et al., 2009).
III.Réponses Structurelles et Fonctionnelles des Communautés de Macroinvertébrés
Les résultats montrent que les communautés de macroinvertébrés des berges sont plus sensibles à la contamination des sédiments que celles du chenal. L'hétérogénéité des habitats limite la détection des impacts à l'échelle des patches. L'étude identifie des espèces indicatrices de la contamination, dont l'abondance diminue significativement avec l'augmentation des polluants. L'analyse des traits biologiques révèle des changements dans les profils fonctionnels des communautés en réponse à la contamination. Les espèces présentes dans les zones contaminées présentent des adaptations à des conditions environnementales difficiles, notamment une plus grande tolérance à la pollution.
1. Réponses des Communautés de Macroinvertébrés aux Différentes Échelles Spatiales
L'étude a révélé des réponses contrastées des communautés de macroinvertébrés à la contamination des sédiments selon l'échelle spatiale considérée. À l'échelle transversale (berges vs. chenal), les communautés associées aux berges se sont avérées plus sensibles à la contamination que celles du chenal. Cette différence est attribuée à une plus grande hétérogénéité des habitats et une plus grande disponibilité de niches sur les berges, ce qui atténue l'impact de la contamination sur la structure de la communauté dans le chenal (Heino, 2000; Harrison et Hildrew, 2001). À l'échelle transversale x longitudinale (combinaison des facteurs berge/chenal et zones tête/milieu/barrage), l'analyse a permis de suivre le gradient de contamination et d'identifier des assemblages spécifiques. A l'échelle des patches (érosion, sédimentation, végétation), l'analyse n'a pas permis de discriminer efficacement les effets de la contamination en raison de l'extrême variabilité et de la complexité des communautés à cette échelle, diminuant la sensibilité de détection de l'impact (Donohue et al., 2009). L’hétérogénéité des habitats littoraux offre de nombreuses niches, permettant le développement de communautés diversifiées et donc des réponses variables à la contamination. La localisation des berges à l'interface terre-eau souligne leur rôle clé dans les processus écosystémiques, confirmant l'importance de la compréhension de la structure et du fonctionnement de l'environnement littoral (Naiman et Décamps, 1997; Rowan et al., 2006; Elosegi et al., 2010; Free et al., 2009).
2. Analyse des Traits Biologiques et Écologiques Biotraits
L'étude a mis en évidence l'intérêt d'une approche basée sur les traits biologiques et écologiques (biotraits) pour une meilleure compréhension des réponses des communautés de macroinvertébrés à la contamination des sédiments. Contrairement à l'analyse de la structure taxonomique seule, les profils de diversité fonctionnelle permettent de discriminer les effets de la contamination des sédiments sur les assemblages des berges et du chenal. L'analyse des biotraits a révélé des différences significatives entre les réservoirs de référence et les réservoirs contaminés. Dans les réservoirs contaminés, on observe un changement de caractéristiques fonctionnelles, les communautés étant typiques d'habitats lentiques et eutrophes. Des traits associés à des systèmes fréquemment perturbés (multivoltinisme, polysaprobie, métapotamon) ont été observés dans les réservoirs contaminés, tandis que les traits caractéristiques d'environnements plus stables (semi-voltinisme, œufs isolés, dispersion active) étaient plus fréquents dans les réservoirs de référence. L'étude a identifié des traits liés à l'impact écotoxique de la contamination des sédiments, tels que la saprobie, le niveau trophique, la locomotion et la taille corporelle (Archaimbault et al., 2010). La taille corporelle, et son rapport surface/volume, joue un rôle déterminant dans la bioconcentration des polluants (Dolédec et Statzner 2008; Preuss et al. 2008; Ippolito et al. 2012). La sélection de plus grandes espèces dans les réservoirs contaminés pourrait s'expliquer par un plus faible taux d'absorption des toxiques chez ces espèces.
3. Espèces Indicatrices et Adaptation aux Perturbations
L'identification d'espèces indicatrices est un outil pertinent pour évaluer l'état des communautés et l'impact de la contamination des sédiments. L'étude a identifié 19 taxons indicateurs pour le chenal des réservoirs fil de l'eau, soulignant la spécificité et la diversité de ces assemblages. Parmi ces taxons, certains sont généralistes (Oligochaeta, Chironomus, Tanypodinae), tandis que d'autres sont plus spécialisés et sensibles aux perturbations (Ephemerella, Ecdyonurus, Allogamus, Leuctra) (McGeoh et Chown 1998). L'abondance de trois taxons spécifiques a révélé l'impact de la contamination métallique des sédiments. Alors que la structure faunistique ne permet pas toujours de discriminer l'effet de la contamination, les profils de diversité fonctionnelle basés sur les biotraits permettent de mettre en évidence l'impact de la contamination sur les assemblages des berges et du chenal. Les changements de profils de biotraits dans les réservoirs contaminés peuvent indiquer une accumulation accrue de sédiments fins, une résilience diminuée, une baisse de la production primaire et une augmentation de la présence de parasites (nématodes). La diminution de la diversité fonctionnelle et l'augmentation de la redondance fonctionnelle peuvent entraîner une diminution de la complémentarité entre espèces et de l'efficacité des processus écosystémiques, comme la décomposition des feuilles.
IV.Impacts sur le Fonctionnement de l Écosystème et les Flux Benthiques
La contamination des sédiments affecte la décomposition des feuilles, un processus essentiel au fonctionnement de l'écosystème. Les communautés microbiennes (bactéries et champignons) sont également impactées. Des analyses plus fines montrent une diminution de la diversité fonctionnelle dans les sédiments contaminés, ce qui peut entrainer une altération des processus écosystémiques. L'étude met en évidence la nécessité de considérer conjointement les impacts physiques (présence du barrage) et chimiques (contamination) pour une meilleure évaluation des risques écologiques et la planification de mesures de restauration.
1. Impacts de la Contamination des Sédiments sur le Fonctionnement de l Écosystème
La contamination des sédiments affecte profondément le fonctionnement des écosystèmes aquatiques, notamment en altérant les flux biogéochimiques et les processus écologiques. L'accumulation de sédiments dans les réservoirs fil de l'eau agit comme un piège efficace pour le phosphore et, dans une moindre mesure, pour l'azote (Garnier et al., 1999; Lebo, 1991; Wang et Li, 2010), perturbant les cycles biogéochimiques naturels et modifiant la quantité de nutriments transportés par la rivière. Cela peut aussi modifier la forme chimique des nutriments ou induire un décalage temporel dans leur libération (Baldwin et al., 2010), en fonction des caractéristiques géochimiques et physicochimiques des sédiments. Le fonctionnement biogéochimique des sédiments est peu étudié dans les petits réservoirs fil de l'eau, pourtant très répandus. Ces systèmes posent un défi majeur pour la compréhension des effets des barrages sur l'intégrité des écosystèmes en aval. Les sédiments accumulés ont une forte capacité d'adsorption des polluants (Cairns et al., 1984; Chapman, 1990; Estebe et al., 1997), et il existe peu de données sur les effets de la contamination des sédiments sur les flux benthiques mesurés in situ. Les polluants stockés dans les sédiments peuvent altérer les compartiments biologiques associés au fonctionnement biogéochimique, modifiant ainsi la forme et la quantité de nutriments mobilisés vers l'eau sus-jacente. Les communautés microbiennes jouent un rôle crucial dans le cycle des nutriments et le transfert d'une partie de la production primaire vers les niveaux trophiques supérieurs (Azam et al., 1983; Sherr et Sherr, 1987). Leurs transformations des nutriments dissous et particulaires influencent les assemblages de macroinvertébrés, également essentiels dans le cycle des nutriments et la production primaire. Le mélange de particules (bioturbation) et le transfert de solutés (bio-irrigation) stimulent la minéralisation (Mermillod-Blondin et al., 2004), augmentant le renouvellement des nutriments disponibles pour la production primaire (Blackburn, 1988; Braeckman et al., 2010). Des changements dans les communautés microbiennes et de macroinvertébrés induits par la contamination des sédiments peuvent donc affecter les processus de minéralisation benthique et la qualité de l'eau dans les réservoirs et en aval.
2. Décomposition des Litières et Indicateurs Fonctionnels
La décomposition des litières est un indicateur communément utilisé pour évaluer les impacts des polluants sur le fonctionnement des écosystèmes. Ce processus met en évidence les changements fonctionnels dans la composition et l'activité des communautés bactériennes, fongiques et d'invertébrés (Gessner et Chauvet, 2002; Woodward et al., 2012). Il a été largement rapporté que la décomposition des litières est réduite dans les eaux contaminées par les métaux (Burton et al., 1985; Maltby et Booth, 1991; Carlisle et Clements, 2005). Les approches basées sur les biotraits peuvent améliorer le diagnostic des impacts anthropiques en permettant une meilleure compréhension mécanistique des relations de cause à effet entre les facteurs de stress et les altérations biologiques (Dolédec et Statzner, 2008; Verberk et al., 2008; Archaimbault et al., 2010; Culp et al., 2010), et en permettant de résoudre partiellement les effets de plusieurs facteurs de stress (Statzner et Bêche, 2010; Schäfer et al., 2011). L'étude conjointe des processus fonctionnels et des changements de biotraits dans les communautés benthiques permettrait d'identifier les meilleurs traits de réponse et d'effet à inclure dans les procédures d'évaluation des risques écologiques et écotoxicologiques pour les sédiments contaminés des rivières. L’étude de la décomposition des litières illustre l’importance des communautés microbiennes et des invertébrés déchiqueteurs dans le fonctionnement des écosystèmes aquatiques (Hieber et Gessner, 2002; Arsuffi et Suberkropp, 1989; Bärlocher et Kendrick, 1975; Mancinelli et al., 2002; Costantini et Rossi, 2010). L'activité combinée de ces deux compartiments est essentielle pour le bon fonctionnement de l'écosystème et devrait être considérée conjointement dans les méthodologies de diagnostic environnemental.
