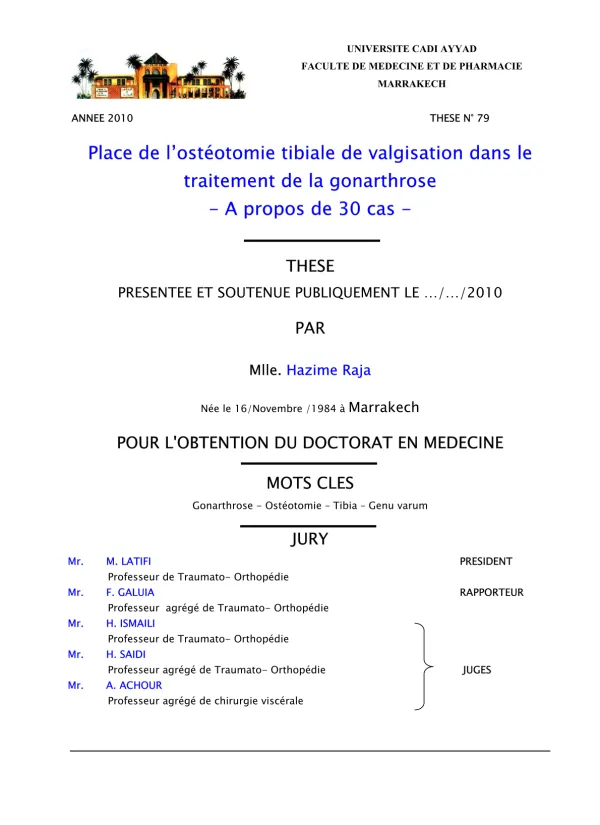
Place de l'Ostéotomie Tibiale de Valgisation dans le Traitement de la Gonarthrose
Informations sur le document
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 2.25 MB |
- Gonarthrose
- Ostéotomie
- Médecine
Résumé
I.Ostéotomie Tibiale de Valgisation OTV pour le Traitement de la Gonarthrose
Cette étude, menée à l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech entre 2000 et 2006, porte sur 30 cas de gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu varum traités par ostéotomie tibiale de valgisation (OTV). L’âge moyen des patients était de 52 ans (73% d'hommes). Dans 90% des cas, l’arthrose était liée à un genu varum primitif, et dans 10% à un genu varum secondaire. Les résultats, évalués selon le score GUEPAR, montrent une nette amélioration de la douleur et une stabilisation du processus arthrosique dans la majorité des cas. L’OTV apparaît comme une intervention efficace pour soulager la douleur et retarder l’évolution de la gonarthrose chez des patients présentant une arthrose fémoro-tibiale interne de stade peu avancé (principalement stades I et II d'Ahlback), confirmant son rôle dans l'arsenal thérapeutique des affections du genou.
1. Présentation de l étude et méthodologie
L'étude, réalisée au service de traumatologie orthopédique de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech entre 2000 et 2006, a porté sur 30 patients atteints de gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu varum. L'âge moyen des patients était de 52 ans, avec une prédominance masculine (73%). La majorité des cas (90%, soit 27 patients) présentaient un genu varum primitif, tandis que les 10% restants (3 patients) souffraient d'un genu varum secondaire. Cliniquement, 90% des patients se plaignaient de douleurs mécaniques, et 10% de douleurs mixtes. La plupart des cas d'arthrose fémoro-tibiale (90%) correspondaient aux stades I et II de la classification d'Ahlback. La déviation angulaire moyenne était de 9,7°, variant entre 2° et 22°. Trois techniques d'ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) ont été utilisées : curviplane (50%), soustraction externe (33%), et addition interne (17%). L’étude a évalué l’efficacité de l’OTV dans le traitement de cette pathologie spécifique, en se basant sur des critères cliniques et le score GUEPAR pour l'évaluation de la douleur.
2. Anatomie du genou et biomécanique
Le document détaille l'anatomie du plateau tibial, décrivant ses surfaces articulaires (cavités glénoïdes interne et externe), l'espace intercondylaire, et l'articulation avec les condyles fémoraux. La fonction des ménisques dans l'adaptation des surfaces articulaires est mentionnée. L'anatomie de la rotule et son articulation avec le fémur sont également abordées, soulignant l'importance de la jonction condylo-trochléenne et son implication dans les prothèses fémoro-patellaires. La description des moyens d'union, incluant la capsule articulaire, les ligaments, et les muscles, met en lumière les aspects biomécaniques du genou. L'analyse des forces agissant sur le genou, notamment les forces varisantes et valgisantes, explique l'importance de l'équilibre mécanique et l'impact d'un déséquilibre sur le développement de la gonarthrose. L'étude des contraintes sur les compartiments fémoro-tibiaux interne et externe est essentielle à la compréhension de l'intérêt de l'OTV.
3. L Ostéotomie Tibiale de Valgisation Principe et Technique
L’OTV est présentée comme une intervention conservatrice de référence pour le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu varum. Son but est de corriger le varus, redistribuant les charges sur le compartiment externe du genou pour soulager le compartiment interne arthrosique. Le principe biomécanique repose sur l’hypercorrection en valgus, dont l’amplitude (entre 3° et 6° pour la majorité des auteurs, contre 8 à 10° pour d'autres) est un point de débat. Le document explore différentes techniques chirurgicales : l’ostéotomie curviplane, l’ostéotomie de soustraction externe (utilisant des agrafes de Blount ou des plaques vissées en T), et l’ostéotomie d’addition interne (avec ou sans greffon). Le niveau d’ostéotomie, généralement métaphysaire supra-tubérositaire pour une meilleure consolidation osseuse, est discuté. Les avantages de l'OTV, notamment un effet antalgique rapide, sont contrebalancés par le risque de dégradation à long terme et d'autres complications (thrombophlébite, syndrome des loges, hypo ou hypercorrection).
4. Résultats Indications et Contre indications de l OTV
L'étude rapporte de bons et très bons résultats (81,5%) selon les critères GUEPAR à un recul moyen de 3 ans et 6 mois post-opératoire, avec une amélioration significative de la douleur. Cependant, la littérature mentionne une dégradation quasi constante des résultats à long terme. L'OTV est indiquée pour les gonarthroses unicompartimentales de stade peu avancé (principalement stades I et II d’Ahlback) sur genu varum, mais des auteurs considèrent une déformation en varus inférieure à 10° ou 15° comme plus favorable. Descamps contre-indique l’ostéotomie pour les déformations supérieures à 20°. La présence d'un syndrome fémoro-patellaire avancé ou d'une laxité ligamentaire préopératoire significative est considérée comme un facteur défavorable. L'âge n'est pas un critère absolu d'exclusion, l'espérance de vie du patient étant un facteur plus pertinent. Les prothèses totales du genou, bien que présentant une bonne survie à long terme, ne sont pas toujours préférables à l'OTV chez les patients jeunes et actifs en raison de leurs performances réduites à l'effort.
II.Principes et Objectifs de l OTV
L’ostéotomie tibiale de valgisation vise à corriger l’axe mécanique du membre inférieur, redistribuant les charges sur les compartiments fémoro-tibiaux interne et externe. Ceci permet de soulager les douleurs (gonalgies) et de stabiliser le processus arthritique. L’intervention, extra-articulaire, se base sur des concepts biomécaniques et implique une correction en valgus, généralement entre 3° et 6°, pour éviter une dégradation du compartiment externe. La correction de la déformation au niveau du tibia est privilégiée. Plusieurs techniques chirurgicales existent (curviplane, soustraction externe, addition interne), chacune ayant ses avantages et inconvénients.
1. Correction de l axe mécanique du membre inférieur
L'ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une procédure chirurgicale reposant sur des principes biomécaniques. Son objectif principal est de corriger l'axe mécanique du membre inférieur, plus précisément au niveau du tibia, dans les cas de genu varum. Cette correction vise à redistribuer les contraintes mécaniques sur l'articulation du genou, en particulier sur les compartiments fémoro-tibiaux interne et externe. En corrigeant l'alignement défectueux, l'OTV ambitionne de soulager la pression excessive sur le compartiment interne du genou, souvent la source de douleurs et de lésions cartilagineuses dans la gonarthrose. L'objectif est donc de réduire la charge supportée par la zone pathologique, diminuant ainsi l'usure du cartilage et la progression de l'arthrose. Cette redistribution des charges se traduit par une amélioration des symptômes douloureux (gonalgies) et une stabilisation de la progression de la maladie arthrosique.
2. Décharge du compartiment fémoro tibial interne
Un des objectifs majeurs de l'OTV est de décharger le compartiment fémoro-tibial interne, fréquemment la zone la plus touchée dans la gonarthrose associée au genu varum. Le genu varum, caractérisé par une déviation en varus des membres inférieurs, concentre les forces de compression sur ce compartiment interne, accélérant l'usure du cartilage. L'OTV corrige cette déviation en créant un valgus, modifiant ainsi la répartition des charges. L'objectif est de transférer une partie de la charge du compartiment interne, surchargé et arthrosique, vers le compartiment externe, moins affecté par l'arthrose. Ce transfert de charge est crucial pour soulager la douleur, réduire l'inflammation et ralentir la progression de la destruction cartilagineuse au niveau du compartiment interne. Le succès de l'OTV repose sur l'efficacité de cette redistribution des forces et sa capacité à préserver le compartiment externe à long terme.
3. Stabilisation du processus arthrosique et prévention de la progression
Au-delà du soulagement de la douleur, l'OTV vise à stabiliser la progression de la gonarthrose. En redistribuant les charges, l'intervention cherche à freiner le processus de dégradation cartilagineuse. La stabilisation du processus arthrosique est un objectif à long terme de l'OTV. Il est attendu que l'intervention n'entraîne pas de dégradation du compartiment fémoro-tibial externe, tout en améliorant ou au moins stabilisant l'arthrose interne. En limitant l'usure du cartilage, l'OTV espère retarder ou même éviter la nécessité d'une intervention plus invasive comme l'arthroplastie totale du genou à un stade ultérieur. L'efficacité de l'OTV à long terme dépend de la précision de la correction chirurgicale, de la qualité de la consolidation osseuse et de la réponse individuelle du patient à l’intervention.
4. Amplitude de la correction et techniques chirurgicales
L'amplitude de la correction en valgus est un aspect crucial de l'OTV, et la littérature médicale ne présente pas de consensus à ce sujet. Certaines approches privilégient une hypercorrection importante (jusqu’à 8-10°), tandis que d'autres recommandent une correction plus modérée (3-6°). Le choix de l'amplitude de la correction dépend de plusieurs facteurs, y compris le degré de varus initial, l'âge et l'activité du patient, et l'état de l'articulation fémoro-patellaire. Le document mentionne plusieurs techniques chirurgicales pour réaliser l’OTV, chacune ayant ses propres avantages et inconvénients, et influant sur le niveau de correction possible et la rééducation postopératoire : l'ostéotomie curviplane, l’ostéotomie de soustraction externe et l'ostéotomie d'addition interne. La maîtrise technique du chirurgien est un facteur déterminant dans le succès de l'intervention.
III.Techniques Chirurgicales et Résultats
Trois techniques d’OTV ont été utilisées dans l’étude : curviplane (15 cas), soustraction externe (10 cas), et addition interne (5 cas). Le choix de la technique dépend des caractéristiques spécifiques de chaque patient et de la préférence du chirurgien. Les moyens d’ostéosynthèse varient (agrafes de Blount, plaques vissées en T). La rééducation postopératoire commence rapidement, l’appui total étant autorisé après un délai variable selon la technique et la fixation utilisée. A 3 ans et 6 mois de suivi, 81,5% des patients présentaient des résultats bons ou très bons selon l'échelle GUEPAR.
1. Techniques chirurgicales utilisées
L'étude a comparé trois techniques d'ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) : l'ostéotomie curviplane (utilisée chez 15 patients, soit 50 %), l'ostéotomie de soustraction externe (10 patients, 33 %), et l'ostéotomie d'addition interne (5 patients, 17 %). Pour l'ostéotomie de soustraction externe, les moyens d'ostéosynthèse étaient des agrafes de Blount dans 7 cas et des plaques vissées en T dans 3 cas. L'ostéotomie d'addition interne a utilisé une cale en ciment dans 4 cas et un greffon iliaque dans 1 cas. L'abord chirurgical variait également : voie antérieure (50 %), antéro-externe (33 %), et interne (17 %). Le choix de la technique et de l'ostéosynthèse dépendait probablement des caractéristiques spécifiques de chaque cas et de la préférence du chirurgien. L'absence de consensus sur la technique optimale dans la littérature est soulignée, chaque approche ayant ses propres avantages et inconvénients.
2. Résultats postopératoires et suivi
Le suivi des patients a permis d'évaluer l'efficacité des différentes techniques d'OTV. Sur 18 patients revus en consultation après un recul moyen de 3 ans et 6 mois, une nette amélioration du syndrome douloureux a été observée. Les scores GUEPAR (grades D0 et D1) sont passés de 30 % en préopératoire à 83 % en postopératoire, indiquant une réduction significative de la douleur. Concernant la marche, les perturbations ont diminué de 60 % en préopératoire à 33 % en postopératoire, témoignant d'une amélioration fonctionnelle. Dans l'ensemble, les résultats évalués selon les critères GUEPAR étaient bons ou très bons dans 81,5 % des cas et moyens ou mauvais dans 18,5 % des cas. Ces résultats semblent positifs, mais il est important de noter que la littérature mentionne une dégradation progressive des résultats à plus long terme (70 % à 6 ans, 45 % à 13 ans selon Goutallier).
3. Analyse des résultats et considérations
L’étude met en avant l’efficacité globale de l’OTV dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu varum, avec un taux élevé de bons résultats à moyen terme. Cependant, il est important de prendre en compte les limites de l’étude, notamment la taille relativement modeste de l’échantillon et le recul limité du suivi. La diversité des techniques chirurgicales utilisées rend difficile une comparaison précise de leur efficacité respective. L’étude confirme le besoin d’une évaluation minutieuse préopératoire, incluant l’analyse du degré de varus, l’état de l’articulation fémoro-patellaire, et la stabilité ligamentaire, afin d’optimiser les chances de succès de l’OTV. Malgré des résultats positifs à moyen terme, la perspective d’une dégradation progressive des résultats à long terme souligne l'importance d'une sélection rigoureuse des patients candidats à cette intervention conservatrice.
IV.Indications et Contre indications de l OTV
L’OTV est indiquée pour les gonarthroses unicompartimentales de stade peu avancé (principalement stades I et II d’Ahlback) sur genu varum primitif ou secondaire. La présence d’un syndrome fémoro-patellaire avancé ou d’une laxité ligamentaire significative peut constituer une contre-indication ou nécessiter une approche chirurgicale différente. L'âge n'est pas un facteur excluant l'OTV en soi, l'espérance de vie du patient étant plus déterminante. Les résultats à long terme de l’OTV peuvent se dégrader, soulignant l’importance d’une sélection rigoureuse des candidats à l’intervention.
1. Critères d inclusion et stades d arthrose
L'ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est principalement indiquée dans les cas de gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu varum, soit une arthrose localisée au compartiment médial du genou associée à une déformation en varus. L'étude a ciblé des patients dont l'arthrose était classée aux stades I et II d'Ahlback, représentant 90 % des cas, conformément à la littérature (86 % chez Rinonapoli, 90,5 % chez Aydogdu). Ce ciblage vers les stades précoces de l'arthrose est justifié par le fait que des lésions cartilagineuses moins importantes au départ offrent de meilleurs résultats postopératoires. La majorité des patients (90 %) présentaient un genu varum primitif, tandis que 10 % seulement avaient un genu varum secondaire. L'étude a exclu les cas d'origine inflammatoire ou métabolique, en raison de l'atteinte souvent tricompartimentale dans ces situations, pour lesquelles l'OTV est moins adaptée. La présence d'un syndrome fémoro-patellaire (F-P) avancé, signe d'une arthrose plus sévère, a également été considérée comme un facteur d'exclusion dans cette série, mis à part 2 patients (7%).
2. Rôle de la stabilité articulaire et de l âge
Bien que la laxité ligamentaire ne soit pas une contre-indication absolue à l'OTV, plusieurs auteurs (Insall et Joseph, Hutchison, Descamps, Segal, Darrell) recommandent une stabilité articulaire préopératoire optimale. Une laxité ligamentaire rend la planification opératoire plus complexe et est corrélée à de moins bons résultats. En préopératoire de l'étude, un seul cas de laxité ligamentaire antérieure a été traité par ligamentoplastie simultanément à l'OTV. Concernant l'âge, il n'existe pas de limite absolue au-delà de laquelle l'OTV serait vouée à l'échec. Langlais a montré que le risque d'échec était similaire après 60 ans et même après 70 ans, à un stade d'arthrose comparable. Lerat met l'accent sur l'espérance de vie du patient : pour les individus ayant une espérance de vie supérieure à 20 ans, l'OTV est souvent préférée aux prothèses totales de genou en raison de la longévité limitée de ces dernières, surtout du fait de l'usure du polyéthylène.
3. Degré de déformation en varus et autres facteurs
Le degré de déformation en varus est un élément important à considérer. Certains auteurs (Aglietti et Rinonapoli, Insall, Kettelkamp) recommandent d'opérer les déformations en varus ne dépassant pas 10°, tandis que Darrell s'est limité à un genu varum inférieur à 15°. À l'inverse, Descamps contre-indique l'ostéotomie pour des déformations supérieures à 20°. Cependant, Maquet, Hernigou, et Dubrana ont rapporté d'excellents résultats même avec des déformations supérieures à 15°. L’étude marocaine a inclus des patients avec une déviation angulaire moyenne de 9,7°, allant de 2° à 22°. En somme, la décision chirurgicale ne repose pas uniquement sur le degré de varus mais tient compte d’autres critères, notamment l'âge, l'état général du patient, la présence d'une atteinte fémoro-patellaire, et la stabilité ligamentaire. Une évaluation globale du patient est donc nécessaire pour déterminer l’adéquation de l’OTV.
V.Informations Importantes sur l Étude
L’étude a été menée à l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech au Maroc entre 2000 et 2006. Elle comprend 30 patients, dont 73% étaient des hommes, avec un âge moyen de 52 ans. Les patients souffraient principalement de douleurs mécaniques (90% des cas). La déviation angulaire moyenne était de 9,7°.
1. Contexte de l étude et données démographiques
Cette étude rétrospective a été menée au service de traumatologie orthopédique de l'hôpital militaire Avicenne de Marrakech, au Maroc, entre 2000 et 2006. Elle a inclus 30 patients atteints de gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu varum. L'âge moyen des patients était de 52 ans, avec une nette prédominance masculine (73 %). La majorité des cas (90 %) étaient liés à un genu varum primitif, les 10 % restants correspondant à un genu varum secondaire. Cliniquement, la majorité des patients (90 %) souffraient de douleurs de type mécanique, tandis que les 10 % restants décrivaient des douleurs mixtes. La plupart des patients présentaient une arthrose aux stades I et II de la classification d'Ahlback (90 %), conformément aux données de la littérature. La déviation angulaire moyenne du genu varum était de 9,7°, avec des valeurs extrêmes allant de 2° à 22°.
2. Méthodologie et résultats de l étude
L'étude a utilisé trois techniques d'ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) : curviplane (15 patients), soustraction externe (10 patients), et addition interne (5 patients). Dans la technique de soustraction externe, 7 patients ont eu des agrafes de Blount et 3 des plaques vissées en T. Pour l'addition interne, 4 patients ont eu une cale en ciment et 1 un greffon iliaque. L'évaluation des résultats a été effectuée à l'aide du score GUEPAR. Le suivi, avec un recul moyen de 3 ans et 6 mois, a montré une nette amélioration du syndrome douloureux chez les 18 patients revus. Le pourcentage de patients classés D0 et D1 sur l’échelle GUEPAR est passé de 30 % en préopératoire à 83 % en postopératoire. Globalement, 81,5 % des patients présentaient des résultats bons ou très bons, tandis que 18,5 % avaient des résultats moyens ou mauvais.
