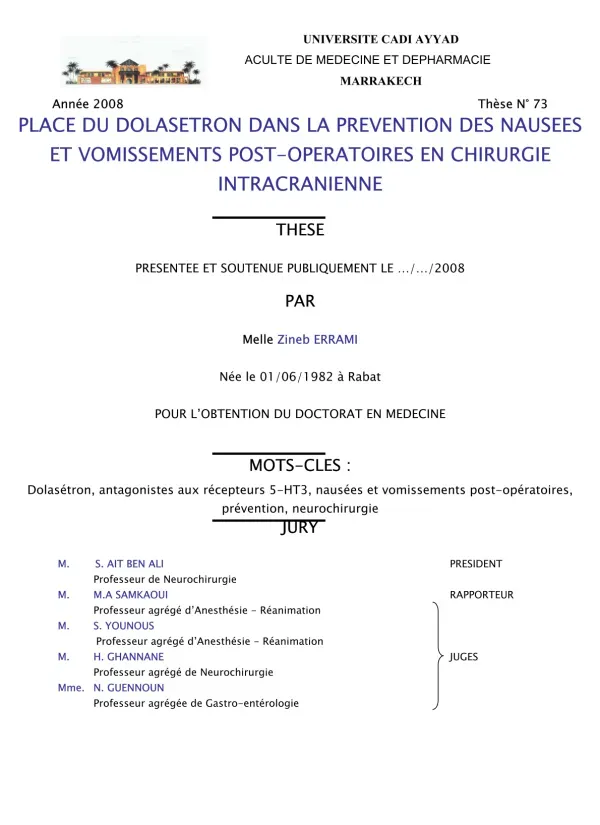
Prévention des nausées et vomissements post-opératoires en chirurgie intracrânienne
Informations sur le document
| Auteur | Melle Zineb Errami |
| École | Non spécifié |
| Spécialité | Médecine |
| Lieu | Rabat |
| Type de document | Thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 0.98 MB |
- Dolasétron
- nausées et vomissements
- neurochirurgie
Résumé
I.Nausées et vomissements postopératoires NVPO en neurochirurgie
Cette étude prospective, randomisée et en double aveugle, menée au CHU Mohammed VI de Marrakech entre janvier 2006 et février 2007, a évalué l'efficacité du dolasetron dans la prévention des nausées et vomissements postopératoires (NVPO) chez 80 patients (15-70 ans) subissant une crâniotomie pour tumeurs intracrâniennes ou lésions vasculaires. L'étude a comparé l'administration de 20 mg de dolasetron (groupe D) à un placebo (groupe P) 30 minutes avant la fermeture cutanée. La neurochirurgie, étant une spécialité à haut risque de NVPO, justifie l'intérêt porté à cette recherche sur les antagonistes des récepteurs 5-HT3, comme le dolasetron et l'ondansétron, pour réduire l'incidence de ces effets indésirables.
1. Contexte et objectifs de l étude
L'étude, réalisée au CHU Mohammed VI de Marrakech entre janvier 2006 et février 2007, est une étude prospective, randomisée et en double aveugle portant sur les nausées et vomissements postopératoires (NVPO) en neurochirurgie. Elle vise à évaluer l'efficacité du dolasetron dans la prévention de ces NVPO chez des patients adultes subissant une craniotomie pour des lésions intracrâniennes tumorales ou vasculaires. Le choix de la neurochirurgie se justifie par le risque élevé de NVPO associé à ce type d'intervention chirurgicale. 80 patients âgés de 15 à 70 ans ont été inclus dans l'étude, randomisés en deux groupes : un groupe recevant du dolasetron (20 mg) et un groupe contrôle recevant un placebo (solution saline à 0.9%). Trois patients n'ayant pas été extubés en fin d'intervention ont été exclus de l'analyse, appartenant tous au groupe dolasetron. L'anesthésie générale avec intubation orotrachéale en mode TIVA (Total IntraVeinous Anesthesia) a été utilisée pour tous les patients, avec un protocole standardisé d'induction et d'entretien de l'anesthésie. Un suivi rigoureux des paramètres vitaux a été mis en place pendant l'intervention chirurgicale. L’étude a permis de collecter des données démographiques sur les patients, ainsi que des informations sur les facteurs de risques de NVPO : antécédents de NVPO, chirurgie antérieure, mal des transports, anxiété, comorbidités (diabète, obésité), et habitudes toxiques. L'état neurologique préopératoire et le type de chirurgie pratiqué ont également été enregistrés.
2. Définition et physiopathologie des NVPO
Les NVPO sont définis comme l'ensemble des nausées et vomissements survenant dans les 24 heures suivant l'intervention chirurgicale. L'étude souligne l'importance d'analyser séparément les nausées et les vomissements, car leur survenue et leur intensité peuvent varier. Une incidence importante de NVPO est rapportée, affectant un patient sur trois et 35% des patients en chirurgie ambulatoire. La moitié des NVPO surviennent après la sixième heure du postopératoire, ce qui peut entraîner un retard de diagnostic et de traitement. La neurochirurgie est identifiée comme une chirurgie à haut risque de NVPO, probablement en raison de la proximité des centres nerveux régulant les vomissements et la zone opératoire. Le document mentionne les études qui confirment une incidence élevée de NVPO après craniotomie, supérieure à celle observée en chirurgie générale. Le processus de vomissement est décrit comme un réflexe de défense complexe, impliquant une interaction entre le système nerveux central et périphérique. Deux centres médullaires clés sont impliqués : le centre du vomissement et la zone gâchette chimioréceptrice (CTZ). La stimulation de ces centres, via des voies nerveuses (nerf vague) ou par l'exposition directe à des substances émétisantes (chimiothérapie), déclenche le vomissement. Différents récepteurs, notamment les récepteurs 5-HT3, dopaminergiques, cholinergiques et aux neurokinines, sont impliqués dans la régulation du vomissement. L'activation des récepteurs 5-HT3, présents à la fois en périphérie (tractus gastro-intestinal) et au niveau central (area postrema), joue un rôle central dans le processus émétique.
3. Facteurs de risque et scores de prédiction des NVPO
Les facteurs de risque des NVPO sont largement discutés, avec une reconnaissance qu'ils sont similaires pour les nausées et les vomissements. Cependant, des études comme celle de Stadler ont mis en lumière des différences subtiles entre les facteurs de risque des nausées isolées et des NVPO combinées. Des facteurs comme le sexe féminin, l'absence de tabagisme et l'anesthésie générale sont associés à la fois aux nausées et aux vomissements. En revanche, les antécédents de migraine et certains types de chirurgie (neurochirurgie, ophtalmologie, chirurgie viscérale et gynécologique) sont plus spécifiquement liés à la survenue de NVPO. L'utilisation de morphiniques en postopératoire augmente le risque, tandis que les antihistaminiques H1 pourraient avoir un effet protecteur. Les agents halogénés utilisés en anesthésie sont également considérés comme des facteurs de risque importants de vomissements précoces. Le document aborde la controverse concernant l'influence du type de chirurgie sur les NVPO, soulignant que bien qu'une association existe, la causalité n'est pas clairement établie. L'importance de facteurs liés au patient (sexe, antécédents, tabagisme), à l'anesthésie (type d'anesthésique, utilisation de morphiniques) et à la chirurgie (type d'intervention, durée) sont soulignés. La méthodologie de construction des scores de prédiction des NVPO, basée sur l'analyse de régression logistique, est expliquée. Différents scores, tels que ceux de Sinclair, Palazzo et Evans, Koivuranta et Apfel, sont présentés et comparés, avec des discussions sur leurs forces et faiblesses, en particulier sur leur pouvoir discriminant et leur capacité de calibration. Le document note les limites de certains scores, comme l'inadaptation du score d'Apfel à la population pédiatrique ou sa non-prise en compte de certains facteurs importants (type d'hypnotique, mobilisation postopératoire).
4. Traitement médicamenteux des NVPO et résultats de l étude
Le document explore les options pharmacologiques pour la prévention et le traitement des NVPO, notamment les antagonistes des récepteurs 5-HT3 comme l'ondansétron et le dolasetron. L'efficacité de ces agents est liée à leur action au niveau des récepteurs 5-HT3, à la fois périphériques et centraux. L'ondansétron est mentionné comme ayant une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour la prévention des NVPO, mais le document discute aussi d'autres antagonistes des récepteurs 5-HT3 et de leurs avantages et inconvénients. Le droperidol est une autre option pharmacologique, avec une efficacité comparable aux antagonistes 5-HT3 dans certaines études. Cependant, le droperidol présente des effets secondaires potentiels à considérer. La discussion porte sur les doses optimales, les modalités d'administration et les effets secondaires potentiels de ces différentes molécules. Les résultats de l'étude montrent une réduction significative de l'incidence des NVPO à l'extubation et dans la première heure postopératoire dans le groupe ayant reçu du dolasetron par rapport au groupe placebo. Cette différence n'a pas été observée à des intervalles plus longs (H2, H6, H12, H24). De plus, le recours à un traitement antiémétique de secours était significativement plus fréquent dans le groupe placebo (60%) que dans le groupe dolasetron (10.8%). Les effets secondaires liés au dolasetron sont peu importants dans cette étude. La discussion met en perspective les résultats avec d'autres études, soulignant la variabilité des résultats observés selon les études et les populations étudiées. Le choix du traitement antiémétique en neurochirurgie reste un sujet de discussion, vu l'absence de consensus.
II.Physiopathologie des NVPO
Les NVPO résultent d'une activation du centre du vomissement dans le tronc cérébral, influencée par divers facteurs, notamment la stimulation des récepteurs à la sérotonine (5-HT3) au niveau du tractus gastro-intestinal et de l'area postrema. Les antagonistes des récepteurs 5-HT3 agissent en bloquant ces récepteurs, réduisant ainsi les symptômes émétiques. Le rôle des autres récepteurs (dopamine, acétylcholine) est aussi important dans la physiopathologie des nausées et vomissements postopératoires.
1. Le vomissement un réflexe de défense
Le vomissement, ou émésis, est présenté comme un réflexe de défense, commun à l'homme et à l'animal. Il n'existe pas de consensus sur sa définition précise, mais Borison et ses collaborateurs l'ont défini comme l'expulsion forcée du contenu gastro-intestinal par la bouche. Une distinction est faite entre les vomissements et le retching (haut-le-cœur), un phénomène de contractions musculaires respiratoires qui peut accompagner, mais ne précède pas systématiquement les vomissements. Le mécanisme du vomissement implique une contraction unique de la partie moyenne de l'intestin, se propageant de façon rétrograde jusqu'à l'antre gastrique, entraînant l'expulsion violente du contenu gastrique. L'action principale provient de la musculature abdominale et du diaphragme, l'estomac jouant un rôle passif. Le relâchement des sphincters gastriques et la pression intrathoracique facilitent l'expulsion du contenu gastrique vers l'œsophage. La fermeture de la glotte et l'inhibition de la respiration préviennent l'inhalation du vomi.
2. Centres nerveux impliqués dans le vomissement
Au niveau du système nerveux central, le vomissement est coordonné par deux centres médullaires : le centre du vomissement et une zone gâchette chimioréceptrice (CTZ). Le centre du vomissement, situé dans la formation réticulaire latérale de la moelle allongée, est stimulé directement ou indirectement par la CTZ. La stimulation directe peut provenir du pharynx, du tractus gastro-intestinal, du médiastin, du cortex visuel et des régions impliquées dans la perception gustative. La distension des parois du tractus gastro-intestinal stimule le centre du vomissement via le nerf vague. La CTZ, située sur le plancher du quatrième ventricule, est accessible à certaines substances (chimiothérapie) qui peuvent induire des vomissements par un mécanisme indépendant des récepteurs, car la barrière hémato-encéphalique est moins imperméable à cet endroit.
3. Rôle des récepteurs dans le processus émétique
Plusieurs types de récepteurs sont impliqués dans le contrôle du vomissement. Au niveau de l'area postrema (incluant la CTZ), on retrouve des récepteurs à la dopamine, à la sérotonine, à l'acétylcholine et aux neurokinines. D'autres récepteurs, comme les récepteurs histaminiques et cholinergiques, sont présents au niveau des noyaux vestibulaires. L'étude se concentre sur le rôle des récepteurs sérotoninergiques, en particulier les récepteurs 5-HT3, qui jouent un rôle central dans les processus émétiques. Ces récepteurs sont localisés en périphérie (tractus gastro-intestinal) et au niveau central (area postrema, noyau solitaire, terminaisons du nerf vague). Cette distribution périphérique et centrale explique l'efficacité des antagonistes 5-HT3 (sétrons) dans le contrôle des vomissements. La libération de sérotonine suite à la stimulation physique ou à des médicaments cytotoxiques active ces récepteurs 5-HT3, ce qui explique l'efficacité des antagonistes 5-HT3, qui inhibent les vomissements incoercibles.
III.Facteurs de risque des NVPO
Plusieurs facteurs augmentent le risque de NVPO, incluant des antécédents de NVPO, le mal des transports, l'anxiété, des affections chroniques (diabète, obésité), des habitudes toxiques (tabac, alcool), le sexe féminin, le type de chirurgie (la neurochirurgie est particulièrement à risque), et le type d'anesthésie. Divers scores de prédiction, comme le score d'Apfel et celui de Koivuranta, intègrent ces facteurs pour estimer le risque individuel de nausées et vomissements postopératoires.
1. Facteurs de risque intrinsèques du patient
Le texte identifie plusieurs facteurs de risque liés au patient lui-même, indépendamment de l'intervention chirurgicale ou de l'anesthésie. Parmi ceux-ci, on retrouve les antécédents de nausées et vomissements postopératoires (NVPO), soulignant la prédisposition individuelle à ces complications. Le mal des transports est également cité comme un facteur de risque significatif, indiquant une sensibilité accrue du système vestibulaire. La présence d'anxiété préopératoire est mentionnée, suggérant un lien entre l'état psychologique et la survenue des NVPO. De plus, les affections chroniques telles que le diabète et l'obésité sont présentées comme des facteurs aggravants potentiels. Enfin, les habitudes toxiques, notamment la consommation d'alcool et de tabac, sont également mises en avant comme des facteurs contribuant à l'augmentation du risque de NVPO. L’âge et le sexe sont aussi des facteurs importants. Le texte mentionne que le risque est plus important chez les femmes et que chaque tranche de 10 ans supplémentaires diminue la probabilité de NVPO.
2. Facteurs de risque liés à l anesthésie
L'anesthésie joue un rôle important dans la survenue des NVPO. L'utilisation de morphiniques (opiacés) est clairement identifiée comme un facteur d'augmentation du risque. À l'inverse, l'utilisation d'antihistaminiques H1 pourrait avoir un effet bénéfique, suggérant une approche préventive possible. Les agents halogénés, utilisés dans certains types d'anesthésie, sont présentés comme des agents potentiellement émétisants, sans qu'un agent spécifique soit privilégié. Ils sont considérés comme un facteur de risque principal pour les vomissements postopératoires précoces et doivent être évités chez les patients à risque. La durée de l'anesthésie est aussi un facteur de risque, chaque tranche de 30 minutes supplémentaires augmentant le risque. Le type d'anesthésie en elle-même est aussi déterminant, l'anesthésie générale augmentant considérablement le risque par rapport à une anesthésie locorégionale (selon le score de Sinclair).
3. Facteurs de risque liés à la chirurgie et scores de prédiction
L'influence du type de chirurgie sur le risque de NVPO est un point controversé, bien qu'une association claire soit souvent observée. Certaines chirurgies, comme la chirurgie gynécologique et la neurochirurgie, sont identifiées comme présentant un risque plus élevé de NVPO. Cette augmentation de risque pourrait être liée à plusieurs facteurs, notamment les manipulations viscérales, les tractions et les étirements des tissus, stimulant ainsi des récepteurs spécifiques et déclenchant des nausées et des vomissements. Cependant, il est difficile de dissocier l'effet du type de chirurgie des facteurs de risque liés au patient (ex: le fait qu'une majorité de patientes en chirurgie gynécologique soient non fumeuses et reçoivent des morphiniques en postopératoire). Pour pallier à la complexité de l'évaluation du risque, le recours à des scores de prédiction, basés sur des analyses de régression logistique, est mentionné. Ces scores combinent des facteurs liés au patient, à la chirurgie, et à l'anesthésie afin d'estimer le risque individuel de NVPO. Le texte mentionne notamment les scores de Sinclair, Palazzo et Evans, Koivuranta, et Apfel, en soulignant leurs limites (ex: score d'Apfel inadaptés aux enfants) et les différences d'efficacité entre eux.
IV.Traitement des NVPO et efficacité du dolasetron
Le dolasetron et l'ondansétron, antagonistes des récepteurs 5-HT3, constituent des options pharmacologiques pour la prévention des NVPO. L'étude a démontré une réduction significative de l'incidence des NVPO à l'extubation et à la première heure postopératoire dans le groupe ayant reçu du dolasetron (p=0.025). Le besoin de traitement antiémétique de secours était également significativement plus faible dans ce groupe (10.8% vs 60% dans le groupe placebo, p<0.05). L'ondansétron est plus utilisé, mais le dolasetron a montré dans cette étude une efficacité comparable pour la prévention des nausées et vomissements postopératoires précoces en neurochirurgie. Le droperidol est une autre option, mais ses effets secondaires potentiels doivent être pris en compte.
1. Antagonistes des récepteurs 5 HT3 une approche pharmacologique
Le document explore le traitement médicamenteux des nausées et vomissements postopératoires (NVPO), en se concentrant sur les antagonistes des récepteurs 5-HT3, une classe de médicaments antiémétiques. Ces antagonistes agissent en bloquant les récepteurs 5-HT3, présents à la fois au niveau périphérique (tractus gastro-intestinal) et central (area postrema), impliqués dans la régulation du vomissement. Le principal effet de ces antagonistes est de contrer les vomissements provoqués par des stimuli physiques ou des médicaments antinéoplasiques qui libèrent de la sérotonine. Parmi les antagonistes 5-HT3, l'ondansétron est mentionné comme ayant une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour la prévention des NVPO et comme étant la molécule la plus utilisée dans cette indication. Le dolasetron, le granisétron et le tropisétron sont également cités comme des options thérapeutiques, bien que l'on ne dispose pas de données suffisantes pour comparer leur efficacité et leur innocuité. L’efficacité des antagonistes 5-HT3 est supérieure à celle d’autres antiémétiques comme le métoclopramide. Les effets secondaires des antagonistes 5-HT3 sont généralement bien tolérés, mais peuvent inclure des céphalées, une asthénie, de la somnolence, des troubles cardiaques (hypotension, bradycardie), ainsi qu’une constipation.
2. Efficacité du dolasetron et comparaison avec d autres antiémétiques
L'étude principale porte sur l'efficacité du dolasetron dans la prévention des NVPO en neurochirurgie. Le dolasetron, un antagoniste des récepteurs 5-HT3, a été administré à une dose de 20 mg, 30 minutes avant la fermeture cutanée. Les résultats montrent une réduction significative de l'incidence des NVPO à l'extubation et durant la première heure postopératoire dans le groupe traité par le dolasetron (p=0.025), et un besoin de traitement de secours significativement moindre (10.8% vs 60% dans le groupe placebo, p<0.05). Cette efficacité est comparée à celle de l'ondansétron dans d'autres études, avec des résultats variables selon les études et les protocoles. Certaines études montrent une plus grande efficacité du dropéridol sur les vomissements, mais le dolasetron s'avère efficace sur les nausées et vomissements précoces. Le dropéridol, bien qu'efficace, présente des effets secondaires et son efficacité est questionnée en cas d'association avec le propofol et chez les hommes. L'ondansétron est aussi comparé au métoclopramide et au placebo dans plusieurs études avec des résultats variables, parfois contradictoires.
3. Traitement des NVPO en postopératoire et surveillance des effets secondaires
En cas de nausées et/ou de vomissements à la sortie de la salle de réveil, une recherche de facteurs favorisant est recommandée. Ceci inclut une évaluation d'une possible réaction à la morphine, une ingestion de sang (dans certaines chirurgies), ou un signe d'hypertension intracrânienne. Si ces facteurs sont exclus, un traitement médicamenteux peut être envisagé. L'étude souligne l'absence de consensus sur la prise en charge des NVPO, malgré la diversité des antiémétiques disponibles. Le dolasetron, dans le cadre de cette étude, a démontré une efficacité dans la réduction des NVPO précoces, sans effets secondaires notables hormis ceux liés aux complications neurochirurgicales (convulsions, hémiplégie). Des études comparant l’ondansétron à un placebo, ou à d'autres médicaments comme le dropéridol, montrent des résultats variables quant à l'efficacité sur les nausées et vomissements, soulignant la complexité du traitement des NVPO et la nécessité de considérer les facteurs de risque individuels et le contexte chirurgical.
V.Informations importantes sur l étude
L'étude a été réalisée au CHU Mohammed VI de Marrakech, au Maroc. Elle a inclus 80 patients, avec un groupe de 40 patients recevant du dolasetron et 40 recevant un placebo. 3 patients ont été exclus en raison de complications peropératoires majeures.
1. Méthodologie et population étudiée
L'étude, menée au CHU Mohammed VI de Marrakech, est une étude prospective, randomisée, en double aveugle, d'une durée de 14 mois (janvier 2006 à février 2007). Elle a inclus 80 patients âgés de 15 à 70 ans, programmés pour une craniotomie pour la résection de tumeurs intracrâniennes ou de lésions vasculaires. Les patients ont été randomisés en deux groupes de 40 : un groupe recevant du dolasetron (20 mg IV 30 minutes avant la fermeture cutanée) et un groupe placebo (sérum physiologique à 0,9%). Des critères d'exclusion ont été définis, notamment l'impossibilité d'extubation en fin d'intervention (3 patients exclus, tous du groupe dolasetron) et un âge inférieur à 15 ans. Une anesthésie générale standardisée avec intubation orotrachéale (mode TIVA) a été utilisée pour tous les patients, avec un monitorage peropératoire complet (ECG, pression artérielle invasive, oxymétrie de pouls, capnographie, température, analyse des gaz expirés). Le protocole d'analgésie postopératoire était identique pour les deux groupes. Les données collectées comprenaient des données démographiques, la durée de la chirurgie, ainsi que des informations sur les facteurs de risque de NVPO (antécédents, mal des transports, comorbidités, tabagisme, etc.).
2. Collecte des données et critères d évaluation
L'évaluation des NVPO a été effectuée à plusieurs moments après l'intervention : à l'extubation, puis à H1, H2, H6, H12 et H24. Le nombre d'épisodes de nausées et de vomissements a été enregistré pour chaque patient, ainsi que le recours à un traitement antiémétique de secours. Les données démographiques, la durée de la chirurgie, et les protocoles d'anesthésie et d'analgésie étaient comparables entre les deux groupes, ce qui assure une meilleure fiabilité des résultats. L'étude a mis en évidence une réduction significative de l'incidence des NVPO dans le groupe dolasetron à l'extubation et à la première heure postopératoire (p=0.025). Aucune différence significative n'a été observée à d'autres intervalles. Le recours au traitement de secours antiémétique était significativement plus faible dans le groupe dolasetron (10.8%) par rapport au groupe placebo (60%, p<0.05). L’absence d’effets secondaires liés au dolasetron est notable, à l’exception des complications neurochirurgicales classiques telles que les convulsions et l’hémiplégie.
