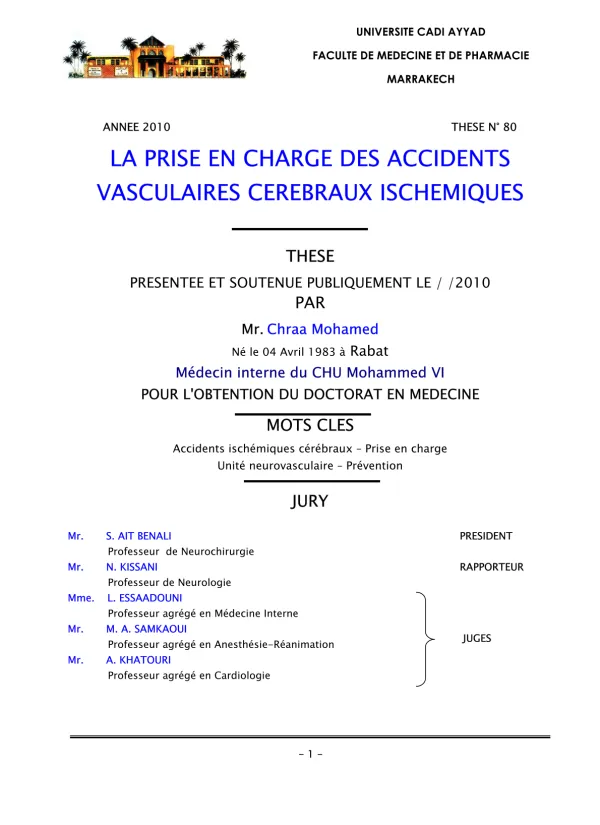
Prise en charge des accidents vasculaires cérébraux ischémiques : Étude de 352 cas
Informations sur le document
| Auteur | Chraa Mohamed |
| school/university | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech |
| subject/major | Médecine |
| Type de document | Thèse |
| city_where_the_document_was_published | Marrakech |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 2.95 MB |
- Accidents vasculaires cérébraux
- Prise en charge médicale
- Médecine interne
Résumé
I.Épidémiologie de l AVC ischémique AVCi à Marrakech
Cette étude rétrospective, menée de 2000 à 2009 au service de neurologie du CHU Mohammed VI de Marrakech, a analysé 352 cas d'AVC ischémique. La prévalence de l'AVCi parmi les patients admis était de 18%. Le sex-ratio était de 0.94. Seulement 40% des patients ont consulté dans les 24h suivant l'apparition des symptômes. L'hypertension artérielle (HTA) était le principal facteur de risque modifiable (42% des cas), suivi du tabagisme (25%). L’hôpital Ibn Tofail, partie intégrante du CHU, couvre une large zone du sud marocain, incluant des villes comme Agadir, Safi et Essaouira, soulignant une importante carence en centres de neurologie bien équipés dans la région.
1. Contexte de l étude et Méthodologie
L'étude, menée de janvier 2000 à décembre 2009 à l'hôpital Ibn Tofail du CHU Mohammed VI de Marrakech, est une étude rétrospective portant sur 352 cas d'accidents vasculaires cérébraux ischémiques (AVCi). Le choix de cette période correspond à l'intégration du service de neurologie au sein de la structure universitaire. L'hôpital Ibn Tofail, situé à Marrakech, couvre une vaste région du sud du Maroc, incluant des villes comme Agadir, Safi et Essaouira, où l'accès à des soins spécialisés en neurologie est limité. Cette situation géographique explique la forte proportion de patients venant de zones rurales (56%). La méthodologie consistait en une collecte de données à partir des dossiers médicaux, analysant des paramètres épidémiologiques (prévalence, âge, sexe, origine géographique, facteurs de risque), cliniques, paracliniques, thérapeutiques et évolutifs. L’étude vise à dresser un bilan global de la prise en charge de l’AVCi dans le service sur cette période, afin d’identifier des axes d’amélioration pour réduire la morbidité et la mortalité liées à cette pathologie. Les données ont été collectées par l'étude des dossiers des archives du service, à l'aide d'une fiche d'exploitation spécifiquement conçue à cet effet. Seuls les patients hospitalisés et chez qui le diagnostic d'AVCi a été confirmé ont été inclus dans cette étude, en respectant les critères d’inclusion/exclusion.
2. Prévalence et Délai de Consultation
Durant les neuf années de l'étude, la prévalence des AVCi parmi tous les patients admis au service de neurologie était de 18%, avec un sex-ratio de 0,94. Un constat préoccupant est apparu concernant le délai de consultation : seulement 40% des patients ont consulté avant 24 heures, et seulement 5% avant 3 heures. Un retard diagnostique important, dépassant parfois une année, a été observé chez une part significative des patients. Plusieurs facteurs contribuent à ce retard. La difficulté à identifier les symptômes graves précurseurs de l’AVCi par les patients eux-mêmes et les professionnels de santé non neurologues joue un rôle crucial. De plus, l’étude souligne les problèmes de transport et les lacunes organisationnelles du système de santé national comme des éléments aggravants. L'amélioration du délai de consultation est essentielle, compte tenu de l'impact positif démontré par une prise en charge précoce, notamment l’accès à la thrombolyse et aux unités neurovasculaires, sur le pronostic à court, moyen et long terme.
3. Principaux Facteurs de Risque
L'étude a mis en évidence plusieurs facteurs de risque de l'AVCi. L'hypertension artérielle (HTA) était le facteur de risque modifiable le plus important, retrouvé chez 42% des patients, conformément aux données de la littérature (40 à 85%). Le tabagisme, présent chez 25% des patients de l'étude, constitue un autre facteur de risque significatif. Ces résultats sont supérieurs à ceux rapportés dans certaines études mais inférieurs à d’autres. L'arythmie cardiaque, notamment la fibrillation auriculaire (ACFA), figurait parmi les causes cardiaques contrôlables de l'AVC. Le manque d’éducation et d’information des malades, ainsi que les lacunes de formation continue des médecins généralistes (souvent les premiers points de contact) contribuent à une prise en charge inadéquate. Un pourcentage important de patients (23%) présentaient un AVCi sans facteur de risque identifiable, soulignant la complexité de la pathologie et la nécessité de recherches complémentaires.
II.Facteurs de Risque et Diagnostic de l AVC
L'étude a identifié l'HTA comme facteur de risque majeur de l'AVC, présent chez 42% des patients. Le tabagisme (25%) et l'athérosclérose (113 cas) étaient aussi fréquents. La fibrillation auriculaire (ACFA) était une autre cause significative, souvent liée au manque d'éducation sanitaire. Le diagnostic reposait principalement sur l'examen clinique et la tomodensitométrie (TDM) cérébrale, réalisée chez 99% des patients. 19% des TDM étaient normales. L'IRM, utilisée dans 13 cas, offrait une sensibilité supérieure pour le diagnostic d'AVC ischémique.
1. Facteurs de Risque de l AVC
L'étude identifie plusieurs facteurs de risque importants associés aux AVC. L'hypertension artérielle (HTA) est le facteur de risque modifiable le plus significatif, affectant 43% des patients de la cohorte. La littérature médicale confirme la forte association entre l'HTA et les infarctus cérébraux, multipliant le risque par quatre, quel que soit l'âge ou le sexe. Le tabagisme est également un facteur de risque majeur, observé chez 25% des patients, un chiffre supérieur à certaines études mais inférieur à d’autres. L’arythmie cardiaque, en particulier la fibrillation auriculaire (ACFA), est identifiée comme une cause cardiaque contrôlable importante d'AVC, responsable de 50% des AVC d'origine cardioembolique. L’étude souligne le manque d'éducation et d'information des patients concernant leur santé, conduisant à la négligence de problèmes de santé, et le manque de formation continue des médecins généralistes, qui sont souvent les premiers consultés et dont l’intervention est cruciale dans la prise en charge adéquate. Il est important de noter que 23% des patients n'avaient aucun facteur de risque identifiable, soulignant la complexité de la pathogénie de l'AVC.
2. Diagnostic de l AVC Imagerie et Examen Clinique
Le diagnostic de l'AVC repose principalement sur l'examen clinique, mais l'imagerie joue un rôle crucial. La tomodensitométrie (TDM) cérébrale est l'examen le plus accessible en urgence, permettant de confirmer le diagnostic et de distinguer un accident vasculaire cérébral ischémique (AVCi) d'un accident vasculaire cérébral hémorragique (AVCh). Dans cette étude, 81% des TDM étaient pathologiques, un pourcentage comparable à celui trouvé dans d'autres études. Par ailleurs, 69% des AVCi impliquaient l'artère sylvienne, un résultat cohérent avec les données de la littérature. L'IRM encéphalique, bien que réalisée dans seulement 13 cas de cette étude, offre une sensibilité diagnostique supérieure. L'IRM de diffusion (DW1) permet d'évaluer l'œdème cytotoxique, tandis que l'IRM de perfusion (P1) apprécie le flux sanguin capillaire, un élément important dans le contexte de la thrombolyse. L’étude a également utilisé le score de Glasgow à l'admission pour évaluer l'état neurologique des patients à l'arrivée. Les résultats obtenus sont inférieurs à ceux des études sur les patients de réanimation, ce qui pourrait être expliqué par le contexte spécifique des admissions au service de neurologie générale.
III.Traitement et Complications de l AVC
Le traitement comprenait principalement des antiagrégants plaquettaires (64%), du Piracetam (60%), des statines (42%) et des anticoagulants (AVK) (38%). Malgré des moyens limités, la létalité était relativement faible (13%). Les complications les plus fréquentes étaient motrices et cognitives. Le manque d'une unité neurovasculaire et l'absence de thrombolyse constituent des limites importantes à une prise en charge optimale des AVC au sein du service de neurologie.
1. Modalités Thérapeutiques
Le traitement des AVC dans cette étude comprenait une combinaison de médicaments. Les antiagrégants plaquettaires étaient les plus fréquemment utilisés (64%), suivis du Piracetam (60%), des statines (42%) et des anticoagulants (AVK) (38%). Cette approche thérapeutique, bien que jugée honorable compte tenu des ressources disponibles, souligne les limites de la prise en charge actuelle. L’absence de thrombolyse, une thérapie pourtant efficace pour améliorer le pronostic à court, moyen et long terme, est une lacune majeure. L’étude mentionne 135 patients ayant nécessité une anticoagulation au long cours avec des AVK, soulignant la fréquence des complications thromboemboliques dans cette population. Le service de neurologie, n'étant pas spécialisé en pathologie vasculaire, fait face à des contraintes limitant l’efficacité du traitement. Ces limitations incluent l’incapacité du service à gérer le flux important de patients AVC provenant de toute la région sud du Maroc, la difficulté pour certains patients à réaliser les examens complémentaires nécessaires à un diagnostic étiologique précis, et l’absence d’une thérapeutique adéquate dans certains cas. Malgré ces défis, les résultats sont encourageants : la moitié des patients ont connu une bonne évolution, un résultat proche de celui observé dans les centres spécialisés. Cette observation met l'accent sur le besoin urgent de ressources supplémentaires.
2. Complications et Nécessité d une Approche Multidisciplinaire
L'étude a révélé des complications chez un quart des patients, principalement des séquelles motrices puis cognitives. Ces données mettent en lumière la nécessité d'une prise en charge neuropsychologique précoce et d'une rééducation appropriée. L'amélioration de la prise en charge passe par une approche multidisciplinaire, intégrant neurologues, kinésithérapeutes, logopèdes et autres professionnels de santé. L’implémentation d'une unité neurovasculaire (Stroke Unit) serait bénéfique. Une Stroke Unit, unité hospitalière spécialisée dans la prise en charge des AVC, permet une prise en charge globale et immédiate du patient, réunissant une équipe pluridisciplinaire pour la surveillance médicale et la rééducation précoce. L’étude fait remarquer que le service de neurologie possède trois lits dédiés à la pathologie vasculaire, équipés d’un système d’aspiration et d’oxygénothérapie, mais qu’un monitoring des malades et l’exploration doppler sont absents. La faible létalité (13%), malgré les ressources limitées, témoigne du travail accompli, mais souligne également les améliorations nécessaires pour optimiser les soins et le devenir des patients.
IV.Amélioration de la Prise en Charge de l AVC au Maroc
L'étude souligne la nécessité d'améliorer la prise en charge des AVC au Maroc, notamment en créant des unités neurovasculaires et en implémentant la thrombolyse. Des actions de prévention primaire et secondaire sont cruciales, passant par des campagnes d'information et d'éducation sanitaire pour la population et une formation continue des professionnels de santé, afin de réduire le retard diagnostique et améliorer le pronostic des patients atteints d'AVC ischémique.
1. Amélioration de la Prise en Charge Besoins et Recommandations
L'étude met en lumière les insuffisances de la prise en charge actuelle des AVC au Maroc et propose des améliorations cruciales. La création d'une unité neurovasculaire (Stroke Unit) est une recommandation majeure, car elle permettrait une prise en charge multidisciplinaire immédiate et globale des patients, incluant surveillance médicale et rééducation précoce. L’étude souligne que le service de neurologie dispose de 3 lits dédiés aux pathologies vasculaires avec aspiration et oxygénothérapie, mais manque de monitoring et d'exploration doppler. Le démarrage de la thrombolyse, une thérapie non encore pratiquée au Maroc, est une autre recommandation clé pour améliorer le pronostic. L'étude précise que les préparatifs pour le démarrage de cette thérapie sont en cours. L'amélioration de la prise en charge passe également par une meilleure coordination entre les différents acteurs de santé (SAMU, urgentistes, neurologues, radiologues, cardiologues) afin de réduire le délai de consultation. Actuellement, seulement 40% des patients consultent avant 24 heures, et 5% avant 3 heures, mettant en évidence un besoin urgent d'amélioration de l'accès aux soins et de l'information de la population.
2. Prévention Primaire et Secondaire des AVC
La prévention, tant primaire que secondaire, est essentielle pour réduire l'incidence des AVC. L'étude identifie la nécessité de mettre en place une stratégie nationale de prévention, axée sur plusieurs points. Il est important d’évaluer les connaissances de la population sur les signes annonciateurs d'un AVC et la prévalence de l'AVC dans le contexte marocain. Il est crucial de comprendre les raisons des retards diagnostiques importants et d'analyser les pratiques des médecins généralistes face à des cas suspects d'AVC. Sur la base de ces évaluations, des campagnes de communication et d'information publiques seront mises en place pour encourager une consultation rapide. Parallèlement, une stratégie nationale de formation continue des médecins (généralistes et spécialistes) est indispensable pour améliorer leurs compétences dans le diagnostic et la prise en charge des AVC. La prévention primaire, en agissant sur des facteurs de risque comme l'hypertension artérielle, le tabagisme et le manque d'activité physique, est essentielle, tout comme la prévention secondaire pour les personnes ayant déjà eu un AVC, visant à réduire le risque de récidive.
V.Anatomie des Artères Cérébrales
Cette section décrit l'anatomie de l'artère cérébrale antérieure (ACA) et de l'artère cérébrale moyenne (artère sylvienne), soulignant leur importance dans le contexte des AVC ischémiques. Elle précise l'origine, le trajet et les branches de chaque artère, information essentielle pour comprendre la physiopathologie des AVC.
1. Artère Cérébrale Antérieure ACA
La description anatomique de l'artère cérébrale antérieure (ACA) détaille son origine à partir de la carotide interne, son trajet en avant et en dedans vers la face interne du lobe frontal, et sa division en trois segments (A1, A2, A3). Le segment A1, ou segment cisternal, se situe au-dessus du nerf optique et du chiasma optique. Le segment A2 chemine dans la scissure longitudinale du cerveau (scissure callosomarginale), passant devant la lame terminale et suivant le genou du corps calleux. Enfin, le segment A3, ou artère péricalleuse, se trouve à la face dorsale du corps calleux. Cette description précise de l'anatomie de l'ACA est importante pour comprendre l'impact d'une obstruction de cette artère sur le fonctionnement cérébral et la survenue d'un AVC. La connaissance de son trajet et de ses segments est cruciale pour le diagnostic et la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux affectant cette zone spécifique du cerveau.
2. Artère Cérébrale Moyenne Artère Sylvienne
L'artère cérébrale moyenne, ou artère sylvienne, est décrite comme la plus grosse branche de la carotide interne. Elle possède deux branches, une par hémisphère cérébral. Son origine est la branche distale externe de la carotide interne. Son trajet est divisé en quatre segments (M1 à M4). Le segment M1, à la base du crâne, comprend des artères perforantes. Le segment M2 traverse la fissure de la face latérale du lobe de l'insula, puis la face médiale de l'opercule fronto-pariétal, avant de cheminer sur la face latérale de l'hémisphère. Le segment M3 se trouve à la partie postérieure de la fosse latérale. Enfin, le segment M4 (terminal) est constitué de l’artère angulaire ou artère du pli courbe. Cette description anatomique détaillée de l'artère sylvienne est essentielle pour comprendre les conséquences d'une ischémie ou d'une hémorragie dans cette région, fréquemment impliquée dans les accidents vasculaires cérébraux.
