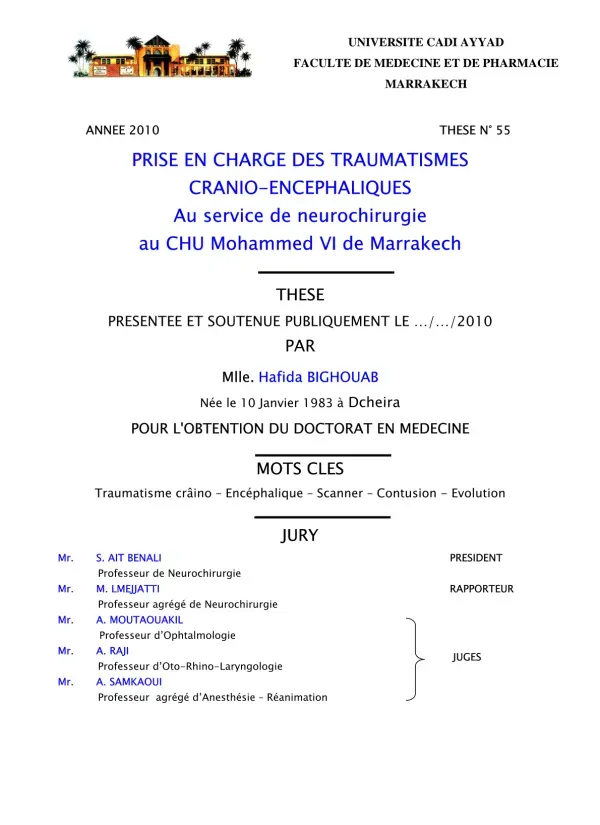
Prise en Charge des Traumatismes Crâniens au CHU Mohammed VI de Marrakech
Informations sur le document
| Auteur | Hafida Bighouab |
| École | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech |
| Spécialité | Médecine |
| Lieu | Marrakech |
| Type de document | Thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 1.57 MB |
- Traumatismes crâniens
- Neurochirurgie
- Médecine
Résumé
I.Définition et Étiologie des Traumatismes Crânio Encéphaliques TCE
Cette étude rétrospective, menée au Service de Neurochirurgie du CHU Med VI de Marrakech sur 5896 cas de TCE hospitalisés entre 2002 et 2008, définit le traumatisme crânio-encéphalique (TCE) selon la NHIF comme toute agression cérébrale due à une force externe, altérant l'état de conscience et les capacités cognitives ou physiques. Les accidents de la voie publique (AVP) constituent la principale cause de TCE, particulièrement chez les hommes jeunes (15-25 ans). Au Maroc, l'augmentation du nombre de TCE est observée, malgré les campagnes de sensibilisation.
1. Définition du Traumatisme Crânio Encéphalique TCE
L'étude définit le traumatisme crânio-encéphalique (TCE) selon la National Head Injury Foundation (NHIF). Il est caractérisé par une agression cérébrale consécutive à une force externe. Cette agression provoque une diminution ou une altération de l'état de conscience, entraînant des troubles cognitifs, physiques, comportementaux ou émotionnels. Ces troubles peuvent être transitoires ou permanents, allant d'incapacités partielles à des incapacités totales, avec des conséquences psychosociales significatives. La définition met l'accent sur l'impact d'une force externe sur le cerveau et la variété des conséquences qui en résultent, soulignant la complexité des lésions et leur impact sur la vie du patient. La définition est basée sur le consensus établi par la NHIF, faisant autorité dans le domaine des traumatismes crâniens. Cette définition formelle sert de point de départ pour l'analyse des données de l'étude.
2. Répartition selon l Étiologie des TCE
L'étude explore les causes des TCE, révélant que les accidents de la voie publique (AVP) sont la principale étiologie, quel que soit le degré de gravité du traumatisme. La proportion d'AVP varie significativement selon l'âge et le pays. Chez les adolescents et les jeunes adultes (15-25 ans), principalement les hommes, les AVP dominent, représentant plus de la moitié des cas de TCE graves. À l'inverse, les chutes sont plus fréquentes aux âges extrêmes de la vie et associées davantage aux TCE légers. L'étude mentionne des travaux effectués au Maroc, soulignant une augmentation de la fréquence des TCE durant certaines saisons, corrélée à l'augmentation du trafic routier et au retour des Marocains résidents à l'étranger. Cette observation met en lumière l'influence contextuelle et géographique sur l'incidence des TCE. L’analyse de l’étiologie permet de cibler les stratégies de prévention appropriées, en fonction des groupes à risque et des contextes spécifiques.
3. Répartition des TCE en Fonction du Temps
L'analyse de la répartition des TCE au cours des sept années de l'étude (2002-2008) montre une augmentation constante du nombre de cas, malgré les efforts de sensibilisation. Cette observation souligne la nécessité de stratégies de prévention plus efficaces. Bien que la variabilité annuelle soit constatée, la tendance générale est à la hausse, ce qui est préoccupant. L’augmentation constante du nombre de cas de TCE, malgré les efforts de prévention, indique un besoin d’approches plus globales et plus impactantes pour réduire l’incidence de ces traumatismes. Cette donnée met en perspective les défis liés à la prévention des TCE et la nécessité de développer des stratégies plus efficaces. L'augmentation du nombre de cas malgré les campagnes de sensibilisation met en exergue la complexité du problème.
II.Diagnostic des TCE Imagerie et Examen Clinique
Le diagnostic des TCE repose sur l'examen clinique, notamment l'évaluation de la conscience via le score de Glasgow, et sur des examens complémentaires. La tomodensitométrie (TDM) permet de visualiser les lésions, notamment les hématomes extraduraux (HED), qui se présentent comme une lentille biconvexe hyperdense sur le scanner. L'IRM, en particulier l'IRM de tractographie, est utilisée pour détecter les lésions de la substance blanche et guider les interventions chirurgicales. L'examen clinique répété est crucial pour suivre l'évolution des symptômes et dépister une aggravation secondaire.
1. Examen Clinique et Échelle de Glasgow
L'évaluation clinique est primordiale dans le diagnostic des traumatismes crânio-encéphaliques (TCE). Elle commence par une évaluation minutieuse de l'état de conscience du patient, souvent réalisée à l'aide de l'échelle de Glasgow. Développée par Teasdale et Jennett en 1974, cette échelle mesure l'altération de la conscience en observant l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice à des stimulations. Le score total, obtenu par l'addition des notes pour chaque critère, permet une évaluation objective de l'état du patient et sert d'indicateur pronostique, prédisant la mortalité. L'examen clinique dépasse l'échelle de Glasgow, incluant l'observation des pupilles (réactivité à la lumière, mydriase) qui peut indiquer des lésions spécifiques. Des facteurs comme un traumatisme oculaire direct ou un choc cardio-vasculaire peuvent interférer avec l'interprétation des signes pupillaires. La répétition de l'examen clinique permet de suivre l'évolution dynamique des symptômes et est cruciale pour le diagnostic.
2. Imagerie Médicale Tomodensitométrie TDM et Imagerie par Résonance Magnétique IRM
L'imagerie médicale joue un rôle crucial dans le diagnostic précis des TCE. La tomodensitométrie (TDM) est un examen essentiel, permettant de visualiser avec précision les lésions intracrâniennes. Bien qu'elle ne soit pas systématiquement indiquée selon la classification de Masters, la TDM est particulièrement utile pour identifier les hématomes extraduraux (HED), qui apparaissent comme une lentille biconvexe hyperdense. La TDM permet également de localiser précisément le saignement, de visualiser les fractures osseuses associées et d'évaluer l'effet de masse sur les structures ventriculaires. Les examens répétés permettent de suivre l'évolution des lésions. L'IRM, surtout l'IRM de tractographie, est utilisée pour la recherche de lésions chez les patients présentant des séquelles neuropsychologiques. Elle permet de visualiser la substance blanche et ses faisceaux, offrant un outil diagnostique et pronostique important. L’imagerie permet donc non seulement de poser un diagnostic précis mais aussi de suivre l’évolution des lésions et d’orienter le traitement.
III.Traitement des TCE Médical et Chirurgical
La prise en charge des TCE est à la fois médicale et chirurgicale. Le traitement médical inclut la correction de l'hypovolémie, l'utilisation de sérum salé hypertonique (limité à la réanimation préhospitalière), et l'éviction de la corticothérapie et du sérum glucosé dans la phase initiale. Le mannitol peut être utilisé pour diminuer la pression intracrânienne. Le traitement chirurgical, particulièrement urgent pour les HED, implique une craniectomie de décompression. L'objectif est de réduire l'hypertension intracrânienne (HIC) et d'améliorer le pronostic vital. Dans cette étude, 491 cas d’infections post-traumatiques (12,01%) ont été rapportés.
1. Traitement Médical des TCE
Le traitement médical des traumatismes crânio-encéphaliques (TCE) vise à corriger rapidement toute hypovolémie par un remplissage vasculaire adéquat et, si nécessaire, par des médicaments vasoactifs. La perte d'autorégulation du débit sanguin cérébral (DSC) après un TCE rend le patient dépendant de la pression artérielle moyenne systémique. Le sérum glucosé est proscrit en phase initiale en raison de l'aggravation possible de l'ischémie cérébrale due à l'hyperglycémie induite par le stress. Le sérum salé hypertonique est utilisé pour restaurer la volémie et diminuer l'œdème cérébral, mais son utilisation est principalement limitée à la réanimation préhospitalière. La corticothérapie est déconseillée en raison de ses effets négatifs sur le métabolisme (déséquilibres glycémiques, rétention hydrosodée, hypertension artérielle) et le système immunitaire. Le mannitol, quant à lui, est utilisé pour diminuer la pression intracrânienne grâce à un double mécanisme : osmotique et vasoconstricteur. Son utilisation doit être prudente, car il peut augmenter la pression intracrânienne dans certaines situations. La position du patient (inclinée à 30 degrés dans cette étude) est également un aspect du traitement médical.
2. Traitement Chirurgical des TCE L Hématome Extradural HED
Le traitement chirurgical des TCE est indiqué principalement pour les hématomes intracrâniens et les traumatismes crâniens ouverts. L'hématome extradural (HED) représente une urgence neurochirurgicale absolue. La chirurgie de l'HED temporal typique comprend une incision cutanée en fer à cheval, guidée par la tomodensitométrie (TDM), et la taille d'un volet pédiculé sur le muscle temporal pour contrôler l'artère méningée moyenne. Les localisations sus- et sous-tentorielles, impliquant une lésion du sinus latéral, nécessitent une craniectomie sous-occipitale à os perdu, avec réparation du sinus. Pour les localisations frontales, l'incision respecte les sinus frontaux, et la recherche de l'origine du saignement peut être complexe. Un lavage abondant est effectué pour décoller les caillots, et un drainage sous-dural est parfois nécessaire. Le traitement chirurgical chronique de l'HED, avec craniectomie et drainage, donne de bons résultats (80% de guérison). La craniectomie de décompression, efficace pour traiter l'hypertension intracrânienne réfractaire, améliore le pronostic vital, selon des études animales et humaines.
3. Complications Postopératoires et Soins Infirmiers
Des complications postopératoires, telles que les infections (respiratoires, urinaires, méningites, ophtalmiques; 12,01% dans cette série), peuvent survenir. Des précautions d'asepsie rigoureuse, une antibiothérapie prophylactique ou curative, et des cytoprotecteurs gastriques sont importants pour minimiser ces risques. Les soins infirmiers (nursing) sont essentiels pour prévenir les escarres de décubitus grâce à l'utilisation de matelas à eau et des changements de position fréquents. Les mobilisations articulaires préviennent les rétractions musculo-tendineuses et les attitudes vicieuses. L’incidence des infections selon la littérature anglo-saxonne est de 2 à 3 pour mille. L'étude souligne l'importance des mesures prophylactiques et des soins intensifs postopératoires pour optimiser le pronostic et réduire la durée d'hospitalisation.
IV.TCE chez l Enfant et Séquelles Neuropsychologiques
L'étude a inclus 308 enfants, avec un taux de mortalité de 1,62%. Chez les enfants, les chutes sont la cause principale de TCE. Le risque de séquelles épileptiques varie en fonction de la gravité du TCE. Les séquelles affectives et neuropsychologiques à long terme sont importantes et ne doivent pas être sous-estimées, affectant le quotient intellectuel, la scolarité et la réinsertion sociale.
1. TCE chez l Enfant Incidence et Étiologie
L'étude porte sur 308 enfants victimes de traumatismes crânio-encéphaliques (TCE), représentant 12,3% de l'échantillon total. Le taux de mortalité chez ces enfants s'élève à 1,62% (5 décès sur 308 cas). Contrairement aux adultes où les accidents de la voie publique sont la cause principale, les chutes accidentelles constituent le facteur étiologique dominant chez les enfants de cette étude, représentant 53,5% des cas. Le document mentionne des travaux de Levin (144) rapportant une mortalité plus élevée chez les enfants de 0 à 4 ans comparativement aux enfants plus âgés (10-15 ans). Cette différence d'étiologie et de mortalité souligne les vulnérabilités spécifiques des enfants face aux traumatismes crâniens et l’importance d’adapter les stratégies de prévention en fonction des groupes d’âge. Les données montrent que la prévention des chutes est un enjeu majeur pour réduire l'incidence des TCE chez les enfants.
2. Séquelles Épileptiques et Affectives chez l Enfant
Le risque de séquelles épileptiques après un TCE est abordé, variant considérablement selon la gravité du traumatisme : 3% pour les TCE bénins contre 75% pour les formes compliquées. Chez l'enfant, les séquelles affectives constituent une réaction secondaire importante, se manifestant par une instabilité caractérielle (colère, agressivité), une forte émotivité et des troubles du sommeil. Ces troubles émotionnels nécessitent une attention particulière, car ils peuvent impacter le développement de l'enfant. L’étude met en avant l’importance de prendre en compte les aspects psychologiques et émotionnels, en plus des aspects physiques, dans la prise en charge des enfants victimes de TCE. Il est primordial de proposer un suivi adapté aux besoins de l’enfant et de sa famille.
3. Séquelles Neuropsychologiques à Long Terme
L'étude souligne l'importance des séquelles neuropsychologiques à long terme après un TCE, soulignant la nécessité de ne pas les sous-estimer. Ces séquelles peuvent compromettre sérieusement le quotient intellectuel de l'enfant, affectant sa scolarité et sa future réinsertion sociale. Le document cite une étude de l'université du Maryland (1992) sur les motocyclistes, montrant que le non-port du casque double le risque de traumatisme crânien. Cette donnée illustre l'importance des mesures préventives. L'impact des séquelles neuropsychologiques sur le développement cognitif et social à long terme est significatif, soulignant le besoin d'un suivi neuropsychologique régulier et de stratégies d'intervention précoce pour atténuer ces conséquences. Des programmes de rééducation neuropsychologique adaptés sont essentiels pour accompagner les enfants dans leur développement post-traumatique.
V.Prévention des TCE liés aux Accidents de la Voie Publique AVP
La prévention des TCE liés aux AVP nécessite une approche multifactorielle, ciblant les facteurs environnementaux, humains, liés au véhicule et à l'infrastructure routière, avec un accent majeur sur le facteur humain. Des initiatives comme le collectif « Arrêtons le massacre sur les routes » en France illustrent les efforts de prévention. Une étude sur les motocyclistes souligne l'importance du port du casque pour réduire le risque de TCE.
1. Facteurs de Risque des Accidents de la Voie Publique AVP
Pour mieux orienter les actions de prévention des traumatismes crânio-encéphaliques (TCE) liés aux accidents de la voie publique (AVP), il est crucial d'identifier les facteurs de risque. Le document souligne quatre catégories principales de facteurs : les facteurs environnementaux (conditions météorologiques, par exemple), les facteurs humains (non-respect du code de la route, imprudence, conduite sous l'emprise de substances), les facteurs liés au véhicule lui-même (état de marche, entretien, équipements de sécurité) et enfin, les facteurs liés à l'infrastructure routière (état des routes, signalisation). Cependant, l'étude précise que tous ces facteurs sont liés au facteur humain, soulignant le rôle central de la responsabilité individuelle dans la survenue des accidents. Comprendre l'interaction complexe de ces facteurs permet de mettre en place des stratégies de prévention ciblées et efficaces.
2. Initiatives de Prévention et Rôle du Port du Casque
Le document mentionne l'existence d'initiatives de prévention, illustrées par l'exemple du collectif français « Arrêtons le massacre sur les routes », formé de 13 associations en 2000. Ce collectif travaille à renforcer la sécurité routière en impliquant les différents acteurs concernés. Par ailleurs, une étude citée dans le document souligne l'impact significatif du port du casque pour les motocyclistes, démontrant que son absence double le risque de traumatisme crânien. Ces exemples illustrent les différentes approches possibles pour la prévention des AVP et leurs conséquences en termes de TCE. La combinaison de mesures législatives, de campagnes de sensibilisation et de l'amélioration de l'infrastructure routière est nécessaire pour une prévention efficace. Le port du casque pour les deux-roues est présenté comme une mesure préventive simple et pourtant très efficace.
VI.Anatomie du Crâne et Mécanismes des Lésions Cérébrales
L'étude rappelle l'anatomie du crâne, distinguant la voûte et la base. Deux mécanismes principaux provoquent les lésions cérébrales: le choc direct (lésions focales) et les accélérations/décélérations (lésions diffuses, notamment les lésions axonales diffuses). L'œdème cérébral, conséquence des lésions, contribue à l'hypertension intracrânienne (HIC), principale cause de mortalité après TCE grave.
1. Anatomie du Crâne
Le document rappelle brièvement l'anatomie du crâne, le décrivant comme composé de quatre os impairs médians (frontal, ethmoïde, sphénoïde, occipital) et de deux os pairs latéraux (temporal, pariétal). Il est divisé en une voûte (calvaria) et une base. La base du crâne, percée de nombreux orifices pour le passage des nerfs et des vaisseaux, possède une face interne (endocrânienne) et une face externe (exocrânienne). Elle est subdivisée en trois fosses : antérieure (lobes frontaux), moyenne (hypophyse, lobes temporaux) et postérieure (tronc cérébral, cervelet). Cette description anatomique sert de base à la compréhension des mécanismes des lésions cérébrales lors d'un traumatisme crânio-encéphalique (TCE), en précisant la structure osseuse et les structures neurologiques qu'elle protège. La connaissance de l’anatomie est fondamentale pour comprendre la localisation des lésions et leurs conséquences.
2. Mécanismes des Lésions Cérébrales lors d un TCE
Deux mécanismes principaux sont décrits pour expliquer les lésions cérébrales lors d'un TCE : le choc direct (traumatisme de contact) et les accélérations/décélérations. Le choc direct, causant des déformations crâniennes et des fractures possibles, produit des lésions principalement focales. Les accélérations et décélérations, en revanche, engendrent des lésions plus disséminées (diffuses). En l'absence de fracture osseuse, l'énergie cinétique se transmet à l'encéphale, causant des lésions de cisaillement (élongation et rupture des axones de la substance blanche) dues aux forces d'accélération. Les forces de décélération induisent des contusions parenchymateuses au point d'impact (lésion de coup) ou à l'opposé (lésion de contrecoup). Ces lésions diffuses, souvent associées à des hémorragies, sont plus représentatives des TCE graves et responsables des pertes de connaissance et des séquelles neuropsychologiques. L'étude mentionne deux types de lésions cérébrales : focales (contusions) et diffuses (substance blanche), en expliquant les mécanismes physiques à l’origine de ces lésions.
3. Lésions Encéphaliques Focales et Diffuses
Les lésions encéphaliques focales, principalement superficielles, sont de petits foyers hémorragiques pouvant induire un œdème focal et une nécrose tissulaire. Des hémorragies plus importantes constituent des foyers de contusion atteignant la substance blanche. L'hématome extra-cérébral, souvent associé aux contusions, résulte de déchirures vasculaires. L'œdème cérébral, pouvant être focal ou diffus, résulte d'un mécanisme cellulaire (rétention d'eau) et/ou vasogénique (modification de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique). Il participe aux phénomènes de gonflement parenchymateux et au développement d'une hypertension intracrânienne, principale cause de mortalité après TCE grave. L'étude différencie clairement les mécanismes des lésions focales et diffuses, soulignant l'impact combiné des deux sur la gravité du TCE. L'hypertension intracrânienne est identifiée comme une conséquence majeure des œdèmes cérébraux, mettant en exergue son rôle dans la mortalité des traumatismes crâniens graves.
