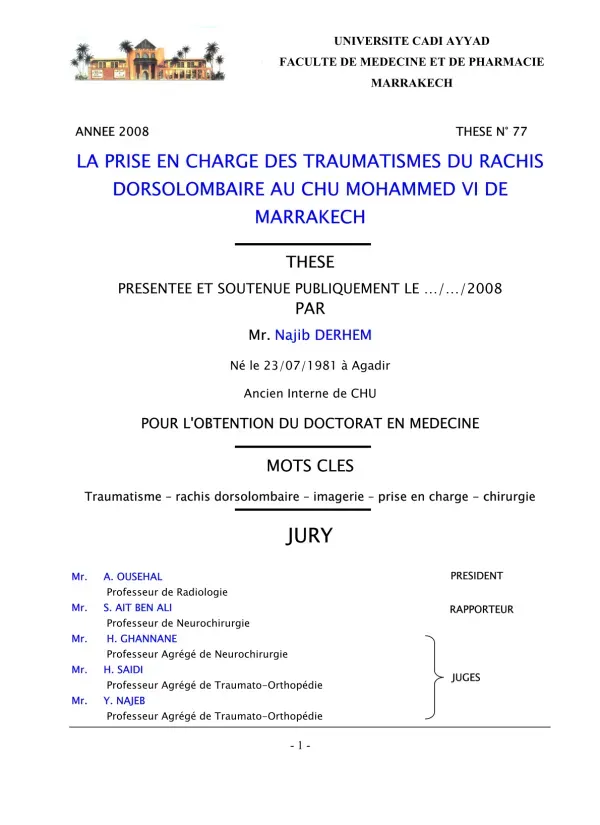
Prise en Charge des Traumatismes du Rachis Dorsolombaire au CHU Mohammed VI de Marrakech
Informations sur le document
| Auteur | Najib Derhem |
| instructor | A. Ousehal (Professeur de Radiologie) |
| École | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech |
| Spécialité | Médecine |
| Type de document | Thèse |
| Lieu | Marrakech |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 3.43 MB |
- traumatismes
- rachis dorsolombaire
- prise en charge
Résumé
I.Épidémiologie et Caractéristiques Cliniques des Traumatismes du Rachis Dorsolombaire
Cette étude rétrospective, menée au CHU Mohammed VI de Marrakech entre 2003 et 2007, a analysé 231 cas de traumatismes du rachis dorsolombaire. Les traumatismes rachidiens dorsolombaires étaient plus fréquents que les cervicaux (56%). Le sexe masculin était majoritairement affecté (67,8%), avec un âge moyen de 37 ans. Les chutes (68%) et les accidents de la voie publique (30%) étaient les principales étiologies. La douleur rachidienne était le symptôme principal, souvent associée à des troubles neurologiques (58,8%). Les lésions associées comprenaient principalement des traumatismes des membres (23,3%). La jonction thoracolombaire était le site le plus fréquemment touché (58%), avec une prédominance des fractures par compression, notamment au niveau de la première vertèbre lombaire. L'imagerie médicale, incluant des radiographies standard et des scanners, a été utilisée pour le diagnostic. L'IRM n'a été réalisée que dans 9 cas.
1. Épidémiologie des Traumatismes Rachidiens Dorsolombaires
L'étude rétrospective menée au service de neurochirurgie du CHU Mohammed VI de Marrakech entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2007 a porté sur 231 patients ayant subi un traumatisme du rachis dorsolombaire. L’analyse épidémiologique révèle une prédominance des traumatismes dorsolombaires par rapport aux traumatismes cervicaux (56%). Le profil type du patient concerné est un homme jeune, avec un âge moyen de 37 ans. Les causes principales des traumatismes sont les chutes (68% des cas), suivies par les accidents de la route (30%), les agressions représentant une part mineure (2%). Ces données soulignent la fréquence des traumatismes dorsolombaires chez les adultes jeunes et mettent en lumière les principaux facteurs de risque liés à l'environnement et aux accidents de la vie quotidienne. L’importance des chutes comme principale cause suggère une nécessité de prévention ciblée sur ce facteur de risque. La surreprésentation des hommes dans les cas étudiés nécessite une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs contributifs.
2. Caractéristiques Cliniques et Diagnostic Imagerie
La douleur au niveau de la région traumatisée était le symptôme clinique principal, rapporté par la majorité des patients. De manière significative, les troubles neurologiques étaient fréquents, touchant 58,8% des patients, soulignant la gravité potentielle de ces traumatismes. Des lésions associées ont été observées, les traumatismes des membres étant les plus fréquents (23,3%). Le diagnostic s'appuyait sur un bilan radiologique minimal comprenant une radiographie standard, complétée par une tomodensitométrie (TDM) et/ou une IRM selon les cas. La jonction thoracolombaire était le siège le plus fréquent des lésions (58%), avec une prédominance des fractures par compression, principalement localisées au niveau de la première vertèbre lombaire. L’utilisation limitée de l’IRM (9 cas seulement) suggère que la TDM joue un rôle dominant dans la visualisation des lésions osseuses, tandis que l’IRM complète le diagnostic dans des cas spécifiques afin de visualiser des anomalies des parties molles, comme les lésions discales, ligamentaires et médullaires.
II. Traitement des Traumatismes du Rachis Dorsolombaire
Le traitement variait selon la stabilité de la lésion et la présence de troubles neurologiques. Un traitement chirurgical, impliquant une ostéosynthèse pour la fixation des lésions instables, a été réalisé chez 147 patients (62,33%), dont 13 sans signes neurologiques (8,8%). Le traitement orthopédique a été utilisé chez 84 patients (24%). Les techniques chirurgicales incluaient le vissage pédiculaire, reconnu pour sa rigidité et sa stabilité, mais également des techniques d'ostéosynthèse antérieure. La gestion des complications post-opératoires est un aspect crucial du traitement.
1. Approches Thérapeutiques Chirurgicales vs Orthopédiques
Le choix du traitement des traumatismes du rachis dorsolombaire dépendait de la stabilité de la fracture et de la présence de signes neurologiques. Deux approches principales étaient utilisées : chirurgicale et orthopédique. Le traitement chirurgical, appliqué à 147 patients (62,33%), visait une fixation efficace des lésions instables. Parmi ces patients opérés, 13 (8,8%) ne présentaient aucun signe neurologique, soulignant que la chirurgie pouvait être envisagée même en l'absence de troubles neurologiques dans certains cas. Le traitement orthopédique a été appliqué à 84 patients (24%), constituant une alternative dans les cas moins sévères. Le document ne détaille pas les critères précis qui définissaient le choix entre l'approche chirurgicale et orthopédique, mais met l'accent sur la nécessité d'une évaluation individualisée pour chaque patient afin de choisir la méthode thérapeutique la plus appropriée, selon la stabilité de la lésion et le statut neurologique.
2. Techniques Chirurgicales utilisées
Le document mentionne plusieurs techniques chirurgicales utilisées pour la stabilisation du rachis, parmi lesquelles le vissage pédiculaire est mis en avant comme un système de fixation rigide et stable. Cependant, l'insertion des vis pédiculaires au niveau du rachis dorsal peut être difficile en raison de la direction variable et du petit diamètre des pédicules. Une étude morphométrique sur cadavres a révélé que 35% des pédicules du rachis dorsal avaient un diamètre inférieur à 5 mm, ce qui peut rendre l’utilisation des vis standard difficile. D'autres techniques chirurgicales sont évoquées, comme l'ostéosynthèse antérieure, permettant une décompression antérieure, associée à une arthrodèse. L’ostéosynthèse par matériel de Cotrel-Dubousset est également mentionnée pour la stabilisation des fractures communicatives du rachis lombaire et de la jonction thoracolombaire, permettant la mobilisation du patient sans corset post-opératoire. Le choix du matériel et de la technique chirurgicale dépendait de la localisation et du type de lésion, soulignant une approche personnalisée adaptée à chaque cas clinique.
3. Complications Post opératoires
Six cas de complications post-opératoires sont rapportés. Trois patients ont nécessité un débricolage de matériel avec réinsertion de vis pédiculaires. Un autre patient a présenté une issue de liquide céphalo-rachidien (LCR) au point d’insertion d’une vis, nécessitant une reposition sans évolution vers une méningite. Un cas de sciatalgie L5 liée à un malpositionnement d’une vis a été mentionné. Enfin, un patient a présenté une infection de plaie profonde. Toutes ces complications ont été jugulées par un traitement approprié. Bien que le nombre de complications soit limité dans cette série, cela met l'accent sur l'importance de la surveillance post-opératoire rigoureuse et la nécessité de gérer efficacement les complications potentielles afin de garantir la réussite du traitement et le rétablissement complet du patient.
III.Évolution et Complications des Lésions Médullaires
L'évolution des patients dépendait fortement de l'état neurologique initial. Les lésions médullaires complètes présentaient un pronostic plus sombre, tandis que les lésions incomplètes offraient un potentiel de récupération plus élevé. Des complications, telles que les escarres cutanées (7 malades dans la série), les infections urinaires et les troubles vésico-sphinctériens, étaient fréquentes. La rééducation et la prise en charge psychologique étaient essentielles pour l'adaptation et la réinsertion sociale des patients. La morbidité était marquée par les complications liées à la période initiale, à 13.1% des cas.
1. Impact de l État Neurologique Initial sur l Évolution
L'évolution des lésions médullaires post-traumatiques est fortement corrélée à l'état neurologique initial. L'état neurologique au moment de l'admission détermine en grande partie les possibilités de récupération à long terme. Une amélioration dans les 24 heures suivant le traumatisme peut indiquer un potentiel de récupération, même dans le cas de lésions médullaires complètes. Les lésions médullaires incomplètes ont un pronostic plus favorable, bien qu'aucun moyen clinique ou biologique ne permette d'évaluer précisément le degré de récupération possible. La phase initiale de paralysie flasque peut être suivie d'une phase d'autonomisation des centres médullaires sous-lésionnels, se manifestant par des réactions incontrôlées des membres. Cette observation souligne l'importance d'une évaluation neurologique précise et immédiate après le traumatisme pour établir un pronostic et orienter la prise en charge thérapeutique.
2. Complications Fréquentes et Leur Prise en Charge
Plusieurs complications peuvent survenir au cours de l'évolution des lésions médullaires. La perte de sensibilité cutanée est une cause majeure d'escarres, des lésions qui peuvent s'étendre rapidement. La prévention des escarres est essentielle et repose sur des mesures préventives telles que des changements de position fréquents, des massages et l'utilisation de matelas spécifiques. Dans cette étude, 7 patients ont développé des escarres. Les troubles vésico-sphinctériens sont également fréquents, entraînant des infections urinaires et des complications génitales. Une surveillance régulière de l'appareil urinaire est donc nécessaire, comprenant un examen morphologique (échographie, urographie intraveineuse) et un examen urodynamique. Les complications digestives et les septicémies sont également rapportées, soulignant la complexité de la prise en charge des patients atteints de lésions médullaires et la nécessité d'une approche multidisciplinaire.
3. Comparaison avec d autres Études et Implications
Une comparaison avec les données de Roy-Camille (complications urinaires prédominantes à 50%) et de Mouhib (complications cutanées de décubitus à 42,86%) met en évidence des différences dans la fréquence des complications, probablement liées à des différences dans les populations étudiées (présence de troubles neurologiques dans la série de Roy-Camille). L’étude souligne le besoin d'améliorer les conditions de nursing et de créer un centre spécialisé pour paraplégiques. Le fait que tous les patients opérés dans la série de Roy-Camille l’aient été au-delà de 72 heures met l’accent sur la morbidité plus importante associée à un traitement chirurgical retardé. L'incontinence et la dysurie sont des aspects fonctionnels importants, sources d'infections et de complications à long terme. L'accent est mis sur la prévention des escarres et sur l'importance d'une réadaptation précoce pour favoriser une meilleure insertion sociale et professionnelle des patients.
IV.Médulloprotection et Traitements Futurs des Lésions Médullaires
La recherche sur la médulloprotection, notamment avec la méthylprednisolone et les gangliosides, a été abordée. Cependant, les résultats restent mitigés. Des perspectives thérapeutiques futures sont évoquées, axées sur des techniques de pontage, de transplantation cellulaire, et l’utilisation de facteurs de croissance pour stimuler la régénération nerveuse. L'amélioration des techniques d'imagerie médicale et le développement de centres spécialisés pour paraplégiques sont nécessaires pour une meilleure prise en charge de ces patients.
1. Médulloprotection et Protocoles Utilisés
Le document aborde la médulloprotection comme une stratégie thérapeutique importante dans la prise en charge des traumatismes médullaires. L’étude mentionne l'utilisation du protocole NASCIS II pour tous les patients admis dans les 12 heures suivant le traumatisme. L'efficacité de la méthylprednisolone et des gangliosides dans la médulloprotection est discutée. Une étude citée incluant 760 patients a comparé l'efficacité du ganglioside GM-1 (à deux dosages différents) avec un placebo, tous les patients recevant également de la méthylprednisolone selon le protocole NASCIS II. Bien qu'une évolution favorable ait été observée plus rapidement dans les groupes traités au GM-1, aucune différence significative n'a été constatée à la fin de l'étude (un an) en termes de classification de Benzel et de score ASIA. Ces résultats mettent en évidence le besoin de recherches plus approfondies pour mieux évaluer l'efficacité de ces traitements et optimiser les protocoles de médulloprotection.
2. Perspectives Thérapeutiques Futures
Face aux limites des traitements actuels, le document explore les pistes de recherche pour améliorer la prise en charge des traumatismes médullaires. Plusieurs approches innovantes sont mentionnées, notamment les pontages nerveux utilisant des fragments de nerfs périphériques ou des tubes de silicone/collagène. Des études sur les animaux (rats et primates) montrent des résultats prometteurs pour les pontages moelle-muscle, moelle-moelle et bulbe-moelle. Les transplantations substitutives, consistant à implanter des neurones mono-aminergiques dans la zone sous-lésionnelle pour restaurer des activités réflexes, sont également évoquées. Cependant, l'application chez l'homme se heurte à des limitations, notamment la disponibilité de cellules fœtales humaines. L'utilisation de cellules eucaryotes génétiquement modifiées pour produire des facteurs trophiques est une autre voie explorée, mais pose des défis liés au risque de rejet et au développement tumoral. Ces avancées scientifiques ouvrent des perspectives encourageantes, mais soulignent la nécessité de recherches complémentaires pour développer des traitements efficaces et sécuritaires pour la régénération nerveuse.
