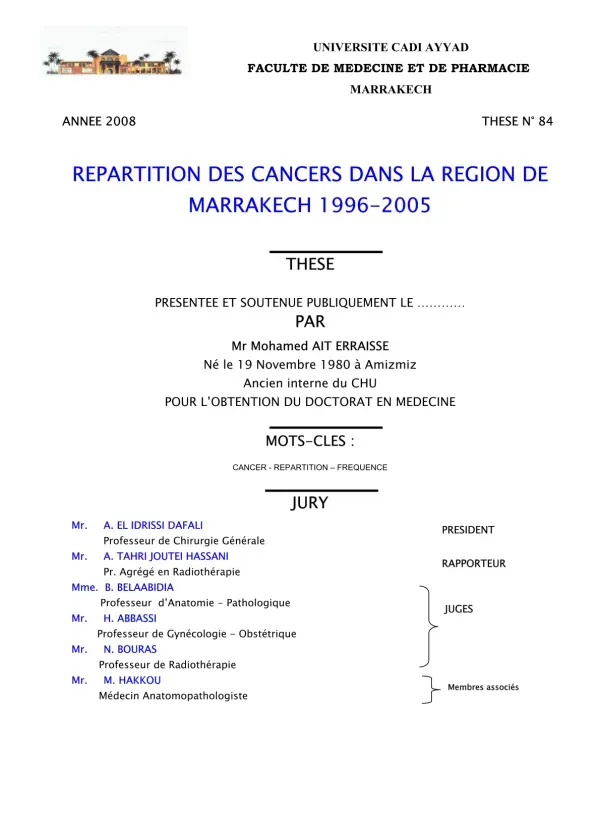
Répartition des cancers dans la région de Marrakech (1996-2005)
Informations sur le document
| Auteur | Mohamed Ait Erraisse |
| École | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech |
| Spécialité | Médecine |
| Lieu | Marrakech |
| Type de document | Thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 916.17 KB |
- cancer
- répartition
- médecine
Résumé
I.Épidémiologie du Cancer dans la Région de Marrakech Tensift Al Haouz
Cette étude rétrospective analyse l'épidémiologie du cancer dans la région de Marrakech Tensift Al Haouz au Maroc, entre janvier 1996 et décembre 2005. Basée sur l'analyse de 11 002 cas de cancer recensés dans les registres anatomopathologiques, l'étude identifie les types de cancer les plus fréquents et explore des facteurs comme l'âge et le sexe. Les principaux cancers étudiés incluent le cancer de l'estomac, le cancer colorectal, le cancer du sein, le cancer du col utérin, le cancer de la prostate, et le cancer de la vessie. L'étude compare également les résultats avec les données d'autres régions du Maroc et d'autres pays, soulignant les différences dans l'incidence et la prévalence de certains types de cancer.
1. Introduction à l Épidémiologie du Cancer
L'étude commence par définir l'épidémiologie comme l'étude des facteurs intervenant dans l'apparition et l'évolution des maladies. En cancérologie, elle est essentielle pour la recherche (clinique et fondamentale), la mise en place de mesures de dépistage et de prévention, et la planification sanitaire. Deux approches sont distinguées : l'épidémiologie descriptive (étude de la fréquence du cancer et ses variations dans différentes populations) et l'épidémiologie analytique (établissement d'une relation de cause à effet entre un facteur de risque et la survenue d'un cancer). L'instauration de registres des cancers améliore significativement la connaissance de l'épidémiologie de ces affections, permettant d'identifier les facteurs de risque et étiologiques, ouvrant ainsi la voie à des mesures prophylactiques et thérapeutiques plus efficaces dans la lutte contre le cancer. L'objectif global est de mieux comprendre l'incidence et la prévalence des cancers, afin d'améliorer les stratégies de prévention et de traitement.
2. Méthodologie de l Étude Recueil et Traitement des Données
L'étude a recensé tous les cas de cancers confirmés histologiquement dans les registres des laboratoires d'anatomopathologie de la région de Marrakech Tensift Al Haouz, couvrant une période déterminée. Le laboratoire privé DAFALI (2004-2005) a contribué à la collecte des données. Le recueil complet des données a nécessité 26 mois. Les critères d'inclusion étaient simples : tous les diagnostics de cancers confirmés histologiquement, quelle que soit leur localisation, ont été retenus. La collecte manuelle des données sous forme de tableaux a été suivie de la saisie et du traitement informatisé avec le logiciel SPSS version 11.5. L'étude mentionne des difficultés rencontrées, notamment l'absence de données d'âge pour un nombre significatif de cas (2277 cas), ce qui limite l'analyse complète de ce paramètre pour tous les types de cancers étudiés.
3. Analyse des Résultats Fréquence et Localisation des Cancers
Sur un total de 11 002 cas de cancers, l'étude présente une analyse détaillée de la fréquence des cancers selon leur localisation. Les cancers digestifs sont les plus fréquents (24,5%), suivis des cancers gynéco-mammaires (23,3%), urologiques (12,6%), ORL (11,3%), de la peau (10,9%), pleuro-pulmonaires (5,38%) et hématologiques (3,74%). Une analyse plus fine est effectuée selon le sexe. Chez les femmes, le cancer du sein arrive en tête (20,4%), suivi du cancer du col utérin (19,3%). Chez les hommes, c'est le cancer de l'estomac qui domine (15,5%), suivi des cancers de la peau (14,3%) et de la prostate (12,4%). L'étude fournit des pourcentages précis pour chaque type de cancer, soulignant les variations de fréquence entre les sexes et les localisations. Le tableau 3, bien que partiel dans l'extrait fourni, donne un aperçu des localisations cancéreuses recensées.
4. Analyse des Résultats Âge et Sexe Ratio
L'analyse de l'âge met en lumière l'âge moyen des patients atteints d'un cancer, qui est de 55 ans. Cependant, l'âge moyen varie selon le type de cancer. L'étude souligne l'âge moyen pour certains cancers spécifiques (ex: cancer gastrique, cancer du col utérin) ainsi que les tranches d'âge les plus touchées. L'analyse du sexe ratio (H/F) est également fournie pour différents cancers, révélant une prédominance masculine pour certains (ex: cancer gastrique) et féminine pour d'autres (ex: cancer du sein). Ces données sur l'âge et le sexe sont comparées à celles d'autres études menées au Maroc (études du Pr. Gherbaoui et le registre des cancers du grand Casablanca) et à l'échelle internationale (Algérie, Tunisie, France, États-Unis, Japon). Ceci permet de mettre en perspective les résultats de l'étude et d'identifier des tendances ou des particularités spécifiques à la région de Marrakech Tensift Al Haouz.
5. Comparaison Internationale et Conclusion
L’étude compare ses résultats à ceux d’autres études menées au Maroc (notamment à Casablanca), en Algérie, en Tunisie, en France, aux États-Unis et au Japon. Ces comparaisons portent sur la fréquence et l’incidence de différents cancers, notamment le cancer de l’estomac, le cancer colorectal et le cancer du sein. L’étude note des différences significatives entre les pays concernant le classement des cancers les plus fréquents, soulignant ainsi les variations de facteurs de risque et les disparités dans les habitudes de vie. L'occidentalisation des habitudes alimentaires est avancée comme explication possible pour l'évolution de certains cancers. L'augmentation du nombre de cas de cancer ces dernières années est également discutée, en rapportant à la croissance démographique, l'augmentation de l'espérance de vie et l'amélioration des infrastructures médicales (CHU Mohamed VI). En conclusion, l'étude insiste sur la nécessité d'une surveillance épidémiologique continue pour une meilleure compréhension et une gestion efficace du cancer dans la région.
II.Données et Méthodologie
Les données proviennent des registres des laboratoires d’anatomopathologie de la région, notamment le laboratoire DAFALI (2004-2005). Le recueil des données a duré 26 mois. L'étude a inclus tous les diagnostics de cancer confirmés histologiquement, quelle que soit la localisation. Les données ont été traitées à l'aide du logiciel SPSS version 11.5. Des difficultés ont été rencontrées concernant la collecte complète des données d'âge pour tous les patients.
1. Sources des Données
Cette étude a utilisé les registres des laboratoires d'anatomopathologie de la région de Marrakech Tensift Al Haouz comme source principale de données. L'objectif était de recenser tous les cas de cancers confirmés histologiquement. La période couverte par l'étude n'est pas précisément définie dans cet extrait, mais il est mentionné que le laboratoire privé DAFALI a contribué à la collecte des données pour la période 2004-2005. Le recueil de l'ensemble des données a duré 26 mois. Il est important de noter que les données ont été recueillies manuellement, puis saisies et traitées à l'aide du logiciel SPSS version 11.5. La dépendance à des registres anatomopathologiques implique une potentialité de biais liés à la qualité et à la complétude de ces registres, ainsi qu'à leur représentativité de la population de la région. L'utilisation de données provenant d'un seul laboratoire privé pour une partie de la période étudiée pourrait également introduire des biais.
2. Critères d Inclusion et Limitations
L'étude a inclus tous les diagnostics de cancers confirmés histologiquement, sans restriction de localisation. Ce critère d'inclusion large vise à inclure tous les cas possibles dans la région étudiée. Cependant, une limitation majeure est mentionnée : l’âge n’a pas été retrouvé pour 2277 cas de cancers recrutés. Ceci constitue une lacune significative car l'âge est un facteur crucial dans l'analyse épidémiologique du cancer. L'analyse des données d'âge est donc limitée et peut biaiser les résultats pour certaines conclusions sur les différents types de cancers et leurs évolutions. La méthode de collecte manuelle des données, bien qu'elle permette une vérification, est potentiellement plus sujette à des erreurs ou à des omissions que des méthodes informatisées plus complètes. La dépendance au logiciel SPSS version 11.5 pour le traitement des données est également un point à considérer dans le cadre de la reproductibilité de l'étude.
III.Résultats Principaux Fréquence des Cancers
Parmi les 11 002 cas, les cancers digestifs occupaient la première place (24,5%), suivis des cancers gynéco-mammaires (23,3%), des cancers urologiques (12,6%), des cancers ORL (11,3%), des cancers de la peau (10,9%), des cancers pleuro-pulmonaires (5,38%) et des cancers hématologiques (3,73%). Chez les femmes, le cancer du sein était le plus fréquent (20,4%), suivi du cancer du col utérin (19,3%). Chez les hommes, le cancer de l'estomac était dominant (15,5%), suivi du cancer de la peau (14,3%) et du cancer de la prostate (12,4%).
1. Fréquence Globale des Cancers
L'étude, basée sur 11 002 cas de cancers recensés entre 1996 et 2005 dans la région de Marrakech Tensift Al Haouz, révèle une prédominance des cancers digestifs, qui représentent 24,5% de l'ensemble des cas. Ils sont suivis par les cancers gynéco-mammaires (23,3%), les cancers urologiques (12,6%), les cancers ORL (11,3%), les cancers de la peau (10,9%), les cancers pleuro-pulmonaires (5,38%) et les cancers hématologiques (3,74%). Les autres localisations cancéreuses sont moins fréquentes. Cette répartition globale met en évidence l'importance des cancers digestifs dans la région étudiée, soulignant la nécessité de cibler des programmes de prévention et de dépistage spécifiques à ces types de cancers. L'analyse met aussi en lumière la part importante des cancers gynéco-mammaires, confirmant leur place significative dans la morbidité féminine de cette région. La proportion relativement élevée de cancers de la peau souligne peut-être l'exposition solaire significative dans cette région, qui est un facteur de risque avéré pour ce type de cancer.
2. Fréquence des Cancers selon le Sexe
L'analyse est affinée par le sexe, révélant des différences notables dans la fréquence des cancers entre les hommes et les femmes. Chez les femmes, le cancer du sein domine avec 20,4% de tous les cancers, suivi du cancer du col utérin (19,3%), du cancer de la peau (7,11%), du cancer de l'estomac (6,9%) et du cancer colorectal (6%). Cette prédominance du cancer du sein chez les femmes, par rapport au cancer du col utérin (qui était le plus fréquent chez les femmes marocaines dans les études plus anciennes), suggère une évolution des facteurs de risque et une possible occidentalisation des modes de vie dans la région. Chez les hommes, le cancer de l'estomac se positionne en première place (15,5%), suivi du cancer de la peau (14,3%), du cancer de la prostate (12,4%), du cancer de la vessie (7,85%) et du cancer colorectal (6,75%). Cette répartition des cancers selon le sexe permet de mieux cibler les stratégies de prévention et de dépistage en fonction des populations concernées, en tenant compte des spécificités des facteurs de risque liés au sexe.
IV.Résultats Principaux Âge et Sexe
L'étude a révélé des différences significatives dans l'âge moyen de survenue des différents types de cancer. L'âge moyen global des patients était de 55 ans. Des informations détaillées sur l'âge et le sexe sont présentées pour chaque type de cancer, mettant en évidence la prédominance masculine pour certains cancers et féminine pour d'autres. Ces résultats sont comparés aux données internationales et aux études précédentes au Maroc, notamment celles du Pr. Gherbaoui et du registre des cancers du grand Casablanca (RCGC).
1. Âge Moyen et Extrêmes
L'étude rapporte un âge moyen de 55 ans pour l'ensemble des patients, avec des âges extrêmes variant de 1 à 120 ans. Il est cependant crucial de noter que cet âge moyen est calculé sur un sous-ensemble de la population étudiée, car l'âge n'a pas pu être retrouvé pour 2277 cas. Cette absence de données d'âge pour une part importante des cas (plus de 20%) constitue une limitation importante de l'étude, susceptible d'influencer la fiabilité des analyses statistiques sur l'âge et son impact sur l'incidence des différents types de cancer. L'analyse de l'âge est par conséquent incomplète et doit être interprétée avec précaution. La présence d'âges extrêmes aussi marqués (1 et 120 ans) suggère une possible hétérogénéité de la population étudiée, qui pourrait être due à des biais dans la constitution de l'échantillon ou à une variabilité importante de l'accès aux soins médicaux dans la région.
2. Âge et Sexe Ratio selon les Types de Cancer
L'étude fournit des informations plus détaillées sur l'âge et le sexe ratio pour certains types de cancer. Par exemple, pour le cancer gastrique, l'âge moyen est de 58 ans (avec des extrêmes de 15 à 91 ans), la tranche d'âge la plus touchée étant comprise entre 50 et 79 ans (72,5%). Pour les cancers gynéco-mammaires, l’âge moyen est de 49 ans (extrêmes de 8 à 88 ans), la tranche la plus touchée étant située entre 40 et 79 ans. Un sexe ratio homme/femme (H/F) est également mentionné pour certains cancers, permettant de mieux caractériser la prédisposition de ces cancers selon le sexe. Par exemple, pour le cancer gastrique, 72% des cas concernent les hommes (sexe ratio H/F de 2,53), ce qui est cohérent avec les données internationales. L'analyse de l'âge et du sexe ratio pour chaque type de cancer est présentée de manière partielle dans cet extrait, mais elle souligne l'importance d'une analyse plus approfondie afin de mieux comprendre les facteurs de risque spécifiques liés à l'âge et au sexe pour chacun d’entre eux.
3. Comparaison avec d Autres Études
Les résultats sur l'âge et le sexe ratio sont mis en perspective par comparaison avec les données d'études menées au Maroc, notamment celles du Pr. Gherbaoui, et dans d'autres pays (Algérie, Tunisie, France, États-Unis, Japon). Ces comparaisons permettent d'identifier les différences et les similitudes en termes d'âge moyen de survenue et de prédominance selon le sexe pour chaque type de cancer. Par exemple, l'étude note que l'âge moyen de survenue du cancer gastrique est de 65 ans dans les pays à taux d'incidence modérément élevés, mais environ 10 ans plus tôt dans les pays à forte incidence. Dans l'étude de Marrakech, l'âge moyen est de 58 ans, ce qui se situe entre ces deux extrêmes. Cette comparaison souligne l'influence des facteurs socio-économiques, du niveau de dépistage et de l'accès aux soins sur les données épidémiologiques. Des informations sur l'âge moyen de survenue d'autres types de cancer sont également mentionnées, mais de façon partielle dans cet extrait.
V.Comparaison avec d Autres Études et Conclusion
Les résultats de cette étude sont comparés aux données d'incidence et de prévalence du cancer au Maroc (notamment à Casablanca), en Algérie, en Tunisie, en France, aux États-Unis et au Japon. L'étude souligne l'impact de facteurs socio-économiques, comme l'occidentalisation des habitudes alimentaires, sur l'évolution des taux de cancer. L'augmentation du nombre de cas de cancer ces dernières années est attribuée à la croissance démographique, l'augmentation de l'espérance de vie et l'amélioration du niveau de médicalisation de la région avec l'implantation du CHU Mohamed VI. L'étude conclut en soulignant l'importance de la surveillance épidémiologique du cancer au Maroc pour mettre en place des stratégies de prévention et de traitement efficaces.
1. Comparaison avec les données Marocaines et Internationales
L'étude compare ses résultats avec ceux d'autres études menées au Maroc et à l'international. Concernant le cancer gastrique, l'étude du Pr. Gherbaoui le place en 4ème position au Maroc (3% de tous les cancers, 33% des cancers du tube digestif). En 2004, le registre des cancers du grand Casablanca (RCGC) le situait en première position chez les hommes et en deuxième chez les femmes pour les cancers digestifs. Des données comparatives sont aussi fournies pour l’Algérie, la Tunisie, la France, le Japon et les États-Unis, soulignant les variations considérables de fréquence et de classement selon les contextes géographiques et socio-économiques. Pour le cancer colorectal, des comparaisons sont faites avec des données du registre des cancers du grand Casablanca (RCRC) et d'autres pays, révélant des différences d'incidence et de classement. De même, pour le cancer du sein et le cancer du col utérin, des comparaisons sont établies avec les données du Pr. Gherbaoui, du RCGC et de l'international, mettant en évidence l'évolution des tendances dans le temps et entre les pays. Cette comparaison internationale permet de contextualiser les résultats de l'étude de Marrakech et de mettre en lumière des influences potentielles de facteurs socioculturels et environnementaux sur les profils de cancers observés.
2. Facteurs Explicatifs de l Évolution des Taux de Cancer et Conclusion
L'augmentation du nombre de cancers diagnostiqués ces dernières années dans la région de Marrakech Tensift Al Haouz est attribuée à plusieurs facteurs : la croissance démographique, l’augmentation de l’espérance de vie et le changement du mode de vie de la population marocaine. L’implantation du CHU Mohamed VI a également amélioré le niveau de médicalisation de la région, contribuant potentiellement à une meilleure détection des cancers. L'occidentalisation des habitudes alimentaires, notamment une alimentation riche en graisses animales et pauvre en fibres végétales, est avancée comme explication plausible à l'augmentation de certains cancers, comme le cancer colorectal. L'étude conclut en soulignant l'intérêt de l'épidémiologie du cancer comme discipline essentielle pour comprendre cette maladie et adapter les stratégies de prévention et de prise en charge. L'étude, malgré les difficultés rencontrées, espère avoir contribué à établir une cartographie du cancer dans la région de Marrakech Tensift Al Haouz, fournissant une base pour de futures études plus approfondies et des initiatives de santé publique plus ciblées.
