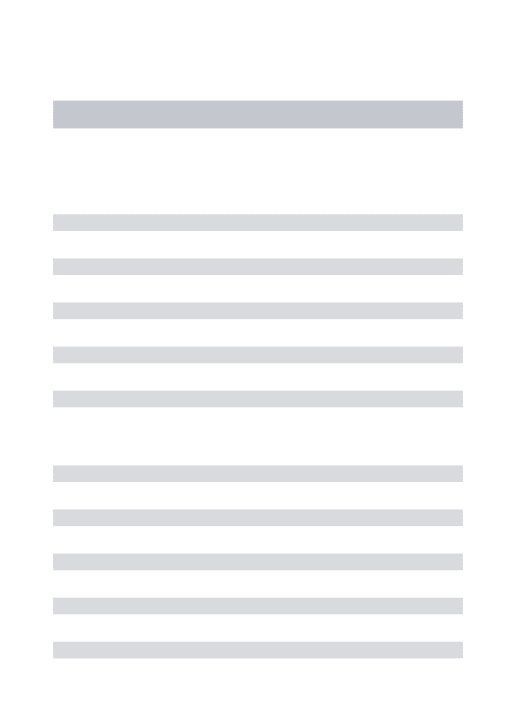
Stigmatisation et Adhérence aux ARV
Informations sur le document
| Auteur | André Ngamlnl Ngul |
| instructor/editor | Lise Goulet |
| École | Université de Montréal |
| Spécialité | Santé Communautaire |
| Type de document | Mémoire de Maîtrise ès sciences (M.Sc.) |
| Lieu | Montréal |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 3.73 MB |
Résumé
I.Impact de la stigmatisation sur l adhérence au traitement ARV du VIH SIDA au Mali et au Burkina Faso
Cette étude explore la relation entre la stigmatisation liée au VIH/SIDA et l'adhérence au traitement antirétroviral (ART) chez 649 patients (322 à Bamako, Mali, et 327 à Ouagadougou, Burkina Faso). Les résultats révèlent que les personnes vivant à Bamako rapportent une stigmatisation plus importante qu'à Ouagadougou. Dans les deux villes, les jeunes, les personnes défavorisées et celles manquant de soutien social sont les plus touchées. L'étude observe une association significative entre une faible stigmatisation et une meilleure adhérence au traitement ARV à Ouagadougou (OR=3,06; IC95%=1,73-5,41), mais pas à Bamako. Des facteurs comme la relation médecin-patient et l'implication dans les associations communautaires influencent la perception de la stigmatisation, mais leur impact sur l'adhérence varie selon la ville.
1. Prévalence de la stigmatisation et adhérence au traitement ARV
L'étude révèle une prévalence plus élevée de la stigmatisation liée au VIH/SIDA à Bamako (Mali) qu'à Ouagadougou (Burkina Faso). Dans les deux villes, les jeunes, les individus défavorisés sur le plan matériel, ceux dépourvus de soutien social pour discuter de leur séropositivité, et ceux ayant une mauvaise perception de leur santé sont les plus stigmatisés. À Bamako, la stigmatisation est particulièrement rapportée par les membres d'associations communautaires et les patients entretenant de bonnes relations avec leur médecin. Globalement, 70% des patients adhèrent au traitement ARV (75% à Bamako et 57,1% à Ouagadougou, p<0,01). L'analyse met en évidence une corrélation significative : les patients peu stigmatisés présentent un taux d'adhérence supérieur (74,34%) comparé à ceux fortement stigmatisés (60,84%, p<0,05). Cependant, après ajustement pour les variables de confusion, cette association reste forte et significative seulement à Ouagadougou (OR=3,06; IC95%=1,73-5,41), pas à Bamako (OR=1,36; IC95%=0,68-2,73).
2. Méthodologie de l étude
L'étude a porté sur 649 patients sous traitement ARV (322 à Bamako et 327 à Ouagadougou). L'adhérence thérapeutique a été évaluée sur la base du nombre de comprimés pris durant les sept jours précédant l'enquête. Un patient était considéré comme adhérent s'il avait pris tous ses médicaments régulièrement et sans interruption. Une échelle de mesure de la stigmatisation, composée de 7 items, a été élaborée à partir d'une analyse factorielle exploratoire de 13 items initiaux. Le coefficient de fidélité de l'échelle a été calculé. Les variables associées à la stigmatisation ont été identifiées via une régression logistique pour évaluer l'association entre la stigmatisation et l'adhérence au traitement ARV.
3. Profils des personnes stigmatisées et leurs caractéristiques
Les analyses multivariées révèlent des profils distincts de personnes stigmatisées à Bamako et Ouagadougou. À Bamako, les jeunes, les personnes pauvres, celles sans soutien social, celles ayant une mauvaise perception de leur santé et, de manière surprenante, celles ayant une bonne relation avec leur médecin, sont davantage stigmatisées. L'implication dans les associations communautaires est également un facteur de stigmatisation à Bamako. À Ouagadougou, l'âge, le confort du logement et la perception de la santé émergent comme facteurs principaux. La relation entre le soutien social, la stigmatisation et le dévoilement du statut séropositif est complexe et mérite une analyse plus approfondie. Des études antérieures sont citées pour contextualiser les résultats, soulignant la complexité de l'impact du soutien social et des interactions avec les professionnels de santé sur l'expérience de la stigmatisation.
II.Méthodologie de l étude sur l adhérence au traitement ARV et la stigmatisation du VIH
L'adhérence au traitement ARV a été mesurée par le nombre de comprimés pris au cours des sept derniers jours. Une échelle de mesure de la stigmatisation, basée sur 7 items, a été construite à partir d'une analyse factorielle exploratoire. Une régression logistique a ensuite été utilisée pour évaluer l'association entre la stigmatisation et l'adhérence, en tenant compte de variables de confusion telles que l'âge, le statut socio-économique et le soutien social.
1. Mesure de l adhérence au traitement ARV
L'étude a évalué l'adhérence au traitement antirétroviral (ARV) en interrogeant 649 patients (322 à Bamako et 327 à Ouagadougou) sur leur consommation médicamenteuse des sept derniers jours. L'adhérence était définie comme la prise régulière et sans interruption de tous les comprimés prescrits. Cette méthode directe, basée sur le rappel des patients, offre une mesure concrète de l'observance du traitement, permettant une quantification précise du respect du protocole thérapeutique. Cependant, il est important de noter que cette méthode repose sur l'auto-déclaration des patients et est donc sujette à des biais potentiels, notamment les biais de mémoire et de désirabilité sociale, qui pourraient influencer la précision des résultats. Des erreurs de classification pourraient ainsi se produire, soit par surestimation (patients souhaitant plaire aux enquêteurs), soit par sous-estimation (patients cherchant à obtenir de l'aide en minimisant leur adhérence).
2. Construction de l échelle de mesure de la stigmatisation
Pour mesurer la stigmatisation liée au VIH, une échelle a été élaborée à partir d'une analyse factorielle exploratoire. Initialement, 13 items ont été considérés, mais après analyse, l’échelle finale a regroupé 7 items issus d'une analyse factorielle exploratoire, effectuée à partir d'une liste initiale de 13 items. Le coefficient de fidélité (alpha de Cronbach) a été calculé pour chaque ville afin d'évaluer la cohérence interne de l'échelle. Une analyse factorielle exploratoire a été menée pour identifier les dimensions sous-jacentes à la stigmatisation. La sélection des items et la validation de l’échelle ont fait l’objet d’une validation faciale par un groupe de discussion composé de membres de l'équipe de recherche et de professionnels de santé spécialisés dans le domaine du SIDA. Cette méthode permet de vérifier la pertinence et la compréhension des items de l'échelle auprès des personnes concernées, assurant une meilleure adéquation du questionnaire au contexte étudié. Des indicateurs de LISREL (RMSEA, NFI, CN) ont ensuite été utilisés pour vérifier l’ajustement du modèle de mesure de la stigmatisation, confirmant la fiabilité de l’outil développé.
3. Analyse statistique de l association entre la stigmatisation et l adhérence
L'analyse des données a utilisé une régression logistique afin de déterminer l'association entre la stigmatisation et l'adhérence au traitement ARV. L'utilisation d'une régression logistique, plutôt qu'une simple analyse bivariée, permet de contrôler les effets confondants d'autres variables (âge, statut socio-économique, soutien social, etc.), offrant ainsi une estimation plus précise de la relation entre la stigmatisation et l'adhérence. Des analyses séparées pour chaque ville (Bamako et Ouagadougou) ont été réalisées, reconnaissant la spécificité des contextes épidémiologiques et organisationnels. L'objectif était d'identifier une association statistiquement significative entre la stigmatisation et l'adhérence au traitement ARV, indépendamment des variables de confusion, et d'évaluer la force de cette association à l'aide du ratio de cotes (OR). Cette analyse permet de quantifier l'impact de la stigmatisation sur l'adhérence, indépendamment d'autres facteurs, et de comprendre sa pertinence dans chaque contexte géographique.
III.Facteurs associés à la stigmatisation du VIH au Mali et au Burkina Faso
L'analyse des facteurs associés à la stigmatisation montre des variations entre Bamako et Ouagadougou. À Bamako, la jeunesse, la pauvreté, le manque de soutien social, une mauvaise perception de la santé et paradoxalement, une bonne relation médecin-patient sont associés à une plus forte stigmatisation. À Ouagadougou, l'âge, le niveau de confort du logement et la perception de la santé sont les principaux facteurs. Le dévoilement du statut séropositif influence fortement la perception du soutien social et de la stigmatisation.
1. Facteurs de stigmatisation à Bamako et Ouagadougou
L'étude révèle des différences significatives dans les facteurs associés à la stigmatisation du VIH entre Bamako et Ouagadougou. Dans les deux villes, la jeunesse, la pauvreté, le manque de soutien social (absence de personne avec qui parler de sa séropositivité), et une mauvaise perception de sa propre santé sont des facteurs contribuant à une expérience plus intense de la stigmatisation. Cependant, des nuances apparaissent. À Bamako, l'implication dans des associations communautaires et une bonne relation avec le médecin sont paradoxalement associés à une plus forte stigmatisation. Cette observation suggère que le simple fait d'être impliqué dans des soins médicaux ou des groupes de soutien peut exacerber le sentiment de stigmatisation dans un contexte social où la maladie est encore fortement stigmatisée. L'étude souligne la nécessité de considérer le contexte local pour comprendre la complexité des facteurs contribuant à la stigmatisation.
2. Analyse multivariée des facteurs de stigmatisation à Bamako
L'analyse multivariée des données de Bamako confirme l'importance de plusieurs facteurs dans la stigmatisation. Les jeunes, les personnes en situation de pauvreté matérielle, celles dépourvues de soutien social pour aborder leur séropositivité, ainsi que les individus ayant une mauvaise perception de leur santé, sont plus susceptibles de rapporter une forte stigmatisation. Il est notable que même une bonne relation avec le médecin est corrélée à une plus forte stigmatisation à Bamako. Ceci pourrait indiquer que les personnes stigmatisées par leur entourage cherchent un soutien auprès de leur médecin, renforçant ainsi le lien entre une relation positive avec le professionnel de santé et une plus grande perception de la stigmatisation. L'étude souligne la nécessité de prendre en compte ces interactions complexes pour mieux appréhender le phénomène de la stigmatisation et son impact sur la santé mentale des personnes vivant avec le VIH.
3. Comparaison des facteurs de stigmatisation entre Bamako et Ouagadougou
Bien que les jeunes, les personnes défavorisées et celles manquant de soutien social soient stigmatisées dans les deux villes, l'analyse multivariée révèle des différences dans les facteurs prédominants. À Ouagadougou, l'âge, la qualité du logement et la perception de la santé sont les variables les plus fortement associées à la stigmatisation. À Bamako, le tableau est plus complexe, avec l'ajout de l'importance du soutien social et de la relation médecin-patient comme facteurs influents. Cette divergence souligne l'impact du contexte socioculturel sur l'expérience de la stigmatisation. La différence entre les résultats à Bamako et Ouagadougou souligne la nécessité d'approches contextuelles et spécifiques pour lutter efficacement contre la stigmatisation liée au VIH/SIDA. Des interventions adaptées aux réalités de chaque contexte sont essentielles pour réduire l'impact négatif de la stigmatisation sur l'adhérence au traitement et la qualité de vie des personnes infectées.
IV.Association entre la stigmatisation et l adhérence au traitement ARV Résultats et limites de l étude
L'analyse bivariée révèle un manque d'association entre les variables sociodémographiques et l'adhérence à Bamako, contrairement à Ouagadougou. L'étude souligne des limites, notamment la qualité métrologique de l'instrument de mesure de la stigmatisation et la possibilité de biais de mémoire ou de désirabilité sociale dans l'auto-déclaration de l'adhérence. Des études futures sont nécessaires pour affiner l'instrument de mesure et explorer l'influence du contexte socioculturel sur la stigmatisation et l'adhérence au traitement ARV du VIH/SIDA en Afrique de l'Ouest.
1. Association Stigmatisation Adhérence Résultats par ville
L'analyse de l'association entre la stigmatisation et l'adhérence au traitement ARV révèle des résultats contrastés entre Bamako et Ouagadougou. À Ouagadougou, une association significative apparaît, même après ajustement pour les variables de confusion : les patients faiblement stigmatisés présentent une meilleure adhérence (OR=3,06 ; IC95%=1,73-5,41). En revanche, à Bamako, aucune association significative n'est observée entre ces deux variables (OR=1,36 ; IC95%=0,68-2,73). Cette différence souligne l'influence du contexte socioculturel sur la relation entre la stigmatisation et l'observance du traitement. Des facteurs autres que la stigmatisation pourraient jouer un rôle prépondérant dans l'adhérence thérapeutique à Bamako, appelant à des investigations plus approfondies pour identifier ces facteurs spécifiques.
2. Limites de l étude et biais potentiels
L'étude présente des limites méthodologiques qui pourraient influencer l'interprétation des résultats. L'utilisation d'un instrument de mesure de la stigmatisation basé sur des données secondaires soulève des questions quant à sa validité et à sa fiabilité pour prédire l'adhérence. De plus, le recours à l'auto-déclaration de l'adhérence par les patients est sujet à des biais de mémoire et de désirabilité sociale. Les patients pourraient surévaluer leur adhérence pour plaire aux enquêteurs ou sous-estimer leur non-adhérence pour obtenir de l'aide ou éviter le blâme. Ces biais potentiels mettent en perspective les résultats et soulignent la nécessité de mener des études ultérieures avec des méthodologies plus robustes, notamment pour valider l'outil de mesure de la stigmatisation et améliorer la mesure de l'adhérence.
3. Généralisation des résultats et perspectives
Les résultats de cette étude, bien que significatifs, doivent être interprétés avec prudence concernant leur généralisation à d'autres villes d'Afrique de l'Ouest. Les contextes socioculturels, les systèmes de santé et les perceptions de la maladie varient considérablement d'une région à l'autre. Pour améliorer l'instrument de mesure de la stigmatisation, des études de validité concomitante sont suggérées. Des études utilisant des méthodes multi-niveaux permettraient également de mieux appréhender l'influence du contexte sur la stigmatisation et l'adhérence. L’étude met en évidence le besoin d'approches plus nuancées tenant compte des contextes spécifiques pour comprendre la complexité de l'impact de la stigmatisation sur l'adhérence thérapeutique au VIH/SIDA. Des recherches futures doivent se concentrer sur la validation des outils de mesure et sur l’inclusion de méthodes plus robustes pour l’évaluation de l’adhérence.
