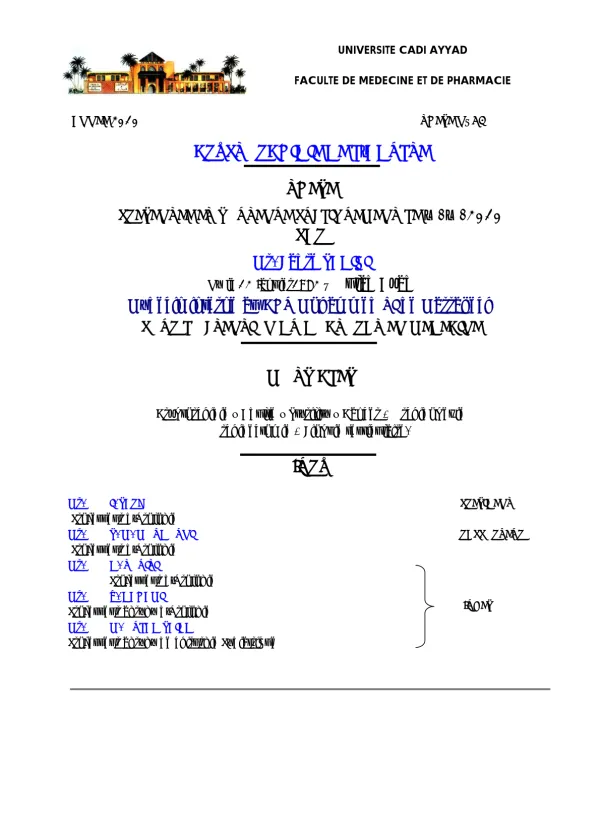
Thèse sur la Cryptorchidie de l'Adulte
Informations sur le document
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 3.32 MB |
- Cryptorchidie
- Urologie
- Médecine
Résumé
I.Développement Testiculaire et Cryptorchidie
Cette étude rétrospective, menée sur 76 cas de cryptorchidie chez des adultes de plus de 15 ans au CHU MED VI de Marrakech, explore le développement testiculaire. Elle détaille la migration testiculaire, le rôle de la testostérone et de l'hormone antimüllérienne dans la descente testiculaire, ainsi que les conséquences de la cryptorchidie non traitée. L'analyse se concentre sur les anomalies anatomiques, notamment le rôle du gubernaculum testis et des canaux de Wolff et de Müller. Des études épidémiologiques, notamment la fréquence de la cryptorchidie chez les adultes marocains de la région de Marrakech-Tensift-Elhaouz, sont intégrées.
1. Développement Embryonnaire du Testicule
Le document décrit le développement du testicule in utero, commençant par la migration des cellules germinales du sac vitellin vers la crête génitale à la 8ème semaine de gestation. Cette migration induit le développement testiculaire. L'épithélium cœlomique prolifère activement, formant des cordons sexuels primitifs qui entourent les cellules germinales primordiales. Pendant la vie fœtale, ces cordons, constitués de cellules germinales et de cellules de soutien (futures cellules de Sertoli), restent pleins jusqu'à la puberté. À la puberté, ils se creusent, formant les tubes séminifères connectés au rete testis, puis aux cônes efférents, et finalement au canal de Wolff, qui deviendra le canal déférent chez le mâle. Le développement des canaux dépend du sexe; chez le mâle, l'épididyme et le canal déférent se développent à partir du canal de Wolff, sous l'influence de la testostérone sécrétée par les cellules de Leydig fœtales, stimulées par les gonadotrophines chorioniques maternelles. Simultanément, les cellules de Sertoli sécrètent l'hormone antimüllérienne, induisant la régression des canaux de Müller. Le testicule, initialement intra-abdominal, descend progressivement dans le scrotum entre la 2ème et la 7ème mois de gestation, guidé par le gubernaculum testis et facilité par l'allongement du déférent, du pédicule vasculaire, et la distension du scrotum et du canal inguinal. La descente est achevée avec la formation de la vaginale.
2. Migration Inguino Scrotale et Cryptorchidie
La migration inguino-scrotale du testicule est sous contrôle androgénique. La stimulation androgénique modifie le gubernaculum testis, le divisant via le processus vaginalis pour former les fibres du muscle crémaster et une partie mésenchymateuse guidant la descente. La pression abdominale joue également un rôle, notamment dans les cryptorchidies associées à une aplasie de la paroi abdominale (syndrome de Prune Belly). L’hormone antimüllérienne, sécrétée par les cellules de Sertoli, agit sur le gubernaculum testis, stimulant sa croissance et son raccourcissement, entrainant la descente testiculaire. La persistance de structures mülleriennes est associée à une cryptorchidie haute avec des testicules en situation ovarienne. Des modifications histologiques sont observées: augmentation des fibres de collagène dans les cellules de Sertoli et les spermatogonies. L'atteinte du testicule controlatéral est controversée: certains auteurs rapportent des lésions dans 70% des cas, d'autres n'en observent aucune, ou décrivent une hypertrophie compensatrice. Néanmoins, les spermogrammes dans les cryptorchidies unilatérales sont plus altérés que ne le suggèrent les lésions histologiques unilatérales.
3. Théories sur l étiologie de la Cryptorchidie
Plusieurs théories tentent d'expliquer la cryptorchidie. La théorie hormonale suggère qu'un défaut de la sécrétion hypophysaire de LH et FSH, entre le 2ème et le 3ème mois de vie, entraine un défaut de sécrétion de testostérone par les cellules de Leydig fœtales, retardant la transformation des gonocytes en spermatogonies. Ceci expliquerait la bilatéralité des lésions. La théorie immunologique propose que l'hyperthermie testiculaire altère la barrière hémato-testiculaire, permettant aux cellules immunitaires de produire des anticorps anti-sperme. L’augmentation récente du nombre de cas de cryptorchidie dans les études épidémiologiques suggère une influence de facteurs environnementaux, notamment les pesticides. L'étude note que les patients proviennent majoritairement de la région de Marrakech-Tensift-Elhaouz, au Maroc, mais ne permet pas de déterminer la fréquence exacte de la cryptorchidie chez l'adulte dans cette région. Un retard au diagnostic est souvent observé, lié à une méconnaissance de l'anomalie à la naissance, à la négligence des parents, et à des accouchements à domicile sans examen systématique des bourses.
II.Conséquences de la Cryptorchidie à l Âge Adulte
L'étude examine les impacts de la cryptorchidie sur la fertilité et le risque de cancer testiculaire. Un lien est établi entre la position du testicule non descendu (haut situé vs. inguinal) et la sévérité des lésions histologiques, affectant la production de spermatozoïdes et augmentant le risque de cancer. 77% des spermogrammes étaient perturbés, particulièrement dans les cas de cryptorchidie bilatérale ou de testicules haut situés. Le risque de cancer testiculaire est significativement plus élevé chez les patients cryptorchides, nécessitant une surveillance régulière. Deux cas de dégénérescence maligne et un cas de néoplasie intratubulaire ont été observés dans l'échantillon de Marrakech.
1. Impact sur la Fertilité
La cryptorchidie, qu'elle soit unilatérale ou bilatérale, a un impact significatif sur la fertilité masculine. Des études montrent que le taux de paternité chez les hommes ayant une cryptorchidie unilatérale non traitée est variable, estimé entre 74 et 80%. Cependant, 50 à 70% de ces hommes présentent des anomalies du spermogramme, allant de l'azoospermie à l'oligospermie. Dans le cas d'une cryptorchidie bilatérale non traitée, l'infertilité est quasiment systématique. L'étude rapporte que 77% des spermogrammes étaient perturbés chez les patients adultes cryptorchides, cette perturbation étant plus fréquente en cas de cryptorchidie bilatérale ou lorsque le testicule est haut situé. La sévérité des lésions testiculaires, et donc l'impact sur la fertilité, semble corrélée à la hauteur de la localisation du testicule non descendu. Certaines études suggèrent que les lésions testiculaires ne surviennent qu'à partir de l'âge de deux ans, justifiant une intervention chirurgicale vers cet âge. Cependant, il est important de noter que la littérature présente des conclusions divergentes sur l'impact de la cryptorchidie unilatérale sur la fertilité, certains auteurs considérant que les lésions au niveau du testicule controlatéral contribuent également à l'infertilité.
2. Risque de Cancer Testiculaire
La cryptorchidie est un facteur de risque majeur pour le développement d'un cancer du testicule. Le risque de cancer chez un sujet cryptorchide est multiplié par dix par rapport à la population générale, avec des estimations variant considérablement dans la littérature (de 10 à 50 fois plus élevé). La fréquence du cancer du testicule est estimée à 0,013% dans la population générale, mais elle dépasse nettement 0,1% chez les sujets porteurs de testicules cryptorchides. Certaines études augmentent encore ce risque, allant jusqu'à multiplier par 40 le risque de dégénérescence en cas de cryptorchidie, un risque d'autant plus important que le testicule est haut situé et présente des lésions dysgénésiques importantes. Le risque de cancer in situ (CIS) chez les patients ayant un antécédent de cryptorchidie est estimé entre 2 et 3%, avec un risque de 50% de progression vers une tumeur invasive. Les testicules inguinaux profonds ou intra-abdominaux nécessitent une surveillance rigoureuse après le traitement. Une étude de suivi de 1075 enfants cryptorchides traités par HCG ou orchidopexie a montré un risque de cancer de 11,3%. Dans la série étudiée, deux patients présentaient une dégénérescence maligne et un seul une néoplasie intratubulaire.
3. Autres Complications Torsion Testiculaire
En plus de l'infertilité et du cancer testiculaire, la cryptorchidie augmente le risque de torsion testiculaire. Chez l'adulte jeune, ce risque est multiplié par 13 par rapport aux individus sans cryptorchidie. La torsion survient souvent sur un testicule déjà atteint d'une dégénérescence maligne; dans 65% des cas de torsion chez des adultes cryptorchides, le testicule est malin. Le diagnostic tardif rend le pronostic plus grave. La présentation clinique est souvent un syndrome douloureux, pouvant simuler une appendicite ou une colique néphrétique, avec un scrotum homolatéral vide. La présence d'une masse volumineuse douloureuse au niveau du testicule non descendu peut indiquer un stade tumoral plus avancé, avec des métastases ganglionnaires inguinales et iliaques plus fréquentes. Cependant, la survie à 5 ans est identique à celle des patients atteints d'un cancer du testicule sans antécédent de cryptorchidie.
III.Diagnostic et Traitement de la Cryptorchidie
Le diagnostic repose sur l'examen clinique, incluant la palpation inguino-scrotale pour déterminer la position et la taille du testicule. L'échographie testiculaire et le TDM abdomino-pelvienne peuvent être utilisés, bien que leur efficacité soit limitée pour les testicules intra-abdominaux. La laparoscopie est une option pour le diagnostic et le traitement, notamment pour les testicules haut situés ou absents. Le traitement chirurgical, l'orchidopexie, est décrit, avec les différentes techniques d'incision et les considérations anesthésiques (rachianesthésie vs. anesthésie générale). L'étude souligne l'importance de la précocité du diagnostic et du traitement pour minimiser les risques d'infertilité et de cancer. Les résultats de l'orchidopexie dans cette étude ont montré un faible taux de réascension testiculaire.
1. Examen Clinique et Imagerie
Le diagnostic de cryptorchidie chez l'adulte commence par un examen clinique minutieux. La palpation de la région inguino-scrotale, réalisée avec douceur et des mains réchauffées, permet de déterminer la présence, la position (spontanée et après manipulation), le volume et la consistance du testicule. Si le testicule est palpable, sa localisation (inguinale, haute, etc.) est notée. L'examen clinique est suffisant pour les testicules inguinaux superficiels. Cependant, pour les testicules inguinaux profonds ou intra-abdominaux, l'échographie et la tomodensitométrie abdomino-pelvienne (TDM) peuvent être utilisées. L'échographie a une sensibilité limitée pour les testicules intra-abdominaux. La TDM est plus fiable, permettant de visualiser une masse ovalaire d'au moins 1 cm de diamètre, sa sensibilité étant meilleure dans la région inguinale haute. La laparoscopie, à visée diagnostique ou thérapeutique, est envisagée pour les testicules très haut situés ou non palpables, permettant de visualiser le déférent et les vaisseaux spermatiques jusqu'au testicule. L'absence de pédicule spermatique ou un pédicule grêle interrompu avant l'orifice inguinal profond évite une exploration chirurgicale inutile. Il est important de noter que la méconnaissance de la vacuité d’une bourse à la naissance et la négligence des parents peuvent contribuer à un retard de diagnostic.
2. Traitement Chirurgical L Orchidopexie
Le traitement de la cryptorchidie chez l'adulte est principalement chirurgical, consistant en une orchidopexie. L'intervention chirurgicale est réalisée sous rachianesthésie ou anesthésie générale, un bloc ilio-inguinal et ilio-hypogastrique pouvant être envisagé. La rachianesthésie est privilégiée pour minimiser les risques et les désagréments liés à l'anesthésie générale. L'incision, similaire à celle d'une cure de hernie inguinale congénitale, est transversale et esthétique. Le chirurgien dissèque le pédicule épigastrique, passant le testicule et le cordon derrière celui-ci (manœuvre de décroisement). Le gubernaculum testis est lié ou coagulé avec précaution, en évitant de léser les éléments vasculaires. La libération du cordon peut nécessiter le traitement d'un sac herniaire ou d'un canal péritonéo-vaginal associé. Le testicule est ensuite abaissé et fixé à l'albuginée testiculaire. La peau scrotale est fermée par des sutures résorbables. Seuls 2 cas de réascension testiculaire secondaire ont été observés dans cette étude, suggérant une fiabilité de la technique. En cas de petit reliquat testiculaire ou de testicule intra-abdominal avec pédicule court, une orchidectomie ou un clipage/électrocoagulation du pédicule spermatique (technique de Fowler et Stephens) peut être effectué. L'exploration systématique du canal inguinal est recommandée pour éviter de laisser des reliquats glandulaires susceptibles de dégénérescence.
3. Approches Laparoscopiques et Indications Chirurgicales
La laparoscopie est une technique importante pour le diagnostic et le traitement de la cryptorchidie, particulièrement utile pour les testicules intra-abdominaux. Elle permet de visualiser le déférent et les vaisseaux spermatiques, guidant le chirurgien. L’absence de pédicule spermatique ou un pédicule hypoplasique indique généralement l’absence de testicule. Dans cette étude, la coelioscopie a été utilisée chez 3 patients, aboutissant à une orchidectomie dans deux cas (un cordon très court et une atrophie testiculaire) et à la découverte d'une agénésie testiculaire dans un cas. L'exploration du canal inguinal permet de retrouver un testicule viable dans trois cas sur quatre si le canal est ouvert, mais presque jamais s'il est fermé. Toutefois, certains auteurs recommandent une exploration inguinale systématique pour enlever tout reliquat testiculaire afin de prévenir une dégénérescence ultérieure. La décision de procéder à une orchidectomie doit être prise au cas par cas, et ne doit pas être systématique chez les patients adultes. Elle est réservée aux testicules suspects de dégénérescence ou inopérables. La possibilité d'améliorer la fertilité et de surveiller les testicules abaissés oriente vers une approche plus conservatrice.
IV.Surveillance et Aspects Épidémiologiques
L'étude souligne l'importance d'une surveillance post-opératoire rigoureuse, compte tenu du risque accru de cancer testiculaire chez les patients ayant eu une cryptorchidie. La mauvaise observance des patients et le manque de sensibilisation au risque de dégénérescence posent un défi particulier dans le contexte marocain. L'étude précise que la période d’étude s’est étalée sur 7 ans (janvier 2002 au janvier 2009) et que la cryptorchidie était unilatérale dans 80,3 % et bilatérale dans 19,7 % des cas. L’étude met l'accent sur la nécessité d’une information complète des patients sur les risques et les options de traitement, notamment la décision de conserver ou d'enlever le testicule.
1. Aspects Épidémiologiques et de l Étude
L'étude rétrospective porte sur 76 cas de cryptorchidie chez des adultes de plus de 15 ans, suivis au service d'urologie du CHU MED VI de Marrakech entre janvier 2002 et janvier 2009. L'échantillon n'est pas représentatif d'une population définie, les patients provenant majoritairement de la région de Marrakech-Tensift-Elhaouz. Il n'est donc pas possible de déterminer la fréquence précise de la cryptorchidie chez l'adulte au Maroc à partir de ces données. L'examen clinique a permis de localiser le testicule dans 61 cas (80,2%), précisant son volume et sa consistance. Dans 80,3% des cas la cryptorchidie était unilatérale et dans 19,7% bilatérale. L'atrophie glandulaire et les lésions histologiques étaient plus marquées lorsque le testicule était haut situé. La fertilité, évaluée par spermogramme, était perturbée dans 77% des cas, principalement en cas de cryptorchidie bilatérale ou de testicule haut situé. Deux patients présentaient une dégénérescence maligne et un seul une néoplasie intratubulaire. Le retard au diagnostic est souvent lié à une méconnaissance de l'anomalie à la naissance, à la négligence des parents et à la pratique d'accouchements à domicile sans examen systématique des bourses.
2. Surveillance Post Traitement et Risques à Long Terme
Une surveillance post-opératoire rigoureuse est essentielle après le traitement chirurgical de la cryptorchidie en raison du risque accru de cancer testiculaire. Ce risque est significativement plus élevé chez les sujets cryptorchides, même après traitement chirurgical, justifiant une surveillance clinique, radiologique et biologique régulière. Cependant, cette surveillance est difficile à mettre en œuvre, notamment en raison de la mauvaise observance des patients et du manque de sensibilisation au risque de dégénérescence. L'étude soulève la question de l'information des patients adultes sur ce risque et la nécessité d'obtenir leur consentement éclairé quant à la conservation ou à l'ablation du testicule. La conservation impose une surveillance contraignante, tandis que l’orchidectomie, bien que plus radicale, peut être justifiée en cas de suspicion de dégénérescence ou d’impossibilité d’abaissement testiculaire. L’objectif est d’équilibrer le risque de cancer et le souhait d’améliorer la fertilité et la possibilité de surveillance.
