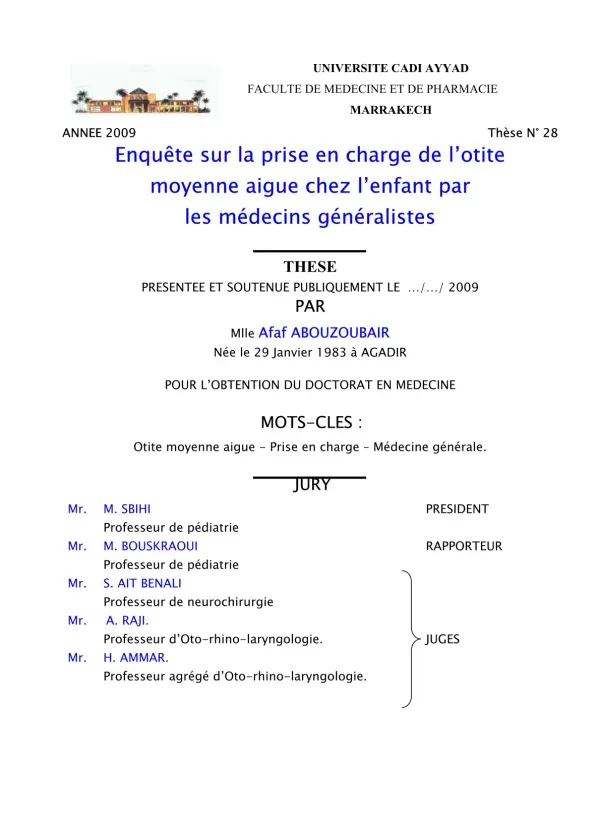
Thèse sur la prise en charge de l'otite moyenne aigue chez l'enfant
Informations sur le document
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 1.56 MB |
- Otite moyenne aigue
- Médecine générale
- Thèse de doctorat
Résumé
I.Épidémiologie et Pathogénie de l Otite Moyenne Aiguë OMA
L'otite moyenne aiguë (OMA) est une affection fréquente, notamment chez les enfants de moins de cinq ans. Elle représente une cause majeure de prescription d'antibiotiques, malgré un taux de guérison spontanée élevé (80%). La pathogénie de l'OMA est multifactorielle, impliquant souvent une infection virale des voies aériennes supérieures (VAS) précédée d'une rhinite, un dysfonctionnement tubaire, et une possible prédisposition génétique. Des bactéries comme le Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, et Moraxella catarrhalis sont fréquemment impliquées. L'émergence de résistances bactériennes aux antibiotiques constitue un problème de santé publique majeur.
1. Fréquence et Importance de l Otite Moyenne Aiguë
L'otite moyenne aiguë (OMA) est un motif de consultation fréquent en médecine ambulatoire, particulièrement chez les enfants de moins de cinq ans, représentant jusqu'à une consultation sur trois en médecine générale. Bien qu'elle soit généralement bénigne, la possibilité de complications graves comme la mastoïdite ou la méningite, ainsi que de séquelles telles que la surdité, justifient souvent le recours à une antibiothérapie systématique. Néanmoins, un taux significatif de guérison spontanée (80%) est observé. L'émergence de résistances bactériennes aux antibiotiques, souvent liée à un diagnostic par excès, pose un problème majeur de santé publique, nécessitant une meilleure gestion de la prescription antibiotique. De nombreuses recommandations thérapeutiques sont en constante évolution pour répondre à la fréquence de l'OMA et à ses conséquences sur l'écologie bactériologique.
2. Pathogénie Multifactorielle de l OMA
La pathogénie de l'OMA est multifactorielle. Une infection virale des voies aériennes supérieures (VAS) est généralement le facteur déclenchant, causant une congestion de la muqueuse. La production accrue de mucus par les cellules caliciformes altère le fonctionnement muco-ciliaire, entraînant une stagnation des sécrétions normalement évacuées par la trompe d'Eustache. Ce dysfonctionnement muco-ciliaire, combiné à la réaction inflammatoire, facilite l'adhérence des bactéries. Un dysfonctionnement de la trompe d'Eustache, plus fréquent chez les jeunes enfants en raison de sa morphologie particulière (courte, horizontale, souple), permet l'entrée de germes pathogènes dans l'oreille moyenne, normalement stérile. La maturation progressive de la trompe d'Eustache, achevée vers l'âge de 6 ans, explique la diminution de l'incidence de l'OMA après cet âge. Une prédisposition génétique est également suggérée par des études sur des jumeaux, démontrant une plus grande similarité de fréquence d'OMA chez les jumeaux monozygotes que chez les jumeaux dizygotes. Une étude américaine sur des enfants amérindiens adoptés dans des familles caucasiennes a mis en évidence une prédisposition génétique plus importante que les facteurs environnementaux.
3. Rôle des Infections Virales et Symptômes Associés
Le rôle des virus dans la pathogénie de l'OMA est bien établi, même si l'importance respective des différents virus reste incertaine. Une étude prospective sur des nourrissons de moins de deux ans a montré une association entre 43% des infections des VAS et l'OMA. Dans une enquête auprès de médecins généralistes, 70,9% considéraient les infections virales des VAS comme facteur favorisant l'OMA. L'analyse de plusieurs études a révélé une présence virale isolée dans 6% des cas d'OMA et une association virus-bactérie dans 19% des cas, impliquant des virus tels que le virus respiratoire syncytial, le virus influenzae, le virus parainfluenzae et l'adénovirus. Le virus de la grippe pourrait perturber la fonction de la trompe d'Eustache et faciliter la fixation des bactéries pathogènes. Après deux ans, une rhinite et des pleurs inhabituels augmentent la probabilité d'OMA, bien que ces signes manquent de spécificité. D'autres symptômes comme une symptomatologie digestive (diarrhée, vomissements) peuvent aussi être présents. La fièvre est un symptôme fortement considéré dans le diagnostic, ainsi que l'otalgie (douleur à l'oreille) et l'otorrhée (écoulement auriculaire).
4. Épidémiologie Bactérienne et Résistance Antibiotique
L'épidémiologie bactérienne de l'OMA est bien connue, avec un germe isolé dans les deux tiers des cas de liquide auriculaire. Les pathogènes les plus fréquemment retrouvés sont Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, et Moraxella catarrhalis. Le rôle du streptocoque du groupe A et du Staphylococcus aureus a diminué avec l'utilisation des antibiotiques. Les virus respiratoires peuvent être isolés seuls ou en association avec des bactéries. La résistance bactérienne aux antibiotiques représente une menace importante, compromettant l'efficacité des traitements et pesant sur la morbidité et la mortalité, particulièrement chez les patients fragilisés. Cette résistance est due à la conjonction de plusieurs facteurs: incitation réglementaire insuffisante, méconnaissance des enjeux, banalisation des antibiotiques et information insuffisante des professionnels. Concernant Haemophilus influenzae, la résistance aux bêta-lactamines est due à la production de bêta-lactamases ou à une modification de la cible des bêta-lactamines (souches BLNAR). Les macrolides sont généralement peu actifs sur cette bactérie.
II.Diagnostic de l Otite Moyenne Aiguë
Le diagnostic de l'OMA repose principalement sur l'examen otoscopique, qui permet de visualiser le tympan. Des signes fonctionnels comme la fièvre, l'otalgie (douleur à l'oreille), et l'otorrhée (écoulement auriculaire) sont également importants, mais manquent de spécificité. L'utilisation d'un otoscope pneumatique améliore la précision du diagnostic en permettant d'évaluer la mobilité du tympan. Une étude sur 155 médecins généralistes de la wilaya d'Agadir en 2008 (taux de participation: 91,1%) révèle que la majorité se base sur les signes fonctionnels (fièvre, otalgie) pour le diagnostic, ce qui contribue à une prescription excessive d'antibiotiques. Le diagnostic différentiel avec l'otite externe et l'otite séromuqueuse est essentiel.
1. L Examen Otoscopique Clé du Diagnostic
L'examen otoscopique est fondamental pour le diagnostic de l'otite moyenne aiguë (OMA). Bien que les signes fonctionnels (fièvre, otalgie) et généraux soient importants, ils manquent de spécificité. L'otoscopie permet l'observation directe du tympan, son aspect (couleur, transparence, mobilité) étant crucial. L'utilisation d'un otoscope pneumatique est recommandée pour objectiver un éventuel épanchement rétrotympanique en observant la mobilité du tympan. Il est conseillé de visualiser au minimum 75% de la surface de la pars tensa pour un diagnostic précis. Chez le nourrisson, l'otite est souvent bilatérale (40%), rendant nécessaire un examen otoscopique systématique des deux oreilles. Une étude réalisée au Maroc a révélé que 71.6% des médecins généralistes considéraient l’aspect otoscopique comme un élément important du diagnostic, seulement 42.5% considéraient l'inflammation de l'oreille moyenne et l’épanchement rétrotympanique comme critère diagnostique. Une incertitude diagnostique, souvent liée à une reliance excessive sur les signes fonctionnels (fièvre + otalgie), contribue à la prescription excessive d'antibiotiques.
2. Limites de l Otoscopie et Alternatives Diagnostiques
Plusieurs facteurs peuvent rendre l'otoscopie difficile : enfant indocile, pleurs, méat auditif étroit, présence de cérumen, faible éclairage. Ces difficultés peuvent conduire à un diagnostic d'OMA par excès, basé sur l'association de symptômes aspécifiques et d'un tympan rouge. L’otoscopie pneumatique permet de différencier l’OMA congestive (sans épanchement) de l’OMA purulente, réduisant ainsi les diagnostics erronés. La sensibilisation des médecins à l'utilisation de l'otoscopie pneumatique est essentielle pour améliorer la précision diagnostique. Une étude danoise mentionne la tympanométrie comme méthode complémentaire, permettant de corriger le diagnostic dans 26% des cas avec une interprétation exacte de 88%, bien que plus coûteuse et nécessitant une formation spécifique. Au Maroc, le Ministère de la santé a mis en place un guide pratique pour la prise en charge des maladies respiratoires dans les structures sanitaires de base, où l'accès à des examens complémentaires est limité.
3. Diagnostic Différentiel
Un diagnostic différentiel est nécessaire pour distinguer l'OMA d'autres affections de l'oreille. L'otite externe se caractérise par une inflammation du conduit auditif externe, une douleur vive au toucher et des sécrétions purulentes, avec un tympan souvent normal. L'otite séromuqueuse, une affection chronique, se manifeste par une effusion dans l'oreille moyenne durant plus de trois semaines. Elle est souvent bilatérale (80%) et se développe fréquemment après un épisode d'OMA. L'examen révèle un tympan transparent, hypervascularisé et mobile mais douloureux, sans épanchement rétrotympanique. Son diagnostic précoce est important en raison de sa grande fréquence chez les jeunes enfants. L’infection virale du rhinopharynx est la cause la plus fréquente, et l’antibiothérapie n’est pas indiquée dans les otites congestives, mais une surveillance médicale est nécessaire.
III.Traitement de l Otite Moyenne Aiguë
Le traitement de l'OMA repose sur la prise en charge symptomatique et, selon le cas, sur une antibiothérapie probabiliste. Chez les enfants de moins de deux ans, ou en cas de complications, une antibiothérapie est généralement recommandée (amoxicilline, amoxicilline-acide clavulanique, céphalosporines de troisième génération (C3G)). Des études suggèrent qu'un traitement plus court (5 jours) peut être aussi efficace qu'un traitement plus long (10 jours) chez les enfants plus âgés, sans pour autant diminuer la fréquence des récidives. L'amoxicilline à forte dose est recommandée en première intention par l'académie américaine de pédiatrie, mais une posologie insuffisante est fréquemment observée chez les médecins généralistes de l'étude d'Agadir. En cas d'allergie à la pénicilline, d'autres antibiotiques comme l'azithromycine peuvent être envisagés. Le paracétamol et l'ibuprofène sont utilisés pour soulager la douleur (otalgie). Les décongestionnants nasaux sont à proscrire chez les enfants. L'étude d'Agadir montre une variabilité des pratiques thérapeutiques, avec une prescription systématique d'antibiotiques chez 35,5% des médecins.
1. Antibiothérapie Indications et Recommandations
Le traitement de l'otite moyenne aiguë (OMA) peut inclure une antibiothérapie, dont les indications varient selon l'âge et l'état de l'enfant. Une antibiothérapie probabiliste est généralement recommandée pour les enfants de moins de deux ans, ou pour les enfants plus âgés présentant un terrain à risque (immunodépression, antécédent de mastoïdite), ou en cas de signes d'infection sévère (fièvre élevée, otalgie intense). Chez les enfants de plus de deux ans sans signes sévères, une surveillance après 48 à 72 heures de traitement symptomatique est préconisée, avec une antibiothérapie seulement si les symptômes persistent. L'antibiothérapie n'est pas recommandée pour les OMA congestives, mais une surveillance est nécessaire. Une enquête auprès de médecins généralistes a révélé que l'état général de l'enfant et la présence d'un terrain immunodéprimé étaient les principales indications à l'instauration d'une antibiothérapie, motivées par la crainte de complications. L'âge de l'enfant n'est pas toujours pris en compte, ce qui montre une variabilité des pratiques. Une étude a montré que la stratégie de surveillance avant la prescription d’antibiotiques peut réduire les taux de prescription, améliorer la satisfaction des parents et diminuer les taux de résistance aux antibiotiques.
2. Choix des Antibiotiques et Schémas Thérapeutiques
Les recommandations pour le choix des antibiotiques évoluent en fonction de la sensibilité des bactéries impliquées. En France, les bêta-lactamines, telles que l'association amoxicilline-acide clavulanique, le cefpodoxime-proxétil et le céfuroxime-axétil, sont souvent utilisées. Dans l'enquête menée, l'amoxicilline-acide clavulanique était le traitement de première intention le plus prescrit (70,3%), tandis que les céphalosporines de troisième génération (C3G) étaient moins utilisées (7,7%). L'amoxicilline seule était une option thérapeutique moins fréquente (14,2%). L’académie américaine de pédiatrie recommande l’amoxicilline à la dose de 80 à 90 mg/kg/j comme traitement de première intention dans la majorité des cas. Cependant, l'enquête montre que dans plus de 50% des cas, la posologie était insuffisante. En cas d'allergie à la pénicilline, des alternatives comme le cefpodoxime-proxétil ou le céfuroxime-axétil sont recommandées. Pour les enfants de plus de deux ans, un traitement de 5 jours peut être envisagé, favorisant l'observance du traitement. Des études comparant des traitements courts (5 jours) et longs (8 à 10 jours) n'ont pas montré de différence significative à long terme, mais un traitement plus court pourrait être moins efficace chez les jeunes enfants.
3. Gestion des Échecs Thérapeutiques et Traitements Complémentaires
Les récidives d'OMA sont plus fréquentes chez les jeunes enfants (près d'un tiers des cas chez les nourrissons de moins de 2 ans), souvent dues à une réinfection par une bactérie différente. Une consultation de contrôle est généralement recommandée (84% des médecins interrogés), souvent deux jours après le début du traitement. En cas d'échec de l'antibiothérapie de première intention, différentes approches sont possibles. Dans l'enquête, 41,9% des médecins ont demandé un avis spécialisé et 15,6% un antibiogramme, tandis que 34,1% ont prescrit une seconde antibiothérapie. L’utilisation d’analgésiques comme le paracétamol ou l’ibuprofène est courante pour soulager la douleur. Les décongestionnants nasaux et oraux sont déconseillés en raison de leur inefficacité prouvée et de leur toxicité chez les enfants. En cas de récidives ou d'infections fréquentes des VAS, un traitement spécifique des facteurs contributifs peut être nécessaire (traitement antiacide pour un reflux gastro-oesophagien par exemple). L'allaitement maternel et des mesures hygiéniques sont également conseillés.
IV.Complications et Prévention de l OMA
Les complications de l'OMA sont rares dans les pays développés mais restent une préoccupation majeure. Elles comprennent la mastoïdite, la méningite, et plus rarement, la paralysie faciale et les abcès cérébraux. La vaccination antipneumococcique peut contribuer à réduire l'incidence de l'OMA causée par le Streptococcus pneumoniae, bien qu'elle puisse modifier l'épidémiologie bactérienne. L'efficacité du vaccin antigrippal dans la prévention de l'OMA reste discutée. La prise en charge des facteurs de risque (dysfonctionnement tubaire, végétations adénoïdes hypertrophiées, exposition au tabac) est cruciale pour la prévention des récidives.
1. Complications de l Otite Moyenne Aiguë
Bien que généralement bénigne, l'otite moyenne aiguë (OMA) peut présenter des complications, notamment la mastoïdite, la méningite, et plus rarement, la paralysie faciale et les abcès cérébraux. Le pourcentage d'OMA compliquées de mastoïdites était de 0,24% dans une méta-analyse de 66 études internationales, un chiffre plus élevé avant l'ère des antibiotiques et dans les pays en développement. Dans une étude, 36,7% des médecins interrogés ont rapporté avoir déjà diagnostiqué une mastoïdite. Les paralysies faciales, complications de l'OMA, sont des paralysies faciales périphériques unilatérales, souvent d'apparition brutale. Le traitement recommandé inclut une paracentèse (si l'OMA n'est pas perforée), un traitement antibiotique et une corticothérapie. Le taux de paralysies faciales comme complication d'OMA varie selon les études (0,26% à 0,005%). Les abcès extraduraux, sous-duraux et cérébraux sont des complications plus rares, souvent associées à des otites chroniques et/ou à des mastoïdites. Les germes impliqués sont variés (Proteus, Staphylococcus, Klebsiella, anaérobies). La mortalité liée à ces abcès cérébraux, autrefois élevée (environ 30%), est aujourd'hui inférieure à 10% dans les pays occidentaux.
2. Prévention de l OMA Vaccination et Facteurs de Risque
La prévention de l'OMA repose sur plusieurs stratégies. La vaccination antipneumococcique joue un rôle important, bien qu'elle puisse modifier l'épidémiologie bactérienne en diminuant les pneumocoques des sérotypes vaccinaux et augmentant les sérotypes non vaccinaux d'Haemophilus influenzae. L'efficacité du vaccin antigrippal dans la prévention de l'OMA est débattue; une étude a montré qu'il n'y avait pas de différence significative du pourcentage d'OMA avec ou sans vaccin contre la grippe chez les enfants de 6 à 24 mois. La prise en charge des facteurs de risque est essentielle pour la prévention des récidives d'OMA et des infections des voies aériennes supérieures (VAS). Ces facteurs incluent l'hypertrophie des végétations adénoïdes, les infections virales des VAS, le dysfonctionnement tubaire, un terrain atopique et la vie en collectivité. Des mesures adaptées peuvent être envisagées : retrait temporaire de la crèche, éviction du tabac, sevrage de la tétine, et encouragement à l'allaitement maternel au minimum pendant les six premiers mois. L’adénoïdectomie est parfois proposée, mais son effet bénéfique n'est admis que dans les otites séreuses.
