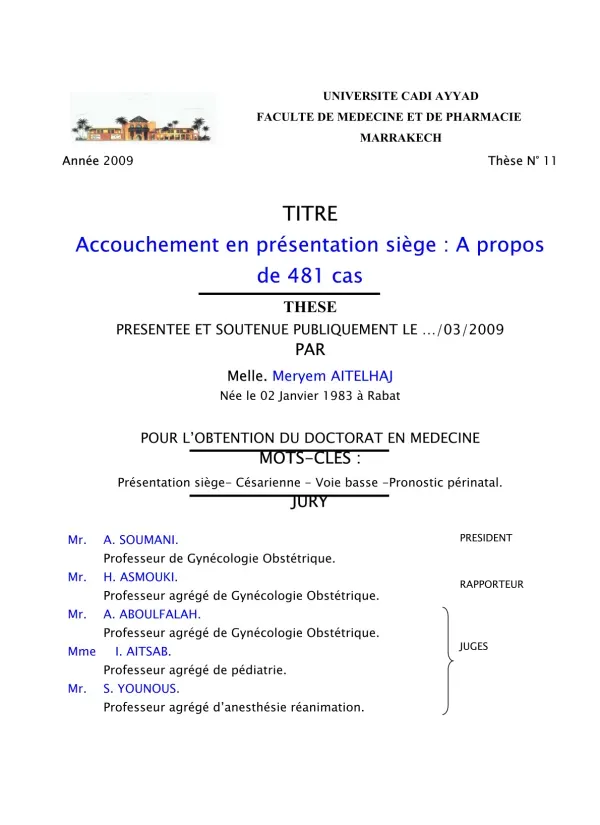
Thèse sur l'Accouchement en Présentation Siège
Informations sur le document
| Auteur | Melle. Meryem Aitelhaj |
| Spécialité | Médecine |
| Lieu | Rabat |
| Type de document | Thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 1.28 MB |
- Gynécologie
- Obstétrique
- Présentation siège
Résumé
I.Présentation du Siège Fréquence et Mode d Accouchement
Cette étude rétrospective, menée au service de gynéco-obstétrique « B » de la maternité du CHU Mohammed VI de Marrakech, a analysé 481 cas de présentation du siège sur un total de 15 412 accouchements sur 2 ans et 9 mois. La présentation du siège représentait 3,12% des accouchements. L'étude a montré que 68,2% des accouchements se sont déroulés par voie basse, dont 93,6% spontanés et 6,4% assistés. La césarienne, quant à elle, a été pratiquée dans 31,8% des cas, principalement en raison d'anomalies du rythme cardiaque fœtal (40%). La mortalité périnatale globale était de 8,7%, mais la mortalité périnatale corrigée s'établissait à 3,3%.
1. Fréquence de la Présentation du Siège à Marrakech
L'étude, réalisée au service de gynéco-obstétrique « B » de la maternité du CHU Mohammed VI de Marrakech sur une période de 2 ans et 9 mois, a observé 481 cas de présentation du siège parmi 15 412 accouchements. Cela représente une fréquence de 3,12% des accouchements totaux. Cette donnée fournit une base statistique importante concernant la prévalence de cette présentation spécifique dans le contexte marocain, plus précisément à Marrakech. La taille de l'échantillon, significative, permet une analyse statistique robuste des différents paramètres liés à la présentation du siège et aux modes d'accouchement qui en résultent. L'étude met en lumière l'importance de comprendre les facteurs influençant la survenue de cette présentation obstétricale afin de pouvoir optimiser la prise en charge et améliorer les résultats périnatals. La localisation géographique précise de l’étude, à savoir la maternité du CHU Mohammed VI de Marrakech, est un élément crucial pour comprendre les spécificités locales et éventuellement extrapoler les résultats à des contextes similaires.
2. Mode d Accouchement Voie Basse vs. Césarienne
L'analyse des modes d'accouchement révèle une nette prédominance de la voie basse (68,2% des cas). Parmi ces accouchements par voie basse, 93,6% ont été spontanés, témoignant d'une bonne capacité d'adaptation physiologique dans un nombre important de cas de présentation du siège. Seuls 6,4% des accouchements par voie basse ont nécessité une assistance. En revanche, la césarienne a été réalisée dans 31,8% des cas. Il est important de noter que dans 40% des césariennes, l'indication principale était liée à des anomalies du rythme cardiaque fœtal, soulignant le rôle crucial de la surveillance fœtale continue. Cette répartition entre voie basse et césarienne met en évidence la complexité de la gestion des présentations du siège, avec la nécessité d'une évaluation attentive des risques et d'une prise de décision individualisée. La différence importante entre les deux modes d'accouchement démontre la nécessité d'une approche multifactorielle pour identifier les candidates à un accouchement par voie basse et de mettre en œuvre un protocole de surveillance approprié.
3. Mortalité et Morbidité Périnatale
L'étude rapporte une mortalité périnatale globale de 8,7% (42 cas). Cependant, la mortalité périnatale corrigée est significativement inférieure, à 3,3% (16 cas). Cette différence souligne l'importance de corriger les biais statistiques pour obtenir une évaluation plus précise du risque réel lié à la présentation du siège. Ces données sur la mortalité périnatale, tant globale que corrigée, sont des indicateurs essentiels de la qualité des soins et de l'efficacité des stratégies de prise en charge des présentations du siège. La différence entre les deux chiffres suggère une possible surmortalité liée à des facteurs autres que la présentation du siège elle-même, ou à une différence dans la qualité de la surveillance des grossesses et des accouchements. L’analyse plus approfondie des facteurs contributifs à cette mortalité est nécessaire pour améliorer les stratégies préventives et le suivi des patientes.
II.Facteurs de Risque Associés à la Présentation du Siège
Plusieurs facteurs influencent le choix entre voie basse et césarienne dans les cas de présentation du siège. L'âge maternel (avec une prédominance des cas entre 20 et 34 ans dans cette étude), la parité (légère prédominance des primipares), la taille maternelle, le poids fœtal (macrosomie et hypotrophie étant des facteurs de risque), la position de la tête fœtale (déflexion céphalique), les anomalies de l'utérus (malformations utérines), les problèmes placentaires (placenta praevia), et la brièveté du cordon ombilical sont autant d'éléments pris en compte. L'étude a également noté une incidence de 8,5% de prématurité.
1. Âge Maternel et Parité
L'âge maternel apparaît comme un facteur pertinent. Dans cette étude, l'âge moyen des patientes était de 27 ans, la présentation du siège étant plus fréquente dans la tranche d'âge 20-34 ans. Des études antérieures (Vendittelli, Hannah) indiquent un pronostic moins favorable pour un accouchement par voie basse chez les femmes de plus de 35 ans (Vendittelli) ou même de plus de 30 ans (Hannah). Concernant la parité, une légère prédominance de la primarité (49,7%) a été observée, coïncidant avec les données de la littérature. Cependant, la mortalité périnatale était plus élevée chez les grandes multipares (4,3%) comparé aux primipares (3,8%) et aux multipares (2,7%). La morbidité périnatale, quant à elle, était plus importante chez les multipares (7,5%), ce qui pourrait s'expliquer par une plus grande fréquence d'accouchement par voie basse dans ce groupe. Ces observations soulignent l'interaction complexe entre l'âge, la parité et le choix du mode d'accouchement optimal pour les présentations du siège.
2. Taille Maternelle et Morphologie Pelvienne
La taille maternelle semble également jouer un rôle, bien que l'étude de Desargues n'ait pas démontré de différence statistique significative entre le mode d'accouchement et la taille. Néanmoins, dans la présente série, 3,4% des parturientes (16 cas) avaient une taille inférieure à 1,50 m, parmi lesquelles 68,75% (11 cas) ont accouché par césarienne. La mortalité périnatale était plus élevée dans cette tranche de taille, tandis que la morbidité était plus fréquente chez les femmes mesurant entre 1,50 m et 1,65 m. Ces résultats pourraient être influencés par le faible effectif des groupes extrêmes. D'autres auteurs (Denis, Grall et coll.) ont mis en lumière la corrélation inverse entre la taille maternelle et le nombre de césariennes, expliquée par une plus grande fréquence de bassins rétrécis chez les femmes de petite taille. La morphologie pelvienne, donc, apparaît comme un facteur indirect à prendre en considération.
3. Poids Fœtal et Anomalies Placentaires
Le poids du fœtus est un facteur de risque important. Dans cette étude, 80% des nouveau-nés pesaient entre 2500 et 3900 g. L’hypotrophie (poids < 2500 g) représentait 12,7% et la macrosomie (poids > 3900 g) 7,3% des cas. La mortalité et la morbidité périnatales étaient plus élevées chez les hypotrophes, soulignant la vulnérabilité de ces nouveau-nés. Une étude de Demol confirme la présentation du siège comme facteur de risque indépendant de mortalité néonatale, tandis que la césarienne prophylactique semble avoir un effet protecteur. Par ailleurs, des anomalies placentaires, notamment l'insertion basse du placenta et la brièveté du cordon ombilical, sont identifiées comme des facteurs pouvant compliquer l'accouchement par voie basse. L'étude mentionne une incidence de 3 cas de placenta praevia, et souligne le lien entre la brièveté du cordon, les circulaires ou anomalies d'insertion, et les difficultés d'engagement du siège.
4. Position de la Tête Fœtale et Malformations Utérines
La position de la tête fœtale est critique. La déflexion primitive de la tête, retrouvée dans environ 10% des cas selon Roseneau et Irondelle, a été observée dans 12,76% des cas ayant bénéficié d'une radiographie du contenu utérin (RCU) dans cette étude (18 cas sur 141). Une tête défléchie représente une indication formelle de césarienne. De plus, des malformations utérines (unicorne, didelphe, cloisonné) sont plus fréquentes dans les présentations du siège (5% dans une étude citée). Dans cette étude, 3 cas (0,6%) ont été rapportés, cette faible fréquence étant probablement due à un diagnostic souvent tardif. L’hydramnios (1,7%) et l’oligoamnios (1,2%) ont également été observés, rejoignant les données de la littérature. Ces anomalies, associées à la position de la tête fœtale et aux malformations utérines, représentent des facteurs de risque importants à considérer lors de la prise en charge des présentations du siège.
III.Techniques d Accouchement et Manœuvres Obstétricales
L'étude examine différentes approches pour l'accouchement du siège, incluant l'épreuve du travail, la surveillance du rythme cardiaque fœtal, et les manœuvres obstétricales telles que les manœuvres de Bracht et de Lovset. La décision de pratiquer une césarienne dépend de nombreux critères et est souvent prise en cas d'anomalies du rythme cardiaque fœtal ou de difficultés lors de l'expulsion. La grande extraction du siège est déconseillée par la FIGO pour les sièges de fœtus unique à terme.
1. Épreuve du Travail et Surveillance Fœtale
Dans certains cas, une épreuve du travail peut être tentée. Cette approche particulière vise à évaluer, en fonction de la dilatation, la possibilité d'une expulsion facile et sans risque. Une collaboration efficace de la parturiente est essentielle, nécessitant une préparation psychoprophylactique adéquate. Un monitoring correct de la dilatation et du rythme cardiaque fœtal est indispensable. Toute altération du rythme cardiaque fœtal, même avec une progression de la dilatation, doit inciter à une césarienne car le fœtus pourrait ne pas avoir toutes ses réserves pour l'expulsion. L'analgésie péridurale est recommandée pour le confort de la mère et pour faciliter les manœuvres obstétricales éventuelles. L'objectif est d'assurer la sécurité de la phase expulsive et de permettre la réalisation de manœuvres obstétricales si nécessaire, sans avoir recours à une anesthésie générale.
2. Phase d Expulsion et Manœuvres Obstétricales
La phase d'expulsion est une étape critique où l'engagement et la progression du siège sont évalués. Il est conseillé d'attendre une dilatation complète avant de rompre les membranes. La parturiente ne doit pousser qu'au moment des contractions, lorsque les fesses distendent le périnée. L'expression sur le fond utérin est à éviter. Un délai d'environ 30 minutes est imparti pour que le siège atteigne le périnée; au-delà, une césarienne reste envisageable. Une épisiotomie peut faciliter le dégagement spontané (méthode Vermelin). Pour prévenir l'asphyxie fœtale, il est recommandé de dégager les bras dès l'apparition des omoplates à la vulve, puis de procéder à une manœuvre de Bracht. Des manœuvres comme celles de Bracht et Lovset sont décrites pour faciliter l'expulsion de la tête dernière, la manœuvre de Bracht consistant à relever et renverser le fœtus pour permettre la rotation de la nuque autour de la symphyse pubienne. La manœuvre de Lovset implique une rotation du fœtus pour dégager successivement les bras. La grande extraction du siège est cependant condamnée par la FIGO pour les sièges de fœtus unique à terme.
3. Rétention de la Tête Dernière
La rétention de la tête dernière, un événement potentiellement grave, peut se produire dans l'excavation ou, plus gravement, au niveau du détroit supérieur. Plusieurs causes sont possibles, notamment le rétrécissement du détroit moyen, une dystocie des parties molles, une disproportion fœto-pelvienne ou une déflexion de la tête. Différentes manœuvres sont décrites pour résoudre ce problème, incluant les manœuvres de Bracht et de Lovset, ainsi que la petite et la grande extraction du siège (cette dernière étant déconseillée par la FIGO). Le choix de la manœuvre dépend de la situation clinique et de la compétence de l'équipe obstétricale. La possibilité d'utiliser des instruments comme le forceps ou la ventouse est également mentionnée. La rétention de la tête dans le détroit supérieur est considérée comme la situation la plus critique.
IV.Mortalité et Morbidité Périnatale et Maternelle
Les résultats montrent une mortalité périnatale plus élevée chez les hypotrophes et les grandes multipares. La morbidité périnatale est liée aux traumatismes obstétricaux (fractures, lésions nerveuses). Concernant la morbidité maternelle, l'étude note que la césarienne est associée à des risques tels que l'hémorragie de la délivrance et les infections. Des études contradictoires existent quant aux effets à long terme de la voie basse sur le développement neuro-psychomoteur de l'enfant. L’étude souligne l’importance de la surveillance post-natale.
1. Mortalité Périnatale
L'étude a révélé une mortalité périnatale globale de 8,7% (42 cas), mais une mortalité périnatale corrigée de 3,3% (16 cas). Cette différence souligne la complexité de l'interprétation des données brutes et la nécessité de prendre en compte les facteurs de confusion. La mortalité périnatale était plus élevée chez les parturientes âgées de plus de 35 ans et chez les femmes dont le nouveau-né présentait une hypotrophie. L'étude souligne également que la mortalité périnatale était plus élevée chez les grandes multipares (4.3%) que chez les primipares (3.8%) et les multipares (2.7%). Ces variations de mortalité périnatale selon différents facteurs (âge, poids du fœtus, parité) mettent en évidence l’importance d'une évaluation individualisée des risques lors de la prise en charge des présentations du siège. La comparaison de la mortalité périnatale corrigée entre la tentative de voie basse et la césarienne prophylactique est mentionnée, mais les résultats détaillés de cette comparaison ne sont pas fournis dans cet extrait.
2. Morbidité Périnatale et Traumatismes Obstétricaux
La morbidité périnatale, définie ici par des accidents majeurs liés à la présentation du siège (souffrance néonatale avec score d'Apgar < 7 à 5 min et traumatismes obstétricaux), est un sujet important. Les traumatismes obstétricaux, souvent liés aux manœuvres obstétricales, incluent des fractures (fémur, humérus, clavicule), des décollements épiphysaires, des traumatismes crânio-faciaux, des lésions nerveuses (plexus brachial), des lésions musculaires et des hémorragies méningées. La morbidité périnatale était plus élevée chez les hypotrophiques, avec une différence statistiquement significative. L'étude de Hannah et coll. (2000) met en avant une réduction significative de la mortalité et de la morbidité périnatales avec une césarienne systématique comparée à la tentative de voie basse. Cependant, une étude ultérieure de Hannah (2004) montre l'absence de réduction significative de la morbidité à 2 ans après la naissance pour les enfants nés par césarienne. L'impact à long terme de l'accouchement par voie basse sur le développement neuro-psychomoteur nécessite un suivi prolongé.
3. Morbidité Maternelle liée à la Césarienne
La morbidité maternelle liée à la césarienne n'est pas négligeable. Van Ham rapporte que 4,5% des patientes césarisées présentent des complications graves, incluant l'hémorragie de la délivrance (>1500 ml), la laparotomie itérative, l'infection pelvienne, la thrombose profonde, le sepsis, la pneumonie et les troubles de la coagulation. Ces complications sont plus fréquentes après une césarienne qu'après un accouchement par voie basse. Cependant, Hannah a montré dans une étude à 3 mois post-partum que la césarienne prophylactique était associée à un risque moindre d'incontinence urinaire sans augmentation d'autres problèmes. Après un suivi de 2 ans, il n'y a pas de différence significative dans les complications maternelles entre voie basse et voie haute, sauf pour la constipation, plus fréquente après césarienne. Il est donc important de peser les bénéfices et les risques de chaque mode d'accouchement en fonction du contexte clinique et des caractéristiques de la patiente.
V.Version Externe et Prévention de la Présentation du Siège
La version externe est présentée comme une méthode pour prévenir la présentation du siège avant le travail. Son efficacité varie selon les auteurs et la parité, avec un taux de réussite entre 40% et 60%. L'étude discute des avantages et des inconvénients de cette intervention, ainsi que de son impact sur le taux de césarienne.
1. La Version Externe VME Une Technique de Prévention
La version par manœuvre externe (VME) est présentée comme une technique de prévention de la présentation du siège. Son objectif est de retourner le fœtus en présentation céphalique avant le début du travail. De nombreux auteurs recommandent la réalisation d'une VME dès la découverte d'un siège afin de diminuer le nombre de présentations du siège en travail. Le taux de réussite de la version varie selon les auteurs et la parité, généralement compris entre 40% et 60%. Vézina note que les chances de césarienne augmentent de deux fois chez les primipares et de quatre fois chez les multipares après une VME, comparé à une présentation céphalique spontanée. Hutton et al. ont comparé l'efficacité de la VME à 34-36 semaines d'aménorrhée (SA) et à 37-38 SA, concluant qu'une tentative plus précoce n'était pas plus efficace ni délétère, mais augmentait le nombre de tentatives. Le Bret souligne que la VME réduit le taux de césariennes pour présentation du siège de 20,5%, diminuant ainsi la morbidité maternelle. Cependant, Marpeau, dans une revue de littérature, conclut que la pratique large de la VME n'influence que de façon négligeable le taux de césarienne.
2. Avantages et Inconvénients de la Version Externe
La VME, bien qu'offrant la possibilité de diminuer le recours à la césarienne pour présentation du siège, n'est pas sans risques. Elle nécessite un monitoring fœtal rigoureux et la prise en compte des contre-indications. Le texte souligne que le succès de la manœuvre n'est pas garanti et que le taux de réussite varie considérablement. L'augmentation du risque de césarienne après une tentative de version externe, notamment chez les multipares, est un point important à considérer. Le choix de réaliser une VME doit être une décision mûrement réfléchie, prise en tenant compte des risques potentiels pour la mère et l'enfant. L'efficacité de la VME dépend aussi du terme de la grossesse, une tentative trop précoce ne garantissant pas un meilleur résultat tout en augmentant le nombre de tentatives nécessaires. La conclusion générale est que la VME peut être une option viable dans certains cas, sous une surveillance médicale étroite et si les contre-indications sont respectées.
