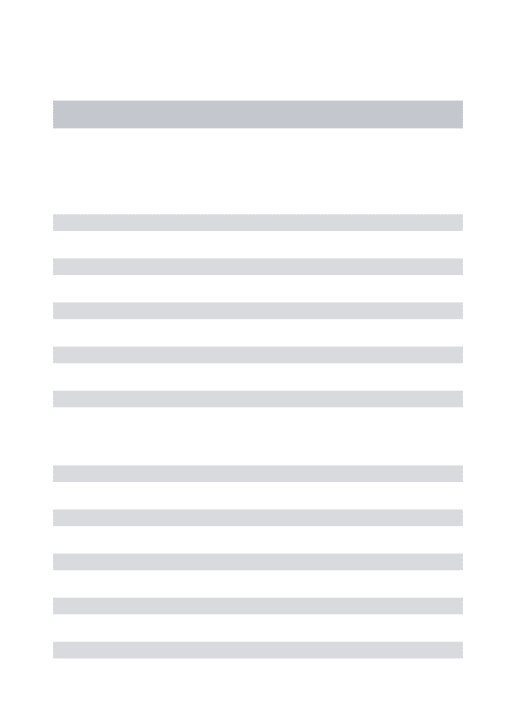
Thèse sur les Hémorragies Digestives Hautes en Milieu de Réanimation
Informations sur le document
| Auteur | Mlle. Wiam Ennassiri |
| École | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech |
| Spécialité | Médecine |
| Lieu | Marrakech |
| Type de document | Thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 1.57 MB |
- Hémorragies digestives
- Réanimation
- Endoscopie
Résumé
I.Épidémiologie de l Hémorragie Digestive Haute HDH
L'incidence annuelle de l'hémorragie digestive haute (HDH) varie selon les études. En France, elle est estimée à 146 épisodes pour 100 000 habitants, tandis qu'au Maroc, des données précises manquent. Les principales causes de HDH incluent les ulcères gastroduodénaux, les varices œsophagiennes, la gastrite, l'œsophagite, les tumeurs gastriques, et les hémorragies de stress. L'étude menée à l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech a analysé 80 cas de HDH sur trois ans.
1. Fréquence de l Hémorragie Digestive Haute HDH
L'étude aborde la fréquence de l'hémorragie digestive haute (HDH), soulignant des variations selon les contextes géographiques. Les données anglo-saxonnes indiquent une incidence annuelle estimée entre 100 et 150 épisodes pour 100 000 habitants. En France, une étude en région Ouest rapporte une incidence de 146 cas pour 100 000 habitants. Cependant, au Maroc, l'absence de registre national et la nature symptomatique, et non maladie à part entière, de l'hémorragie digestive rendent difficile la détermination d'une incidence précise. Cette difficulté de quantification souligne un manque crucial de données épidémiologiques au Maroc concernant la HDH, contrastant avec les données plus complètes disponibles dans les pays anglo-saxons et en France. La comparaison de ces chiffres met en évidence les disparités dans la collecte et la disponibilité des informations concernant l'incidence de la HDH, soulignant le besoin d'un système de surveillance plus robuste au Maroc pour mieux comprendre la prévalence réelle de ce problème de santé publique. L'absence de données fiables handicape l'évaluation précise du poids de la HDH au Maroc et la mise en place de stratégies de prévention et de soins appropriées.
2. Investigations diagnostiques complémentaires
Lorsque l'endoscopie digestive haute ne permet pas d'identifier la source de l'hémorragie, d'autres examens peuvent être envisagés. L'artériographie est une option, notamment à partir d'un débit de 0,5 ml/min. Pour les patients hémodynamiquement stables, la scintigraphie aux hématies marquées peut être utile, avec un seuil de détection de 0,1 ml/min. Une revue de littérature sur l'artériographie dans la HDH, basée sur 14 études et 675 patients, indique un taux de positivité moyen de 47%, allant de 27% à 72%. Les taux les plus élevés (61% à 77%) sont observés chez les patients hémodynamiquement instables ou avec une hyperfixation immédiate à la scintigraphie. Des techniques artériographiques plus agressives, incluant l'injection d'anticoagulants et/ou de vasodilatateurs, ont montré une amélioration de la sensibilité, passant de 32% à 65% selon Koval et al. Ces informations soulignent l'importance d'une stratégie diagnostique adaptée à la situation clinique du patient. Le choix de l'examen complémentaire dépendra de l'état hémodynamique et de la nécessité d'une identification rapide et précise du site hémorragique. La discussion sur les différentes techniques et leurs sensibilités respectives permet de mieux comprendre les outils à disposition pour la prise en charge des hémorragies digestives hautes.
3. Étude de cas Analyse des 80 patients
L'étude a inclus 80 patients soumis à une fibroscopie. Parmi eux, 38 présentaient un ulcère duodénal et 7 un ulcère gastrique comme cause de l’hémorragie. Divers facteurs influençant les hémorragies digestives associées à une maladie ulcéreuse sont détaillés : la prise d'aspirine (risque relatif de 2 à 15), d'AINS non salicylés (risque relatif de 3 à 9), les traitements antithrombotiques, et l'intoxication alcoolique aiguë. D'autres facteurs de risque liés à la prise d'AINS ont été identifiés, incluant l'âge supérieur à 60 ans, le sexe féminin (selon certaines études), les antécédents d'ulcère duodénal ou d'hémorragie ulcéreuse, l'association de deux AINS, des doses élevées d'AINS, un traitement récent par AINS, et un stress récent. La présence d'Helicobacter pylori ne semble pas influencer le risque hémorragique lié à la prise d'AINS, mais elle constitue un facteur de risque indépendant de complication ulcéreuse hémorragique. La mortalité globale de l'hémorragie digestive d'origine ulcéreuse est estimée à environ 5%, un chiffre proche de celui observé dans l’étude (8,8%). Ces données mettent en lumière les multiples facteurs contribuant au risque d'hémorragie digestive dans le contexte de la maladie ulcéreuse et fournissent une base pour une approche personnalisée de la prévention et du traitement.
4. Autres causes d hémorragie digestive haute
Outre les ulcères, le document explore d'autres causes d'hémorragie digestive haute. Les varices œsophagiennes représentent la première cause (70%), avec une mortalité à six semaines pouvant atteindre 15%, voire 30% en cas de cirrhose sévère (Child-Pugh C). La mortalité est liée à l'hémorragie incontrôlée, aux infections, et à l'insuffisance rénale. Des facteurs pronostiques défavorables incluent une fonction hépatique altérée, une hypertension portale sévère (>20 mmHg), et un saignement actif à l'endoscopie. Les varices gastriques, dont le risque hémorragique est lié à la taille, au score de Child-Pugh, et à la présence de signes rouges, sont aussi mentionnées, ainsi que la gastropathie congestive, dont la prévalence varie de 7% à 98% dans l'hypertension portale. L'œsophagite peptique sévère et les hernies hiatales compliquées d'ulcère ou d'œsophagite peuvent également causer des saignements, souvent de faible abondance, aggravés par la prise d'AINS. Les tumeurs gastriques, malignes ou bénignes, constituent une cause moins fréquente, nécessitant des biopsies systématiques des bords d'un ulcère. Ce résumé met en perspective la diversité des étiologies de la HDH, soulignant la nécessité d’une évaluation diagnostique complète pour identifier la cause précise du saignement et adapter le traitement.
II.Facteurs de Risque et Complications de la HDH
Plusieurs facteurs augmentent le risque de HDH, notamment la prise d'AINS, d'aspirine, les troubles de l'hémostase, la ventilation mécanique prolongée, l'absence de nutrition entérale, et la présence d'Helicobacter pylori. Les complications incluent la récidive hémorragique et la mortalité, qui varie selon la cause de l'hémorragie (ex: 5% pour les hémorragies ulcéreuses, jusqu'à 30% pour les hémorragies liées à la cirrhose et une hypertension portale sévère). Des scores de risque comme le score de Rockall et le score de Child-Pugh aident à évaluer le pronostic.
1. Facteurs de risque de l hémorragie digestive haute HDH
Le texte identifie plusieurs facteurs augmentant le risque d'hémorragie digestive haute (HDH). Pour les hémorragies d'origine ulcéreuse, la prise d'aspirine (risque relatif de 2 à 15) et d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) non salicylés (risque relatif de 3 à 9) sont soulignés. Les traitements antithrombotiques et l'intoxication alcoolique aiguë sont également cités comme facteurs de risque. Dans le contexte spécifique d'une prise d'AINS, d'autres éléments sont mis en évidence: un âge supérieur à 60 ans, le sexe féminin (selon certaines études), des antécédents d'ulcère duodénal ou d'hémorragie ulcéreuse, l'association de deux AINS, une dose élevée d'AINS, un début récent du traitement (4 premières semaines), et un stress physique ou psychique récent. Intéressant, la présence d'Helicobacter pylori ne semble pas aggraver le risque hémorragique lié à la prise d'AINS, bien qu'elle soit un facteur de risque indépendant de complication hémorragique ulcéreuse. En milieu de réanimation, les facteurs de risque incluent la ventilation mécanique (au moins 48 heures), les troubles de l'hémostase, l'absence de nutrition entérale et l'infection à Helicobacter pylori. Cette identification multifactorielle souligne la complexité de la survenue d'une HDH, nécessitant une approche préventive globale tenant compte de ces différents éléments.
2. Complications de l hémorragie digestive haute HDH
Les complications de l'hémorragie digestive haute (HDH) incluent la récidive hémorragique et la mortalité. La récidive hémorragique est un point central, son occurrence et sa prise en charge étant mentionnées. La mortalité, quant à elle, est variable selon l'origine de l'hémorragie. Pour les hémorragies d'origine ulcéreuse, la mortalité globale est estimée à environ 5%, un chiffre relativement stable malgré les avancées thérapeutiques. Cependant, l'étude mentionnée a observé un taux plus élevé de 8,8%. Dans le cas des hémorragies liées à l'hypertension portale (HTP), la mortalité est sensiblement plus importante, aux alentours de 20%. En présence de cirrhose, la mortalité globale atteint 15%, grimpant à 30% pour les patients Child-Pugh C. Les causes de décès incluent l'hémorragie incontrôlée, les infections, l'insuffisance rénale (surtout dans les jours ou semaines suivant l'épisode), l'encéphalopathie, l'insuffisance hépatique, et l'insuffisance rénale. Différents scores (Baylor, Blatchford, Rockall) sont utilisés pour évaluer le risque, mais seul le score de Rockall a été validé de manière indépendante. La variabilité de la mortalité selon l'étiologie de la HDH met en évidence la nécessité d'une évaluation précise des risques et de stratégies de prise en charge individualisées.
III.Diagnostic et Traitement de la HDH
Le diagnostic repose principalement sur l'endoscopie digestive haute (FOGD). Le traitement dépend de la cause et de la sévérité de l'hémorragie. Il peut inclure des mesures de réanimation, un traitement médical (IPP, anti-H2, somatostatine), un traitement endoscopique (hémostase endoscopique, sclérothérapie, obturation à la colle), ou une intervention chirurgicale. L'étude de Marrakech montre que l'hémostase a été obtenue dans 71,25% des cas, avec 16,25% de saignements persistants et 12,5% de récidives hémorragiques. Le taux de mortalité dans cette étude était de 3,75%.
1. Diagnostic de l hémorragie digestive haute HDH
Le diagnostic de l'hémorragie digestive haute (HDH) repose principalement sur l'endoscopie digestive haute (FOGD). La rapidité de réalisation de l'endoscopie est un facteur clé pour le diagnostic. Dans l'étude citée, un diagnostic certain a été obtenu dans 84% des cas lorsque l'endoscopie a été réalisée en moins de 24 heures, contre seulement 37,5% lorsque l'examen a été effectué après 72 heures. Ce constat souligne l'importance d'une intervention rapide pour le diagnostic précis de la HDH. Si l'endoscopie ne permet pas d'identifier la cause de l'hémorragie, d'autres examens sont envisagés tels que l'artériographie (à partir d'un débit de 0,5 ml/min) et la scintigraphie aux hématies marquées (seuil de détection de 0,1 ml/min). L'artériographie présente une sensibilité de 47% et une spécificité de 100% dans les hémorragies gastro-intestinales, selon les données de la littérature. Des techniques artériographiques plus invasives, utilisant des anticoagulants et/ou vasodilatateurs locaux, peuvent améliorer la sensibilité. Le délai de réalisation de l'examen endoscopique et la mise en place d'examens complémentaires sont donc cruciaux pour une gestion optimale de l'hémorragie digestive haute. Une approche diagnostique rapide et précise est essentielle pour un traitement efficace et pour optimiser les chances de succès.
2. Traitement de l hémorragie digestive haute HDH
Le traitement de l'hémorragie digestive haute (HDH) est multiforme et dépend de la cause et de la sévérité de l'hémorragie. Le traitement repose sur une approche combinant mesures de réanimation, traitement médical, et traitement endoscopique ou chirurgical. Les mesures de réanimation, mises en place en urgence, sont cruciales pour la survie. L’hospitalisation dans un service spécialisé est recommandée pour la mise en place d’une stratégie thérapeutique appropriée (médicale, endoscopique, radiologique et chirurgicale). Le traitement médical peut inclure les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) — les plus puissants antisécrétoires — et les anti-H2, la somatostatine et ses dérivés (octréotide) étant utilisés notamment dans les hémorragies liées à l'hypertension portale. Des études ont démontré la supériorité des IPP sur les anti-H2 pour la réduction du risque de récidive hémorragique et la durée d'hospitalisation. Le traitement endoscopique est une option importante, particulièrement efficace en cas d'hémorragie active, avec une hémostase endoscopique souvent suffisante pour une résolution définitive. La chirurgie est une solution de dernier recours, notamment en cas d'échec du traitement endoscopique ou de situations d'urgence. L'étude citée a fait état d'une hémostase obtenue dans 71,25% des cas, 16,25% présentant un saignement persistant et 12,5% une récidive hémorragique. L’efficacité du traitement dépend de la rapidité d'intervention et du choix de la modalité thérapeutique en fonction de la cause de l'hémorragie.
IV.Résultats de l Étude de Marrakech
L'étude à l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech a inclus 80 patients avec une moyenne d'âge de 47 ans et un sex-ratio de 3,4. Les modes de révélation les plus fréquents étaient l'hématémèse avec méléna (38,75%), l'hématémèse isolée (30%), et le méléna isolé (27,5%). Les causes les plus fréquentes étaient les ulcères gastroduodénaux (56,25%), suivis des varices œsophagiennes (20%). Le traitement endoscopique a été utilisé chez 18 patients et la chirurgie chez 6.
1. Caractéristiques des patients
L'étude menée à l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech a porté sur 80 patients atteints d'hémorragie digestive haute (HDH). L'âge moyen était de 47 ans, avec un sex-ratio de 3,4 (beaucoup plus d'hommes que de femmes). Les modes de présentation clinique étaient variés : hématémèse avec méléna (38,75%), hématémèse isolée (30%), méléna isolé (27,5%), et saignement par sonde nasogastrique (3,75%). Le délai moyen d'admission était de 6 heures. Des antécédents significatifs ont été relevés: 48,75% des patients étaient des fumeurs chroniques, 20% étaient des alcooliques chroniques, et 24% prenaient des médicaments gastro-toxiques. Les principaux motifs d'admission en réanimation étaient l'état de choc (23,75%) et l'anémie sévère avec retentissement hémodynamique (37,5%). Ces données décrivent un profil de patients assez homogène en termes d'âge et de sexe, mais révélant une importante prévalence de facteurs de risque connus pour aggraver les hémorragies digestives, comme le tabagisme et la prise de médicaments gastro-toxiques. L’étude montre également une proportion importante de patients présentant des complications sévères au moment de l’admission, nécessitant une prise en charge en réanimation.
2. Diagnostic et traitement
Tous les patients ont bénéficié d'une endoscopie. Dans 62,5% des cas, l'endoscopie a été réalisée en moins de 24 heures, permettant un diagnostic certain dans 84% de ces cas. En comparaison, le diagnostic était certain seulement dans 37,5% des cas lorsque l'endoscopie était réalisée après 72 heures. Les causes de saignement les plus fréquentes étaient, par ordre décroissant : les ulcères gastroduodénaux (56,25%), les varices œsophagiennes (20%), les gastrites et œsophagites (6,25% chacune), les tumeurs gastriques (10%), et les hémorragies de stress (7,5%). Un traitement endoscopique a été instauré chez 18 patients, et un traitement chirurgical chez 6. L'hémostase a été obtenue chez 71,25% des patients. Il restait 16,25% de patients avec un saignement persistant et 12,5% avec une récidive hémorragique. La durée moyenne du séjour était de 6 jours et le taux de mortalité de 3,75%. Cette étude met en évidence l'efficacité du traitement endoscopique et la faible proportion de cas nécessitant une chirurgie. La rapidité du diagnostic endoscopique influence significativement la réussite du traitement et l’évolution de la HDH.
