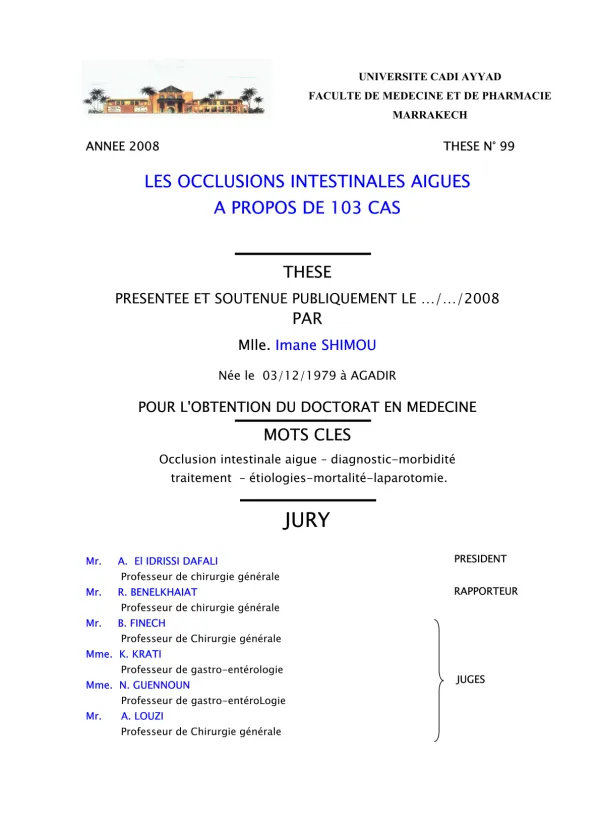
Thèse sur les Occlusions Intestinales Aigües : Étude de 103 Cas
Informations sur le document
| Auteur | Mlle. Imane Shimou |
| École | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech |
| Spécialité | Médecine |
| Lieu | Marrakech |
| Type de document | thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 1.38 MB |
- occlusion intestinale
- médecine
- chirurgie
Résumé
I.Épidémiologie et Diagnostic de l Occlusion Intestinale Aiguë
Cette étude rétrospective, menée de juillet 2004 à juillet 2008 au CHU Mohammed VI de Marrakech, a analysé 103 dossiers de patients atteints d'occlusion intestinale aiguë (OIA). L'étude a révélé une prédominance de l'occlusion du grêle (54,36%) et des occlusions mécaniques, principalement dues aux brides et adhérences (31,06%) et aux tumeurs intestinales (22,33%). Le symptôme principal était l'arrêt du transit des matières et des gaz (87,37%), souvent associé à des niveaux hydroaériques à l'ASP (88,34%). 44,66% des patients présentaient des antécédents chirurgicaux, majoritairement appendiculaires (9,70%). L’âge moyen des patients était de 43,4 ans (67 hommes et 36 femmes), contrairement aux pays développés où l’âge est plus avancé. La fréquence des hernies étranglées est plus élevée dans les pays en voie de développement, comme le souligne cette étude marocaine.
1. Étude Rétrospective et Contexte Marocain
L'étude, réalisée au CHU Mohammed VI de Marrakech entre juillet 2004 et juillet 2008, a porté sur 103 dossiers de patients souffrant d'occlusion intestinale aiguë (OIA). Elle se positionne dans un contexte marocain, permettant une analyse spécifique des particularités épidémiologiques et thérapeutiques dans ce pays. L'échantillon comprenait 67 hommes et 36 femmes, avec un âge moyen de 43,4 ans. Un point notable est la fréquence des antécédents chirurgicaux abdominaux, observée chez 44,66% des patients, avec une prédominance de la chirurgie appendiculaire (9,70%). Cette donnée permet de souligner le rôle des adhérences post-opératoires dans l'étiologie des OIA au Maroc. L'étude contraste également avec les données de pays développés, où l'âge moyen des patients atteints d'OIA est généralement plus élevé. L'analyse des résultats a permis de comparer les données marocaines avec celles de la littérature internationale, soulignant les similarités et les différences, notamment concernant l'âge et la fréquence des hernies étranglées. La prise en charge précoce, via une sensibilisation accrue des populations, apparaît comme une priorité pour améliorer les résultats.
2. Fréquence et Types d Occlusion Intestinale Aiguë
L'analyse a mis en évidence une prédominance des occlusions du grêle (54,36%) parmi les OIA. Cette observation est importante pour la planification des interventions chirurgicales et la gestion des ressources. Les principales causes identifiées étaient les brides et adhérences (31,06%), soulignant l'impact des interventions chirurgicales antérieures, et les tumeurs intestinales (22,33%), pointant vers la nécessité d'un diagnostic précoce des affections cancéreuses. Le symptôme le plus courant était l'arrêt du transit des matières et des gaz (87,37%), un indicateur essentiel pour la prise en charge rapide des patients. La présence de niveaux hydroaériques à l'abdomen sans préparation (ASP) était également fréquente (88,34%), confirmant la valeur diagnostique de cet examen. La comparaison des taux d'OIA avec d'autres études en Afrique noire (41%, 30%, et 36,6% selon différentes sources) révèle des différences significatives, attribuées à la prise en charge des hernies inguinales simples, plus précoce dans les pays occidentaux. Ces données précisent le contexte épidémiologique des OIA au Maroc et mettent en relief la nécessité d'interventions ciblées pour améliorer la prise en charge.
3. Analyse des Antécédents et Facteurs de Risque
L'étude a révélé une corrélation significative entre les antécédents chirurgicaux abdominaux et l'apparition d'une OIA. 45% des patients de l'étude avaient un historique d'intervention chirurgicale, avec une prédominance de la chirurgie appendiculaire, reflétant le rôle important des brides et adhérences post-opératoires dans le développement de l'occlusion intestinale. Cette observation souligne l'importance d'une approche chirurgicale minutieuse et d’une prévention efficace des adhérences lors des interventions précédentes. Les taux d'antécédents chirurgicaux observés dans d'autres études varient considérablement (de 20,83% à 60%), soulignant les variations dans les pratiques chirurgicales et les populations étudiées. Ces données soulignent l'importance de recueillir un historique chirurgical complet pour mieux évaluer le risque d'OIA chez les patients. L'analyse des données met en évidence la nécessité d'une meilleure connaissance des facteurs de risque liés aux antécédents chirurgicaux afin d'améliorer les stratégies de prévention et de prise en charge de l'occlusion intestinale.
II.Modalités Thérapeutiques et Prise en Charge de l OIA
Tous les patients opérés ont subi une laparotomie. Une résection intestinale a été nécessaire dans 15,53% des cas, en raison d'une nécrose intestinale. Le traitement de l’occlusion colique a varié selon la technique utilisée (colostomie de décharge, hémicolectomie gauche...). Le taux de morbidité était de 6,79%, comparable aux séries marocaines, mais inférieur aux taux observés en Afrique subsaharienne, en Asie et en Europe. La mortalité globale était de 6,93%. Des complications postopératoires comme les suppurations pariétales (2,97%), la péritonite, l’éviscération, la pneumonie et la septicémie ont été rapportées. La prise en charge précoce de l’OIA est essentielle pour réduire la morbidité et la mortalité.
1. Approche Chirurgicale et Laparotomie
L'étude rapporte que tous les patients ayant nécessité une intervention chirurgicale ont été traités par laparotomie. Cette approche chirurgicale majeure est standard dans la prise en charge de l'occlusion intestinale aiguë (OIA), permettant une exploration complète de la cavité abdominale et la résolution des problèmes occlusifs. La laparotomie a permis une résection intestinale dans 15,53% des cas, témoignant de la nécessité de ce geste pour traiter les nécroses intestinales liées à la strangulation ou à d'autres pathologies. L'étude souligne l'importance du jugement clinique du chirurgien pour décider de la nécessité d'une résection intestinale, en fonction de l'évaluation de la vitalité intestinale et du degré de nécrose. Des techniques complémentaires telles que l’entérovidange rétrograde ont été utilisées dans 45,63% des cas, pour évacuer le contenu intestinal de manière sûre et minimiser les risques de contamination. Cette approche chirurgicale, bien que standard, présente des risques de complications postopératoires comme les suppurations pariétales, la péritonite ou l’éviscération, que l’étude a documentées. L'analyse des résultats met l'accent sur l'importance d'une technique chirurgicale précise et rigoureuse afin de minimiser ces risques.
2. Résultats Postopératoires et Complications
Les suites postopératoires immédiates ont été simples pour 83,49% des patients (86 sur 103). Cependant, l'étude a documenté plusieurs complications postopératoires, notamment 3 cas de suppuration pariétale (2,97%), un cas de péritonite postopératoire (0,99%), un cas d'éviscération (0,99%), un cas de pneumonie (0,99%) et un cas de septicémie (0,99%). Ces complications illustrent les risques liés à la chirurgie abdominale et soulignent la nécessité d'une surveillance postopératoire attentive. Le taux de mortalité globale s'élevait à 6,93%. La morbidité, significativement plus élevée chez les patients ayant subi une résection intestinale, souligne l’importance d'un diagnostic et d'une intervention chirurgicale précoces pour limiter la sévérité des lésions et le besoin de résection. La classification ASA, prenant en compte l'âge, les pathologies cardiaques et pulmonaires, s'avère un facteur prédictif de complications. Ces données soulignent l'importance d'une approche multidisciplinaire pour minimiser les risques et optimiser les résultats postopératoires.
3. Alternatives Thérapeutiques et Techniques Minimales
L’étude mentionne la place de la coelioscopie dans le traitement des occlusions intestinales, notamment celles liées à des brides. Bien que l'efficacité de la coelioscopie varie (de 46% à 82% de réussite selon la littérature), elle est présentée comme une alternative à la laparotomie, avec un potentiel moindre de complications telles que les suppurations pariétales. Cependant, les études rétrospectives mentionnées suggèrent un taux plus élevé de ré-intervention après coelioscopie. Pour les occlusions coliques d'origine tumorale, l'utilisation de prothèses métalliques auto-expansives est envisagée comme une alternative pour lever l'obstruction en urgence avant une intervention curative. L'étude mentionne également des techniques de lavage colique peropératoire comme alternative à l'intervention de Hartmann pour les lésions occlusives du côlon gauche. Ces alternatives thérapeutiques témoignent de l'évolution des pratiques chirurgicales pour une prise en charge plus efficace et moins invasive des OIA.
III.Techniques Chirurgicales et Innovations
L’étude explore différentes approches chirurgicales, incluant la coelioscopie pour le traitement des occlusions par brides, et l’utilisation de prothèses métalliques auto-expansives pour les occlusions coliques tumorales. La technique de Mac Vay était la plus utilisée pour la réparation des hernies (66% des cas). Pour le volvulus du sigmoïde, la détorsion chirurgicale était la technique privilégiée, bien que la récidive soit possible. La prévention des adhérences post-opératoires par différentes méthodes (membranes, gels, solutions anti-adhérentielles) a été discutée, soulignant l’importance d’une approche prudente et respectueuse de la structure tissulaire pour limiter les complications.
1. Coelioscopie dans le Traitement de l Occlusion Intestinale
L'étude aborde la place de la coelioscopie dans la prise en charge de l'occlusion intestinale, notamment en cas d'occlusion par brides. Si la coelioscopie offre un rôle diagnostique indéniable dans le cadre des syndromes occlusifs, sa faisabilité thérapeutique varie selon la littérature, oscillant entre 46% et 82% de succès, ceci dépendant fortement de la sélection des patients. L'analyse de plus de 10 publications, incluant un nombre important de patients (n>20), montre que la principale cause d'échec de la coelioscopie est l'importance des adhérences (47%), suivie de perforations iatrogènes nécessitant une conversion en laparotomie (112). Une récidive précoce de l'occlusion est également observée dans 14% des cas. L'absence d'études randomisées comparant la coelioscopie à la laparotomie pour les occlusions par brides limite la portée des conclusions. Une étude comparative rétrospective suggère un taux de réintervention plus élevé après coelioscopie (14%) qu'après laparotomie (4,6%), mais cette observation ne permet pas de conclure formellement sur la supériorité de l'une ou l'autre technique. La sélection des patients est donc un facteur crucial pour le succès de la coelioscopie dans le traitement de l'occlusion intestinale.
2. Techniques Chirurgicales pour l Occlusion Colique
L'étude explore différentes techniques chirurgicales pour la gestion de l'occlusion colique. Elle souligne l'utilisation de prothèses métalliques auto-expansives comme alternative au traitement chirurgical dans certaines situations, permettant la levée de l'occlusion colique aiguë en urgence avant une chirurgie curative ultérieure. La technique du lavage colique peropératoire est présentée comme une méthode efficace et sûre pour réaliser une anastomose colique en un temps lors d'une intervention pour lésion occlusive du côlon gauche, offrant une alternative à l'intervention de Hartmann. L'étude note que dans leur série, la colostomie latérale de décharge était le geste le plus pratiqué en urgence (75%), une observation similaire à celle d'une étude marocaine (43,33%), contrairement aux séries européennes qui privilégient l'hémicolectomie gauche avec anastomose immédiate ou l'intervention de Hartmann. Cette différence est attribuée à l'usage plus fréquent du lavage colique peropératoire dans les séries européennes. Ces différentes approches chirurgicales mettent en avant la diversité des techniques utilisées en fonction du contexte et des préférences des équipes chirurgicales.
3. Réparation des Hernies et Traitement du Volvulus
En ce qui concerne la réparation des hernies, la technique de Mac Vay a été la plus utilisée dans cette étude (plus de 66%), en raison de sa maîtrise par l'équipe chirurgicale. Cette étude souligne la variation des techniques chirurgicales selon les équipes, avec les méthodes de Bassini, Mac Vay et Shouldice mentionnées dans la littérature. Pour le volvulus du sigmoïde, la détorsion chirurgicale est la technique la plus employée dans la série de l'étude, contrairement à d'autres séries qui privilégient l'intervention de Hartmann. La détorsion chirurgicale, bien que susceptible de récidive et nécessitant une éventuelle réopération, présente l'avantage d'éviter une colostomie, ce qui a un impact socio-économique important dans certains contextes. La détorsion avec ou sans fixation sigmoïdienne a été proposée par d'autres auteurs. Le choix de la technique chirurgicale dépend donc de nombreux facteurs, parmi lesquels les préférences de l'équipe, les compétences, ainsi que le contexte socio-économique. Une prise en charge rapide est essentielle pour minimiser la morbidité et la mortalité liées à ces pathologies.
IV.Pronostic et Facteurs de Risque
Le pronostic de l’occlusion intestinale aiguë dépend fortement du diagnostic précoce et du type d’occlusion (obstruction vs. strangulation). Un syndrome inflammatoire de réponse systémique (SIRS) peut indiquer une strangulation. Des facteurs comme le retard thérapeutique, la nécrose intestinale, la strangulation, l’âge avancé, la déperdition hydrosodée et des antécédents médicaux influent sur la morbidité et la mortalité. L'amélioration de la prise en charge passe par une meilleure sensibilisation, une détection précoce de l'occlusion intestinale, et une prise en charge chirurgicale appropriée.
1. Importance du Diagnostic Précoce et Mécanisme de l Occlusion
Le pronostic de l'occlusion intestinale aiguë mécanique est fortement lié à son mécanisme et à la rapidité du diagnostic. Un diagnostic précoce de strangulation est crucial car il est souvent associé à des complications graves. Plusieurs auteurs suggèrent des examens biologiques, comme le dosage des CPK, pour le diagnostic précoce de la strangulation. Une étude prospective mentionne le syndrome inflammatoire de réponse systémique (SIRS) comme un signal d'alerte pour l'occlusion par strangulation, défini par au moins deux des critères suivants : température >38°C ou <36°C, pouls >90 battements/min, fréquence respiratoire >20/min ou PaCO2 >32 torr (<4.3 kPa). La durée de la nécrose intestinale est corrélée à la présence de SIRS. Dans l'étude, la strangulation est plus fréquente que l'obstruction simple (64,28% vs 35,71%), une observation similaire à celle d’autres études africaines et européennes. La fréquence de la strangulation varie selon les études, allant de 58,2% à 93,5%.
2. Évaluation de la Vitalité Intestinale et Techniques Chirurgicales
L'appréciation de la vitalité intestinale est essentielle lors d'une intervention chirurgicale pour occlusion intestinale. Une résection intestinale, bien que nécessaire en cas de nécrose, augmente le risque de contamination péritonéale. A l'inverse, la conservation d'une anse dévitalisée expose à une péritonite postopératoire. Des techniques de réchauffement de l'anse ischémique (compresses imbibées de sérum chaud) sont mentionnées, tout en veillant à un état hémodynamique stable. L’utilisation de vasodilatateurs peut être envisagée, tandis que l'infiltration locale de novocaïne est déconseillée en raison du risque de lésion vasculaire. Deux techniques d'entérovidange sont décrites : l'entérovidange rétrograde, la technique la plus sûre, et la vidange par entérotomie. L'entérovidange rétrograde est préférée car elle évite l'ouverture du tube digestif, minimisant le risque de contamination et de fistule. Cependant, elle présente un risque de choc septique lié aux décharges bactériennes à partir du liquide de stase. La vidange rétrograde facilite une exploration complète de la cavité abdominale, permettant de rechercher des métastases et des adénopathies.
3. Prévention des Adhérences et Facteurs de Risque de Morbi Mortalité
La prévention des adhérences postopératoires est abordée, incluant des méthodes comme l'hydro-flotation (injection de liquide dans la cavité péritonéale), bien que son efficacité soit contestée par des méta-analyses. La péritonisation, quant à elle, est déconseillée en raison de son association à la formation de brides. Des études mentionnent une diminution de la sévérité des adhérences après fermeture de Hartmann ou résection colorectale. Le pronostic de l'occlusion intestinale est influencé par plusieurs facteurs : le retard thérapeutique, la présence de nécrose intestinale, le mécanisme de strangulation, la durée de l'acte opératoire, la déperdition hydrosodée, et l'âge avancé. Le taux de morbidité est significativement plus élevé après résection intestinale, tandis que la mortalité reste similaire entre les patients opérés avec ou sans résection. La classification ASA (basée sur l'âge, les pathologies cardiovasculaires et pulmonaires) est un facteur de risque de complications. L’âge avancé est également un facteur de risque important, comme l’indiquent certaines études.
