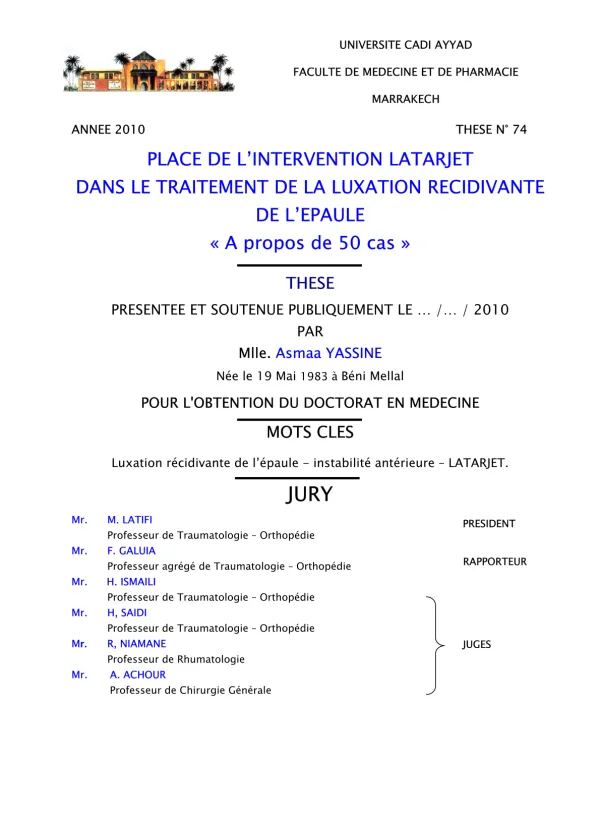
Thèse sur l'Intervention Latarjet dans le Traitement de la Luxation Récidivante de l'Épaule
Informations sur le document
| Auteur | Asmaa Yassine |
| instructor/editor | M. Latifi, Professeur de Traumatologie – Orthopédie |
| school/university | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech |
| subject/major | Médecine |
| Type de document | Thèse |
| city_where_the_document_was_published | Marrakech |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 4.42 MB |
- Luxation récidivante de l'épaule
- Intervention Latarjet
- Traumatologie-orthopédie
Résumé
I.Luxation Traumatique Antéro Interne de l Épaule Étude de Cas et Traitement par la Procédure de Latarjet
Cette étude porte sur 50 cas de luxations récidivantes de l'épaule traités par la procédure de Latarjet à l'hôpital militaire Avicenne de Marrakech entre 2002 et 2007. L'âge moyen des patients était de 29 ans, avec une prédominance masculine (84%). 96% des luxations étaient traumatiques. Le diagnostic reposait sur des examens radiologiques standard (dont la recherche de lésions de Bankart et de Hill-Sachs) et un examen clinique (test d'appréhension, test du tiroir antérieur). L'objectif principal était d'évaluer l'efficacité de la procédure de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure de l'épaule et d'analyser les résultats à court et moyen terme.
1. Présentation de l étude et population étudiée
Cette étude rétrospective, menée à l'hôpital militaire Avicenne de Marrakech sur une période de cinq ans (2002-2007), porte sur 50 cas de luxations antéro-internes récidivantes de l'épaule. La population étudiée est majoritairement masculine (84%), avec un âge moyen de 29 ans. Il est important de souligner que 96% des luxations étaient d'origine traumatique, soulignant la nature de la blessure initiale. L'étude vise à évaluer l'efficacité de la procédure chirurgicale de Latarjet dans le traitement de ces luxations récidivantes, en analysant les résultats à moyen terme. Les données recueillies incluent les informations sur le premier accident d’instabilité (circonstances, âge, type de lésion), ainsi que sur les récidives, afin de déterminer les facteurs pronostiques. L’analyse des motifs de consultation (douleur, appréhension de déboîtement, gêne fonctionnelle) complète le tableau clinique.
2. Diagnostic et examens préopératoires
Le diagnostic de luxation antéro-interne récidivante de l'épaule s'appuie sur un examen clinique rigoureux, incluant des tests spécifiques comme le test d'appréhension (positif chez 94% des patients dans l'étude) et le test du tiroir antérieur (positif dans 62% des cas). Ces tests permettent de mettre en évidence l'instabilité de l'épaule et l'appréhension du patient face à un possible déboîtement. Un bilan radiologique standard est systématiquement réalisé, comprenant des clichés de face de l'épaule en rotation interne, neutre et externe, ainsi qu'un profil axillaire et un profil glénoïdien de Bernageau. Ces examens permettent de visualiser les lésions osseuses, notamment les lésions de Hill-Sachs (identifiées chez 60% des patients) et les lésions du rebord glénoïdien antérieur (40% des cas). L’arthroscanner et l’IRM peuvent être utilisés en complément pour une meilleure visualisation des lésions du bourrelet glénoïdien.
3. Techniques chirurgicales et aspects techniques de la procédure de Latarjet
Le traitement chirurgical repose principalement sur la procédure de Latarjet, consistant en une transfert de l'apophyse coracoïde. La technique chirurgicale implique le prélèvement de la branche horizontale de l'apophyse coracoïde, puis sa fixation au bord antéro-inférieur de la glène. Le document détaille les étapes de cette intervention, notamment la préparation du greffon coracoïdien et la technique d'incision du muscle sous-scapulaire. La majorité des interventions (96%) ont utilisé une incision en «L» inversée à la jonction des 2/3 supérieurs et du 1/3 inférieur du muscle sous-scapulaire; une incision horizontale a été tentée dans les 4% restants. La fixation de la butée coracoïdienne sur la glène est réalisée à l’aide de vis, en veillant à un ajustement précis pour assurer une stabilité optimale et éviter les complications telles que la pseudarthrose ou un positionnement inadéquat du greffon. L'étude cite aussi d'autres techniques historiques comme celle de Bristow, MacMurray, Patte, Trillat.
4. Résultats postopératoires et analyse des complications
Les résultats postopératoires de la procédure de Latarjet montrent un taux de succès élevé. 94% des patients ont été complètement soulagés de leurs douleurs, et la stabilité de l'épaule était parfaite dans 90% des cas (45 patients). De plus, 88% des patients ont récupéré une mobilité de l'épaule quasi normale. Globalement, 84% des résultats ont été jugés bons, contre 16% de résultats modérés ou mauvais. Les complications sont restées rares. Cependant, l'étude mentionne 2 cas de pseudarthrose, liés à un défaut de compression initial. La diminution de la rotation externe est une complication potentielle mentionnée, liée à la technique chirurgicale elle-même et observée dans d'autres études. Les taux de récidive sont faibles, cohérents avec les données de la littérature, soulignant l'efficacité de la procédure de Latarjet dans la stabilisation de l'épaule dans le cas de luxations récidivantes.
II.Technique Chirurgicale de Latarjet et Préparation du Greffon Coracoïdien
La procédure de Latarjet impliquait le prélèvement de la portion horizontale de l'apophyse coracoïde et sa fixation au bord antéro-inférieur de la glène. Différentes techniques d'incision du sous-scapulaire ont été utilisées (incision en L inversée dans 96% des cas). L'accent est mis sur la précision du positionnement du greffon coracoïdien pour optimiser la stabilisation de l'articulation gléno-humérale et prévenir la pseudarthrose.
1. Prélèvement et Préparation du Greffon Coracoïdien
La préparation du greffon coracoïdien est une étape cruciale de la procédure de Latarjet. Elle commence par l'excision de l'aponévrose clavi-pectoro-axillaire pour exposer la branche horizontale de l'apophyse coracoïde. Les bords interne et externe du tendon conjoint coraco-biceps sont ensuite disséqués, et l'hémostase de la branche acromiale de l'artère acromio-thoracique est réalisée. La bourse sous-coracoïdienne est effondrée pour permettre un repérage précis de la face profonde de l'apophyse coracoïde. La libération de la branche horizontale se fait médialement à l'insertion du petit pectoral à l'aide d'un bistouri électrique. Latéralement, le ligament coraco-acromial est sectionné, laissant environ un centimètre inséré à la butée. L'ostéotomie de la branche horizontale et d'une partie de la corticale antérieure de la portion verticale de l'apophyse coracoïde est ensuite effectuée à la scie ou au ciseau, créant ainsi le greffon osseux.
2. Fixation du Greffon et Préparation de la Glène
Une fois le greffon coracoïdien préparé, il est positionné sur la glène, dont la partie antéro-inférieure a été préalablement avivée à la rugine jusqu'au bord antérieur du triceps au pôle inférieur. Le positionnement du greffon doit être parfaitement affleurant à la surface cartilagineuse glénoïdienne et descendre jusqu'au pôle inférieur de la glène pour combler l'évidement. La fixation se fait à l'aide d'une ou plusieurs vis, introduites après forage. Le serrage des vis doit être suffisamment ferme pour assurer une bonne compression et une butée stable, mais pas trop pour éviter une fracture de la coracoïde. Avant le serrage définitif, l'exploration de l'articulation (capsule, labrum, tête humérale et rebord glénoïdien) est effectuée pour s'assurer de la bonne position du greffon et de l'absence d'autres lésions. La description précise de l'opération souligne l'importance de la précision et de la technique chirurgicale.
3. Techniques d Incision du Sous scapulaire
L'étude décrit deux principales techniques d'incision du muscle sous-scapulaire : une incision en «L» inversée, utilisée dans 96% des cas, et une incision horizontale dans le sens des fibres, pour les 4% restant. L’incision en «L» inversée est effectuée à la jonction des 2/3 supérieurs et du 1/3 inférieur du muscle. En position de rotation externe maximale, la portion verticale de l'incision est réalisée à la jonction tendino-musculaire à l'aide d'un bistouri électrique. Bien que l'abord horizontal préserve davantage les structures anatomiques et fonctionnelles du muscle sous-scapulaire, il rend l'intervention plus difficile en raison de l'exposition réduite de l'articulation. La plupart des auteurs actuels privilégient une incision horizontale à la jonction du 1/3 moyen et du 1/3 inférieur du muscle.
4. Suture et Fermeture
Après la fixation du greffon coracoïdien, le muscle sous-scapulaire est suturé avec des points en X de fils non résorbables, sans paletot. La tranche de section de la coracoïde est cirée. Un drainage aspiratif est mis en place avant la fermeture du sillon delto-pectoral. La rééducation postopératoire débute après le retrait des drains, avec une immobilisation du coude contre le corps et une rotation interne de l'épaule. La mobilisation progressive de la main, du poignet et du coude est ensuite initiée, suivie d'un travail pendulaire dès que possible et sans douleur. Une phase de récupération sans immobilisation, de la 3ème à la 6ème semaine, vise à la récupération progressive des amplitudes articulaires, évitant les mouvements luxants dans les premières semaines.
III.Résultats et Complications de la Procédure de Latarjet
Les résultats ont montré un taux élevé de succès: 94% des patients étaient complètement soulagés de la douleur. La stabilité de l'épaule était parfaite dans 45 cas (90%), et la mobilité a été restaurée dans 88% des cas. Les complications, telles que la pseudarthrose (2 cas) et la diminution de la rotation externe, étaient rares. Le taux de récidive était faible, comparable aux données de la littérature (0-14%). L'étude souligne l'importance du positionnement précis du greffon coracoïdien pour minimiser le risque de complications et optimiser les résultats fonctionnels à long terme. L'hôpital Avicenne de Marrakech a joué un rôle central dans cette recherche.
1. Résultats Fonctionnels de la Procédure de Latarjet
L'étude rapporte un taux de réussite élevé de la procédure de Latarjet dans le traitement des luxations récidivantes de l'épaule. 94% des 50 patients inclus ont obtenu une disparition complète de la douleur postopératoire, témoignant de l'efficacité de la technique pour soulager la symptomatologie douloureuse. La stabilité de l'épaule s'est avérée parfaite dans 45 cas (90%), démontrant la capacité de la procédure à restaurer la stabilité articulaire et à prévenir les récidives de luxation. En termes de mobilité, 88% des patients ont retrouvé leur amplitude articulaire initiale, indiquant une récupération fonctionnelle satisfaisante. Globalement, 84% des résultats ont été considérés comme bons, soulignant le succès de la procédure de Latarjet dans cette série de cas. Ces résultats positifs mettent en avant l'efficacité de cette technique chirurgicale dans le traitement des luxations récidivantes de l'épaule.
2. Complications Postopératoires et Taux de Récidives
Bien que la procédure de Latarjet ait démontré une grande efficacité, l'étude a relevé quelques complications. Deux cas de pseudarthrose du greffon coracoïdien ont été observés (4%), liés à un défaut de compression initial. Ce taux de pseudarthrose est comparable à des variations observées dans la littérature médicale (0 à 50%), soulignant la variabilité des résultats selon les différentes études et les techniques utilisées. Une autre complication potentielle, mentionnée dans l'étude et la littérature, est une diminution de la rotation externe. Concernant le taux de récidives de luxation, l'étude met en évidence des résultats positifs avec un faible taux, comparable à la fourchette de 0 à 14% rapportée dans d'autres études utilisant la technique de Latarjet. L'étude met ainsi en avant l'importance d'un positionnement précis du greffon pour diminuer le risque de complications et optimiser les résultats à long terme.
3. Comparaison avec la Littérature et Facteurs Influençant les Résultats
Les résultats de cette étude sur l'efficacité de la procédure de Latarjet pour le traitement des luxations récidivantes de l'épaule sont comparables aux données rapportées dans la littérature. Le taux de récidive observé est faible, cohérent avec les résultats d'autres études. Cependant, la littérature mentionne une variabilité des résultats, avec des taux de pseudarthrose allant jusqu'à 50%. Cette étude identifie des facteurs qui pourraient influencer les résultats, comme un positionnement inadéquat du greffon coracoïdien qui augmente le risque de pseudarthrose. La technique d'incision du sous-scapulaire, l'utilisation de vis unicorticales et une fixation incorrecte de la butée (trop interne ou trop externe) sont également pointées comme des facteurs potentiels de complication. L'analyse des résultats met en avant la nécessité d'une technique chirurgicale précise et d'un positionnement optimal du greffon pour minimiser les risques de complications et maximiser les chances de succès de la procédure de Latarjet.
IV.Analyse de la Stabilité et de la Mobilité Postopératoire
L'analyse de la stabilité postopératoire a démontré des résultats comparables à ceux rapportés dans la littérature concernant la procédure de Latarjet, avec un faible taux de récidives. Concernant la mobilité, 88% des patients ont retrouvé leur niveau fonctionnel initial. La perte de mobilité concernait principalement la rotation externe, une complication reconnue dans la littérature. L’arthrose postopératoire est une complication possible mentionnée.
1. Stabilité de l Épaule après la Procédure de Latarjet
L'analyse de la stabilité de l'épaule après la procédure de Latarjet révèle des résultats encourageants. Le taux de récidive de luxation est faible dans cette série, comparable aux données de la littérature qui rapportent un taux variable entre 0 et 14% pour cette technique. Cette faible incidence de récidive souligne l'efficacité de la procédure dans la restauration de la stabilité gléno-humérale. Les causes possibles de récidives, selon la littérature, incluent les pseudarthroses, les fractures ou les lyses du greffon coracoïdien. Un positionnement précis et adéquat de la butée coracoïdienne est donc crucial pour minimiser ce risque. La parfaite stabilité de l'épaule a été observée chez 45 patients sur 50 (90%), confirmant la solidité de la stabilisation obtenue par la procédure de Latarjet dans cette étude.
2. Mobilité de l Épaule Postopératoire
Concernant la mobilité de l'épaule après la procédure de Latarjet, l'étude montre que 44 patients sur 50 (88%) ont retrouvé leur niveau fonctionnel initial. Cependant, 6 patients (12%) n'ont pas retrouvé l'amplitude articulaire préopératoire. La diminution de la mobilité concernait principalement la rotation externe, une complication signalée également dans la littérature. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce déficit de rotation externe, notamment la technique chirurgicale employée (incision du sous-scapulaire), la présence d'arthrose postopératoire (complication potentielle à long terme), ou un positionnement non optimal du greffon coracoïdien. L’étude souligne que bien que la technique d'incision horizontale du sous-scapulaire soit plus respectueuse des structures anatomiques et fonctionnelles, elle peut rendre l'intervention techniquement plus difficile en réduisant l'exposition de l'articulation.
