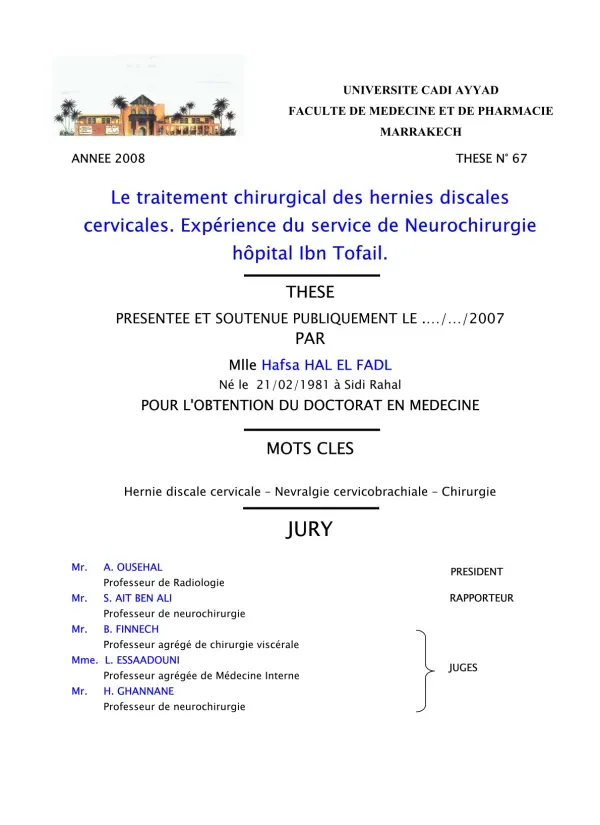
Traitement Chirurgical des Hernies Discale Cervicales
Informations sur le document
| Auteur | Hafsa Hal El Fadl |
| École | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech |
| Spécialité | Médecine |
| Lieu | Marrakech |
| Type de document | thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 7.17 MB |
- Chirurgie
- Hernie discale cervicale
- Neurochirurgie
Résumé
I.Hernie Discale Cervicale et Unco discarthrose Diagnostic et Imagerie
L'article détaille les aspects diagnostiques et thérapeutiques de la hernie discale cervicale et de l'unco-discarthrose, deux manifestations de la dégénérescence discale. Longtemps confondues, ces pathologies sont aujourd'hui distinguées grâce aux progrès de la tomodensitométrie et surtout de l'imagerie par résonance magnétique (IRM). L'IRM, en particulier, offre une meilleure visualisation des structures anatomiques, notamment le canal rachidien et la moelle épinière, permettant une analyse précise des lésions. L'examen permet de visualiser une hernie discale calcifiée, une uncarthrose, et de mesurer les dimensions canalaires pour détecter un canal cervical étroit. La myélographie, méthode plus ancienne, est mentionnée comme moins précise. Le diagnostic nécessite souvent une injection intraveineuse de produit de contraste pour l'IRM, en raison de la faible quantité de graisse épidurale antérieure dans la région cervicale.
1. Hernie Discale Cervicale et Unco discarthrose Définition et Confusion passée
Le texte introduit la hernie discale molle et l’unco-discarthrose comme deux expressions anatomiques distinctes d'une même maladie : la dégénérescence discale. Ces deux affections ont été longtemps confondues en raison de la similitude de leurs symptômes, notamment la compression médullaire, et des limitations de la myélographie, technique d'imagerie ancienne. La difficulté du diagnostic différentiel est soulignée, notamment à cause de l’imprécision de la myélographie pour différencier précisément ces deux pathologies.
2. Importance de l Imagerie par Résonance Magnétique IRM
L'évolution des techniques d'imagerie médicale a permis de clarifier le diagnostic différentiel entre hernie discale cervicale et unco-discarthrose. L’article met en avant l'importance de l'imagerie par résonance magnétique (IRM), considérée comme supérieure à la tomodensitométrie pour l'exploration du rachis cervical. La haute sensibilité de l'IRM et sa capacité de caractérisation tissulaire sont mises en avant. L'IRM apporte une dimension longitudinale cruciale grâce aux coupes sagittales, essentielle pour l'analyse globale du canal rachidien et de la moelle épinière. L'examen permet d'analyser la structure osseuse, de mettre en évidence des ostéophytes, une hernie discale calcifiée, une uncarthrose, et un canal cervical étroit grâce à la mesure des dimensions canalaires. L'article précise cependant que la technique IRM nécessite une rigueur particulière, notamment l’utilisation de coupes fines et parfois une injection intraveineuse de produit de contraste pour améliorer la visualisation, en raison de la faible quantité de graisse épidurale antérieure au niveau cervical. Des détails sont donnés concernant la procédure d'examen IRM, incluant l’importance de l’immobilité du patient et la nécessité d’éviter les mouvements pendant l’acquisition des images.
3. Tomodensitométrie et Myélographie Méthodes d Imagerie Anciennes
Bien que l'IRM soit présentée comme la méthode d'imagerie la plus performante, le texte mentionne également la tomodensitométrie et la myélographie. La tomodensitométrie est évoquée comme ayant des limites par rapport à l'IRM. La myélographie, méthode plus ancienne utilisant des produits de contraste injectés dans l'espace sous-arachnoïdien, est décrite comme imprécise. L’évolution des techniques de myélographie, avec l’introduction de produits de contraste plus performants et mieux tolérés, est brièvement mentionnée. L'article souligne le rôle historique de la myélographie dans l'exploration médullo-rachidienne, avant l'avènement des techniques d'imagerie plus modernes. Un aspect important mentionné est la sémiologie tomodensitométrique de la hernie discale, décrite comme hypodense par rapport aux tissus épiduraux qui captent le contraste. L’utilisation de produits de contraste ioniques est abordée, mettant en garde contre les risques neurotoxiques en cas d'injection intra-thécale. L'indice de Pavlov, utilisé pour estimer la taille du canal rachidien, est également mentionné, soulignant la relation entre la taille du canal et l’importance des ostéophytes.
II.Exploration Neurologique et Électromyographie EMG
L’exploration neurologique inclut l’électromyographie (EMG), essentielle pour le diagnostic électrophysiologique. L’EMG explore l'activité électrique musculaire et la conduction nerveuse. Elle permet de détecter une dénervation active ou chronique, souvent tardive et présente uniquement en cas de participation motrice. L'examen est utilisé pour diagnostiquer le Syndrome de Parsonage-Turner, une atteinte pluriradiculaire prédominant au niveau de C5. Les résultats de l'EMG, combinés aux autres examens, aident à différencier entre une pathologie radiculaire, tronculaire ou plexique.
1. L électromyogramme EMG Un outil essentiel du diagnostic neurologique
L’article souligne l’importance de l’électromyographie (EMG) dans le diagnostic des pathologies du rachis cervical. L'EMG est présentée comme un examen primordial pour le diagnostic électrologique, comprenant deux parties distinctes. La première partie explore l'activité électrique des muscles en utilisant des aiguilles électrodes fines, permettant d’évaluer l'état des muscles. Il est précisé que cet aspect de l’examen est peu invasif et présente peu de risque de saignement ou d'infection, les aiguilles étant à usage unique et stériles. Une alternative avec des électrodes de surface est mentionnée pour les patients présentant une contre-indication à la piqûre (traitement anticoagulant). Cependant, les informations recueillies sont moins précises dans ce cas. La deuxième partie de l’EMG explore la conduction nerveuse, c’est-à-dire la circulation de l'influx nerveux le long des nerfs. Cette partie comprend l'exploration des nerfs moteurs et sensitifs, en stimulant le nerf par des impulsions électriques de très faible intensité. L’examen est décrit comme rapide et sans risque, même pour les patients cardiaques ou porteurs de pacemakers.
2. Analyse de l EMG et Interprétation des Résultats
L’analyse de l’électromyogramme repose sur l'étude de divers paramètres des potentiels d'unité motrice : richesse des tracés, amplitude, durée, fréquence et morphologie. L'analyse classique est décrite comme une opération longue, contrairement à l’analyse automatisée rendue possible par l’informatisation. Divers dispositifs utilisant des filtres de fréquences ont été développés pour automatiser cette analyse. Concernant l’interprétation des résultats, l’article cite Bouche (18), qui souligne que l’efficacité des techniques électrophysiologiques ne fait pas encore l’unanimité. La détection de signes de dénervation active ou chronique est souvent tardive et limitée aux cas avec participation motrice. Bien que des méthodes plus nouvelles existent (potentiels évoqués somesthésiques, stimulations électriques ou magnétiques des racines cervicales), l’EMG traditionnel garde un intérêt majeur, notamment pour éliminer une pathologie tronculaire ou plexique.
3. Syndrome de Parsonage Turner et Applications Cliniques de l EMG
Le document utilise l’EMG dans le contexte du diagnostic différentiel, notamment en évoquant le Syndrome de Parsonage-Turner. Ce syndrome, caractérisé par un début hyperalgique suivi d'une paralysie amyotophiante du moignon de l'épaule, est confirmé par l'EMG qui montre une atteinte pluriradiculaire prédominant au niveau de C5, sans déficit sensitif. L’article souligne que l’étiologie de ce syndrome reste incertaine (ischémie médullaire aiguë ou affection virale). En pratique clinique, l'EMG est utilisée dans le cadre d'une névralgie cervicobrachiale, d'un syndrome rachidien cervical ou de troubles neurologiques des membres supérieurs. Elle est intégrée dans un processus diagnostique plus large incluant des radiographies standards et une IRM afin d’éliminer d’autres pathologies.
III.Traitement de la Hernie Discale Cervicale Approches Chirurgicales
Le traitement de la hernie discale cervicale peut être médical ou chirurgical. L'approche chirurgicale dépend de la localisation et de la sévérité de la hernie (hernie discale molle postéro-latérale, hernie discale médiane). Deux voies d'abord principales sont décrites : l'abord antérieur, privilégié pour les hernies discales médianes ou les symptomatologies médullaires, permettant un accès direct à la lésion et une reconstruction de la statique rachidienne par arthrodèse/ostéosynthèse; et l'abord postérieur, une alternative pour les hernies postéro-latérales à symptomatologie radiculaire aiguë. Plusieurs techniques chirurgicales sont mentionnées, incluant la discectomie, la discectomie percutanée manuelle ou semi-automatique, la discectomie percutanée au laser, et le remplacement prothétique du disque (prothèse de remplacement discal), cette dernière cherchant à préserver la mobilité cervicale tout en gardant à l'esprit le risque de dégénérescence arthrosique des étages adjacents. L'utilisation de plaque est discutée, offrant une meilleure stabilisation pour l'arthrodèse et pouvant réduire la durée d’hospitalisation. La corporéctomie peut également être utilisée.
1. Voies d abord chirurgicales Antérieure vs Postérieure
Le texte détaille les différentes approches chirurgicales pour le traitement de la hernie discale cervicale, en distinguant principalement deux voies d'abord : antérieure et postérieure. La voie postérieure, historiquement la première utilisée, est mentionnée comme ayant des indications qui se sont réduites au profit de la voie antérieure. Onimus (85) et Faillot (41) indiquent que l'abord antérieur est formellement indiqué en cas de hernie discale médiane ou de symptomatologie médullaire associée à une radiculopathie. Un abord antérieur est également préférable en présence d'une composante ostéophytique ou d'une déformation sagittale en cyphose, permettant la correction par interposition d'un greffon. La voie postérieure est considérée comme une alternative à l'abord antérieur pour les hernies discales molles postéro-latérales avec une symptomatologie radiculaire aiguë, notamment pour un geste chirurgical rapide. Kehr (64) souligne que le traitement chirurgical moderne privilégie l'abord antérieur pour son accès direct aux lésions et sa capacité à reconstruire la statique rachidienne grâce à l'arthrodèse/ostéosynthèse.
2. Techniques chirurgicales Discectomie et Arthrodèse
Plusieurs techniques chirurgicales sont mentionnées, centrées sur la discectomie. Nohra (84) rapporte une étude sur 101 patients opérés par voie antérieure, avec des résultats à court et long terme jugés bons dans les deux groupes (avec ou sans greffe). La discectomie sans greffe est associée à moins de complications, moins de douleur postopératoire et un temps opératoire plus court. Tavernier (108) indique que la discectomie sans greffe est la technique la plus répandue pour les hernies molles, tandis que la mise en place d'un greffon est réservée aux lésions disco-ostéophytiques importantes. Onimus (85), citant Yamamoto, souligne que le risque de douleurs cervicales postopératoires après discectomie sans greffe est plus élevé en cas de névralgie cervico-brachiale sur arthrose préexistante. L'arthrodèse, souvent associée à l'ostéosynthèse, est mentionnée comme une technique de reconstruction de la statique rachidienne. L'utilisation de plaques antérieures est discutée, permettant une meilleure stabilisation, une discectomie à plusieurs niveaux, une diminution de la cyphose postopératoire et une réduction du temps d'hospitalisation (selon différents auteurs, 59, 63, 113, 114, 115, 103). Une méta-analyse de 103 patients confirme cet avantage pour les traitements ambulatoires (2).
3. Techniques Mini Invasives et Remplacement Discal
Le document mentionne des techniques moins invasives, comme la discectomie percutanée manuelle ou semi-automatique, utilisant des instruments de moins de 3 mm, permettant une visualisation intradiscale par micro-vidéo-endoscopie et une cicatrisation minimale. La discectomie percutanée au laser est aussi décrite, réalisée sous anesthésie locale avec sédation, via un abord postéro-latéral. Une étude prospective d'un an par Gozlan (51) sur 29 patients ayant subi une nucléotomie percutanée au laser montre de bons résultats à court terme (72% de succès à 3 mois), mais des complications sont observées à plus long terme. L'article aborde également la place de la prothèse de remplacement discal, visant à préserver la mobilité cervicale et à réduire le risque de dégénérescence arthrosique des étages adjacents. Cependant, ce risque de remaniement arthrosique radiologique est estimé jusqu’à 92% par certains auteurs (48, 117), même si l'incidence des manifestations cliniques reste faible (2.6% par an) (63). L'absence d'éléments prédictifs pour ce risque est soulignée (63).
