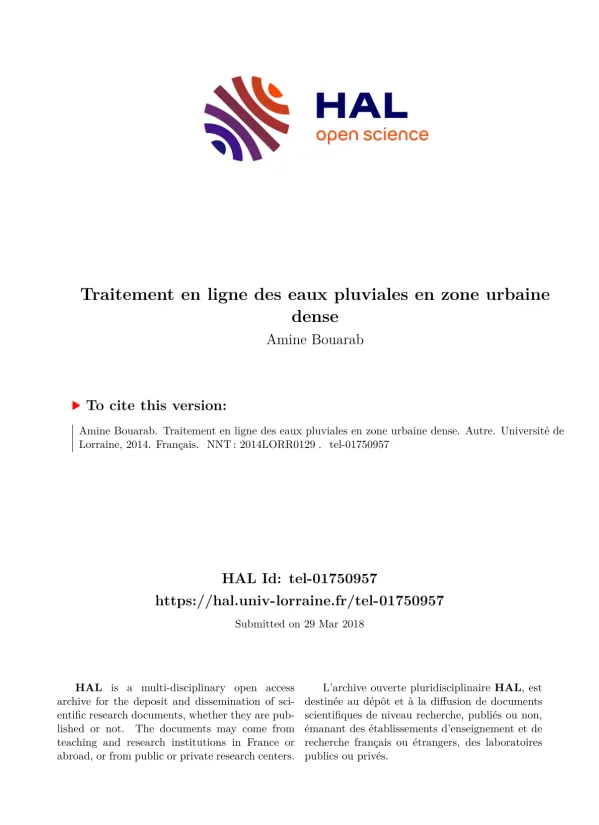
Traitement des Eaux Pluviales en Milieu Urbain Dense
Informations sur le document
| Auteur | Amine Bouarab |
| instructor/editor | Marie-Noëlle Pons |
| École | Université de Lorraine |
| Spécialité | Génie des Procédés et des Produits |
| Type de document | Thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 11.96 MB |
- eaux pluviales
- urbanisme
- traitement des eaux
Résumé
I.Gestion des Eaux Pluviales Urbaines à Grand Nancy Caractérisation et Modélisation de l Ouvrage Charles Keller
Cette étude se concentre sur la gestion des eaux pluviales urbaines (EPU) et la lutte contre les inondations urbaines dans la Communauté Urbaine du Grand Nancy (CUGN). L'accent est mis sur la caractérisation et la modélisation de l'ouvrage Charles Keller, un bassin de stockage temporaire de 7000 m³ destiné au traitement des EPU du bassin versant de Boudonville. Ce travail vise à évaluer l'efficacité du traitement physico-chimique mis en œuvre, en analysant notamment les processus de décantation, de floculation-coagulation, et en tenant compte des problématiques de ruissellement urbain et de pollution liée aux surfaces imperméables. L'étude utilise des modèles mathématiques pour simuler le fonctionnement du système (bassin versant, ouvrage Charles Keller, station d'épuration de Maxéville), afin d'optimiser la gestion des EPU et de réduire l'impact sur le milieu récepteur.
1. Contexte et Problématique des Eaux Pluviales Urbaines
L'étude s'inscrit dans le contexte de la Directive Cadre Européenne sur l'Eau (2000/60/CE) visant à atteindre le bon état écologique des milieux aquatiques d'ici 2015. Le traitement des rejets urbains de temps de pluie (RUTP) est crucial, notamment en raison de l'urbanisation croissante. L'imperméabilisation des sols accélère le ruissellement, diminuant l'infiltration et surchargeant les réseaux d'assainissement, causant des débordements et des inondations. La concentration des polluants est aggravée par la dilution des eaux usées, la remise en suspension des sédiments et le lessivage des polluants accumulés sur les surfaces imperméables. Cette double contrainte (hydrodynamique et qualité de l'eau) rend les techniques classiques de gestion des eaux usées urbaines inefficaces, nécessitant le développement de nouvelles approches plus performantes en matière de stockage temporaire et de traitement en ligne.
2. L Ouvrage Charles Keller Présentation et Objectifs de l Etude
L'étude porte sur l'ouvrage Charles Keller, un ouvrage expérimental de traitement en ligne des eaux pluviales situé à Nancy, dans le bassin versant de Boudonville (CUGN). Cet ouvrage, d'une capacité de 7000 m³, a été conçu pour traiter les eaux pluviales d'un bassin versant fortement urbanisé. La démarche de recherche s'articule autour de deux axes : la caractérisation des eaux pluviales du bassin versant de Boudonville et le suivi du fonctionnement de l'ouvrage Charles Keller. L'objectif final est de modéliser le système global, incluant le bassin versant, l'ouvrage Charles Keller et la station d'épuration de Maxéville, afin d'optimiser le traitement des eaux pluviales et de mieux comprendre les interactions entre les différents composants du système d'assainissement. L'étude vise à proposer des améliorations pour la gestion des eaux pluviales urbaines dans un contexte d'urbanisation dense.
3. Gestion des Eaux Pluviales Contraintes et Solutions Alternatives
L'inondation des zones urbaines lors de précipitations extrêmes représente un problème majeur, engendrant des coûts économiques importants et des risques pour la sécurité des personnes. L'extension des réseaux d'évacuation devient de plus en plus coûteuse. Les ouvrages de stockage temporaire constituent une solution alternative pour écrêter les débits de crue et protéger les réseaux existants. Différentes techniques sont envisagées, allant du contrôle en temps réel des ouvrages de gestion à des techniques de stockage temporaire plus complexes, incluant des systèmes de vannes et de pompes. L'absence de traitement biologique permet de gérer des débits importants de manière autonome et dynamique, bien que les pannes d'appareils électromécaniques représentent un risque potentiel.
II.Composition des Eaux Pluviales Urbaines et Impact de l Urbanisation
L'urbanisation augmente considérablement le volume des eaux de ruissellement, réduit les temps de concentration et accroît la fréquence des pics de débit. La composition des eaux pluviales urbaines est analysée, soulignant la contribution de la pollution atmosphérique et du lessivage des polluants accumulés sur les surfaces imperméables. L'importance des premiers flux, transportant plus de 80% de la masse polluante, est mise en avant. Les polluants clés incluent les matières en suspension (MES), la demande chimique en oxygène (DCO), les métaux lourds (Cd, Cu, Zn, Pb), et les éléments organiques. La gestion classique par déversoirs d'orage se révèle insuffisante, justifiant le développement de techniques alternatives.
1. Impact de l Urbanisation sur les Eaux Pluviales
Les transformations de l'environnement urbain affectent profondément les écoulements et la qualité des eaux pluviales. L'urbanisation modifie les bassins versants, augmentant le volume des eaux ruisselées et diminuant les temps de concentration. Il en résulte des hyétogrammes avec des pics de débit plus importants, comme l'ont démontré Codner et al. (1988) et Mein et Goyen (1988). Cette augmentation des volumes d'eau à traiter sature les systèmes d'assainissement, notamment les réseaux d'égouts et les stations d'épuration, conduisant à un déversement direct et non traité dans le milieu naturel, avec des conséquences néfastes pour la qualité de l'environnement. Historiquement, les eaux pluviales étaient considérées comme peu polluées, mais cette approche s'est révélée inadéquate face à la réalité de la pollution urbaine. Des politiques de gestion alternatives sont devenues nécessaires, combinant parfois des techniques classiques et innovantes.
2. Composition Chimique des Eaux Pluviales Urbaines
La pollution des eaux pluviales provient de deux sources principales : l'atmosphère et le sol. La pollution atmosphérique, généralement faible sauf en cas d'activité industrielle intense, acidifie les eaux de pluie et peut être transportée sur de longues distances. Elle contribue à la pollution accumulée en surface entre les pluies, représentant 0,6 à 3% des MES selon Thévenot (1992). Les eaux pluviales contiennent des concentrations non négligeables de métaux (Cd, Cu, Zn, Pb), comme l'ont déterminé Gehin et al. (2008). La composition chimique dépend également du pH et de l'agressivité physique de la pluie (intensité et durée). Bertrand-Krajewski (1998) a mis en évidence l'importance des premiers flux d'une pluie, qui transportent plus de 80% de la masse des polluants accumulés sur le bassin versant. La littérature confirme que 70 à 80% de la pollution est entraînée par les premiers 20 à 30% du volume de l'événement pluvial (Wanielista et Yousef, 1993 ; Sansalone et Buchberger, 1997 ; Bertrand-Krajewski et al., 1998 ; Deletic, 1998 ; Deletic et Maksimovic, 1998).
III.Techniques de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines Alternatives aux Systèmes Classiques
Face aux limites des systèmes d'assainissement classiques, l'étude explore des techniques alternatives de gestion des EPU. L'infiltration des eaux dans le sol, le stockage temporaire dans des bassins de rétention secs ou en eau, et des ouvrages de prétraitement (dessablage) sont abordés. La faisabilité de ces solutions est évaluée en fonction des caractéristiques hydrologiques du bassin versant et des contraintes spécifiques du milieu urbain dense. L'utilisation de bassins de rétention est explorée comme solution alternative aux problèmes de gestion des EPU dans les zones fortement urbanisées. Le colmatage des systèmes d'infiltration est aussi discuté.
1. Techniques Classiques d Assainissement et Leurs Limites
L'implantation des réseaux d'assainissement visait initialement à améliorer la salubrité des agglomérations en évacuant rapidement les eaux usées vers le milieu naturel (Chocat et al., 1997). Cependant, l'augmentation des volumes d'eaux pluviales liés à l'imperméabilisation des sols a saturé ces systèmes, entraînant des débordements et des inondations. A partir des années 1970, des réseaux secondaires et des bassins de rétention ont été construits pour renforcer les capacités d'évacuation. Vers les années 1980, les préoccupations environnementales ont mis en lumière la pollution liée au ruissellement. La directive cadre européenne ERU 16 (1991) et la loi sur l'eau (1992) ont favorisé l'émergence de techniques alternatives plus respectueuses de l'environnement. Ces techniques offrent une alternative efficace à la gestion classique, en combinant la protection contre les inondations à une meilleure gestion de la pollution, tout en réduisant la charge sur les stations d'épuration. Les systèmes unitaires initiaux, où eaux usées et eaux pluviales étaient mélangées, ont évolué vers des systèmes plus sophistiqués pour limiter les problèmes. Les travaux d'Albert Caquot (circulaire 1333 de 1949) ont apporté des avancées significatives dans la conception des réseaux d'assainissement.
2. Techniques Alternatives de Gestion des Eaux Pluviales
Plusieurs techniques alternatives sont présentées pour gérer efficacement les eaux pluviales urbaines. L'infiltration des eaux dans le sol permet de réduire la charge sur les réseaux d'assainissement et de recharger les nappes phréatiques. Ces ouvrages d'infiltration, installables à proximité de la source ou centralisés, peuvent être à l'air libre ou enterrés. Leur efficacité dépend de la capacité d'infiltration du sol, de son humidité et de la surface mobilisée. L'association avec des ouvrages de prétraitement améliore leur durée de vie en réduisant le colmatage. Le stockage temporaire des eaux pluviales, dans des bassins de rétention secs ou en eau, permet de réguler les débits de crue et de réduire les risques d'inondation. Les bassins secs, peu profonds et vides entre deux événements pluviaux, favorisent la décantation des matières en suspension. Les bassins en eau, plus profonds, utilisent la décantation gravitaire et permettent l'élimination de la pollution organique par les systèmes aquatiques qui s'y développent. Cependant, le temps de séjour limité et le risque de gel en climat froid constituent des limites à ces techniques. L'optimisation des dimensions et de la forme des bassins est cruciale pour leur efficacité.
3. Exemples de Traitements et leurs Efficacités
Le document cite l'exemple de 165 dessableurs installés sur le réseau de collecteurs du Val de Marne, avec un rendement de 60% en raison de court-circuits et de réentraînement lors des forts débits. La décantation et la sédimentation, procédés de séparation solide/liquide basés sur la gravité, sont également abordés. L'efficacité de la rétention dépend des caractéristiques hydrologiques du bassin versant et de l'écoulement à l'intérieur de l'ouvrage, afin d'éviter les court-circuits. Le colmatage, diminution de la conductivité hydraulique due au dépôt de particules solides et au développement de biofilm, est un facteur important à considérer pour une gestion efficace à long terme (Schuh, 1990; Lindsey et al., 1992; Waarmars et al., 1999; Gautier et al., 1999; Le Coustumer et Barraud, 2007). Des techniques de traitement plus complexes, impliquant des vannes, des pompes et un centre de contrôle, permettent une gestion en temps réel et une amélioration de la capacité de traitement. L'intégration d'opérations unitaires (prétraitement, traitement primaire, traitement physico-chimique) peut optimiser le processus.
IV.Modélisation et Simulation du Système d Assainissement
La modélisation du système d'assainissement global, incluant le bassin versant de Boudonville, l'ouvrage Charles Keller, et la station d'épuration de Maxéville, est réalisée à l'aide de modèles mathématiques. Le logiciel Infoworks CS est utilisé pour simuler le fonctionnement du réseau d'assainissement en temps sec et en temps de pluie. L'objectif est de fournir une vision intégrée de la qualité et de la quantité des EPU traitées, en tenant compte des différents paramètres influençant le système. Les limites de la modélisation globale, notamment l'effet global des eaux sur le milieu récepteur, sont discutées. La modélisation permet d'évaluer l'efficacité du traitement physico-chimique et de proposer des scénarios d'amélioration.
1. Modèles Mathématiques en Hydrologie Urbaine
L'estimation de la qualité et de la quantité des eaux pluviales en zones urbaines repose sur des modèles statistiques, plus précisément des modèles de régression. Ces modèles relient les quantités mesurées (débit) à des paramètres physiques mesurables (intensité de la pluie, occupation du sol, coefficient de ruissellement, pente du bassin versant). Un exemple de modèle de régression non linéaire est mentionné, illustrant la relation entre les données mesurées et les paramètres du bassin versant. L'utilisation de ces modèles permet une meilleure compréhension des processus hydrologiques en milieu urbain et une prédiction plus précise des volumes et de la qualité des eaux de ruissellement. La précision des résultats dépend de la qualité des données d'entrée et de la pertinence du modèle choisi par rapport aux spécificités du site étudié. La modélisation permet également d'évaluer l'impact des aménagements urbains sur le ruissellement et la qualité des eaux.
2. Modélisation Globale des Systèmes d Assainissement Apports et Limites
La modélisation globale des systèmes de gestion des eaux, imposée par la directive cadre européenne sur l'eau, offre une vision intégrée et pluridisciplinaire du système. Elle prend en compte les eaux de surface, souterraines et littorales, introduisant de nouveaux concepts dans la gestion des masses d'eau (Roche et al., 2005). Les modèles mathématiques développés ont permis de répondre aux besoins d'hygiène publique et de protection contre les inondations, puis ont intégré la problématique de la qualité de l'eau pour la préservation des écosystèmes (Rauch et al., 2002). Cependant, la modélisation globale ne prend pas toujours en compte l'effet global des eaux sur le milieu récepteur, se concentrant sur les paramètres les plus représentatifs. La sélection de paramètres et de processus ayant un impact direct sur la qualité du milieu récepteur permet de simplifier le modèle et d'identifier les polluants clés et la période de simulation nécessaire. Cette approche permet de considérer le temps de dégradation des polluants à long terme, contrairement aux événements individuels et isolés qui offrent une vision limitée de l'accumulation de la pollution et de ses impacts (appauvrissement en oxygène, modification de l'hydrodynamique).
3. Modélisation du Système du Bassin Versant de Boudonville
Le logiciel Infoworks CS (version 8.5.0.15014) est utilisé pour simuler le fonctionnement du bassin versant de Boudonville, en temps sec et en temps de pluie. Le modèle simule le réseau d'assainissement et ses ouvrages élémentaires, prenant en compte le débit et la composition des eaux en pollution. La calibration du modèle nécessite l'ajustement de paramètres comme le coefficient de ruissellement (Cr), dont différentes valeurs sont testées (Cr1 = 0.98, Cr2 = 0.8, Cr3 = 0.35). Le coefficient de ruissellement est un facteur crucial dans l'estimation des volumes d'eau ruisselés. La validation du modèle est confrontée à un problème de non-correspondance des pas de temps entre les données mesurées (limnimètres) et simulées. Les limnimètres enregistrent une valeur à chaque changement de niveau, contrairement au pas de temps constant du modèle. Ce décalage pose un problème pour une estimation numérique précise de la performance du modèle.
V.Résultats et Analyse du Traitement Physico Chimique à l Ouvrage Charles Keller
Les résultats des analyses montrent l’efficacité du traitement physico-chimique à l'ouvrage Charles Keller, notamment pour l'élimination des MES. Cependant, l'étude souligne la difficulté de gérer le traitement physico-chimique en temps réel face à la variabilité des caractéristiques de la pollution. L’utilisation de coagulants/floculants, dont la performance est testée, est analysée, ainsi que l'intérêt de solutions agro-sourcées. L'impact de l'ouvrage sur la qualité des eaux rejetées dans la Meurthe est également évalué par couplage avec un modèle de la station d'épuration de Maxéville. L'étude conclut sur l'intérêt du traitement en ligne des EPU, même si des optimisations restent possibles concernant la gestion de la vidange de l'ouvrage.
1. Suivi du Fonctionnement de l Ouvrage Charles Keller
Un suivi quotidien de l'azote global et du carbone organique dissous a été effectué après un événement pluvieux du 4 au 5 mars 2012. Des prélèvements ont été réalisés à l'entrée des dessableurs et à la sortie du décanteur (eau traitée). Les résultats montrent une stabilité de l'azote global à l'entrée, variant entre 9 mg/L et 7,3 mg/L, provenant principalement du ruisseau de Boudonville. A la sortie, l'azote global augmente pour atteindre 12,3 mg/L avant de se stabiliser. Cette augmentation et la période de stabilisation correspondent approximativement au temps de séjour dans l'ouvrage. Ce suivi permet d'évaluer l'efficacité du traitement et d'identifier les variations temporelles de la qualité de l'eau. L'analyse de ces données est essentielle pour optimiser les stratégies de gestion des eaux pluviales.
2. Traitement Physico Chimique Contraintes et Essais
L'étape de floculation-coagulation de l'ouvrage Charles Keller n'a jamais été mise en service en raison de problèmes techniques et de la difficulté de gérer un tel système en contexte variable. La composition des eaux à l'entrée varie au cours de l'événement pluvieux, nécessitant théoriquement une adaptation de la dose de produits chimiques injectés. Des essais ont été réalisés avec un floculateur 10409 (Fisher Bioblock Scientific) en utilisant des eaux du ruisseau de Boudonville mélangées à des eaux résiduaires de la station d'épuration de Maxéville. Les paramètres analysés incluent le pH, les MES, la turbidité, la DCO, l'absorbance à 254 nm et l'ammonium. Les tests ont évalué l'efficacité de différents coagulants/floculants, notamment FeCl3 combiné à un floculant classique et des produits agro-sourcés. FeCl3 avec un floculant classique a montré un bon rendement sans augmentation de la teneur en fer, mais la difficulté de dosage et de préparation des produits reste un obstacle majeur. Les coagulants agro-ressourcés constituent une alternative intéressante par leur simplicité d'utilisation, mais leur pollution organique additionnelle nécessite une optimisation du dosage.
3. Impact sur la Station d Épuration et Conclusions
Un couplage avec la station virtuelle BSM2 a permis de tester l'effet de l'ouvrage Charles Keller sur une station d'épuration classique, selon quatre scénarios différents. La présence de l'ouvrage améliore la qualité globale des eaux traitées, y compris les eaux en surverse et les eaux non traitées évacuées par les déversoirs d'orage. Il est recommandé d'éviter d'envoyer les boues du décanteur vers la station d'épuration pendant l'événement pluvieux. Même avec seulement les étapes de dégrillage et de dessablage, l'ouvrage améliore la qualité du rejet global. La simulation des opérations unitaires de traitement sur une longue période a mis en évidence l'efficacité des dessableurs et l'intérêt d'inclure la coagulation/floculation. Les essais en jar-test montrent l'efficacité du traitement chimique sur la pollution colloïdale, mais un faible abattement de la pollution azotée et carbonée soluble est observé. L'utilisation de produits agro-sourcés peut engendrer une augmentation de la pollution carbonée soluble si le dosage n'est pas optimisé. La modélisation globale conclut sur les avantages du traitement en ligne des eaux pluviales pour améliorer la qualité des eaux rejetées.
