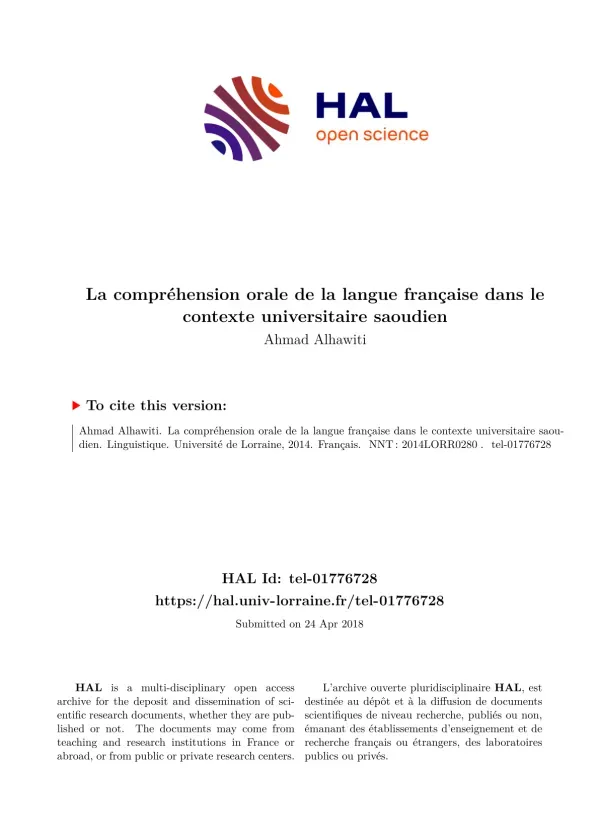
La Compréhension Orale de la Langue Française dans le Contexte Universitaire Saoudien
Informations sur le document
| Auteur | Ahmad Alhawiti |
| instructor/editor | Richard Duda |
| École | Université de Lorraine |
| Spécialité | Didactique des langues |
| Type de document | Thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 36.33 MB |
- compréhension orale
- enseignement des langues
- système éducatif saoudien
Résumé
I.Approches de la Compréhension Orale en FLE et Méthodes d Enseignement
Cette étude explore les difficultés de compréhension orale rencontrées par des étudiants saoudiens apprenant le français langue étrangère (FLE). Elle examine plusieurs méthodes d'enseignement, notamment la méthode S.G.A.V. (structuro-globale audiovisuelle), et l'utilisation de documents authentiques comme outil pédagogique clé pour l'acquisition de la langue. L'efficacité des stratégies top-down et bottom-up dans le décodage du message oral est également analysée. L'utilisation des médias (radio, télévision, internet) dans l'enseignement du français est considérée comme une ressource importante pour une approche plus communicative et engageante de l'apprentissage des langues étrangères.
1. Modèles de la compréhension orale et limites du modèle sémasiologique
Le document introduit la compréhension orale comme un processus complexe. Un premier modèle est présenté, où la signification se transmet du texte à l'auditeur par une accumulation d'informations. Cependant, ce modèle sémasiologique est critiqué car il ne parvient pas à expliquer certains phénomènes, comme l'incapacité des sujets à détecter des élisions sonores (ex: toussotement) dans des énoncés. Cette limitation a poussé les psycholinguistes à développer un modèle plus performant, qui prendrait en compte les interactions et les inférences du locuteur, ainsi que la notion de mémoire collective (Debaisieux, 1997). La phase de synthèse, où l'auditeur construit la signification globale en «additionnant» les sens des mots et des phrases, est aussi abordée. L'analyse met l'accent sur le fait que la compréhension ne repose pas uniquement sur une signification stable et pré-déterminée, mais sur l'interaction des éléments communicatifs et leur rapport à la mémoire collective des locuteurs. L'étude souligne le caractère dynamique et contextuel de la compréhension.
2. La méthode S.G.A.V. Structuro globale audiovisuelle
La méthode S.G.A.V., développée par P. Guberina dans les années 1950, est présentée comme une approche privilégiant la compréhension globale du sens à partir d'un triangle situation de communication/dialogue/image. Elle intègre des éléments audio et visuels pour faciliter l’apprentissage. Bien que cette méthode permette d’apprendre à communiquer oralement rapidement avec des natifs, elle présente des limites : elle ne prépare pas à la compréhension de conversations entre natifs ou de médias. Son implémentation exige un dispositif d'enseignement important: formations spécifiques pour les enseignants, coûts matériels (magnétophone, télévision, laboratoire de langue), et contraintes pédagogiques (nombre réduit d'apprenants, enseignement intensif). Guberina (1965) souligne le rôle de la grammaire dans l'élimination d'informations non-essentielles à la compréhension, mettant l’accent sur l’importance des phénomènes prosodiques comme l’intonation et le rythme pour une compréhension fluide et naturelle, relevant l’importance des pauses dans le rythme du langage.
3. Stratégies de compréhension orale et rôle des documents authentiques
Le texte aborde les stratégies de décodage du message oral, distinguant les stratégies top-down (hypothèses, inférences à partir du contexte) et bottom-up (décryptage du code, discrimination auditive). L’importance des documents authentiques est mise en avant, notamment par le CRAPEL (Centre de Recherche d’Applications Pédagogiques en Langues) dès les années 1970. Duda (1972) définit le document authentique comme un document dont la finalité n’est pas l’enseignement de la langue, une définition appuyée par Abe et al. (1979). Les avantages des documents authentiques résident dans leur variété, leur nouveauté, leur caractère motivant et leur contribution à l'autonomie de l'apprenant (Duda et al., 1973). Carette (2001) souligne leur aspect complet et cohérent avec la situation d’énonciation. L'exemple de l'outil pédagogique « Écoute… Écoute, objectif comprendre » illustre l’utilisation efficace des documents authentiques (interviews, dialogues, bulletins météo…) pour différents niveaux (débutant, moyen, avancé) et nationalités. La sélection des documents doit être méthodique, prenant en compte la durée, le nombre d’interlocuteurs, la situation et la qualité du son et de l’image, tout en garantissant un intérêt linguistique et culturel.
II.L Influence de la Langue Maternelle Arabe sur l Apprentissage du Français
Une partie significative de la recherche porte sur l'impact de la langue maternelle (arabe) sur la compréhension orale en français. Les interférences linguistiques, notamment au niveau phonologique (intonation, rythme, phonétique), sont identifiées comme des obstacles majeurs. L'absence de certains phonèmes en arabe, la présence de faux amis, et les difficultés liées à la discrimination des sons du français sont détaillés. Le document souligne les difficultés spécifiques liées à l'apprentissage tardif du français chez les étudiants saoudiens, souvent débutant l'apprentissage à l'université (Université Roi Saoud, 350 étudiants en 2011-2012, 50 par année).
1. Difficultés Phonologiques liées à la langue maternelle arabe
L'étude met en lumière les difficultés phonologiques rencontrées par les apprenants arabophones. La théorie de l'interférence linguistique est invoquée pour expliquer les problèmes de production de certains sons en français absents en arabe (Guimbretière, 1994). Le « crible auditif », se stabilisant vers l'âge de dix ans, rendrait difficile l'apprentissage de sons nouveaux. Ainsi, l'apprenant transfère les caractéristiques phonologiques de sa langue maternelle (L1) à la langue cible (L2), ce qui peut mener à des interférences négatives. Par exemple, l'absence du son /y/ en arabe peut conduire à sa substitution par /u/. Narcy (1997) précise que le système phonologique de la langue maternelle sert de référence, même pour l'intonation et le rythme. Les différences dans les schémas prosodiques entre l'arabe et le français peuvent engendrer une mauvaise compréhension ou une perception partielle des sons. L’analyse souligne que l’apprenant arabophone a du mal à différencier les sons du français qui n'ont pas d'équivalent dans sa langue maternelle, mentionnant spécifiquement les sons [v] (comme dans vigilant), [p] (comme dans entreprise), et les voyelles nasales [ã] (comme dans «dans», «temps»). La discrimination auditive, nécessitant la reconnaissance des phonèmes, leurs combinaisons et les frontières de mots (Parpette), se révèle être un défi majeur pour ces étudiants.
2. Impact de l Intonation et du Rythme
L'intonation, décrite comme le mouvement mélodique d'une phrase (Champagne et Schneiderman, 1987), est un facteur crucial pour la compréhension. Elle possède une fonction expressive, indiquant les états d'âme du locuteur (Abry, 2007), ce qui peut être difficile à percevoir pour un apprenant non-natif. L'étude souligne l'importance pour l'enseignant de sensibiliser les étudiants aux nuances de l'intonation, notamment la distinction entre phrases interrogatives et déclaratives. Le rythme, aspect phonétique spécifique à chaque langue, représente également un défi. En français, il s'agit d'accentuation des unités phonétiques, souvent différent du rythme de la langue maternelle de l'apprenant. La maîtrise du rythme est essentielle à la fois pour comprendre et pour se faire comprendre ; l'observation de la ponctuation peut être une première étape pour appréhender cette notion. L'adaptation progressive à la variation de débit est également nécessaire pour les débutants, ce qui demande au professeur de choisir des documents avec des phrases courtes et un débit lent au début de l’apprentissage. Bien que des recherches aient été menées sur l'influence du débit sur l'apprentissage (K.E.Rader, 1990; E.K. Blau, 1990; Cornaire, 1998), aucune n’a conclu avec certitude qu'un débit lent améliore la compréhension orale.
3. Influence lexicale et problèmes spécifiques liés aux mots de précision
Le document souligne les difficultés lexicales rencontrées par les apprenants saoudiens, particulièrement au niveau débutant. Des problèmes de compréhension liés aux « mots de précision » (noms propres, jours, mois, chiffres) sont mis en évidence. Les noms propres connus peuvent ne pas poser de problème si leur sonorité est similaire en arabe, mais des difficultés surviennent si cette sonorité diffère (ex: «Pays-Bas» prononcé [holanda] en arabe). L'absence d'équivalents directs entre le français et l'arabe pour certaines expressions (ex: «tant mieux», «tant pis») exige des efforts supplémentaires de la part des apprenants. L'apprentissage tardif du français à l'université accentue ces difficultés, les étudiants adultes ayant tendance à un apprentissage sélectif, se focalisant sur des thèmes liés à leurs centres d'intérêt (ex: football, musique). Sergit (1985), en se basant sur une recherche de 1984, a étudié le lien entre l'âge et les performances en compréhension orale, soulignant la complexité de l'acquisition de cette compétence chez les adultes.
III.Utilisation de Documents Authentiques et Médias en Classe de FLE
L'étude met en avant l'importance des documents authentiques (ex: extraits de journaux télévisés, interviews, dialogues) pour développer la compréhension orale. L'utilisation de supports variés et riches culturellement est recommandée pour motiver les apprenants et améliorer leur autonomie linguistique. Les médias sont présentés comme un outil puissant pour simuler des situations de communication réelles. Le texte mentionne l'outil pédagogique 'Écoute… Écoute, objectif comprendre' comme un exemple pertinent d'utilisation des documents authentiques en FLE.
1. Les Documents Authentiques comme Outil Pédagogique
L'utilisation de documents authentiques est présentée comme une approche essentielle pour l'apprentissage de la compréhension orale en FLE. Le texte cite le CRAPEL (Centre de Recherche d’Applications Pédagogiques en Langues) et les travaux de Duda (1972) qui définit le document authentique comme un document dont la finalité première n'est pas l'enseignement linguistique. Cette approche est soutenue par Abe et al. (1979) et Carette (2001), qui mettent en avant l'intérêt de ces documents pour leur aspect complet et leur cohérence contextuelle. Les documents authentiques motivent les apprenants grâce à leur variété et leur nouveauté, contribuant à un apprentissage plus engageant. Ils favorisent également l'autonomie de l'apprenant, en développant notamment son autonomie linguistique et pédagogique (Duda et al., 1973). Un exemple concret est donné avec l'outil pédagogique « Écoute… Écoute, objectif comprendre », qui utilise des documents authentiques variés (interviews, dialogues, bulletins météo) pour tous les niveaux et toutes les nationalités. Le choix des documents doit être judicieux, en considérant des critères comme la durée, le nombre d'interlocuteurs, le contexte, la qualité du son et de l'image, ainsi que leur intérêt linguistique et culturel. Des documents riches socialement et culturellement sont particulièrement exploitables.
2. Intégration des Médias en Classe de FLE
Les progrès technologiques permettent aux enseignants d'intégrer les médias (radio, télévision, internet, téléphone) pour accéder à une large variété de documents authentiques et enrichir l'enseignement du FLE. L'omniprésence des médias dans la vie quotidienne les rend particulièrement pertinents pour un apprentissage contextualisé. Barthelemy Fabrice et al. (2011) soulignent leur aspect attractif, motivant et leur capacité d'adaptation aux besoins des apprenants, que ce soit en milieu scolaire ou en autodidacte. La télévision, en associant son et image, permet au téléspectateur de mieux comprendre les dialogues grâce aux gestes, au décor et aux informations sur le locuteur, offrant en plus un accès à une autre culture (C. Compte, 1993). Internet, bien qu'offrant un accès illimité à la langue et à ses locuteurs (chats, forums, blogs), pose des problèmes quant à la fiabilité des sources et la qualité des documents. Le document insiste sur l’importance pour l’enseignant de choisir ses ressources médiatiques avec soin.
3. Préparation à l écoute et stratégies de visionnement
La préparation à l'écoute est une phase essentielle. L’enseignant doit sélectionner des documents sonores qui facilitent l'interprétation du message oral et fournir des indices contextuels aux apprenants (Cornaire, 1998). Les apprenants mobilisent leurs expériences personnelles, leurs connaissances linguistiques, lexicales et culturelles pour anticiper le thème et la signification du message. Cette phase implique une analyse phonétique, syntaxique et lexicale. Une mauvaise segmentation du message oral conduit à de fausses hypothèses et à une interprétation incorrecte. La prise de notes, loin d'être mécanique, demande une écoute active et un processus de réflexion (Simonet, 1993; Simonet, 1998). L’analyse prosodique (phonétique) permet de segmenter la chaîne parlée en unités (syllabes, énoncés), ce qui est crucial pour la compréhension (Dejan de la Bâtie, 1993). Le document souligne l’importance de la pratique phonologique et phonétique, notamment l'analyse de l'intonation et du rythme, pour faciliter le décodage. L’apprentissage du français demande une adaptation progressive à la variation du débit des documents sonores; l’enseignant doit commencer par des documents au débit lent avec des phrases courtes (Lebel, 1990). Malgré des recherches sur l'influence du débit (K.E.Rader, 1990; E.K. Blau, 1990), aucune conclusion définitive n'a été établie.
IV.Analyse des Difficultés et Résultats d une Étude Pratique
Une étude pratique est menée auprès d'étudiants saoudiens pour évaluer leurs compétences en compréhension orale. Les résultats révèlent des difficultés persistantes, notamment avec des aspects prosodiques (rythme, débit, intonation) et le lexique. Les expressions idiomatiques, les mots de précision, et les noms propres posent également des problèmes de compréhension. Des exercices (choix multiple, questions à compléter) sont utilisés pour identifier les points faibles. L'étude met en lumière l'importance du contexte et des connaissances culturelles dans la compréhension de l'implicite.
1. Méthodologie de l étude pratique et population étudiée
L'étude pratique vise à évaluer la compréhension orale d'étudiants saoudiens apprenant le français à l'Université Roi Saoud. En 2011-2012, le département de langue française comptait 350 étudiants, avec 50 nouvelles inscriptions chaque année. Les étudiants suivent un cursus de cinq ans, divisé en semestres. Le corps professoral compte une vingtaine d'enseignants, majoritairement saoudiens, ayant fait leurs études en France. La méthode d'enseignement utilisée est décrite comme la «connexion», et le département a mené des recherches pour adapter les méthodes d’enseignement aux besoins spécifiques des élèves. L'étude souligne que les activités d'apprentissage en français hors du cadre universitaire sont limitées, à l'exception de quelques étudiants s'inscrivant à l'Alliance française ou utilisant les réseaux sociaux.
2. Analyse des réponses et difficultés constatées
L'analyse des résultats révèle des difficultés de discrimination des sons et des mots en français, liées à l'absence d'équivalents en arabe. Des exercices de type «cochez la ou les bonnes réponses» et «complétez les phrases» ont été utilisés. Un lien de cause à effet est établi entre les difficultés de compréhension orale et l'influence de la langue maternelle (arabe). Spécifiquement, l’absence de certains sons en arabe ([v] comme dans vigilant, [p] comme dans entreprise, voyelles nasales) empêche la distinction de ces sons en français. L'étude note un taux important de réponses erronées, particulièrement dans la partie «complétez les phrases», suggérant un niveau de compréhension encore bas. Malgré un choix de sujet censé être motivant (un sketch), la majorité des étudiants n'en a pas compris le principe. Les erreurs sont vues comme une étape normale de l’apprentissage, leur correction permettant la construction des connaissances (Tagliante).
3. Interprétation des résultats et limites de l approche
L'analyse des réponses met en évidence des problèmes de compréhension persistants, même lorsque des thèmes censés motiver les apprenants (ex: sport) sont utilisés. Les étudiants ont eu des difficultés avec des expressions spécifiques («une équipe qui fait peur au monde entier», «la pelouse», «le coup d’envoi»). Ces difficultés persistent malgré la volonté des apprenants et ne sont pas uniquement liées à des aspects linguistiques, mais aussi à des différences culturelles et sociologiques. Une question sur les moyens utilisés pour améliorer la compréhension orale a révélé une prédominance de l'écoute de la radio francophone ou de chaînes de télévision comme TV5 Monde. L’étude conclut que le processus d'apprentissage est complexe et multidimensionnel. Les outils statistiques utilisés permettent une analyse concrète de la situation, mais des facteurs culturels et sociaux doivent être considérés pour comprendre les difficultés des étudiants saoudiens en compréhension orale.
