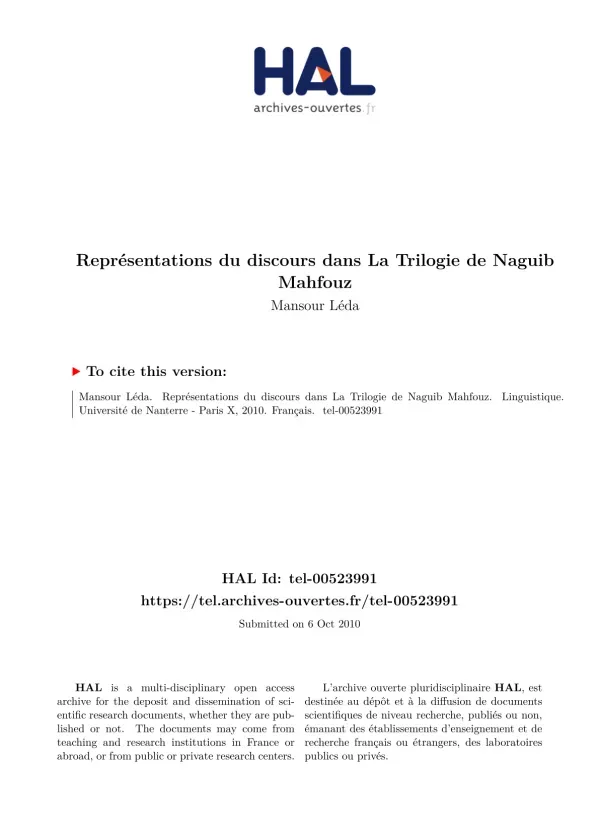
Représentations du discours dans La Trilogie de Naguib Mahfouz
Informations sur le document
| Auteur | Léda Mansour |
| instructor | Jean-François Jeandrillou |
| École | Université Paris Ouest-Nanterre La Défense |
| Spécialité | Sciences du langage |
| Type de document | thèse |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 2.79 MB |
- Linguistique
- Naguib Mahfouz
- Représentations du discours
Résumé
I.Le Réalisme dans la Trilogie de Naguib Mahfouz Un Débat entre Tradition et Modernité
Cette étude analyse la réception critique et la traduction française de La Trilogie du Caire de Naguib Mahfouz, explorant les débats autour du réalisme dans la littérature arabe. L’utilisation de l’arabe classique dans les dialogues, malgré le contexte apparemment réaliste, est un point central. Le document examine comment un présupposé réaliste, influençant tant les analyses critiques que la traduction, peut fausser la compréhension de l'œuvre. L’étude s’intéresse aussi à la question de la dialectalisation ('ammiyya vs. fush’a) et de son impact sur la réception du roman, en lien avec l'identité nationale arabe.
1. Le Réalisme Contesté Une Question de Perception
L'analyse remet en question la perception du réalisme dans La Trilogie de Naguib Mahfouz. L'étude ne se concentre pas sur une analyse intrinsèque du réalisme dans l'œuvre elle-même, mais plutôt sur la manière dont ce concept est perçu et interprété. Le choix d'analyser la traduction française de l'œuvre met en lumière l'influence des interprétations préalables sur la réception du texte. Il est suggéré que le traducteur, influencé par un présupposé réaliste, guide la lecture du lecteur francophone, potentiellement biaisant l'analyse. La possibilité d'une lecture alternative et de différents effets de sens est soulignée, justifiant ainsi une analyse linguistique plus approfondie. Le texte explore le paradoxe d'un romancier censé être réaliste, utilisant pourtant l'arabe classique dans ses dialogues, un point fréquemment soulevé par la critique arabe. Cette divergence entre la forme linguistique et l'interprétation réaliste pose les bases de l'enquête, qui explore l'influence du présupposé réaliste sur l'interprétation de l'œuvre et sa traduction. Des éléments paratextuels (notes, préface) de la traduction française sont évoqués comme témoins possibles de cette influence.
2. Classifications et Approches Comparatives de l œuvre de Mahfouz
L'étude examine les classifications habituelles de l'œuvre de Mahfouz, souvent divisée en phases (pharaonique, sociale et réaliste, philosophique) selon des critères esthétiques et thématiques. L'analyse critique de La Trilogie, souvent comparée à des modèles occidentaux du XIXe siècle, est passée au crible. Le travail de Louis Awad (1964) est cité en exemple, où l'auteur qualifie Mahfouz de romantique dans un cadre classique, notant que la société cherche à le voir comme un réaliste, alors même qu'il utilise des outils réalistes comme la description et l'accumulation de détails. L'idée d'une influence occidentale sur l'interprétation du « réalisme » de Mahfouz est mise en évidence, avec des chercheurs arabes comme al-‘Alam et al-Charouny qui offrent des perspectives différentes. Al-‘Alam explique le réalisme comme une « conjonction des contraires », tandis qu'al-Charouny souligne l'importance des détails descriptifs et la multiplicité des points de vue. La représentation de la « pensée majoritaire » est également abordée, Amina, la mère dans la trilogie, servant d'exemple pour illustrer la représentation d'une mère typique de la classe moyenne.
3. Le Dilemme Linguistique Arabe Classique et Dialectes
Une section importante explore le choix linguistique dans le roman arabe, notamment le débat entre l'arabe classique (fush’a) et les dialectes ('ammiyya). L'arabe classique, issu d'un dialecte arabe préislamique, s'est diversifié géographiquement, créant une diglossie. La plupart des romanciers choisissent l'arabe classique pour un lectorat plus large, même s'ils intègrent des registres dialectales. L'opposition entre la tradition de la langue classique et les besoins de la modernité est abordée, avec les travaux de Miquel et Blachère cités pour leur perspective sur l'unité linguistique arabe et son lien avec le mouvement nationaliste. Le rôle de la langue commune (par opposition aux dialectes) dans la construction d'un paradigme identitaire est souligné. L’étude questionne la conception même du lien entre oralité et dialogue romanesque, selon la vision de Mahfouz et d'autres auteurs arabes. L'analyse rappelle le prestige de l'arabe classique en tant que langue de culture et de religion.
II.La Langue dans la Trilogie Classique ou Dialectale
Un aspect clé porte sur le choix linguistique de Mahfouz: l'emploi de l'arabe classique (fush’a) dans les dialogues de La Trilogie, un choix souvent critiqué par les études comparatives qui lui imputent un réalisme incomplet. Le texte examine le lien entre langue et nationalisme dans le monde arabe au XXe siècle, soulignant le prestige de l'arabe classique en tant que langue de la culture et de la religion, tout en discutant de l’intégration du dialectal ('ammiyya) dans la littérature moderne. Les exemples d'auteurs comme Tawfik al-Hakim et Yahya Haqqi illustrent les différentes approches du dialogue dans le roman arabe, mêlant parfois le classique et le dialectal.
1. Le Choix Linguistique de Mahfouz Un Débat Central
L'analyse de La Trilogie de Naguib Mahfouz met en lumière le choix linguistique comme élément clé de l'œuvre et de sa réception. Le point crucial réside dans l'utilisation de l'arabe classique (fush’a) pour les dialogues, alors même que le roman est souvent perçu comme réaliste. Cette divergence entre l'attente d'un réalisme linguistique (utilisation du dialecte, 'ammiyya) et le choix stylistique de Mahfouz est au cœur du débat. Des critiques arabes s'étonnent de cette utilisation de l'arabe classique dans un roman soi-disant réaliste. Cette contradiction apparente soulève des questions sur les intentions de l'auteur et la manière dont le choix linguistique influe sur l'interprétation du texte. L’étude propose l'hypothèse qu'un présupposé réaliste oriente ces lectures critiques et, plus encore, qu'il a pu influencer la traduction française de La Trilogie, comme semblent le suggérer divers éléments paratextuels.
2. Langue et Nationalisme Arabe au XXe Siècle
La discussion s'élargit ensuite au contexte historique et politique du choix linguistique. L'étude examine le lien entre la langue et le nationalisme arabe au XXe siècle, en mettant en perspective le débat entre l'arabe classique et les dialectes. L'arabe classique, en tant que langue commune, est présenté comme un élément unificateur dans un monde arabe diversifié, permettant un large lectorat. L'arabe classique, selon les travaux de Fleisch (1974), a une origine dialectale en Arabie préislamique, mais son usage s'est répandu avec les conquêtes arabes, se diversifiant phonétiquement et grammaticalement ('ammiyya). Miquel souligne l'importance d'une unité linguistique comprise par tous les arabophones, tout en acceptant les originalités locales, perceptibles à travers les dialogues. Blachère quant à lui explique cet « arabisme » par la nécessité de construire un ciment unificateur pour les différents éléments du monde arabe. L'objectif d'une littérature nationale comme « paradigme identitaire » (Jacquemond, 2007) est évoqué, soulignant le lien entre langue et sentiment national, même si les dialectes étaient considérés comme une forme corrompue de l'arabe.
3. Variétés Linguistiques dans le Roman Arabe Exemples d auteurs
L'étude examine ensuite la pratique linguistique de différents auteurs arabes. L’écriture du dialogue, en discours direct, varie selon les auteurs et même au sein d'une même œuvre. Le choix entre l'arabe classique et les dialectes au XXe siècle était crucial pour le développement des formes littéraires. Tawfik al-Hakim, avec son œuvre Awdat al-Rûh (L’Âme retrouvée), est cité comme un exemple d'usage du dialecte égyptien dans les dialogues, avec des termes spécifiques à l'Égypte, contrastant avec l'arabe classique utilisé par le narrateur. Yahya Haqqi, avec sa nouvelle Qindil Oum Hachim, est mentionné pour son mélange de dialectal et de littéraire, mettant en scène une confrontation entre deux mémoires et l'expression de voix différentes (Hallaq, 1999). Ces exemples montrent une variété de stratégies pour gérer les différents registres linguistiques, en fonction des effets de sens recherchés par les auteurs, dépassant une simple approche réaliste du dialogue. L'analyse souligne que l'usage linguistique ne se réduit pas à une question de réalisme.
III.Analyse Linguistique du Discours Rapporté dans La Trilogie
L'analyse se concentre sur le discours rapporté (DR) dans La Trilogie, en examinant les formes du discours direct (DD), du discours indirect (DI), et du discours indirect libre (DIL). L'étude dépasse une simple classification grammaticale pour explorer comment le narrateur utilise ces formes pour construire le personnage et créer des effets de sens spécifiques. L'approche s'appuie sur les théories de Bakhtine et Authier-Revuz sur la dialogicité et la réflexivité du langage, soulignant l'importance de la perspective métalinguistique du narrateur et son impact sur l’interprétation du texte. Les verbes introducteurs et les choix stylistiques du traducteur sont également examinés.
1. Le Discours Rapporté Définitions et Approches
L'analyse linguistique se concentre sur le discours rapporté (DR) dans La Trilogie, en examinant les différentes approches théoriques et terminologiques. Le document souligne la variabilité des formes du DR selon les langues, mentionnant les formes classiques du discours direct (DD), indirect (DI) et indirect libre (DIL) en arabe. Il relève que la traduction transpose ces formes sans modifications majeures des indices de signalisation (verbes introducteurs, typographie). L'étude aborde les différents termes utilisés pour désigner le phénomène du DR : « discours rapporté », « discours représenté », « représentation du discours autre », etc., chacun soulignant un aspect particulier du phénomène. Le DR n'est pas simplement une inclusion d'un discours dans un autre, mais un acte complexe de représentation soumise à l'interprétation du locuteur. Le groupe de recherche ELEXTRA est mentionné pour ses travaux sur les difficultés de traduction, notamment les problèmes d'intertextualité. La présence d'intertextes coraniques ou de propos du prophète Mahomet, supposés connus des personnages, peut entraver la compréhension des rapports discursifs, posant un défi pour le traducteur.
2. L approche d Authier Revuz Le Discours Direct comme Autonyme
L'analyse du discours direct (DD) s'appuie sur l'approche d'Authier-Revuz qui le considère comme un autonyme, c'est-à-dire un signe renvoyant au signe lui-même. Le DD est ainsi une mention du message, et non son usage, contrairement au discours indirect. Cette approche souligne la richesse des fonctionnements et effets de sens du DD en contexte, contrairement à sa perception comme une forme de langue « pauvre ». Le caractère autonymique du DD permet d'étudier l'implication de l'énonciateur, ses attitudes langagières et ses effets de sens (distanciation, détachement, adhésion...). Le texte explore la perspective de Bakhtine sur le « mot à deux voix », qui porte une orientation interprétative vers autrui, et son concept du « mot réfléchi d'autrui », pertinent pour comprendre les interactions dialogiques dans le texte. La dialogicité est donc analysée non seulement comme des échanges verbaux, mais aussi comme un discours traversé par l'altérité discursive. Les reprises, postures interrogatives, rectificatives et intertextuelles illustrent la dimension dialogique du texte.
3. Formes du Discours Rapporté et la Question de la Fidélité
Le texte examine les trois formes classiques du DR : discours direct (DD), indirect (DI), et indirect libre (DIL), et les points de vue sur leur interrelation. L’approche grammatical traditionnelle envisage une « dérivabilité » où le DI est dérivé du DD et le DIL des deux précédents. Combettes (1990) note l'idée de « transformation » entre ces formes, presente dans les grammaires et dictionnaires, soulignant les changements de personne, de temps, et d'indications spatio-temporelles. La notion de « degré de fidélité » est également discutée, avec le DD comme la forme la plus fidèle, et le DIL comme la moins fidèle. Cependant, Combettes propose une approche alternative, axée non pas sur la dérivation ou la fidélité, mais sur les procédés de l'énonciateur dans l'activité de rapporter le discours. L'intervention de l'énonciateur premier, le narrateur, marque sa propre zone discursive et permet de définir celle de l'énonciateur second. L'analyse privilégie donc l'étude de la présence ou de l'absence des deux instances énonciatives.
IV.Temps et Récit dans La Trilogie Un Regard sur la Structure Narrative
L’étude analyse la structure narrative de La Trilogie, en particulier la succession des situations et des scènes de dialogue. Le rôle du temps dans le récit est exploré à travers le prisme de la théorie de Paul Ricœur (Mimèsis), soulignant l'interaction entre le temps de l'histoire et le temps du récit. L’analyse examine comment le narrateur gère le temps (passé, présent, futur) et comment les souvenirs des personnages influencent leur perception du présent, en évitant une lecture purement fataliste des événements. Des personnages importants comme Ahmed Abd el-Gawwad et Amina sont mentionnés pour illustrer ces dynamiques.
1. Le Temps et le Récit selon Ricœur Une Perspective Théorique
L'analyse du temps dans le récit de La Trilogie s'appuie sur la théorie de Paul Ricœur et ses trois temps de la mimèsis. La mimèsis I représente la préfiguration, la pré-compréhension du monde de l'action qui fonde la composition de l'intrigue. La mimèsis II est la médiation, la mise en intrigue et la configuration narrative. Enfin, la mimèsis III correspond à la re-figuration, incluant la réception et l'acte de lecture. Le lien entre temps et récit est ainsi mis en lumière. L'événement narratif est défini comme étant construit sur un ensemble de situations, caractérisées par un lieu et un ensemble de circonstances. La place du personnage est analysée comme passive (raconté par le narrateur) ou active (racontant conventionnellement, parlant dans les dialogues). Une scène de dialogue, contrairement à une situation, est définie par son aspect dialogal. La structure de La Trilogie est ensuite abordée, illustrant la succession des situations et l'enchaînement des chapitres autour de thèmes et de personnages spécifiques, la rapidité de la succession étant plus marquée dans le dernier tome.
2. Discours Direct Analeptique et Effets d Objectivité
L'analyse porte ensuite sur l'utilisation du discours direct analeptique (rapports au passé) dans La Trilogie. Deux exemples sont analysés : le premier concerne Ahmed Abd el-Gawwad se souvenant du discours de sa voisine pour mieux comprendre sa visite actuelle. Le second concerne Amina se souvenant d'un discours de son mari, mais sans plus souffrir. L'utilisation du discours direct dans ces analepses discursives permet de restituer l'aspect sec de la parole et de réactualiser le souvenir. Le narrateur vise à représenter le souvenir de manière « authentique », même si le traducteur introduit des modifications (par exemple, « conseil » au lieu de « son dire »). L’étude souligne que le narrateur construit son récit autour du temps « qui se vit », réfutant une simple acceptation fataliste des événements. Le retour des souvenirs ne représente pas l'oubli, mais une posture d'objectivité pour expliquer le présent. L'exemple de Kamal, regardant par la fenêtre, est analysé, soulignant la conscience des personnages de la logique évolutive des événements et la possibilité de surmonter le passé.
3. Structure du Récit et Importance du Sujet Parlant
La structure narrative de La Trilogie est analysée en examinant le rôle du dialogue et du « sujet parlant ». La scène de dialogue est un élément permanent, surgit à chaque événement et représente un temps de rassemblement (ex : la séance de café). La composante discursive contribue à la construction des effets de sens. Le narrateur cède la parole à d'autres locuteurs, soulignant l'importance du « sujet parlant ». Si les notions de « fonction » et « d'actant » rendent compte des actions, parler reste le propre des personnages. Le narrateur construit l'« objet du personnage parlant ». L'analyse se concentre sur les traces et effets du personnage dans le texte et le récit, au niveau des actions et propos. Le texte discute des effets de sens liés aux caractéristiques génériques, tout en soulignant qu'ils ne déterminent pas à eux seuls le genre du récit. La Trilogie, malgré des aspects philosophiques, n’est pas un roman philosophique. Le discours rapporté montre les personnages interrogeant leur monde, leur rapport à la société, à la politique, à la famille, etc.
