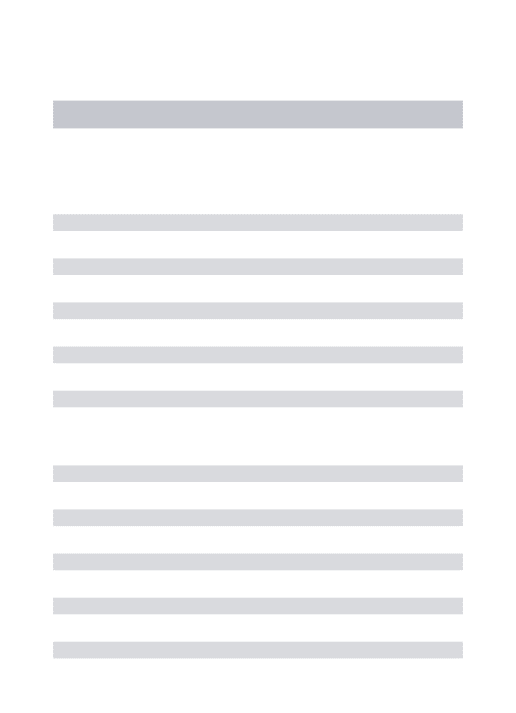
Discrimination à l'embauche: apparence
Informations sur le document
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 11.43 MB |
Résumé
I.L apparence et la discrimination à l embauche dans le secteur bancaire français
Cette étude sociologique explore l'impact de l'apparence (tenue vestimentaire, gestuelle, etc.) sur les décisions de recrutement dans huit banques françaises. Elle analyse si la prise en compte de l'apparence lors des entretiens d'embauche constitue une forme de discrimination. La recherche s'appuie sur des entretiens non directifs avec des recruteurs (cadres RH et directeurs d'agence) concernant le recrutement de commerciaux (chargés de clientèle, conseillers). L'objectif est d'identifier les régimes d'action des recruteurs et de déterminer si leurs jugements sont justes et équitables, ou s'ils engendrent une discrimination. Des photographies de candidats avec différentes tenues ont été utilisées comme outil d'analyse pour stimuler la discussion.
1. Contexte et problématique de la discrimination par l apparence
Cette section introduit la problématique centrale de l'étude : l'influence de l'apparence sur les processus de recrutement et le risque de discrimination. Elle retrace brièvement l'histoire des codes vestimentaires et leur lien avec la structure sociale, soulignant l'évolution vers une plus grande liberté individuelle à partir du 18ème siècle. Le décret du 8 Brumaire an II, garantissant la liberté vestimentaire, est cité comme un point de bascule. L'étude se positionne dans une perspective sociologique, posant la question de la justesse et de l'équité des critères de sélection basés sur l'apparence, considérant que la discrimination liée à l'apparence a une dimension morale et juridique. L'originalité de la recherche réside dans l'analyse de la discrimination liée au vêtement, aux attributs vestimentaires et corporels dans le contexte spécifique du recrutement, un champ peu exploré jusqu'à présent. L’étude se centre sur le milieu bancaire et se propose d'analyser comment l'apparence influence le jugement des recruteurs lors des entretiens d'embauche. Elle évoque la nécessité de définir précisément ce qu’est un jugement juste et équitable dans ce contexte.
2. Méthodologie de l enquête et le choix des participants
La méthodologie de recherche est détaillée, précisant le choix de huit banques françaises pour leur pratique du recrutement interne, réalisé par le service des ressources humaines. La définition du terme « recruteur » est précisée, incluant tout acteur contribuant au processus de recrutement, interne ou externe. L’étude se concentre sur les cadres salariés des banques, afin d’analyser le lien entre leur jugement et les valeurs institutionnelles. L'enquête repose sur des entretiens non directifs menés auprès de recruteurs réguliers ou occasionnels, sélectionnés pour leur expérience des entretiens de recrutement pour des postes de commerciaux (chargés de clientèle, conseillers). La méthodologie et le protocole d'enquête seront détaillés ultérieurement. L'étude explore également la question de la justification des choix des recruteurs, en relation avec des considérations juridiques et institutionnelles. La loi du 31 décembre 1992, encadrant les pratiques de recrutement et protégeant la vie privée des candidats, est mentionnée. La possibilité de recours à la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations) pour les cas d’injustice et de discrimination est également soulignée.
3. L analyse des régimes d action et le rôle de la justification
Cette partie explore les régimes d'action des recruteurs, en lien avec la sociologie pragmatique. Le concept de « régimes d’action » permet d'analyser comment les recruteurs prennent en compte, ou non, l'apparence des candidats et justifient leurs décisions. L'étude vise à déterminer si ces décisions s'inscrivent dans un régime de justice ou d'injustice, et si l'injustice mène à la discrimination. Le lien étroit entre injustice et discrimination est souligné : demander justice c'est dénoncer la discrimination. L'analyse des régimes d’action se base sur les travaux de Boltanski et Corcuff, une classification qui sera détaillée plus tard. L'acte de recrutement en lui-même est présenté comme un acte discriminant au sens littéral, mais la critique se porte sur le processus de décision, la justification et l’équité du jugement. Les travaux d'Eymard-Duvernay et Marchal sont cités pour illustrer comment l’adéquation entre un profil de candidat et le poste repose sur plusieurs critères, alors que l’élimination est souvent basée sur un seul critère, sans lien direct avec les compétences requises. L'étude s'attache donc à analyser les arguments utilisés par les recruteurs et la validité de leurs justifications.
II.La méthodologie et les outils d enquête
L'enquête repose sur des entretiens non directifs menés auprès de 32 recruteurs dans huit banques françaises. Ces recruteurs, autant opérationnels que stratégiques, sont impliqués dans le processus de recrutement interne. Une approche qualitative prédomine. Pour compléter l’analyse des entretiens, des photographies représentant différents styles vestimentaires ont été utilisées, afin d’analyser la perception des recruteurs face à divers types d’apparence. L'analyse des données utilise le logiciel Alceste, mais également une analyse qualitative approfondie des verbatim.
1. Les entretiens non directifs Une approche qualitative
L'étude utilise une méthodologie qualitative basée sur des entretiens non directifs. Ces entretiens ont été conduits auprès de 32 recruteurs issus de huit banques françaises. Le choix de ces banques repose sur leur pratique du recrutement interne, géré par leurs services des ressources humaines. Les recruteurs interrogés occupent des postes variés, aussi bien opérationnels (directeurs d'agence) que stratégiques (responsables RH), permettant une analyse croisée des points de vue. L’objectif des entretiens est de comprendre les mécanismes de décision des recruteurs lors des entretiens d'embauche, en particulier concernant le rôle de l'apparence dans leur jugement. Le guide d'entretien, basé sur des thèmes généraux, permettait une certaine flexibilité, s'adaptant aux réponses des interviewés. La méthode choisie s'apparente à une observation à découvert, l'intervieweur assumant clairement sa posture de chercheur en sociologie. La question introductive visait à identifier la pratique du recrutement par les interviewés : « Monsieur (ou Madame), je vous remercie de me recevoir au sujet de mon étude en sociologie portant sur le recrutement dans les banques. À ce sujet, j’aurais une question à vous poser : est-ce que vous-même vous pratiquez des recrutements, si oui, sous quelle forme ? »
2. La photographie comme outil d analyse complémentaire
La photographie, bien que peu utilisée en sciences sociales, est ici employée comme outil de recherche polysémique. L’étude s’appuie sur des travaux d’ethnologie et d’anthropologie, mentionnant Malinowski, Mauss, Bateson et Mead comme précurseurs de l’utilisation de la photographie comme matériau de recherche. L'objectif est de susciter des réactions et des expressions plus libres chez les interviewés concernant l’apparence. Les photographies ont été conçues pour répondre à des contraintes théoriques spécifiques. Les visages sont floutés pour éviter tout biais lié au jugement sur la beauté, l'arrière-plan est neutre (blanc, sans objet) pour concentrer l'attention sur l’apparence vestimentaire et gestuelle. Les modèles photographiés présentent un IMC moyen, dans des positions corporelles (debout, de face ou ¾ profil) définies pour l’étude. Le nombre de photographies (huit : quatre hommes, quatre femmes, représentant quatre styles vestimentaires) est basé sur les travaux antérieurs, évitant un nombre trop faible ou trop élevé. Les critères photographiques visent une neutralité maximale, une impression quasi clinique pour mettre en évidence l’apparence vestimentaire et gestuelle. La construction des photographies s’appuie sur les concepts de mimésis et d’indiciel pour amener les interviewés à exprimer leurs perceptions et réactions sur une forme d’éthique et d’esthétique.
3. Analyse des données Alceste et analyse qualitative
L’analyse des données s'appuie sur le logiciel Alceste pour le traitement informatique du corpus des entretiens. Cependant, l'étude reconnaît les limites de l'analyse lexicale automatique, soulignant le risque d’une approche trop « neutre » et incomplète pour une analyse sociologique approfondie. Le traitement informatique ne permet pas à lui seul de comprendre les actions et les justifications des interviewés. L’interprétation qualitative du chercheur est donc essentielle. L'analyse du corpus repose sur une étude approfondie de chaque entretien, complétant et illustrant les résultats de Alceste. La sélection des verbatim les plus pertinents se fait en fonction de leur lien avec les termes les plus représentatifs de chaque classe identifiée par le logiciel, mais aussi en fonction d'éléments nouveaux méritant d'être abordés, éléments qui pourraient être ignorés par l’analyse automatique du logiciel. L’étude met en avant la nécessité d’une analyse contextuelle et concrète, au-delà du traitement informatisé des données.
III.Les valeurs et les normes dans le monde bancaire
L'analyse met en lumière l'influence des principes généralisés (mondes domestiques et industriels) sur les critères de recrutement. L'étude révèle une tension entre les exigences de performance commerciale (monde marchand) et les valeurs de la tradition bancaire (monde domestique). Les compétences recherchées sont analysées à partir du corpus d'entretiens, des offres d'emploi, et de descriptifs de postes. Un compromis entre logique industrielle (qualifications, normes) et logique inspirée (intuition, expérience) est observé dans le processus d'évaluation des candidats.
1. Les valeurs et normes générales dans le secteur bancaire
Cette section analyse les valeurs et les normes en vigueur dans le secteur bancaire, en utilisant le cadre théorique des « Économies de la grandeur » de Boltanski et Thévenot (1991). L'analyse des entretiens révèle que le monde marchand est peu présent dans le discours des professionnels bancaires, contrairement à ce qu'on pourrait attendre. L’étude se concentre sur les valeurs et les normes du monde bancaire en général, puis se restreint au métier de commercial. L'analyse s'appuie sur le discours des recruteurs (opérationnels et stratégiques), la communication des banques (slogans) et les chartes de valeurs. L'objectif est de comprendre les relations établies entre les professionnels, les clients, et les produits/services bancaires, afin de définir les valeurs et les normes à la fois dans le secteur bancaire et dans le métier de commercial. L’entretien de recrutement est analysé comme une épreuve soumise à des principes d’équivalence relevant de mondes différents, permettant d’identifier les grandeurs et les critères utilisés par les recruteurs pour porter leur jugement sur les candidats.
2. Compétences requises pour un poste de commercial en banque
Cette partie explore les compétences requises pour un poste de commercial en banque. L'analyse confronte les données issues des entretiens avec des données externes : descriptifs de compétences issus d'offres d'emploi (Banque A et H sont spécifiquement mentionnées comme exemples représentatifs), descriptif du métier par un consultant externe, et descriptif de l'ONISEP. L’analyse lexicale de ces différentes sources corrobore les données du corpus et met en évidence des critères résonnant à la fois dans les mondes domestiques et industriels. La section souligne la prédominance de la logique domestique pour définir les compétences requises, même si la logique industrielle (qualifications, diplômes) est aussi présente. Les qualifications (diplômes, certifications comme l’AMF) sont considérées comme relevant d’une équivalence industrielle, mais ne constituent pas le critère principal. L'étude met en évidence une articulation entre logiques domestiques et industrielles dans la définition des compétences. Un exemple d'entretien illustre l’évolution du métier de commercial dans le secteur bancaire, passant d’un profil axé sur le contact client à un profil nécessitant une forte organisation et une gestion rigoureuse des risques.
3. Risque incertitude et le compromis industriel inspiré
Cette section analyse le rôle central du risque et de l'incertitude dans le secteur bancaire, et comment ces éléments contribuent à définir les compétences recherchées chez les commerciaux. Les travaux de Courpasson, Lazarus et Goukloviezoff, et Beck sur le risque et l'incertitude sont mentionnés. L’étude souligne la distinction entre risque (mesurable, objectivable) et incertitude (incertitude radicale selon Knight), et comment la gestion du risque utilise des logiques industrielles (outils informatiques, calculs algorithmiques). L'opposition entre le banquier d'hier (intuition, flair) et le banquier d'aujourd'hui (outils sophistiqués) est mise en évidence. La gestion du risque exige une expertise spécifique, acquise par un diplôme, et permet de gérer une nouvelle cible client : les entreprises. L’incertitude, quant à elle, est liée à une logique inspirée (intuition, manipulation, hasard). L’étude conclut qu’une articulation entre rationalisation et intuition est nécessaire dans le secteur bancaire et que la gestion des risques et des incertitudes nécessite un compromis entre les logiques industrielles et inspirées. L’étude évoque un équilibre fragile entre ces deux logiques dans le jugement des recruteurs.
IV.L apparence comme critère de jugement Justice et injustice
L'étude montre que l'apparence est un critère important pour les recruteurs, influençant leur jugement sur les candidats. Cependant, une distinction est faite entre la prise en compte de l’apparence comme un facteur parmi d'autres, et une discrimination basée uniquement sur l'apparence. L’apparence est analysée comme un élément de communication non verbale influant sur la perception du candidat, liée à des valeurs esthétiques et morales du monde domestique. L’étude explore comment cette perception se traduit dans le jugement du recruteur et la justification de son choix, en lien avec les concepts de justice et d’injustice.
1. L apparence comme critère incontournable mais non déterminant
L'étude démontre que l'apparence est considérée comme un critère essentiel et incontournable dans le processus de recrutement bancaire, mentionné par tous les recruteurs interrogés. L'analyse du corpus montre que la présentation est liée à la tenue vestimentaire, aux accessoires, à la coiffure, et au comportement corporel (gestes, maintien, attitudes). Un extrait d'entretien illustre cette approche globale de la présentation : « Je vais regarder le regard, le visage, comment je suis coiffé, comment je parle, les mimiques… et ensuite comment je me tiens, comment je marche, comment je me positionne, donc vous voyez, c’est une démarche un peu globale, ces points-là, donc je dirais une bonne présentation. » (Madame K., Banque A). Cependant, une nuance importante est apportée : l'apparence ne doit pas être le critère déterminant, au risque de tomber dans la discrimination. Cet avertissement, mentionné trois fois par des recruteurs stratégiques, souligne la nécessité d’un jugement équitable.
2. L apparence un objet du monde domestique et vecteur de communication
L'apparence est analysée comme un objet du monde domestique, permettant la qualification des personnes et contribuant à un accord tacite entre les individus. Un extrait d'entretien souligne son importance : « Après, il y a bien évidemment la présentation, la présentation compte beaucoup, physique, la façon de s’exprimer, le geste aussi et tout ce qui tourne autour du gestuel est pour moi aussi… ça m’alimente, je ne dis pas que j’en ferais un critère absolu mais en tout cas ça m’alimente dans l’appréciation que je peux faire » (Monsieur N., Banque B). L’apparence est donc traitée avec respect, car elle véhicule des valeurs positives ou négatives. L'étude associe l'apparence à des principes généralisés et à des objets du monde domestique, en l'analysant comme un objet naturel et un outil du dispositif domestique. L'apparence est aussi considérée comme un langage non verbal, un vecteur de communication au sens large, utilisant le corps et le vêtement comme outils. Le texte retrace l'évolution du concept de communication, de la communion à l'échange d'informations verbales et non verbales (Bateson), positionnant l'apparence comme source d'informations non verbales.
3. L apparence et le jugement morale esthétique et justification
La section explore la relation entre l'apparence et le jugement des recruteurs, en lien avec les valeurs morales et esthétiques. L'étude met en avant le lien entre éthique et esthétique, illustré par des termes comme « ce n’est pas convenable » (éthique) et « ce n’est pas joli » (esthétique). Le jugement moral est intimement lié aux attributs physiques, suivant une sorte de grammaire des apparences basée sur un consensus. Les normes esthétiques sont analysées en termes de corps (minceur, jeunesse, fermeté, santé) et de vêtement. Le texte cite des auteurs comme Le Breton et Pagès-Delon, qui décrivent les canons esthétiques actuels et la stigmatisation des apparences jugées comme « laides ». L'évolution du vêtement de la fonctionnalité à l'esthétique, et le style vestimentaire classique dans le milieu bancaire comme symbole de tradition et de respect des normes, sont présentés. L'importance de l'hygiène corporelle et vestimentaire est également soulignée, comme un marqueur social et moral, liée à la notion de confiance. Le « droit », comme posture corporelle, est aussi mis en avant, comme symbole de droiture morale et de respect.
V.Le rôle du vêtement et des attributs corporels
L'analyse du vêtement et des attributs corporels (gestuelle, regard, hygiène) souligne leur importance dans la formation du jugement du recruteur. La propreté, la tenue soignée et un style vestimentaire jugé classique sont des éléments valorisés, liés à des valeurs morales et esthétiques. Le regard et la gestuelle sont aussi des facteurs cruciaux dans la communication non verbale et contribuent à la perception de la personnalité et de la crédibilité du candidat. L'étude explore comment ces éléments, en tant que vecteurs de communication, interagissent dans l'évaluation des candidats et peuvent, s'ils sont mal interprétés, conduire à une situation d’injustice.
1. Le vêtement expression sociale et individuelle
Cette section explore le rôle du vêtement dans la perception des candidats par les recruteurs. Le vêtement est analysé non seulement comme un marqueur social, reflétant la position sociale de l'individu (comme le montrent les lois somptuaires sous François Ier et Henri II), mais aussi comme une expression de l'individualité. L'évolution historique du vêtement est mentionnée : du rôle déterminant dans la hiérarchie sociale sous l'Ancien Régime à l'affirmation de la liberté individuelle à partir du 18ème siècle. Le texte souligne que l’apparence intègre une dimension individuelle, psychologique et morale, révélatrice d'un mécanisme social complexe. L’approche s’appuie sur les travaux de différents auteurs : Yonnet (sur l’obsolescence des signes de prestige), Monneyron (sur la liberté individuelle liée au vêtement), et Bourdieu (sur la fabrication culturelle de l’apparence).
2. Attributs vestimentaires et corporels vecteurs de communication non verbale
Cette partie détaille l'analyse des attributs vestimentaires (accessoires, coiffure) et corporels (gestes, maintien, attitudes, voix) comme vecteurs de communication non verbale. L’étude précise que ces éléments sont observés et interprétés par les recruteurs pour évaluer les candidats. Un extrait d'entretien met en lumière l’importance du regard, du visage, de la coiffure et des mimiques, ainsi que de la posture : « Je vais regarder le regard, le visage, comment je suis coiffé, comment je parle, les mimiques… et ensuite comment je me tiens, comment je marche, comment je me positionne… » (Madame K., Banque A). L’analyse explore la gestuelle comme source d’impressions positives ou négatives, contribuant à la formation de critères d’évaluation. La voix et l’élocution sont également considérées comme des éléments importants, pouvant être rédhibitoires dans le jugement. L’étude mentionne les travaux de Nicolas Herpin (1984) qui montrent que le vêtement véhicule des informations sur la condition sociale, les activités quotidiennes, et le style personnel du candidat.
3. Hygiène posture et regard morale et esthétique
Cette section explore le lien entre l'hygiène corporelle et vestimentaire et le jugement moral des recruteurs. La propreté est un élément central, souvent cité dans les entretiens, lié à des valeurs de bienséance et de respect des convenances. La propreté vestimentaire, soignée, sans tache, est perçue comme un élément incontournable de la présentation. L'étude souligne le lien entre l'hygiène et la confiance, l'odeur étant considérée comme une révélation d'intériorité (Le Breton). L'entretien du poil est analysé comme un signe de rejet de « l'animalité », lié à des principes moraux et esthétiques. L'importance de la posture corporelle (droiture) est également mise en avant, traduisant le respect et la tenue. Le regard direct est considéré comme symbole de franchise et de sincérité, tandis que le regard fuyant peut être perçu négativement. La notion de « naturalité » dans l'apparence est abordée, mais le texte souligne l'ambiguïté de ce terme, le travail sur le corps devant être subtil et discret pour ne pas paraître artificiel.
