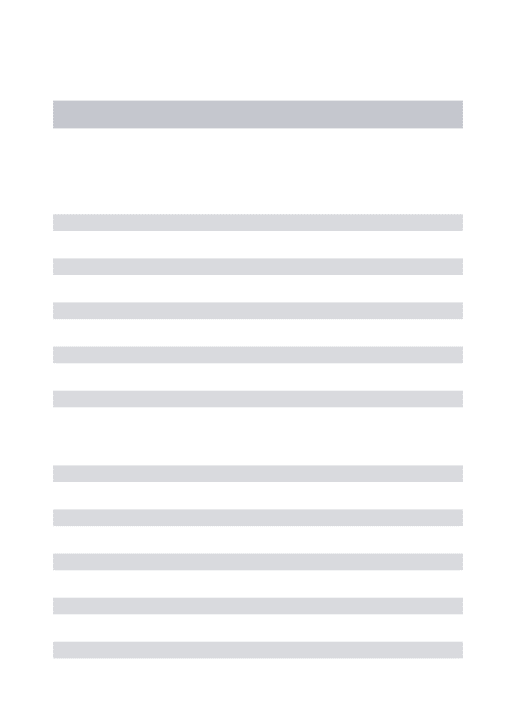
Alimentation femmes enceintes : Adéquation PNNS
Informations sur le document
| Auteur | Manik Kadawathagedara |
| École | Inserm, Université Paris Descartes, Inra |
| Spécialité | Épidémiologie, Nutrition, Santé Publique |
| Lieu | Paris, France |
| Type de document | Article de recherche |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 1.05 MB |
Résumé
I.Évaluation de l adéquation de l alimentation des femmes enceintes aux recommandations du PNNS
Cette étude, basée sur la cohorte ELFE, a évalué l’adéquation de l'alimentation des femmes enceintes françaises aux recommandations du Programme National Nutrition Santé (PNNS). Deux scores ont été créés : un score général (score-PNNS) basé sur les recommandations nutritionnelles pour adultes, et un score spécifique à la grossesse (score-grossesse). L'étude a utilisé un questionnaire de fréquence alimentaire (QFA) administré à la maternité, couvrant les trois derniers mois de la grossesse. L'analyse a porté sur près de 15 000 femmes. Les résultats permettront de mieux comprendre les habitudes alimentaires des femmes enceintes et d'identifier les points à améliorer pour promouvoir une nutrition optimale pendant la grossesse.
1. Présentation de l étude ELFE et objectifs
L'étude porte sur l'évaluation de l'adéquation des consommations alimentaires des femmes enceintes de l'étude ELFE par rapport aux recommandations du Programme National Nutrition Santé (PNNS). L'étude ELFE est une cohorte de grande envergure qui suit des enfants depuis leur naissance. L'objectif principal est d'analyser la qualité de l'alimentation des femmes enceintes et de déterminer dans quelle mesure elle correspond aux recommandations nutritionnelles. Cette analyse vise à identifier les forces et les faiblesses des habitudes alimentaires durant la grossesse, en utilisant un questionnaire de fréquence alimentaire (QFA) collecté à la maternité. L'étude, dont la taille de l'échantillon est considérable (près de 15 000 femmes), se concentre sur les trois derniers mois de la grossesse. Les données obtenues permettront une meilleure compréhension des besoins nutritionnels spécifiques à cette période cruciale de la vie. L'analyse des résultats permettra d'évaluer l'impact des facteurs socio-démographiques et de santé sur la qualité de l'alimentation maternelle.
2. Méthodologie de collecte et d analyse des données
La collecte de données repose principalement sur un questionnaire de fréquence alimentaire (QFA) rempli par les femmes à la maternité. Ce QFA couvrait les trois derniers mois de la grossesse, fournissant ainsi une image relativement précise des habitudes alimentaires pendant cette période. Un manuel photos issu de l'étude SU.VI.MAX a servi de support visuel pour faciliter l'estimation des quantités consommées. Les participantes pouvaient choisir parmi sept fréquences de consommation, allant de « jamais » à « plus d'une fois par jour ». Pour des variables spécifiques, l’étude a privilégié les données de suivi à 2 mois, plus détaillées que celles recueillies à la maternité. Les données manquantes ont été complétées si possible. Des ajustements méthodologiques ont été appliqués pour tenir compte de certains éléments. Ainsi, pour les matières grasses ajoutées, l'apport calculé à partir du QFA a été multiplié par 1,25. Le calcul d’un ratio pain complet/pain total a été effectué pour une meilleure évaluation de la consommation de pain complet. Pour le sel, l'étude a pris en compte le sel contenu uniquement dans les aliments, car le QFA ne comprenait pas de question sur le sel de table. Des exclusions ont été effectuées pour gérer les cas de grossesses gémellaires (277 exclusions), assurant que chaque femme soit représentée une seule fois. Des analyses de sensibilité ont été réalisées pour évaluer l'impact de l'exclusion des données et de la pondération de l’échantillon.
3. Construction des scores nutritionnels Score PNNS et Score Grossesse
Deux scores ont été développés : le score-PNNS, basé sur 11 items reprenant les recommandations du PNNS pour les adultes, et le score-grossesse, basé sur 9 items spécifiques à la grossesse (détails dans le matériel additionnel). Ces scores ont été conçus pour être progressifs, reflétant le pourcentage de recommandations atteintes par les femmes. La méthodologie repose sur l'attribution d'un point pour chaque item répondant aux critères définis. Pour les nutriments spécifiques, les besoins nutritionnels ont servi de seuil. L’étude a utilisé les besoins nutritionnels moyens pour les femmes adultes pour l’évaluation de l’apport en fer. Cependant, l’apport en vitamine D n’a pas été inclus du fait de la complexité de sa mesure (exposition solaire et statut biologique). Le seuil pour chaque nutriment a été choisi pour minimiser le biais sur la prévalence de l'inadéquation des apports. Le score-PNNS n'a pas été corrigé pour l'apport énergétique en raison des difficultés à déterminer précisément les besoins énergétiques individuels des femmes enceintes. La construction des scores est détaillée dans le matériel additionnel fourni avec l’article.
II.Méthodologie de construction des scores nutritionnels
La construction des scores-PNNS et score-grossesse repose sur une méthodologie spécifique. Chaque item (fruits et légumes, viandes, poissons, produits laitiers, etc.) a été évalué en fonction de son adéquation aux recommandations du PNNS, en utilisant des seuils définis pour obtenir un score de 1 point. Le score final est un indicateur de l'adéquation globale du régime alimentaire aux recommandations. Des ajustements ont été effectués pour certains nutriments, comme les matières grasses ajoutées et le fer. Le seuil minimal retenu pour l'apport en fer, basé sur les besoins nutritionnels moyens pour les femmes adultes, a révélé qu'une grande proportion de femmes enceintes présentent des apports inadéquats. L'apport en vitamine D n'a pas pu être inclus dans le score en raison de la complexité de sa mesure (exposition solaire et statut biologique).
1. Définition et construction des scores nutritionnels
L'étude a développé deux scores pour évaluer l'adéquation de l'alimentation des femmes enceintes aux recommandations nutritionnelles. Le premier, le "score-PNNS", est basé sur 11 items issus des recommandations du Programme National Nutrition Santé (PNNS) pour la population adulte. Le deuxième, le "score-grossesse", se concentre sur 9 items spécifiques aux besoins nutritionnels de la grossesse. La méthodologie utilisée pour la construction de ces scores est basée sur un système de points : un point est attribué pour chaque item dont la consommation respecte les recommandations. L'objectif est d'obtenir un score progressif reflétant le pourcentage de recommandations atteintes. La description détaillée des 11 et 9 items composant respectivement le score-PNNS et le score-grossesse se trouve dans le matériel additionnel de l'étude. Cette méthode permet une évaluation quantitative de l'adéquation du régime alimentaire aux recommandations.
2. Traitement des données spécifiques et ajustements méthodologiques
Plusieurs ajustements méthodologiques ont été nécessaires pour affiner le calcul des scores. Pour les matières grasses ajoutées, l'apport calculé à partir du questionnaire de fréquence alimentaire (QFA) a été multiplié par 1,25 pour mieux refléter la consommation réelle. En ce qui concerne la consommation de pain, un ratio « pain complet / pain total » a été calculé pour une évaluation plus précise de la consommation de produits céréaliers complets. Un point crucial est la prise en compte du sel : comme le QFA ne posait pas de questions sur le sel de table, seuls les apports en sel via les aliments ont été considérés. L’étude mentionne que 80% de l'apport en sel en France provient des aliments, justifiant cette approche. Concernant l'apport en fer, le besoin nutritionnel moyen pour les femmes adultes a servi de référence. Seulement 51.9% des femmes de l'étude ELFE présentaient un apport en fer considéré comme adéquat, selon ce seuil. L'apport en vitamine D n’a pas été inclus dans le score car il est difficile à mesurer précisément (exposition solaire et statut biologique de la vitamine D).
3. Gestion des données manquantes et analyses de sensibilité
La gestion des données manquantes est un point important de la méthodologie. L'étude a privilégié les données du suivi à 2 mois, plus détaillées que celles collectées à la maternité, pour compléter les données manquantes. Par ailleurs, des analyses de sensibilité ont été menées afin d’évaluer la robustesse des résultats. Ces analyses ont consisté à réaliser des analyses sans exclusion des données sur l’apport énergétique et à utiliser différentes pondérations pour tenir compte des non-réponses, permettant d'évaluer l'impact de ces choix méthodologiques sur les résultats. Enfin, afin de garantir l’indépendance des données, des exclusions ont été réalisées pour les grossesses gémellaires (n=277), assurant qu'une seule femme soit prise en compte par grossesse. La taille importante de l'échantillon final (environ 14 950 femmes) renforce la fiabilité des analyses.
III.Résultats et facteurs associés aux scores nutritionnels
L'analyse des résultats montre des associations significatives entre les scores nutritionnels et plusieurs facteurs sociodémographiques et de santé. Des scores plus élevés (meilleure adéquation à la nutrition recommandée) ont été observés chez les femmes plus âgées, ayant un niveau d'études et des revenus plus élevés, et ayant suivi des cours de préparation à la naissance. L'âge, le lieu de naissance (étranger), la région de résidence (Sud de la France) et le diabète étaient également associés aux scores. La comparaison avec d'autres études utilisant une méthodologie similaire sera essentielle pour valider les résultats. Les résultats suggèrent une corrélation entre un meilleur score-PNNS et un nombre plus élevé d'enfants, potentiellement liée à une meilleure connaissance des recommandations alimentaires.
1. Facteurs sociodémographiques et de santé associés aux scores nutritionnels
L'analyse des résultats révèle des corrélations entre les scores nutritionnels (score-PNNS et score-grossesse) et plusieurs facteurs sociodémographiques et de santé. Les femmes plus âgées, ayant un niveau d'éducation et des revenus plus élevés, et ayant suivi des cours de préparation à la naissance présentaient des scores plus élevés, indiquant une meilleure adéquation à l'alimentation recommandée. De manière intéressante, les femmes nées à l'étranger, résidant dans le sud de la France, et ayant un historique de diabète avant ou pendant la grossesse ont également obtenu des scores plus élevés. À l'inverse, des scores plus faibles étaient associés à la consommation de tabac pendant la grossesse. Ces résultats suggèrent que certains facteurs socio-économiques et de santé peuvent influencer les pratiques alimentaires des femmes enceintes. L'étude souligne l'importance de prendre en compte ces différents aspects pour élaborer des stratégies efficaces de promotion de la santé nutritionnelle pendant la grossesse.
2. Interprétation des résultats et comparaisons avec d autres études
Les résultats obtenus sont analysés en tenant compte du contexte de l'étude ELFE, notamment le niveau d’études élevé de la population étudiée, par rapport à la population générale. Une relation entre un score PNNS plus élevé et le nombre d'enfants a été observée, ce qui pourrait être lié à une meilleure connaissance des recommandations. Les auteurs précisent qu'une comparaison des résultats avec d’autres études est nécessaire. Une analyse comparative avec d’autres études utilisant la même méthodologie est envisagée pour valider la pertinence des conclusions. Les scores nutritionnels sont interprétés de manière relative, permettant de comparer les femmes enceintes de l'étude ELFE entre elles plutôt que d’évaluer des valeurs absolues. Des références sont faites à des études réalisées dans des pays nordiques, en Allemagne et aux États-Unis, soulignant des différences significatives dans les apports nutritionnels selon les pays. L’étude mentionne également l’étude PIN (Pregnancy, Infection and Nutrition) menée aux États-Unis qui a développé un index de qualité de l’alimentation pour la grossesse (Pregnancy Quality Index for Pregnancy).
3. Limites de l étude et perspectives
L’étude met en lumière quelques limites méthodologiques. Le QFA utilisé dans l’étude ELFE a été rempli à la maternité et portait sur les trois derniers mois de la grossesse, limitant sa représentativité de l'alimentation sur toute la durée de la gestation. De plus, l’absence de question spécifique sur la consommation de sel de table dans le QFA limite l’évaluation précise des apports en sodium. Malgré ces limitations, la grande taille de l’échantillon (environ 15 000 femmes) constitue un atout majeur. La cohérence entre les observations de l'étude et les données de la littérature est mentionnée, notamment concernant l'association entre un âge plus jeune et des scores nutritionnels plus faibles. Cependant, la nature transversale de l'étude ne permet pas d'établir de relations de causalité. Des études longitudinales seraient nécessaires pour confirmer les associations observées et mieux comprendre l'évolution des habitudes alimentaires des femmes enceintes.
IV.Comparaison avec d autres études et limites de l étude
Les résultats de cette étude sur la qualité de l’alimentation pendant la grossesse sont comparés à ceux d'autres études, notamment des études menées dans des pays nordiques, en Allemagne et aux États-Unis. Des différences significatives d’apports en certains nutriments, notamment le fer et la vitamine D, ont été relevées. Les auteurs mentionnent l'étude PIN (Pregnancy, Infection and Nutrition) menée en Caroline du Nord comme référence. Les limitations de l'étude ELFE incluent le fait que le QFA ne reflète que les habitudes alimentaires des trois derniers mois de la grossesse et ne mesure pas l'apport en sel provenant du sel de table. La taille importante de l’échantillon (près de 15 000 femmes) constitue un atout majeur de cette recherche.
1. Comparaison des résultats avec d autres études internationales
L'étude souligne l'importance de comparer ses résultats avec ceux d'autres études menées dans différents contextes. Des références sont faites à des travaux réalisés dans les pays nordiques, en Allemagne et aux États-Unis. Ces comparaisons révèlent des variations significatives dans les apports nutritionnels selon les pays. Par exemple, les apports en fer et en vitamine D semblent différer notablement entre la France et d'autres pays, où ils peuvent être multipliés par 1,5 ou 2. L'étude mentionne également l'étude PIN (Pregnancy, Infection and Nutrition) menée en Caroline du Nord, aux États-Unis, qui a développé un index de qualité de l'alimentation pour la grossesse (Pregnancy Quality Index for Pregnancy), offrant un cadre de comparaison supplémentaire. Ces comparaisons internationales permettent de contextualiser les résultats de l'étude ELFE et d'identifier les spécificités de la situation française concernant l'alimentation des femmes enceintes.
2. Limites méthodologiques de l étude ELFE
L'étude reconnaît plusieurs limites méthodologiques. Premièrement, le questionnaire de fréquence alimentaire (QFA) utilisé a été rempli à la maternité et couvrait uniquement les trois derniers mois de la grossesse. Ceci limite la représentativité de l'alimentation sur l'ensemble de la période gestationnelle. Deuxièmement, l'absence de question spécifique sur la consommation de sel de table dans le QFA empêche une évaluation précise de l'apport total en sodium. Seul le sel contenu dans les aliments transformés a été considéré, ce qui pourrait sous-estimer la consommation globale de sel. Troisièmement, l'impossibilité d'intégrer l'apport en vitamine D dans le score nutritionnel, du fait de la complexité de sa mesure (exposition solaire et statut biologique), constitue une autre limitation. Malgré ces limitations méthodologiques, les auteurs soulignent la taille importante de l'échantillon (environ 15 000 femmes), ce qui renforce la fiabilité statistique des résultats.
