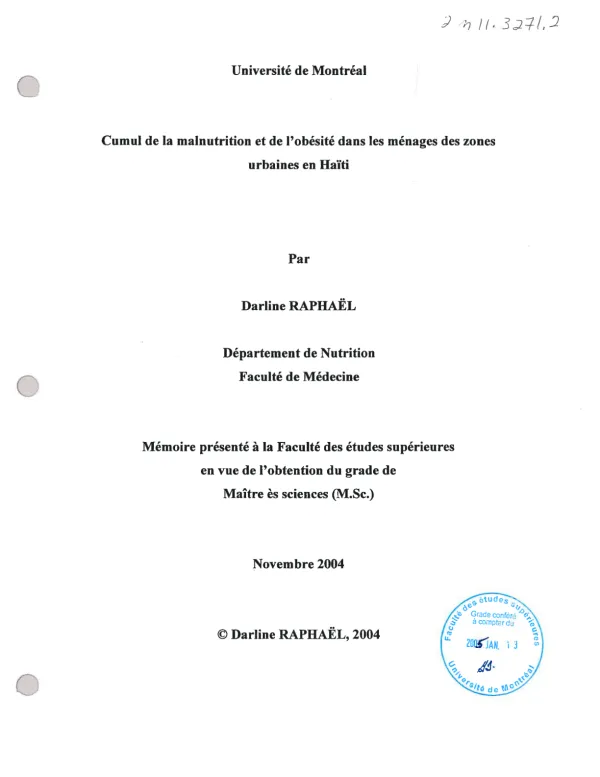
Malnutrition-Obésité en Haïti: Un Cumul ?
Informations sur le document
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 4.36 MB |
Résumé
I.Le Double Fardeau Nutritionnel en Milieu Urbain Pauvre en Haïti Malnutrition Infantile et Surpoids Maternel
Cette étude transversale examine la coexistence préoccupante de la malnutrition infantile et du surpoids (voire de l'obésité) maternel au sein des ménages d'un bidonville haïtien. En Haïti, un pays à faible revenu, la prévalence nationale des ménages présentant un enfant présentant un retard de croissance et une mère en surpoids est de 3% (Gaiett et Ruel, 2003). Cependant, la situation est aggravée dans les zones urbaines pauvres. L’étude, menée auprès de 203 ménages, vise à déterminer la prévalence de ce « cumul » et à analyser les facteurs associés, notamment la transition nutritionnelle, la sécurité alimentaire, et le statut socio-économique (SES). Les résultats révèlent une forte prévalence de la malnutrition (36% des enfants sont affectés par le retard de croissance) et du surpoids maternel (32%).
1. Contexte du Double Fardeau Nutritionnel
L'étude s'intéresse au phénomène du « cumul » de la malnutrition et de l'obésité au sein des mêmes ménages dans les pays en développement (PED). Ce « double fardeau nutritionnel » représente un défi majeur pour les systèmes de santé, nécessitant des stratégies d'intervention simultanées et cohérentes. La transition nutritionnelle, résultant de l'urbanisation, des changements de niveau de vie et de la mondialisation, est identifiée comme un facteur clé influençant les habitudes alimentaires et les modes de vie, contribuant à cette coexistence paradoxale de la malnutrition et de l'obésité. L'objectif principal est d'évaluer le profil nutritionnel des ménages haïtiens, en se concentrant sur la prévalence du cumul « enfant malnutri, mère en surpoids » dans un milieu urbain pauvre. Deux hypothèses sont posées : le cumul est favorisé par l'insécurité alimentaire liée à la pauvreté, et il est plus fréquent chez les ménages ayant récemment migré vers la ville. L'étude se base sur une approche transversale, analysant 203 ménages d'un grand bidonville haïtien sélectionnés aléatoirement, avec comme unité d'analyse le ménage lui-même. Les critères d'inclusion précisent la présence d'une mère et d'au moins deux enfants biologiques de moins de 10 ans (dont un âgé entre 6 et 59 mois), tous en bonne santé apparente.
2. Prévalence et Caractéristiques des Ménages
Les résultats montrent une prévalence importante de la malnutrition infantile (36%) et du surpoids maternel (31%) au sein de ce bidonville haïtien. Il est observé que 14% des ménages présentent le cumul « enfant malnutri, mère en surpoids ». Il est intéressant de noter que les ménages ayant une mère en surpoids, quel que soit le statut nutritionnel de l'enfant, affichent un meilleur statut socio-économique (SES), une meilleure sécurité alimentaire et une plus grande diversité alimentaire que les ménages où la mère et l'enfant sont malnutris (7%) ou seulement l'enfant (36%). La durée de la résidence urbaine n'est pas corrélée au profil nutritionnel des ménages. Globalement, les données suggèrent que les effets de la transition nutritionnelle se manifestent principalement dans les ménages relativement plus aisés, même au sein d'un contexte de pauvreté extrême. La prévalence nationale du cumul « enfant présentant un retard de croissance, mère en surpoids » est de seulement 3% en Haïti, selon une étude précédente (Gaiett et Ruel, 2003), soulignant la gravité de la situation spécifique à ce bidonville.
3. Définition et Mesure des Variables
La malnutrition est définie comme un déséquilibre entre l'apport en nutriments et les besoins de l'organisme, souvent exacerbée par les infections. Elle affecte près de 150 millions d'enfants de moins de 5 ans dans les PED (UNICEF, 2002). Ses conséquences à long terme sur le développement individuel et social sont bien documentées, incluant des effets intergénérationnels (Delisle, 2002). L'obésité, souvent considérée comme un signe de prospérité dans certains PED, est de plus en plus fréquente, même dans des milieux défavorisés. La sécurité alimentaire est évaluée à travers la diversité alimentaire (nombre d'aliments ou de groupes d'aliments consommés) et la perception subjective des mères concernant leur situation alimentaire. Le statut socio-économique (SES) est mesuré par des indicateurs indirects, incluant la possession de biens durables (radio, télévision, réfrigérateur), les conditions de logement, l'accès à l'eau potable et les installations sanitaires. Divers outils et méthodes de mesure (questionnaires, rappel de 24 heures), adaptés au contexte haïtien, ont été employés afin de caractériser au mieux la situation nutritionnelle, socio-économique et alimentaire des ménages.
II.Facteurs Associés à la Coexistence de la Malnutrition et du Surpoids
L'analyse montre que les ménages avec une mère en surpoids, indépendamment du statut nutritionnel de l'enfant, présentent un meilleur SES, une meilleure sécurité alimentaire, et une plus grande diversité alimentaire que les ménages où la mère et l'enfant sont malnutris. La durée de résidence en milieu urbain ne semble pas corrélée au profil nutritionnel du ménage. L'insécurité alimentaire, perçue par les mères, est fortement liée au cumul malnutrition-surpoids, suggérant des restrictions alimentaires périodiques. La diversité alimentaire, bien que généralement associée à un meilleur statut nutritionnel, est paradoxalement corrélée au surpoids dans cette étude, probablement en raison d'une augmentation des quantités consommées plutôt qu'une amélioration de la qualité.
1. Statut Socio économique SES Sécurité Alimentaire et Diversité Alimentaire
L'étude révèle une corrélation significative entre le statut socio-économique des ménages et la présence de surpoids chez les mères. Indépendamment du statut nutritionnel des enfants, les ménages avec une mère en surpoids présentent un meilleur SES, une meilleure sécurité alimentaire et une plus grande diversité alimentaire que les ménages où la mère et l'enfant sont malnutris, ou seulement l'enfant. Ceci suggère que des conditions socio-économiques légèrement meilleures, même au sein d'un bidonville, peuvent être associées à un meilleur accès à la nourriture et à une plus grande variété d'aliments, contribuant au surpoids maternel. La longueur de la résidence urbaine, contrairement à l'hypothèse initiale, n'influence pas le profil nutritionnel du ménage. L'analyse souligne l'importance du SES, de la sécurité alimentaire et de la diversité alimentaire comme facteurs déterminants dans la coexistence de la malnutrition infantile et du surpoids maternel. Des ménages plus aisés, même dans un contexte de pauvreté généralisée, ont davantage accès à des ressources alimentaires suffisantes, même si la qualité de ces aliments n’est pas forcément optimale.
2. Insécurité Alimentaire et Consommation Alimentaire
L'insécurité alimentaire, évaluée à la fois par la perception subjective des mères et par la diversité alimentaire, apparaît comme un facteur crucial dans la coexistence de la malnutrition infantile et du surpoids maternel. Les ménages présentant le cumul « enfant malnutri, mère en surpoids » ont une proportion significativement plus élevée d'insécurité alimentaire grave, souffrant de la faim. Ceci suggère des restrictions alimentaires périodiques qui pourraient contribuer à la malnutrition infantile. L'analyse de la consommation de fruits et jus de fruits montre des différences significatives entre les profils nutritionnels: les ménages avec le cumul « enfant malnutri, mère en surpoids » affichent une consommation inférieure à ceux où l'enfant est en bonne santé et la mère est en surpoids, soulignant le rôle de la qualité de l'alimentation dans le développement de la malnutrition infantile. L'obésité maternelle, dans ce contexte, serait plutôt le résultat d'un apport énergétique positif, même avec une alimentation de faible qualité. Les résultats contrastent avec des études dans les pays développés qui montrent une association entre insécurité alimentaire et obésité chez les femmes pauvres, soulignant des différences contextuelles importantes.
3. Diversité Alimentaire et Surpoids Une Relation Paradoxale
La diversité alimentaire, bien que généralement considérée comme un indicateur de qualité de l'alimentation, est positivement associée au surpoids dans cette étude. Ce résultat paradoxal est interprété comme un corollaire du SES : les ménages avec un meilleur SES ont une alimentation plus diversifiée et consomment de plus grandes quantités d'aliments différents sans pour autant réduire les portions. Cette observation est soutenue par des études qui mettent en évidence l'impact indépendant de la taille des portions et de la densité énergétique des aliments sur la quantité totale consommée. Dans les populations pauvres, l'accent est souvent mis sur l'aspect quantitatif plutôt que qualitatif de l'alimentation, ce qui peut expliquer cette association entre diversité alimentaire et surpoids. L'étude souligne la complexité de la relation entre la diversité alimentaire, le statut socio-économique, et les problèmes de surpoids et d'obésité, même au sein de populations pauvres.
III.Contexte Haïtien et Méthodologie
L'étude se déroule à Jalouzi, un bidonville de Port-au-Prince, Haïti. Haïti est confrontée à une crise socio-politique profonde, se classant 153ème sur 175 pays selon l'indice de développement humain du PNUD (2004). Les caractéristiques socio-démographiques sont préoccupantes : densité de population élevée (292 hab/km²), espérance de vie faible (49 ans), faible revenu par habitant (231 $US), taux d'analphabétisme important (65%), chômage élevé (60%), et mortalité infantile élevée (80‰) (EDS, 2000). La migration rurale-urbaine massive aggrave les conditions de vie dans les zones urbaines. La méthodologie inclut un échantillon aléatoire de 203 ménages répondant à des critères spécifiques (présence d'une mère et d'au moins deux enfants de moins de 10 ans, dont un âgé de 6 à 59 mois). Le SES est évalué à partir de variables proxy telles que les biens durables (radio, télévision, réfrigérateur), le logement, l’accès à l’eau et les installations sanitaires.
1. Contexte Haïtien et la Crise Socio politique
L'étude se déroule à Jalouzi, un bidonville de Port-au-Prince, Haïti, un pays classé 153ème sur 175 selon l'Indice de Développement Humain du PNUD en 2004. Haïti est le pays le plus pauvre du continent américain, souffrant d'une crise socio-politique prolongée depuis 1986, qui a eu des conséquences dramatiques sur les indicateurs sociaux. En 2000, la population était estimée à 7 958 964 habitants, dont 36% en milieu urbain. La densité de population est élevée (292 habitants/km²), l'espérance de vie basse (49 ans), et le revenu par habitant très faible (231 $US). Les taux d'analphabétisme (65%) et de chômage (60%) sont importants, de même que la mortalité infantile (80‰) (EDS, 2000). Cette situation de pauvreté extrême est aggravée par une migration massive des populations rurales vers les zones urbaines, notamment vers Port-au-Prince qui absorbe environ 13 000 migrants par an (4,8% de croissance démographique annuelle), ce qui contribue à l'expansion des bidonvilles et à la détérioration des conditions de vie en milieu urbain (Rousseau, 1998). En 1997, environ 50% de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince était déjà considérée comme « bidonvillisée » (Brailowsky, 1997). Ce contexte de pauvreté et d’instabilité politique exacerbe la vulnérabilité des populations face aux problèmes de malnutrition et d’obésité.
2. Méthodologie de l Étude
L'étude utilise une méthodologie transversale, basée sur un échantillon aléatoire de 203 ménages dans le bidonville de Jalouzi. Les ménages inclus dans l'étude comprenaient au minimum une mère et au moins deux enfants biologiques de moins de 10 ans, dont un âgé de 6 à 59 mois, tous apparemment en bonne santé. Les femmes enceintes ont été exclues. Le recrutement s'est fait par des visites à domicile, avec un consentement verbal des chefs de ménage (les formulaires écrits n'ayant pas été utilisés en raison des difficultés pratiques). La collecte de données s'est étalée sur deux mois (juillet-août 2003) et s'est appuyée sur plusieurs outils : questionnaires administrés aux mères concernant la sécurité alimentaire (utilisant le questionnaire de fréquence et le rappel de 24h, ainsi qu'une échelle de perception subjective de l'insécurité alimentaire développée par le USDA et validée pour les contextes de pays en développement (Bickel et al., 2000; Lorenzana et Sanjur, 1999)), les habitudes alimentaires, le statut vaccinal des enfants, l'hygiène (type de toilette et accès à l'eau potable), et l'accès aux soins de santé. Le statut socio-économique (SES) a été évalué de manière indirecte via la possession de biens durables, les conditions de logement, l'accès à l'eau et les installations sanitaires. L'environnement immédiat a également été évalué par l'auteure.
IV.Résultats et Implications pour les Programmes d Intervention
Malgré la prévalence élevée du surpoids maternel et du cumul malnutrition-surpoids, la malnutrition infantile reste le problème majeur en Haïti. Les programmes d'intervention doivent prioriser la lutte contre la malnutrition infantile chronique, sachant que celle-ci peut prédisposer à l'obésité à l'âge adulte. Il est crucial de développer des approches tenant compte des déterminants complexes de la transition nutritionnelle dans les contextes urbains pauvres, en considérant la sécurité alimentaire qualitative et quantitative, la diversité alimentaire, et le SES des ménages. Des interventions ciblées sont nécessaires pour améliorer l'accès à une alimentation de qualité et pour promouvoir des modes de vie sains.
1. Résultats Principaux sur la Malnutrition et le Surpoids
L'étude révèle une forte prévalence de la malnutrition infantile (36%) et du surpoids maternel (32%) dans le bidonville haïtien étudié. Le cumul « enfant malnutri, mère en surpoids » est observé chez 14% des 203 ménages échantillonnés. Il est important de noter que, malgré la prévalence significative du surpoids maternel, la malnutrition infantile reste le problème le plus répandu dans cette population. Seulement 8% des mères présentent de l'obésité (IMC ≥ 30), tandis que le surpoids (25 ≤ IMC < 29,9) touche 23% des mères. Le retard de croissance est plus prévalent (32%) que l'émaciation (7%) chez les enfants, ce qui suggère des problèmes de sous-nutrition chronique plutôt qu'une carence alimentaire récente. Cette situation est cohérente avec le contexte socio-politique haïtien marqué par une détérioration des indicateurs sociaux depuis plus de 15 ans (baisse de l’espérance de vie, augmentation du chômage, expansion des bidonvilles). Les ménages avec une mère en surpoids, indépendamment du statut nutritionnel de l'enfant, ont un meilleur score de SES, de sécurité alimentaire et de diversité alimentaire que les ménages avec à la fois une mère et un enfant malnutris.
2. Implications pour les Programmes d Intervention
Malgré la présence notable du surpoids maternel et du cumul malnutrition-surpoids, l'étude met en évidence la nécessité de prioriser la lutte contre la malnutrition infantile, qui reste le problème majeur. Les programmes d'intervention doivent tenir compte de la complexité du phénomène, notamment des liens entre la malnutrition infantile chronique et le risque d’obésité à l'âge adulte. Une approche préventive et curative est donc essentielle. Les résultats suggèrent une intervention multidimensionnelle qui prend en compte les facteurs socio-économiques, l'accès à une alimentation de qualité et la diversité alimentaire. L'étude souligne la nécessité de développer des programmes adaptés au contexte spécifique de la transition nutritionnelle dans les zones urbaines pauvres d'Haïti, tenant compte des particularités culturelles et des réalités socio-économiques locales. Il est crucial de prévenir la malnutrition infantile, non seulement pour son impact immédiat sur la santé des enfants, mais aussi pour éviter le risque accru d’obésité à l’âge adulte, créant ainsi un cercle vicieux de problèmes de santé.
