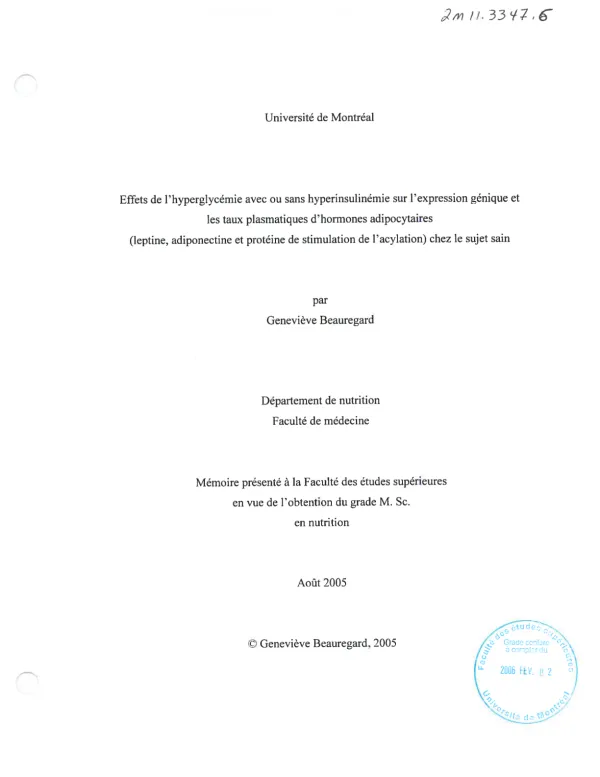
Hyperglycémie: Effets sur les hormones adipocytaires
Informations sur le document
| Auteur | Geneviève Beauregard |
| school/university | Université de Montréal |
| subject/major | Nutrition |
| Type de document | Mémoire |
| academic_year/year_document_was_written | Août 2005 |
| city_where_the_document_was_published | Montréal |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 2.90 MB |
Résumé
I.Rôle du tissu adipeux et des adipokines dans le métabolisme glucido lipidique
Cette étude explore le rôle de trois adipokines clés – la leptine, l'adiponectine, et la protéine de stimulation de l'acylation (ASP) – dans la régulation du métabolisme glucido-lipidique. Le tissu adipeux, autrefois considéré comme un simple réservoir d'énergie, est maintenant reconnu pour sa fonction endocrine, sécrétant des substances qui influent sur le métabolisme énergétique et lipidique. L'étude porte sur l'impact de l'hyperglycémie et de l'hyperinsulinémie, caractéristiques de l'insulinorésistance et du diabète de type 2, sur l'expression génique et la concentration plasmatique de ces hormones.
1. Le tissu adipeux un organe endocrine
Traditionnellement perçu comme un simple site de stockage d'énergie, le tissu adipeux est désormais reconnu pour son rôle crucial dans la régulation métabolique. Il sécrète un éventail de substances, parmi lesquelles trois adipokines sont particulièrement étudiées : la leptine, l'adiponectine et l'acyl-stimulating protein (ASP). Ces hormones jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'homéostasie énergétique et lipidique, influant sur des processus aussi importants que l'apport alimentaire, l'utilisation des substrats et la dépense énergétique. La leptine, notamment, reflète les réserves adipeuses et participe à la régulation de ces paramètres. L'adiponectine, quant à elle, intervient dans le catabolisme des lipides, améliore le contrôle glycémique et pourrait protéger contre les maladies cardiovasculaires. Cette nouvelle vision du tissu adipeux comme un organe de régulation endocrine souligne l'importance de comprendre les interactions complexes entre les adipokines et le métabolisme global.
2. Objectif de l étude et justification
L'étude se propose d'analyser l'impact de l'hyperglycémie, seule ou combinée à l'hyperinsulinémie, sur l'expression génique et la concentration plasmatique des trois adipokines mentionnées précédemment (leptine, adiponectine et ASP). Cette approche vise à reproduire, chez des sujets sains, les conditions métaboliques observées dans l'intolérance au glucose et le diabète de type 2, où l'hyperglycémie et l'hyperinsulinémie sont fréquentes. L'analyse de l'hyperglycémie seule permettra d'isoler les effets du glucose de ceux de la combinaison hyperinsulinémie-hyperglycémie. L'étude s'appuie sur le constat que les données concernant les effets de ces stimuli sur les adipokines sont fragmentaires, basées sur des études in vitro ou animales, et souvent incomplètes chez l'humain. En étudiant à la fois l'expression génique et la concentration plasmatique, l'étude offre une perspective plus complète sur la régulation de ces hormones clés dans le métabolisme.
3. Rôle physiologique des adipokines
Le document détaille les fonctions physiologiques de la leptine, de l'adiponectine et de l'ASP. La leptine, principalement produite par le tissu adipeux, est une protéine de 16 kDa composée de 167 acides aminés. Sa concentration plasmatique est plus élevée chez les femmes que chez les hommes, même après correction pour l'adiposité. Elle intervient dans la régulation de l'appétit, de l'utilisation des substrats et de la dépense énergétique, jouant un rôle d'adaptation au jeûne. L'adiponectine, dont les effets métaboliques ont été principalement étudiés chez l'animal, favorise le catabolisme des acides gras dans les muscles squelettiques et améliore la sensibilité à l'insuline dans le foie. Enfin, l'ASP, produite et libérée dans le sang par les adipocytes, stimule la synthèse des triglycérides et pourrait jouer un rôle dans la sécrétion d'insuline. La compréhension de leurs rôles respectifs est essentielle pour appréhender le métabolisme glucido-lipidique.
II.Effet de l hyperglycémie et de l hyperinsulinémie sur la leptine
Des études in vitro et in vivo ont montré des résultats contradictoires quant à l'effet de l'insuline seule sur la concentration plasmatique de leptine. Alors que certaines études suggèrent une augmentation de la leptine sous l'effet de l'hyperinsulinémie, d'autres ne montrent pas d'effet significatif. La combinaison hyperinsulinémie-hyperglycémie semble augmenter la concentration plasmatique de leptine, mais l'effet du Sandostatin (utilisé pour inhiber la sécrétion d'insuline endogène) reste à éclaircir. L'étude vise à déterminer si l'hyperglycémie a un effet indépendant sur la leptine.
1. Effet de l insuline sur la leptine résultats contradictoires
L'étude de l'effet de l'insuline sur la leptine révèle des résultats contradictoires dans la littérature. Des études in vitro suggèrent que l'insuline stimule l'expression du gène ob dans les adipocytes de souris, de rats et d'humains. Par exemple, Leroy et al. (51) ont observé une augmentation triplée de l'expression du gène ob après 10 heures de culture en présence d'insuline, et quintuplée après 24 heures. De même, Kolaczynski et al. (49) ont constaté une augmentation significative de l'expression du gène ob après 72 heures de culture d'adipocytes humains avec de l'insuline. Cependant, des études in vivo montrent des résultats plus variables. Certaines études démontrent un effet stimulateur de l'insuline sur la concentration plasmatique de leptine, tandis que d'autres ne montrent aucun effet significatif. Cette divergence pourrait être due à des différences dans les doses d'insuline utilisées, la durée des expérimentations ou d'autres facteurs non contrôlés. La question de l'effet isolé de l'insuline sur la concentration plasmatique de leptine reste donc controversée.
2. Effet combiné de l hyperinsulinémie et de l hyperglycémie
Contrairement à l'effet isolé de l'insuline, la combinaison de l'hyperinsulinémie et de l'hyperglycémie semble avoir un impact plus clair sur la leptine. La majorité des études recensées dans la littérature indiquent que cette combinaison augmente la concentration plasmatique de leptine. Cependant, les durées des expérimentations varient considérablement, allant de 16 heures (Sonnenberg et al., 45) à 72 heures (Kolaczynski et al., 49), ce qui pourrait expliquer certaines divergences. Il est également important de noter que l'effet de l'hyperglycémie isolée sur la concentration plasmatique de leptine n'a pas été suffisamment étudié pour permettre une conclusion définitive. L'étude actuelle vise à éclaircir ce point en analysant séparément les effets de l'hyperglycémie et de la combinaison hyperinsulinémie-hyperglycémie chez des sujets sains. Le protocole expérimental utilise des clamps hyperinsulinémiques euglycémiques et hyperinsulinémiques hyperglycémiques pour isoler les effets des deux stimuli.
3. Études in vitro et in vivo comparaison des approches
Les études in vitro, réalisées sur des adipocytes de rats et d'humains, montrent une stimulation de la libération de leptine par l'insuline de manière concentration-dépendante. Cependant, la présence de glucose semble nécessaire pour que l'insuline exerce pleinement son effet. En revanche, les études in vivo présentent une plus grande variabilité des résultats concernant l'effet de l'insuline sur la concentration plasmatique de leptine. Malmström et al. (28) ont observé une augmentation significative de la leptine après un clamp hyperinsulinémique euglycémique de 8,5 heures chez des sujets légèrement en surpoids. Cependant, d'autres études (47, 49) n'ont pas mis en évidence cet effet, même avec des insulinémies plus élevées. Cette discordance souligne la complexité de la régulation de la leptine in vivo et met en lumière la nécessité d'études plus approfondies pour clarifier le rôle respectif de l'insuline et du glucose dans ce processus. L'étude actuelle contribuera à lever cette incertitude en utilisant une méthodologie rigoureuse et contrôlée chez des sujets sains.
III.Effet de l hyperglycémie et de l hyperinsulinémie sur l adiponectine
Une faible concentration plasmatique d'adiponectine est souvent associée à l'insulinorésistance et au diabète de type 2. Des études in vitro ont montré des effets contradictoires de l'insuline sur l'expression du gène apM1 (adiponectine). L'étude explore l'impact de l'hyperglycémie seule et combinée à l'hyperinsulinémie sur la concentration plasmatique d'adiponectine et son expression génique in vivo, chez des sujets sains. L'absence d'effet significatif de l'hyperglycémie chronique dans une étude précédente est mentionnée.
1. Association entre faible adiponectine insulinorésistance et diabète
De nombreuses études ont établi une corrélation entre de faibles concentrations d'adiponectine et le développement de l'insulinorésistance et du diabète de type 2. Cependant, la nature causale de cette relation reste à démontrer. Une faible concentration d'adiponectine est observée chez les hommes et les femmes atteints d'insulinorésistance et de diabète de type 2. Des corrélations négatives ont été trouvées entre la concentration plasmatique d'adiponectine et la glycémie à deux heures après une charge en glucose, l'hémoglobine glyquée (HbA1c) et l'insulinémie à jeun. Inversement, une corrélation positive a été observée avec l'utilisation du glucose stimulée par l'insuline. Il est important de noter que cette relation entre l'insulinorésistance et les concentrations d'adiponectine semble indépendante de l'IMC. Chez les humains, certains polymorphismes génétiques associés à une concentration moindre d'adiponectine augmentent le risque d'évolution vers le diabète de type 2 chez les patients intolérants au glucose. L'administration de thiazolidinediones, un médicament augmentant la sensibilité à l'insuline, a montré une augmentation de la concentration plasmatique d'adiponectine chez des sujets diabétiques de type 2, obèses et même minces, suggérant un lien entre la résistance à l'insuline et la baisse d'adiponectine.
2. Effets de l hyperinsulinémie et de l hyperglycémie sur l adiponectine études in vitro et in vivo
Les études concernant l'impact de l'hyperinsulinémie, de l'hyperglycémie et de leur combinaison sur la concentration plasmatique et l'expression génique de l'adiponectine sont limitées. Des résultats contradictoires existent pour l'effet de l'insuline sur l'expression du gène apM1. Halleux et al. (43) ont observé une augmentation de 179 % de l'expression de apM1 in vitro en présence d'insuline, alors que Fasshauer et al. (44) ont constaté une réduction de 85 % dans des conditions similaires. Cette divergence pourrait être liée à des différences dans les protocoles expérimentaux. Concernant l'hyperglycémie, la seule étude disponible (Mannucci et al., 42) portant sur l'hyperglycémie chronique chez des patients diabétiques de type 2 n'a pas révélé de relation significative avec la concentration plasmatique d'adiponectine, mais l'hyperinsulinémie coexistante chez ces patients constitue un facteur confondant. Aucune étude in vivo n'a exploré l'effet aigu de l'hyperglycémie seule, ni l'effet combiné de l'hyperglycémie et de l'hyperinsulinémie sur la concentration plasmatique d'adiponectine, ni l'effet de ces stimuli sur l'expression du gène apM1 in vivo. Chez l'homme, quelques études suggèrent une diminution de la concentration plasmatique d'adiponectine suite à une hyperinsulinémie isolée, mais la durée des stimulations est un facteur crucial et diffère entre ces études et l'étude actuelle.
3. Isoformes de l adiponectine et limites des études précédentes
Des études récentes ont mis en évidence l'existence de différentes isoformes d'adiponectine (monomères, trimères, hexamères, agrégats). La signification métabolique de ces différentes formes n'est pas encore entièrement comprise, certaines étant associées à un profil métabolique favorable, d'autres défavorable. Les dosages radio-immunologiques (RIA) utilisés dans les études précédentes ne précisent pas toujours les isoformes mesurées, ce qui rend difficile la comparaison des résultats. La présente étude, par son approche méthodologique rigoureuse, vise à approfondir l'impact de l'hyperglycémie et de l'hyperinsulinémie, seuls ou combinés, sur la concentration plasmatique d'adiponectine et son expression génique, en tenant compte des limitations des études antérieures. L'absence d'études in vivo sur l'effet de l'hyperglycémie aiguë, isolée ou combinée à l'hyperinsulinémie sur l'adiponectine chez l'homme sain justifie pleinement cette recherche.
IV.Effet de l hyperglycémie et de l hyperinsulinémie sur l ASP
L'ASP (protéine de stimulation de l'acylation), produite par le tissu adipeux, joue un rôle dans le métabolisme des lipides. L'étude investigate l'effet de l'hyperglycémie et de l'hyperinsulinémie sur l'expression génique de l'ASP et ses précurseurs (protéine C3, adipsine), ainsi que sur sa concentration plasmatique. Des études préliminaires in vitro suggèrent une augmentation de l'ASP sous l'effet de l'insuline, mais l'impact in vivo reste à déterminer. L'étude explore la possibilité d'un effet combiné de l'hyperglycémie et de l'hyperinsulinémie.
1. Synthèse et régulation de l ASP
L'acyl-stimulating protein (ASP) est une adipokine produite et libérée dans la circulation sanguine par les adipocytes. Sa synthèse implique trois protéines : le troisième composant du complément (C3), le facteur B et l'enzyme adipsine, le tissu adipeux étant le seul site de production de ces trois précurseurs. La production locale d'ASP dans le tissu adipeux sous-cutané abdominal est stable pendant le jeûne mais augmente en période post-prandiale, atteignant un maximum 3 à 5 heures après un repas mixte, en corrélation avec la clairance des triglycérides et l'entrée des acides gras dans le tissu adipeux. La protéine transthyrétine (TTR), contenue dans les chylomicrons, est le principal stimulateur de la production d'ASP et de la protéine C3, augmentant la production d'ASP de 150 fois. L'insuline stimule également la production d'ASP, mais à un degré moindre (2 fois). Malgré cette augmentation de production locale après les repas, la concentration plasmatique d'ASP ne varie pas significativement, probablement en raison de la dilution dans la circulation générale.
2. Effets de l insuline et du glucose sur l ASP études in vitro et in vivo
Les études in vitro suggèrent que l'insuline augmente la concentration d'ASP, tandis que le glucose ne semble pas avoir d'influence. Cependant, une seule étude a été menée sur la régulation de l'expression génique des précurseurs de l'ASP par l'insuline, indiquant une absence d'effet. De même, aucune étude n'a exploré la régulation de l'expression génique par le glucose. Concernant la régulation de la concentration plasmatique in vivo, il n'existe pas d'études disponibles. Cette absence de données sur les effets de l'hyperglycémie et de l'hyperinsulinémie in vivo, ainsi que l'absence d'études sur la régulation de l'expression génique des précurseurs de l'ASP par le glucose, constituent des lacunes importantes dans la littérature. La présente étude vise à combler ces lacunes en examinant l'impact de l'hyperglycémie isolée et combinée à l'hyperinsulinémie sur l'expression génique de l'ASP et de ses précurseurs, ainsi que sur la concentration plasmatique d'ASP chez des sujets sains.
3. Objectif de l étude concernant l ASP
L'objectif principal de l'étude concernant l'ASP est d'évaluer les effets d'une hyperglycémie isolée et d'une hyperglycémie combinée à une hyperinsulinémie sur l'expression des gènes de l'ASP et de ses précurseurs dans le tissu adipeux, ainsi que sur la concentration plasmatique d'ASP chez des sujets sains. Cette étude est justifiée par le manque de données in vivo sur le sujet et la nécessité de compléter les connaissances fragmentaires obtenues par des études in vitro ou animales. L'étude contribuera à une meilleure compréhension du rôle de l'ASP dans le métabolisme glucido-lipidique et énergétique, notamment dans le contexte de l'obésité, de l'insulinorésistance et du diabète de type 2, où des altérations du métabolisme de l'ASP ont été observées. En analysant simultanément l'expression génique et la concentration plasmatique, l'étude vise à obtenir une image plus complète de la régulation de l'ASP sous l'influence de l'hyperglycémie et de l'hyperinsulinémie.
V.Méthodologie de l étude
Seize hommes caucasiens en santé ont participé à l'étude, utilisant une technique de clamp hyperglycémique modifiée pour induire une normoinsulinémie ou une hyperinsulinémie. Des échantillons de tissu adipeux sous-cutané ont été prélevés avant et après le clamp. La PCR en temps réel a été utilisée pour quantifier l'ARNm des trois adipokines. Le Sandostatin, un analogue de la somatostatine, a été administré pour inhiber la sécrétion d'insuline endogène. L'âge moyen des participants était de 22-23 ans, avec un IMC de 22-23 kg/m². Novartis Pharma inc. (Dorval, Québec, Canada) est mentionné comme fournisseur du Sandostatin.
1. Population d étude et critères d inclusion
L'étude a inclus seize hommes caucasiens en bonne santé. Les participants ont été répartis aléatoirement en deux groupes : un groupe soumis à un clamp normoinsulinémique hyperglycémique et un groupe soumis à un clamp hyperinsulinémique hyperglycémique. Un sujet du groupe normoinsulinémique hyperglycémique n'a pas pu être inclus dans l'analyse finale en raison d'un volume insuffisant de tissu adipeux prélevé. Dans le groupe normoinsulinémique hyperglycémique, l'âge moyen était de 22 ± 1 ans et l'IMC de 22 ± 1 kg/m². Dans le groupe hyperinsulinémique hyperglycémique, l'âge moyen était de 23 ± 1 ans et l'IMC de 23 ± 1 kg/m². Tous les participants étaient exempts d'antécédents familiaux ou personnels de diabète, d'obésité, de dyslipidémie ou d'hypertension au premier ou au deuxième degré. Ces critères stricts d'inclusion visaient à assurer l'homogénéité de la population étudiée et à minimiser les facteurs confondants potentiels.
2. Protocole expérimental technique du clamp
La méthodologie employée repose sur la technique du clamp hyperglycémique, modifiée pour réaliser des clamps normoinsulinémiques hyperglycémiques et hyperinsulinémiques hyperglycémiques. Les clamps duraient trois heures. Avant et après le clamp, un échantillon de tissu adipeux sous-cutané péri-ombilical a été prélevé chez chaque participant (500 à 700 mg). Pour induire la normoinsulinémie ou l'hyperinsulinémie, la sécrétion endogène d'insuline a été inhibée par l'administration de Sandostatin (Novartis Pharma inc., Dorval, Québec, Canada) en deux phases : un bolus de 25 µg suivi d'une perfusion de 1,0 µg/min. Le Sandostatin a été utilisé selon un protocole précédemment décrit par Giugliano et al. (94). L'infusion de glucose était ajustée pour maintenir la glycémie à un niveau cible. Des pompes Harvard pour seringues (Harvard Apparatus, Ville Saint Laurent, Québec, Canada) ont été utilisées pour administrer les substances. L'anesthésie locale a été réalisée à l'aide de Xylocaïne (Astra-Zeneca Mississauga, Ontario).
3. Analyse des données PCR en temps réel et analyse statistique
L'expression génique des adipokines (leptine, adiponectine et ASP) a été quantifiée à l'aide de la PCR en temps réel (technologie LightCycler, Roche Diagnostics, Mannheim, Allemagne). L'analyse de l'expression génique a été réalisée en utilisant le gène HPRT comme gène de référence. Des courbes standards ont été établies pour chaque dosage. Pour l'analyse des changements de concentration plasmatique des adipokines, les moyennes des concentrations mesurées avant (temps -55 et -50 min) et après (temps +170 et +180 min) le clamp ont été comparées. De même, l'expression génique avant et après le clamp a été comparée. Le test t de Student apparié, unilatéral, a été utilisé pour comparer les données. Les données sont présentées sous forme de moyennes ± écart-types. La méthodologie détaillée vise à garantir la rigueur scientifique et la fiabilité des résultats.
VI.Résultats et Conclusion
Les résultats montrent que l'hyperglycémie seule n'a pas d'effet significatif sur la concentration plasmatique de leptine ni d'adiponectine. La combinaison hyperinsulinémie-hyperglycémie a augmenté l'expression génique de la protéine C3, un précurseur de l'ASP. L'effet du Sandostatin sur les résultats est discuté. L'étude souligne le besoin de recherches supplémentaires pour clarifier le rôle de l'hyperglycémie et de l'hyperinsulinémie sur la régulation des adipokines et leur implication dans l'insulinorésistance et le diabète de type 2. L'étude est originale car elle analyse à la fois l'expression génique et la concentration plasmatique.
1. Résultats concernant la leptine
L'étude a montré que la concentration plasmatique de leptine est restée inchangée lors du clamp hyperinsulinémique hyperglycémique. Ce résultat diffère des conclusions de la plupart des autres études, qui rapportent une augmentation de la concentration plasmatique de leptine suite à une combinaison hyperinsulinémie-hyperglycémie. La discordance pourrait être attribuée à l'utilisation de Sandostatin pour inhiber la sécrétion endogène d'insuline. Il est possible que l'effet stimulant de la combinaison glucose-insuline sur la leptine, comme décrit par Sonnenberg et al. (45) et Kolaczynski et al. (49), ait été masqué par l'effet du Sandostatin. La durée relativement courte du clamp (trois heures) par rapport aux études antérieures (16 heures et 72 heures) pourrait également expliquer l'absence d'augmentation de la concentration plasmatique de leptine. Des études complémentaires sans Sandostatin sont en cours pour approfondir ce point et vérifier si l’effet observé est bien lié au Sandostatin ou à la durée du clamp.
2. Résultats concernant l adiponectine
Les clamps normoinsulinémiques hyperglycémiques et hyperinsulinémiques hyperglycémiques n'ont pas affecté la concentration plasmatique d'adiponectine. Ce résultat concorde avec une étude précédente ayant analysé l'effet de l'hyperglycémie chronique, qui n'a rapporté aucun effet sur l'adiponectine (42). Cependant, il diverge des conclusions de deux autres études (25, 41) qui ont montré une diminution de la concentration plasmatique d'adiponectine suite à une hyperinsulinémie isolée chez des sujets sains. Cette différence pourrait être expliquée par la durée plus courte de la stimulation dans la présente étude. De plus, la complexité des isoformes d'adiponectine (monomères, trimères, hexamères) et les variations de la méthode de dosage utilisées dans les différentes études pourraient également contribuer à ces résultats discordants. Le dosage radio-immunologique utilisé dans cette étude reconnaît les trimères et les hexamères, sans distinction, contrairement à d'autres études qui pourraient ne pas spécifier les isoformes mesurées. Cette étude est la première étude d'intervention à examiner l'effet de l'hyperglycémie aiguë et de la combinaison hyperglycémie-hyperinsulinémie sur la concentration plasmatique d'adiponectine.
3. Résultats concernant l ASP et conclusion générale
L'hyperglycémie seule n'a pas eu d'impact sur l'expression du gène de la protéine C3, un précurseur de l'ASP, alors que la combinaison hyperglycémie-hyperinsulinémie a provoqué une augmentation significative de 27 %. Ce résultat suggère que la combinaison des deux stimuli est nécessaire pour modifier l'expression génique de la protéine C3. Cette étude est la première à analyser simultanément l'expression génique et la concentration plasmatique des trois adipokines étudiées (leptine, adiponectine et ASP) en réponse à l'hyperglycémie et à l'hyperinsulinémie. En résumé, la concentration plasmatique de leptine et d'adiponectine n'a pas changé, tandis que celle de l'ASP a augmenté. Ces résultats suggèrent que l'augmentation de la leptine observée dans des conditions pathologiques comme l'obésité et le diabète de type 2 pourrait être liée à la stimulation du gène ob par l'hyperinsulinémie, mais que cet effet pourrait être masqué par le Sandostatin. La diminution d'adiponectinémie observée dans ces conditions ne semble pas être directement due aux perturbations de la glycémie et de l'insulinémie. Enfin, l'augmentation de l'expression génique et de la concentration d'ASP pourrait être expliquée par la combinaison hyperinsulinémie-hyperglycémie ou par l'hyperinsulinémie seule. Des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats et éclaircir l'influence du Sandostatin.
