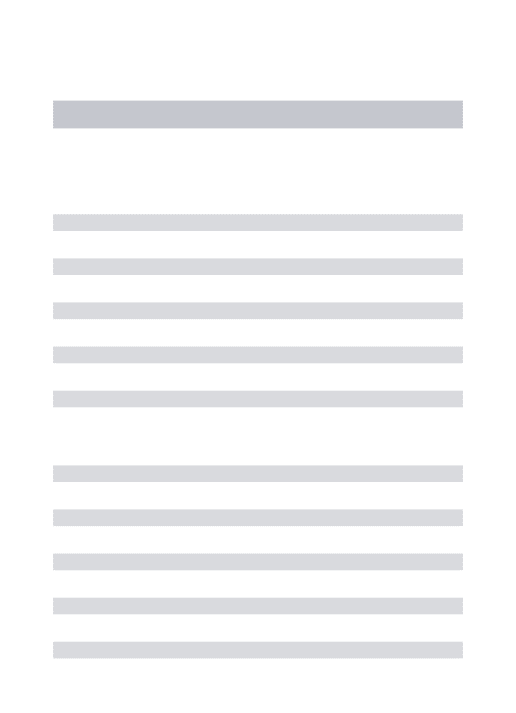
Droits des personnes privées de liberté
Informations sur le document
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 14.53 MB |
Résumé
I.La Privation de Liberté en Droit Français et Européen Définition et Contrôle
Ce document analyse la notion de privation de liberté en droit français et européen, en se concentrant sur son encadrement juridique et les garanties offertes aux personnes concernées. Il explore la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) et du Conseil constitutionnel français, notamment en ce qui concerne l'article 5 CEDH et l'article 66 de la Constitution. L'étude porte sur la définition de la détention arbitraire, l'importance de la sécurité juridique, et le rôle du contrôle juridictionnel. Des cas concrets de jurisprudence sont examinés, soulignant les critères de nécessité et de proportionnalité dans l'application des mesures privatives de liberté. La notion de droit à la sûreté est également abordée, ainsi que la protection de la dignité humaine du détenu.
1. Définition de la privation de liberté et champ d application de l article 5 CEDH
L'analyse débute par la définition même de la privation de liberté, point crucial pour l’application de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). L’arrêt Guzzardi c. Italie (CEDH, plén., 6 nov. 1980) est cité comme décision fondatrice, conditionnant l’application de l’article 5 à « l’existence d’une privation de liberté en l’espèce ». Le texte explore ensuite l’interprétation jurisprudentielle diverse de ce terme, notamment par le Conseil constitutionnel français (décision n° 2011-174 QPC). Différentes situations sont examinées : le dégrisement, la détention suite à un mandat d’amener ou d’arrêt, et la rétention d’étrangers en vue d’éloignement. La jurisprudence de la Cour de cassation est également analysée à travers plusieurs arrêts (Cass. crim., 19 mai 1999 ; Cass. crim., 29 nov. 2000 ; Cass. crim., 15 sept. 2004 ; Cass. civ. I, 9 janv. 2008), mettant en lumière des divergences d’interprétation concernant le moment précis du début de la garde à vue et la notion de contrainte. Le document souligne la complexité de définir une vision unique et uniforme de la privation de liberté, notamment en fonction du contexte et de l'intensité de la contrainte appliquée. Il introduit ainsi le débat central : la difficulté de concilier les différents cas et les nuances dans l'appréciation de la privation de liberté.
2. Privation de liberté dans l intérêt de la personne détenue
Une section importante explore la situation où la privation de liberté est justifiée par l'intérêt même de la personne détenue. Le document souligne un renversement de la charge de la preuve, où le consentement (implicite ou explicite) de l'individu ou de son représentant légal devient prioritaire pour exclure la notion de privation de liberté, même en présence d'une contrainte objective. Ce point est illustré par des exemples concernant l'internement d'aliénés qualifiés de « libre » ou « volontaire ». La Cour, dans sa jurisprudence, accorde une importance prépondérante à la recherche du consentement, sans exiger une preuve absolue. Cette approche est analysée de manière critique, en soulignant la difficulté de concilier cette approche avec la protection de la liberté individuelle et l'exigence de lutte contre la contrainte. Le document fait le lien entre cette jurisprudence et la jurisprudence constitutionnelle, soulignant une certaine latitude accordée aux autorités, même si cela peut paraître paradoxal au regard des principes fondamentaux de protection des libertés individuelles. L'étude questionne ainsi l'équilibre délicat entre le bien-être de la personne et la préservation de ses droits fondamentaux, notamment celui à la liberté.
3. Contrôle d identité et restrictions temporaires de la liberté
Le document examine ensuite les situations de contrôle d'identité et leur possible qualification comme privation de liberté. Le Conseil constitutionnel (décision n° 80-127 DC) et la Cour de cassation (arrêt Bogdan et Vuckovic) sont cités, ces derniers considérant souvent ces contrôles comme de simples restrictions temporaires des droits individuels, sans atteindre le seuil de la privation de liberté. Les décisions analysées différencient selon la durée de la mesure: une courte durée de détention pour vérification d'identité est souvent exclue de la qualification de « privation de liberté », alors qu'une durée dépassant une heure pour réaliser un acte d'enquête est typiquement qualifiée comme telle. La jurisprudence est analysée pour des exemples tels que la détention pour dépistage d'alcoolémie (Cass. crim., 24 janv. 2007) ou de produits stupéfiants (Cass. crim., 30 juin 1999). Le document examine aussi le cas de la retenue de contrevenants ne pouvant justifier de leur identité par les agents de police judiciaire ferroviaires (Cons. const., déc. n° 2011-625 DC), soulignant à nouveau l'importance de la durée et de l'intensité de la contrainte pour déterminer la qualification de « privation de liberté». Le texte met en lumière la complexité de la qualification juridique selon la durée et la nature de la mesure de contrôle.
4. Analyse comparative de la jurisprudence et les limites du contrôle
Cette section poursuit l'analyse de la jurisprudence, notamment sur le cas de la détention de manifestants dans un cordon de sécurité. La Cour européenne des droits de l'homme, tout en reconnaissant une large marge d'appréciation aux autorités nationales, utilise un raisonnement critiqué pour exclure l'application de l'article 5. Le document analyse un arrêt de la Grande Chambre, ainsi qu'une décision plus ancienne concernant le refoulement de manifestants étrangers. Il questionne l'opportunité et la cohérence de la jurisprudence de la CEDH, notamment en comparant des situations similaires traitées différemment. L'étude met en évidence la difficulté de définir des critères clairs et objectifs pour qualifier une privation de liberté. L'analyse se poursuit avec l'examen du maintien en zone d'attente, la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision du 25 février 1992) étant comparée à celle de la CEDH. Le document souligne une différence d’interprétation significative sur la question. L'assignation à résidence est aussi analysée, le Tribunal administratif de Lille et le Tribunal administratif de Versailles rendant des décisions différentes quant à l’excès de pouvoir des autorités administratives. Enfin, l’intensité de la contrainte, notamment son impact sur les contacts sociaux (CEDH, H. L. c. Royaume-Uni ; CEDH, M. S. c. Belgique ; CEDH, Villa c. Italie), est présentée comme un élément clé dans l’évaluation de la privation de liberté.
II.L Habeas Corpus et les Recours Spéciaux
Le document examine le recours de l'Habeas corpus en droit français et européen, soulignant ses exigences en termes de rapidité et d'intervention d'une autorité judiciaire indépendante. Il compare l'approche française, ancrée dans l'article 66 de la Constitution, avec celle de la CEDH. L'analyse porte également sur les différents recours spéciaux disponibles pour contester une privation de liberté, notamment le contrôle de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure de détention. L'objectif est de déterminer l'efficacité de ces recours dans la lutte contre la détention arbitraire.
1. L Habeas Corpus comparaison du droit français et du droit européen
Le document analyse le recours en Habeas Corpus, comparant son application en droit français et en droit européen. En droit français, l’article 66 de la Constitution est interprété par le Conseil constitutionnel comme consacrant un recours d’Habeas Corpus, garantissant une intervention judiciaire rapide en cas de privation de liberté : « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible ». Ce droit est considéré comme plus protecteur que le droit européen, qui ne prévoit l’Habeas Corpus que pour le suspect. Le texte souligne l'automaticité et la célérité de ce recours, qui doit être examiné immédiatement après l’arrestation, son objet étant l’appréciation de la nécessité de la privation de liberté. Il est présenté comme un outil essentiel de lutte contre l’arbitraire, marquant la transition entre une privation de liberté de police et son encadrement judiciaire. Cependant, l’analyse nuance cette comparaison en précisant que la qualification d’Habeas Corpus exige que la première intervention judiciaire présente des garanties suffisantes pour exclure tout arbitraire. Le document introduit ainsi une analyse comparative des systèmes juridique français et européen en matière de protection des libertés individuelles et d’accès à la justice.
2. Les Recours Spéciaux et le Contrôle de la Privation de Liberté
Au-delà de l’Habeas Corpus, le document identifie d'autres recours spéciaux pour contrôler la privation de liberté. Il met en avant le contrôle judiciaire de la nécessité de la privation de liberté, consacré par l’article 66 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel, dès 1980, a déduit de cet article l’existence d’un recours similaire à l’Habeas Corpus. L’analyse souligne que le droit français, avec son intervention judiciaire immédiate, est plus protecteur que le droit européen à cet égard. Les caractéristiques du recours sont détaillées : automaticité, célérité (examen immédiat après l’arrestation), et objet (appréciation de la nécessité de la privation de liberté). L’Habeas Corpus est présenté comme un instrument de lutte contre l’arbitraire, marquant la fin de la phase de privation de liberté de police et l’entrée dans la phase judiciaire. Le texte souligne cependant qu’il faut vérifier que ce premier recours offre suffisamment de garanties pour éviter l’arbitraire et justifier sa qualification d’Habeas Corpus. En plus du contrôle initial, la phase judiciaire de la détention est soumise à un contrôle périodique de la proportionnalité à bref délai, assurant ainsi un suivi permanent de la légalité de la privation de liberté.
III.La Qualité de la Loi et la Lutte Contre l Arbitraire
Une partie importante du document se concentre sur le contrôle de la qualité de la loi encadrant la privation de liberté. Il s'agit d'analyser si la législation nationale est suffisamment précise, claire et prévisible pour éviter l'arbitraire. L'analyse intègre la jurisprudence de la CEDH, qui exige une sécurité juridique pour garantir le respect des droits fondamentaux. L'étude porte également sur la notion de détention arbitraire, en explorant les différents critères jurisprudentiels utilisés pour la qualifier, notamment la présence de mauvaise foi ou de tromperie de la part des autorités, ainsi que l’évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure.
1. La Qualité de la Loi et la Sécurité Juridique
Cette section explore la notion de qualité de la loi en matière de privation de liberté, mettant l’accent sur le concept de « sécurité juridique ». La Cour européenne des droits de l’homme, fidèle à sa conception classique de la légalité, se concentre sur la qualité matérielle de la norme plutôt que sur sa valeur hiérarchique. Divers types de normes, telles qu’une circulaire, une jurisprudence, ou même une note verbale diplomatique, peuvent constituer une base légale. L'analyse souligne l'importance de la clarté, de la précision, et de l’intelligibilité de la loi pour éviter l’arbitraire. La prévisibilité de la loi est essentielle : elle ne doit pas être vague, imprécise ou inintelligible. Le Conseil constitutionnel, dans plusieurs décisions (décision n° 76-75 DC, décision n° 83-164 DC, décision n° 93-325 DC), a censuré des dispositions législatives pour non-respect de ce principe, notamment en ce qui concerne la visite des véhicules et la prolongation de la rétention administrative. La Cour de cassation, quant à elle, a développé un contrôle de la légalité de la loi pénale sur le fondement de l’article 7 de la CEDH, illustrant l'importance d'une rédaction précise et claire des textes légaux pour éviter les violations des droits fondamentaux. L’arrêt Kokkinakis c. Grèce est cité à titre d’exemple. L’objectif est de garantir la sécurité juridique des individus face à la privation de liberté.
2. La Lutte Contre l Arbitraire Au delà de la Simple Légalité
L’analyse se poursuit sur la lutte contre l’arbitraire, un principe fondamental en matière de privation de liberté. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) affirme que l’article 5 § 1er exige la conformité de toute privation de liberté à l’objectif de protéger l’individu contre l’arbitraire. L’arrêt Saadi est mentionné pour illustrer l’enrichissement jurisprudentiel de la notion de détention arbitraire, allant au-delà de la simple légalité. La détention est considérée comme arbitraire en cas de mauvaise foi ou de tromperie des autorités (extradition déguisée, déloyauté dans l’arrestation). La CEDH ajoute la nécessité et la proportionnalité de la mesure à ces critères, précisant que la détention doit rester justifiée par la persistance des motifs initiaux (contrôle de la peine perpétuelle). Ces principes sont essentiels pour délimiter les cas de détention autorisés par l’article 5 § 1er CEDH. La lutte contre l’arbitraire ne repose donc pas uniquement sur l’existence d’une base légale, mais aussi sur sa qualité et l’absence d’arbitraire dans sa délimitation et son application. Cette lutte contre l'arbitraire renforce le contrôle juridictionnel de la détention et bénéficie directement à la personne détenue.
3. Détention Arbitraire Définitions et Critères
Le document aborde la complexité de la notion de « détention arbitraire », en présentant différentes définitions et analyses. Certains auteurs différencient la privation de liberté arbitraire (acte de malveillance) de la privation illégale (hors des cas prévus par la loi) et injustifiée (acte légal mais injustifié). Le Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies définit trois types de détention arbitraire : absence de base légale, résultat de l’exercice de droits fondamentaux, ou violation des normes relatives au procès équitable. D’autres auteurs considèrent comme arbitraire une détention sans titre légal exprès et préalable, sans nécessité, sans respect des droits de la défense, et sans intervention rapide d’un juge. L’article 7 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen est mentionné, ainsi que l’arrêt Assanidze c. Géorgie (CEDH, gde ch., 8 avr. 2004) qui qualifie de détention arbitraire une détention indéterminée et imprévisible sans base légale précise ou décision judiciaire. Le document met en évidence la multiplicité des définitions et des critères utilisés pour qualifier la détention arbitraire, soulignant ainsi les difficultés d'application et d'interprétation de cette notion fondamentale.
IV.Le Paquet de Droits de la Personne Arrêtée
Le document met en lumière l'importance de la protection de la personne dès son arrestation. Il traite du paquet de droits qui lui est garanti avant la première intervention judiciaire, notamment le droit à l'information, l'assistance d'un avocat, et un examen médical. L'analyse explore la valeur de ce paquet de droits dans la lutte contre l'arbitraire et dans la garantie de la sécurité juridique de l'individu. L'étude discute de la consécration (ou non) supra-légale de ces droits, et de leur importance pour assurer l'efficacité des recours contre les privations de liberté.
1. La Nécessité d une Protection Spécifique de la Personne Arrêtée
Cette section souligne la vulnérabilité de la personne arrêtée, dont l'intégrité physique et morale est menacée, notamment par l'usage potentiel de la force lors de la capture. Avant l'intervention du juge judiciaire, la personne est sous la seule autorité de la police, augmentant le risque d’arbitraire. Le document met en avant les atteintes possibles à l’intégrité physique (usage de la force), morale (caractère brutal de l’arrestation), et sociale (altération des relations). L’absence de contrôle judiciaire immédiat accroît ce risque d’arbitraire, menaçant la capacité de la personne à se défendre contre une prolongation de sa détention. La création de droits subjectifs, exigibles dès l’arrestation, est présentée comme une solution pour protéger l’intégrité de la personne et assurer sa défense contre une privation de liberté prolongée. Cette protection vise à s’imposer au législateur via la légalité matérielle, soulignant l’importance de garanties spécifiques pendant cette période préliminaire au contrôle judiciaire.
2. Le Paquet de Droits Composition et Valeur Juridique
Le texte décrit un « paquet de droits » garantissant la protection de la personne arrêtée. Ce paquet, identique dans les différentes législations spéciales, comprend la notification des droits, l'information des raisons de l'arrestation, le droit à l'assistance d'un avocat, le droit à un examen médical, et le droit de prévenir un tiers de l'arrestation. L'analyse souligne l’évolution législative concernant ces droits, notamment l’information sur le droit de se taire, qui a subi plusieurs modifications. Le document note une absence de consécration supra-légale totale de ce paquet de droits, ce qui empêche leur imposition systématique par le législateur. Cependant, le document met en lumière le souci de cohérence juridique qui devrait conduire à leur inclusion dans toutes les situations d'arrestation. L'analyse souligne l'importance de ces droits pour assurer la sécurité de la personne contre l’arbitraire, favoriser l'effectivité de la première contestation judiciaire (Habeas Corpus), et prévenir les mauvais traitements. La discussion aborde la question de la célérité de l’information des droits, en particulier après la réforme de la garde à vue, ainsi que la nécessité de garantir un minimum de droits fondamentaux pendant cette phase préliminaire.
V.La Privation de Liberté pour Raisons Sanitaires
Enfin, le texte aborde brièvement le cas particulier de la privation de liberté pour des raisons sanitaires, notamment la mise en quarantaine en cas d'épidémie. Il analyse les dispositions légales françaises et souligne l'absence de garanties spécifiques pour les personnes concernées, soulignant le besoin d'un encadrement plus précis pour concilier la protection de la santé publique et le respect des droits individuels, en particulier le droit à la liberté et la dignité humaine.
1. Cadre Législatif et Absence de Garanties
Cette section examine la privation de liberté pour raisons sanitaires, en se concentrant sur les dispositions légales françaises relatives à la quarantaine en cas de menace sanitaire grave, notamment d’épidémie. Les articles L. 1311-1, L. 3110-1, et L. 3131-1 du Code de la santé publique sont cités, confiant au pouvoir réglementaire la possibilité de prescrire des mesures de quarantaine sous réserve de proportionnalité. Le document souligne l’absence notable de garanties spécifiques pour les personnes placées en quarantaine. Cette lacune est illustrée par l’exemple de l’épidémie de pneumonie atypique en 2003, où le gouvernement a dû recourir à un décret spécial pour pallier le manque de cadre légal clair. Un projet de décret, basé sur l’article L. 1311-1, prévoyait la mise en quarantaine sous contrainte, mais sans définir les droits des individus concernés. Le Plan de réponse contre le SRAS d’avril 2004, mentionne un « décret SRAS » prévoyant des mesures de restriction des libertés individuelles et de quarantaine, mais sans apporter de précision sur les droits des personnes concernées. L’analyse met donc en lumière une faiblesse du cadre juridique français en matière de privation de liberté pour raisons sanitaires, notamment l’absence de garanties pour les personnes concernées.
2. Histoire Législative et Protection des Libertés
L’analyse historique de la législation française concernant l’isolement sanitaire révèle des lacunes en matière de protection des libertés individuelles. L’ancien article 18 du Code de la santé publique, permettant au gouvernement de prendre des mesures pour empêcher la propagation des épidémies, est cité comme exemple, laissant place à une grande discrétion et soulevant des préoccupations quant au respect des droits fondamentaux. Le décret du 11 juillet 1955, relatif à l’internement sanitaire des malades atteints de variole, est également mentionné, caractérisé par un isolement « obligatoire » et « rigoureux » sans précisions sur les droits des personnes concernées. Le professeur A. Decocq est cité, soulignant que cette disposition permettait l'hospitalisation d'office des malades contagieux. Le texte souligne le contraste avec les réglementations étrangères qui prévoient souvent des régimes juridiques plus complets en cas de maladie contagieuse, avec des garanties pour les individus concernés. L’étude identifie ainsi un manque de protection des libertés individuelles dans les réglementations françaises antérieures et actuelles concernant l’isolement sanitaire obligatoire.
Référence du document
- Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10
