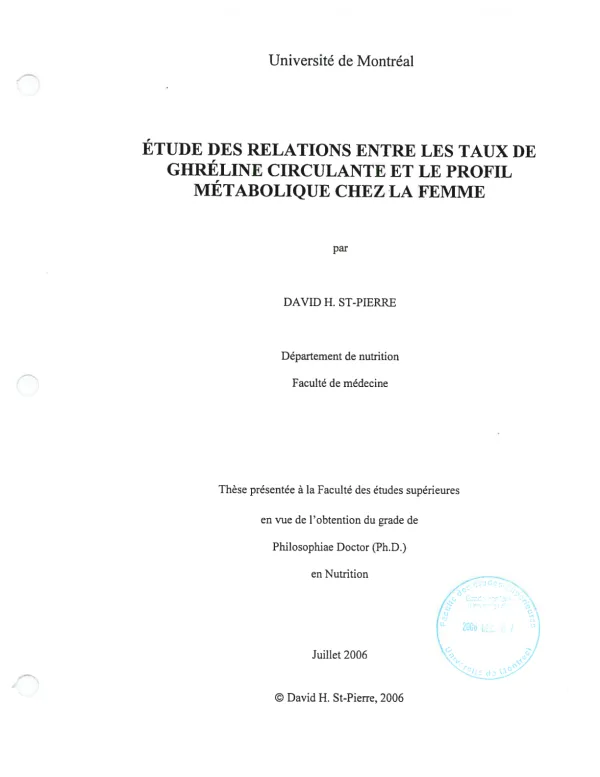
Ghréline et métabolisme féminin
Informations sur le document
| Auteur | David H. St-Pierre |
| École | Université de Montréal |
| Spécialité | Nutrition |
| Type de document | Thèse |
| city | Montréal |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 7.66 MB |
Résumé
I.Obésité troubles métaboliques et rôle de la ghréline
L'augmentation de l'incidence de l'obésité et des troubles métaboliques, tels que la résistance à l'insuline et le diabète de type 2, représente un problème majeur de santé publique. L'étude explore le rôle de la ghréline, une hormone peptidique, dans le développement de ces troubles. Des études ont montré une association entre les niveaux de ghréline et des composantes de l'équilibre énergétique, de la sensibilité à l'insuline et des marqueurs de l'inflammation chronique. Plusieurs méthodes d'évaluation de l'adiposité (IMC, DXA, tomographie) et de la dépense énergétique (eau doublement marquée) sont discutées.
1. Prévalence de l obésité et des troubles métaboliques
L'augmentation significative de l'obésité et des troubles métaboliques associés est présentée comme un problème majeur de santé publique mondiale. Le texte cite les données de la NHANES III, qui révèlent que 85,2% et 54,8% des citoyens américains souffrent de surpoids (IMC > 27 kg/m2) et d'obésité (IMC > 30 kg/m2) respectivement. Ces chiffres soulignent l'urgence de comprendre et de traiter les maladies liées à l'obésité, telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, l'ostéoarthrite et certains cancers. L'étude souligne la prévalence croissante du diabète, avec une projection de doublement des cas dans les 25 prochaines années, accentuant l'importance de la recherche dans ce domaine. La complexité des interactions entre les facteurs génétiques, nutritionnels, comportementaux et hormonaux dans le contrôle de la balance énergétique est également mise en avant. Des perturbations dans l'un ou plusieurs de ces facteurs influencent l'homéostasie énergétique, rendant l'étude de ces interactions cruciales pour comprendre le développement de l'obésité et ses complications.
2. Mesure de l appétit et de la dépense énergétique
Deux approches principales pour mesurer l'appétit sont décrites : l'évaluation subjective (faim, désir de manger, satiété) et l'évaluation objective de l'apport alimentaire. Diverses méthodes sont utilisées pour évaluer l'apport alimentaire, incluant les rappels de 24 heures, les journaux alimentaires sur trois jours, les questionnaires de fréquence alimentaire, les cuisines métaboliques et les buffets à volonté. Le document souligne les limites de chaque méthode, notamment la tendance à la surestimation ou à la sous-estimation de l'apport alimentaire selon le sujet. La dépense énergétique est abordée, avec la description d'une méthode non-invasive utilisant de l'eau doublement marquée. Cette technique, employée depuis les années 1980, permet d'évaluer la dépense énergétique sur une période de une à deux semaines en mesurant le rapport isotopique dans l'urine. Plus la concentration des marqueurs isotopiques est faible, plus la dépense énergétique est jugée élevée. Ces méthodes, bien que présentant des avantages et des inconvénients spécifiques, sont essentielles à la compréhension de la relation entre la consommation énergétique et le développement de l’obésité.
3. Évaluation de l adiposité et de la résistance à l insuline
Le document détaille différentes méthodes d'évaluation de l'adiposité, notamment la mesure de la circonférence de taille (NCEP), le rapport taille/hanches (OMS) pour estimer l'adiposité viscérale, et des techniques plus avancées comme la DXA (densitométrie osseuse) et l'imagerie par résonance magnétique. Ces méthodes permettent une évaluation précise de la répartition de la masse adipeuse, notamment la distinction entre l'adiposité viscérale et sous-cutanée. La majorité des protocoles quantifient les tissus adipeux entre les vertèbres lombaires 4 et 5 par tomographie axiale. L'importance de la résistance à l'insuline dans le syndrome métabolique est discutée, en soulignant que bien que l'hypothèse initiale de Reaven (1988) sur la résistance à l'insuline comme facteur déterminant du syndrome X se soit avérée inexacte, la résistance à l'insuline reste un facteur important. L’étude mentionne également le rôle du métabolisme des particules de HDL et son association avec les VLDL, ainsi que l'influence de l'inflammation sur le catabolisme des particules de HDL. Des facteurs comme les espèces réactives à l'oxygène (ROS) et l'angiotensine II (Ang II) sont mentionnés pour leur implication dans les pathologies associées au syndrome métabolique.
II.Ghréline isolation caractérisation et propriétés biologiques
La ghréline, isolée de l'estomac, est le ligand endogène du récepteur GHS-R1a. Deux formes principales existent : la ghréline acylée (active) et la ghréline non-acylée. La présence du groupe octanoyl sur la Ser3 de la ghréline acylée est essentielle pour sa liaison au récepteur et son activité biologique. Des études de structure-activité ont exploré l'impact de modifications de la structure peptidique sur l'activité de la ghréline. Les niveaux d'expression et la distribution de la ghréline (acylée et non-acylée) dans différents tissus et le plasma sanguin sont également étudiés, soulignant la prédominance de la forme non-acylée.
1. Découverte et rôle de la ghréline
La section introduit la ghréline, un peptide de 28 acides aminés principalement isolé de l'estomac des mammifères. Sa découverte en 1999 par Kangawa et al. a révolutionné la compréhension de la régulation de la balance énergétique. Avant sa découverte, le récepteur GHS-R1a était un récepteur orphelin. La ghréline est maintenant reconnue comme son ligand endogène. La recherche antérieure sur les peptides de libération de l'hormone de croissance (GHRP) et leur récepteur, notamment les travaux de Bowers et al. dans les années 1980, a pavé la voie à cette découverte. L'engouement suscité par la découverte de la ghréline a également stimulé la recherche sur d'autres facteurs hormonaux gastro-intestinaux (GI) impliqués dans la régulation de l'appétit, tels que le PYY, la CCK, l'OXM, le GLP-1, le glucagon et l'amyline. Cette hormone est donc positionnée au cœur d'un système complexe de régulation de l'appétit et du métabolisme.
2. Isolation et caractérisation de la ghréline
La caractérisation de la ghréline par Kojima et al. en 1999 est détaillée. Ils ont utilisé une souche de cellules CHO GHSR62 exprimant le récepteur GHS-R1a de rat pour identifier la ghréline dans des extraits de tissus de rats. La spectrométrie de masse a permis de déterminer son poids moléculaire (3314,9 dalton) et le séquençage a révélé sa séquence de 28 acides aminés. Un acide aminé, initialement inconnu, est noté. L’importance du groupe octanoyl sur la chaîne de la ghréline pour sa liaison au récepteur est soulignée. Des études ultérieures, par exemple celles de Matsumoto et al., ont décrit la plus petite forme d'analogue de ghréline biologiquement active (in vitro), mettant en évidence l'importance des deux premiers résidus et de l'espacement entre le groupe N-terminal et le groupe n-octanoyl. Des substitutions ont été testées in vivo chez le rat (Ser3-n-octanoyl par Cys3-n-octanoyl), démontrant une certaine flexibilité dans la structure tout en maintenant l'activité biologique.
3. Études de structure activité et distribution de la ghréline
Des études de structure-activité, menées par Bednarek et al., ont exploré l'impact de diverses modifications structurales de la ghréline sur sa liaison au récepteur GHS-R. Ces modifications portaient sur la nature et la longueur de la chaîne aliphatique, la nature du lien unissant le groupe aliphatique à la Ser3, la position du groupe octanoyl, et la longueur de la chaîne peptidique. Les résultats indiquent que la liaison au récepteur est peu affectée par la longueur de la chaîne aliphatique (C6 à C16), la nature du lien (amide ou ester), ou la longueur de la chaîne peptidique N-terminale. Même de courts fragments octanoylés N-terminaux (GSSF) peuvent se lier au récepteur. La section aborde ensuite les méthodes de mesure de la ghréline, notamment les trousses de radioimmunoétalonnage (RIA), en soulignant le développement récent de trousses plus spécifiques permettant de distinguer les formes acylée et non-acylée. L'étude mentionne que chez le rat, 85 à 90% de la ghréline est sous forme non-acylée, et propose des enzymes comme la lysophospholipase I, la carboxylestérase et la paraoxonase I comme candidates pour la désacylation de la ghréline.
III.Ghréline et prise alimentaire
La ghréline joue un rôle important dans la régulation de la prise alimentaire. Une augmentation aiguë des taux de ghréline acylée stimule l'appétit (effets orexigéniques), tandis que des taux faibles de ghréline sont associés à une dépense énergétique réduite et à des troubles métaboliques liés à l'obésité. L'étude explore la corrélation entre les niveaux de ghréline et l'apport énergétique, ainsi que l'influence de facteurs tels que la leptine, le PYY, le GLP-1, et l'OXM sur la régulation de l'appétit. Des études post-chirurgie de réduction gastrique montrent des résultats variables quant à l'impact sur les taux de ghréline.
1. Rôle de la ghréline dans l initiation de la prise alimentaire
Le texte établit un lien entre les niveaux de ghréline et la régulation de la prise alimentaire. Une augmentation aiguë des taux de ghréline, notamment de la forme acylée, déclenche un effet orexigénique, stimulant l'appétit. À l'inverse, de faibles taux de ghréline sont associés à une diminution de la dépense énergétique et à des troubles métaboliques liés à l'obésité. La recherche souligne la complexité de ce mécanisme, car il existe des preuves suggérant une relation directe entre l'état moléculaire de la ghréline (acylée vs. non-acylée) et les mécanismes physiologiques précédant et suivant la prise alimentaire. Une perturbation de l'équilibre entre les deux formes de ghréline pourrait jouer un rôle dans le développement de pathologies métaboliques. L'étude souligne le besoin de plus de recherche pour clarifier l'influence de ces deux formes de ghréline sur le contrôle de l’appétit et l'équilibre énergétique.
2. Effets de la ghréline sur l appétit études chez le rat et l humain
Des études chez le rat ont démontré les effets orexigéniques de la ghréline administrée en périphérie ou intracérébroventriculairement (icv). Ces effets sont principalement liés aux noyaux de l'hypothalamus (ARC, LHA, PVN). Chez l'humain, l'administration de ghréline stimule également l'appétit, et les concentrations préprandiales de ghréline sont positivement corrélées à l'intensité de la sensation de faim. Ces données suggèrent un rôle important de la ghréline dans l'initiation de la prise alimentaire. Chez le rat nourri ad libitum, la sécrétion de ghréline et de leptine est pulsatile, avec une relation inversement proportionnelle entre les concentrations plasmatiques des deux peptides. Cependant, d’autres facteurs anorexigènes d'origine gastro-intestinale, comme la CCK, le GLP-1, l'OXM, le PYY3-36, l'urocortine-1 et les inhibiteurs de la NOS, modulent l'activité orexigénique de la ghréline. L’augmentation des taux plasmatiques de ghréline après un repas est inversement proportionnelle au contenu calorique du repas.
3. Ghréline et chirurgie de réduction gastrique
Les études sur les effets de la chirurgie de réduction gastrique sur les taux de ghréline présentent des résultats contradictoires. Cummings et al. ont été les premiers à observer une diminution significative des taux de ghréline après une réduction gastrique chez des sujets obèses, malgré une perte de poids importante. Cette diminution affectait également les pics postprandiaux de ghréline. Cependant, des études ultérieures ont rapporté des résultats variables, allant de l'absence de variation à une légère augmentation des taux de ghréline après la perte de poids postopératoire. Les différences de procédures chirurgicales (anneau gastrique, dérivation biliopancréatique, Roux-en-Y), la durée de la période postopératoire, le régime alimentaire et les effets neurologiques (nerf vague) pourraient expliquer ces variations. Ces résultats mettent en évidence la complexité de la relation entre la ghréline, la chirurgie bariatrique et la régulation de l'appétit.
4. Association entre les niveaux de ghréline et les pathologies
De faibles taux de ghréline sont associés indépendamment à la résistance à l'insuline, l'hypertension et la prévalence du diabète de type 2. Des taux anormalement bas de ghréline totale ont été observés chez les patients obèses atteints de diabète de type 2, les patients acromégaliques, les patientes porteuses d'ovaires polykystiques et chez les Indiens Pima prédisposés à l'obésité et au diabète de type 2. À l'inverse, les enfants atteints du syndrome de Prader-Willi présentent des taux de ghréline totale jusqu'à trois fois plus élevés que la normale. L'étude note une inhibition postprandiale plus importante de la ghréline acylée chez les enfants atteints du syndrome de Prader-Willi que chez les enfants obèses normaux, suggérant un lien entre la régulation de la ghréline acylée et le développement de troubles métaboliques chez les patients obèses. Ces observations soutiennent l'importance d'études plus approfondies sur les mécanismes de régulation des deux formes de ghréline.
IV.Ghréline et métabolisme énergétique Étude 1
L'étude 1 confirme une corrélation négative entre les taux de ghréline totale et le métabolisme basal (MB) chez des jeunes femmes non-obèses et en bonne santé. Cependant, aucune corrélation n'a été trouvée entre la ghréline totale et la composition corporelle (IMC, pourcentage d'adiposité), contrairement à certaines études antérieures. L'étude a également exploré l'association entre la ghréline totale, l'oxydation des substrats, l'activité physique, et les habitudes alimentaires. Une corrélation inverse inattendue entre la ghréline totale et l'apport énergétique est observée, soulignant la complexité du rôle de la ghréline dans l'homéostasie énergétique.
1. Corrélation entre la ghréline totale et le métabolisme de base MB
L'étude 1 a exploré la relation entre les niveaux de ghréline et le métabolisme énergétique. Une corrélation négative significative a été observée entre les taux de ghréline totale et le métabolisme de base (MB) chez un groupe de jeunes femmes non-obèses et en santé. Cette observation confirme les résultats d'autres études chez les humains (normales, obèses, hyperthyroïdiennes) et les rongeurs, suggérant un rôle de la ghréline dans la régulation du MB. L'étude a également analysé l'association entre la ghréline totale et d'autres variables métaboliques comme l'oxydation des substrats, l'activité physique et les habitudes alimentaires. Des données de deux autres groupes de recherche montrant une relation inverse entre les taux de ghréline acylée et totale et le métabolisme de base sont mentionnées pour appuyer les résultats de l’étude. Cette relation inverse entre ghréline totale et MB suggère un rôle potentiel de la ghréline comme biomarqueur de l'efficacité énergétique. Cependant, l’étude précise que cette corrélation n’a pas été observée pour la dépense énergétique totale mesurée par la technique de l'eau doublement marquée.
2. Absence de corrélation entre ghréline totale et composition corporelle
Contrairement à d'autres études, l'étude 1 n'a pas trouvé de corrélation significative entre les taux de ghréline totale et les variables de la composition corporelle, telles que le pourcentage d'adiposité ou l'indice de masse corporelle (IMC). Cette différence pourrait être attribuée à l'homogénéité de la population étudiée (jeunes femmes non-obèses), contrairement aux cohortes plus hétérogènes utilisées dans les études précédentes de Marzullo et al., qui incluaient des hommes et des femmes de poids normal ou obèses. L'absence de lien entre la ghréline totale et la composition corporelle dans cette étude spécifique souligne la complexité des interactions entre la ghréline et les différents paramètres de la balance énergétique, et suggère que cette relation peut varier selon les caractéristiques de la population étudiée. L'étude propose que la ghréline pourrait influencer l'homéostasie énergétique de manière aiguë (effets orexigéniques) et chronique (régulation du MB).
3. Relation inverse inattendue entre ghréline totale et apport énergétique
Une observation inattendue de l'étude 1 est la relation inverse entre les taux de ghréline totale et l'apport énergétique. Cette découverte contraste avec les puissants effets orexigéniques associés à l'administration de ghréline acylée dans d'autres études. L'étude explique que cette différence pourrait être due à la mesure de la ghréline totale (acylée + non-acylée) dans l'étude 1, contrairement à l'administration exclusive de ghréline acylée dans les études antérieures. L'injection centrale de ghréline non-acylée chez le rongeur ne semble pas stimuler l'activité neuronale du noyau arqué de l'hypothalamus, un centre important du contrôle de l'appétit. L'étude suggère donc que la ghréline pourrait avoir des effets à la fois aigus (orexigéniques) et chroniques (régulation du MB) sur l'homéostasie énergétique. Cependant, aucune influence aiguë ou chronique sur les comportements alimentaires n'a été détectée chez les jeunes femmes non-obèses et en santé de cette cohorte.
4. Association entre ghréline totale et HDL
L’étude mentionne une association entre les taux de ghréline totale et les taux de HDL (lipoprotéines de haute densité), rapportée précédemment par Purnell et al. Cependant, le mécanisme sous-jacent à cette relation reste inconnu. L’hypothèse est émise que la présence d'un acide gras (octanoyl) sur la ghréline acylée pourrait permettre des interactions avec des molécules lipophiles, comme le HDL. Une autre étude suggère que les interactions entre le HDL et la ghréline acylée dans la circulation pourraient entraîner la désacylation du peptide, un processus potentiellement lié à l'activité estérase de la paraoxonase. La perte du groupe octanoyl pourrait favoriser l'accumulation de ghréline non-acylée. Ces observations soulignent la nécessité de recherches complémentaires sur les interactions entre les formes acylée et non-acylée de la ghréline et le HDL.
V.Ghréline et facteurs de style de vie Étude 2
L'étude 2, menée auprès de 63 jeunes femmes non-obèses à Montréal (Canada), a examiné l'influence des habitudes alimentaires (évaluées par le questionnaire TFEQ), de la forme physique (VO2 max), des niveaux d'activité physique, et de l'utilisation de contraceptifs oraux sur les taux circulants de ghréline totale, d'adiponectine et de leptine. Les résultats montrent une association entre les taux de leptine et la masse adipeuse, ainsi qu'avec le MB et la désinhibition alimentaire. L'étude souligne la nécessité d'investigations plus approfondies pour comprendre les interactions entre la ghréline et d'autres hormones dans la régulation de l'énergie.
1. Population étudiée et méthodologie
L'étude 2 a porté sur 63 jeunes femmes non-obèses (IMC < 30 kg/m2) âgées de 18 à 35 ans. La composition ethnique de la cohorte était principalement caucasienne (90%), avec 5% de participantes arabes et 5% afro-américaines. 46% utilisaient des contraceptifs oraux. Pour minimiser l'influence du cycle menstruel, tous les tests ont été effectués durant la phase folliculaire. Les participantes ont été recrutées par le biais d'annonces sur le campus et aux alentours de l'Université de Montréal, au Canada. L'étude a été approuvée par le comité d'éthique de l'université, et les participantes ont donné leur consentement éclairé avant de participer. Les critères d'inclusion étaient l'âge (18-35 ans), l'absence d'obésité et une sensibilité à l'insuline (HOMA < 1,69). Les critères d'exclusion comprenaient la grossesse, une maladie aiguë récente, des troubles alimentaires, la résistance à l'insuline, le diabète, l'hypertension ou la dyslipidémie, et la prise de médicaments pouvant affecter les fonctions cardiovasculaires ou métaboliques (ex: anti-hypertenseurs, TZD).
2. Influence des habitudes de vie sur les taux hormonaux
L'objectif principal de l'étude 2 était d'évaluer l'influence des habitudes alimentaires, de la condition physique, de l'activité physique et de l'utilisation de contraceptifs oraux sur les taux de ghréline totale, d'adiponectine et de leptine chez des jeunes femmes non-obèses. Les habitudes alimentaires ont été évaluées à l'aide du questionnaire TFEQ (Three-Factor Eating Questionnaire), qui mesure la restriction alimentaire, la désinhibition alimentaire et la sensibilité à la faim. La condition physique a été déterminée par la mesure du VO2 max (capacité aérobique maximale) sur vélo ergocycle. Les données sur l'activité physique et l'utilisation de contraceptifs oraux ont été recueillies par questionnaire. L'étude visait à établir un lien potentiel entre ces facteurs de style de vie et les variations des taux hormonaux, afin de mieux comprendre les interactions complexes entre les facteurs environnementaux et les régulations hormonales de la balance énergétique.
3. Résultats concernant la leptine
L'étude 2 a révélé une corrélation entre les taux de leptine et le métabolisme de base (MB), la forme physique (VO2 max), et la désinhibition alimentaire. Cependant, une fois l'effet de la masse adipeuse totale ou centrale pris en compte, la relation entre la leptine et les autres composantes de la balance énergétique s'annule. La masse adipeuse totale s'avère être le seul facteur indépendant expliquant 53% de la variation des taux de leptine. Cela suggère que la perte de masse adipeuse pourrait être le principal facteur influençant les niveaux de leptine. Le document rappelle le rôle de la leptine dans la signalisation de l'augmentation de la masse adipeuse, la limitation de l'apport énergétique, l'augmentation du MB et la diminution de la masse corporelle. Chez les sujets obèses, l'hyperleptinémie est associée à une résistance à la leptine, similaire à la résistance à l'insuline. Même si aucune participante n'était obèse, des taux élevés de leptine ont été associés à la résistance à l'insuline et à une capacité physique réduite.
4. Résultats concernant la ghréline et limites de l étude
Concernant la ghréline, l'étude 2 a mesuré les taux combinés de ghréline acylée et non-acylée, sans pouvoir les distinguer individuellement. Une corrélation négative entre les taux de ghréline totale et l'apport énergétique a été observée, ce qui est inattendu compte tenu des effets orexigéniques connus de la ghréline acylée. L'étude ne permet pas de déterminer si la relation entre la ghréline et la dépense énergétique persiste dans des conditions postprandiales. De plus, la présence ou l'absence de multimères d'adiponectine n'a pas été considérée. Ces limitations soulignent la nécessité d'études complémentaires pour mieux définir le rôle de la ghréline et de l'adiponectine dans la régulation de la balance énergétique, en particulier chez des sujets obèses insulino-sensibles et insulino-résistants, en tenant compte de la distinction entre les formes acylée et non-acylée de la ghréline.
VI.Ghréline et réponse à l hyperinsulinémie Études 3 4
Les études 3 et 4 ont utilisé un clamp euglycémique/hyperinsulinémique (CEH) pour évaluer les effets d'une hyperinsulinémie simulée sur les profils de ghréline acylée, ghréline non-acylée et ghréline totale chez des femmes insulino-sensibles ou insulino-résistantes, obèses ou en surpoids. L'étude a également exploré l'association entre les profils de ghréline et les marqueurs de l'inflammation chronique (hsCRP, TNF-α). Des différences significatives dans les réponses de la ghréline à l'hyperinsulinémie ont été observées entre les groupes, suggérant un rôle de la ghréline dans le développement de la résistance à l'insuline.
1. Méthodologie le clamp euglycémique hyperinsulinémique CEH
Les études 3 et 4 ont utilisé la méthode du clamp euglycémique/hyperinsulinémique (CEH) pour étudier les profils de ghréline (acylée, non-acylée et totale) en réponse à une hyperinsulinémie simulée. Cette technique, bien que utilisant des taux d'insuline supraphysiologiques, permet de simuler de manière réaliste l'hyperinsulinémie postprandiale. Le CEH a permis d'évaluer les fluctuations des taux aigus de ghréline pendant le maintien d'un état d'hyperinsulinémie contrôlée. Le protocole débute par un jeûne de 12h, suivi d'une perfusion d'insuline et de dextrose pour maintenir la glycémie à des niveaux basaux. La capacité d'assimilation du glucose est calculée à partir de la moyenne de l'infusion de glucose pendant la période d'état stable. L'utilisation du CEH dans ces études permet une comparaison des effets aigus et chroniques de l'hyperinsulinémie simulée sur les profils de ghréline chez des individus avec des profils métaboliques différents (insulino-sensibles vs. insulino-résistants, obèses vs. en surpoids).
2. Groupes d étude et comparaison des profils de ghréline
Les études 3 et 4 ont comparé les effets d'une hyperinsulinémie simulée sur les profils de ghréline chez deux groupes de sujets : des individus insulino-sensibles et non-obèses (ISOS) et des individus insulino-résistants, obèses ou en surpoids (IROS). L'étude a permis de déterminer les profils de ghréline acylée, non-acylée et totale à jeun, ainsi que leurs variations pendant le CEH. Des différences significatives dans les taux de ghréline totale à jeun ont été observées entre les groupes ISOS et IROS, les ISOS ayant tendance à présenter des taux plus élevés. Cette différence est cohérente avec les résultats d'études précédentes montrant des taux de ghréline totale à jeun plus faibles chez les individus obèses insulino-résistants. Deux hypothèses sont proposées pour expliquer ce phénomène: une activité protéolytique accrue de la ghréline chez les IROS ou une influence négative des taux élevés d'insuline chez les ISOS sur l'expression de la ghréline.
3. Régulation différentielle de la ghréline acylée et non acylée
L'étude a mis en lumière une régulation différentielle du rapport ghréline acylée/non-acylée chez les individus ISOS et IROS pendant le CEH. Des différences significatives dans la réponse du rapport ghréline acylée/non-acylée à l'hyperinsulinémie ont été observées entre les deux groupes. L'hypothèse est émise que l'élévation soutenue des profils de sécrétion de ghréline acylée pourrait être associée au développement de la résistance à l'insuline chez les individus obèses. Cette hypothèse est étayée par des études antérieures qui suggèrent des effets diabétogéniques de la ghréline acylée et des effets insulino-sensibilisants associés à l'injection conjointe de ghréline acylée et non-acylée. Les auteurs affirment qu'ils sont les premiers à rapporter un profil de ghréline significativement différent chez les ISOS et les IROS pendant un CEH, mettant en évidence l'importance de la distinction entre les formes acylée et non-acylée de la ghréline dans la compréhension de la résistance à l'insuline.
4. Ghréline et marqueurs de l inflammation chronique
Les études 3 et 4 ont également examiné l'association entre les profils de ghréline et les marqueurs de l'inflammation chronique (hsCRP, TNF-α) chez les sujets en surpoids ou obèses. L'étude rapporte une relation entre les taux de ghréline et le hsCRP (protéine C-réactive de haute sensibilité), suggérant que des taux élevés de hsCRP et une capacité réduite de réduction des taux de ghréline totale pourraient être des indicateurs du développement de dysfonctions métaboliques comme la résistance à l'insuline et le diabète de type 2, particulièrement chez les femmes post-ménopausées en surpoids ou obèses. Une relation positive entre les taux de hsTNF-α et le rapport aire sous la courbe (AUC) de ghréline acylée/totale a également été observée. L'existence d'une relation entre la ghréline et le TNF-α est discutée, les résultats de l'étude contrastant avec certaines études antérieures mais concordant avec d'autres concernant l'implication de la ghréline dans les processus inflammatoires.
VII.Conclusions et études futures
Les résultats suggèrent un rôle complexe de la ghréline, notamment des formes acylée et non-acylée, dans la régulation de l'homéostasie énergétique et le développement de troubles métaboliques liés à l'obésité. Des études futures, incluant des interventions cliniques, sont nécessaires pour approfondir la compréhension des mécanismes d'action de la ghréline et son potentiel thérapeutique. L'impact des taux de ghréline sur l'inflammation chronique mérite également une étude plus approfondie.
1. Résumé des études 3 et 4 profils de ghréline et hyperinsulinémie
Les études 3 et 4 visaient à caractériser les profils de ghréline (acylée, non-acylée et totale) durant un clamp euglycémique/hyperinsulinémique (CEH), simulant l'hyperinsulinémie postprandiale. L'objectif était de comparer les réponses de la ghréline à l'hyperinsulinémie chez des sujets insulino-sensibles non-obèses (ISOS) et des sujets insulino-résistants, obèses ou en surpoids (IROS). L'étude a également cherché à établir des liens entre les profils de ghréline et les marqueurs d'inflammation chronique. Le CEH, en maintenant des conditions hyperinsulinémiques standardisées, permettait d'étudier les effets aigus et chroniques sur les profils de ghréline. Les résultats ont révélé des différences significatives dans les réponses de la ghréline à l'hyperinsulinémie entre les groupes ISOS et IROS, suggérant un lien entre les profils de ghréline et la sensibilité à l'insuline.
2. Différences entre les profils de ghréline chez les ISOS et les IROS
Les taux de ghréline totale à jeun étaient plus élevés chez les ISOS que chez les IROS, confirmant des observations précédentes. Deux hypothèses sont avancées pour expliquer cette différence : une plus grande activité protéolytique de la ghréline chez les IROS ou une inhibition de la sécrétion de ghréline par les taux élevés d'insuline chez les ISOS. Des différences significatives ont été observées dans le rapport ghréline acylée/non-acylée entre les deux groupes pendant le CEH, suggérant une régulation différente de ce rapport selon la sensibilité à l'insuline. L'étude propose l'hypothèse qu'une augmentation prolongée de la ghréline acylée pourrait être liée au développement de la résistance à l'insuline chez les personnes obèses. Ces résultats sont en accord avec des études montrant des effets diabétogènes de la ghréline acylée et des effets insulino-sensibilisants d'une administration combinée de ghréline acylée et non-acylée. L'étude met en évidence l'importance de la distinction entre les deux formes de ghréline.
3. Ghréline et inflammation relation avec hsCRP et hsTNF α
L'étude a exploré la relation entre les taux de ghréline et les marqueurs d'inflammation chronique, en particulier le hsCRP et le hsTNF-α. Les résultats indiquent une relation entre les taux de ghréline et le hsCRP chez les sujets obèses ou en surpoids. Bien que la relation ne soit pas indépendante de l'adiposité totale, ces résultats reproduisent ceux d'études antérieures sur la maladie pulmonaire obstructive chronique. Des taux élevés de hsCRP et une capacité réduite de réduction des taux de ghréline totale pourraient servir d'indicateurs du développement de dysfonctions métaboliques. Concernant le hsTNF-α, une relation positive, indépendante de l'adiposité totale, a été trouvée avec le rapport AUC de ghréline acylée/totale. Ces résultats sont discutés en relation avec la littérature existante, qui présente des opinions contradictoires sur le rôle anti-inflammatoire de la ghréline.
4. Perspectives futures de la recherche
La conclusion souligne la nécessité d'études d'intervention clinique pour approfondir les relations entre la ghréline et le profil métabolique. La modulation des taux de ghréline (acylée, non-acylée, totale) pourrait être étudiée afin de mesurer directement son impact sur des paramètres métaboliques et des marqueurs inflammatoires. L'étude suggère également l'intérêt de réaliser des biopsies de tissus adipeux et musculaires pour analyser les variations de l'expression génique en réponse à l'administration de ghréline exogène. Ces études futures permettront une meilleure compréhension des mécanismes impliqués et du potentiel thérapeutique de la ghréline dans la prévention ou le traitement des troubles métaboliques associés à l'obésité.
