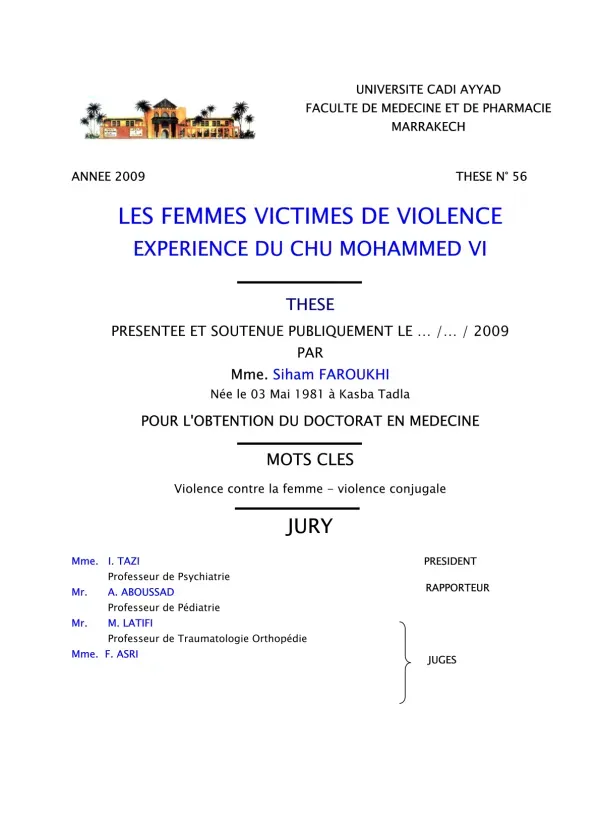
Les Femmes Victimes de Violence: Étude au CHU Mohammed VI
Informations sur le document
| Auteur | Mme. Siham Faroukhi |
| instructor/editor | Mme. I. Tazi (Professeur de Psychiatrie) |
| school/university | Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie Marrakech |
| subject/major | Médecine |
| Type de document | Thèse |
| city_where_the_document_was_published | Marrakech |
| Langue | French |
| Format | |
| Taille | 1.79 MB |
- violence contre les femmes
- médecine
- CHU Mohammed VI
Résumé
I. La Violence Contre les Femmes au Maroc Une Étude de Cas à Marrakech
Cette étude rétrospective, menée auprès de 371 femmes ayant consulté la cellule d'accueil des enfants et femmes victimes de violence à Marrakech (CHU Mohamed VI), explore les différentes formes de violence basée sur le genre au Maroc. Créée en 2001, cette cellule, gérée par un pédiatre et deux assistantes sociales, offre un soutien aux victimes de violence conjugale, viol, harcèlement sexuel, mutilations génitales féminines (MGF), et autres formes de violence familiale. L'étude souligne que 89,21% des femmes victimes sont mariées, et que dans 81,13% des cas, le mari est l'agresseur. Les données révèlent une prévalence plus élevée de la violence en milieu rural. L'étude met en évidence le besoin urgent d'améliorer la prévention et la sanction de la violence contre les femmes au Maroc, notamment via la mise en œuvre effective des lois existantes. Le numéro vert a enregistré 10 053 appels de femmes violentées en 2007, révélant l'ampleur du problème de la violence conjugale (82,1%), suivi par la violence sexuelle (33,7%).
1. Méthodologie et Contexte de l Étude
L'étude, de nature rétrospective, porte sur un échantillon de 371 femmes ayant sollicité l'aide de la cellule d'accueil du CHU Mohamed VI de Marrakech. Cette cellule, créée en 2001, est gérée par un pédiatre et deux assistantes sociales et fonctionne de 8h à 20h, cinq jours sur sept. Un protocole de collaboration avec l'hôpital Ibn Tofail et l'association Ennakhil assure une prise en charge coordonnée des femmes victimes de maltraitance. L'étude se concentre sur la violence subie par ces femmes, incluant la violence physique, psychologique et sexuelle, soulignant les conséquences physiques et morales de ces actes. La définition de la violence par l'UNFPA est mentionnée : il s'agit d'une violence impliquant hommes et femmes, où la femme est généralement la victime, et dont l'origine réside dans les inégalités de pouvoir entre les sexes. Ce type de violence affecte de manière disproportionnée les femmes et inclut les pratiques et torts physiques, sexuels et psychologiques.
2. Profils des Femmes Victimes et Types de Violence
L'analyse des données révèle que la majorité des femmes (89,21%) ayant subi des violences sont mariées, et dans la plupart des cas (81,13%), l'agresseur est le mari. L'étude observe une plus grande fréquence de la violence en milieu rural. Les auteurs de violence contre les femmes sont classés en trois catégories selon la Déclaration des Nations Unies de 1979 : la famille (violence liée à la dot, viol conjugal, mutilations génitales, violence conjugale, exploitation), la collectivité (viol, sévices sexuels, harcèlement sexuel, intimidation au travail, proxénétisme, prostitution forcée), et l'État (violence directement perpétrée ou tolérée, incluant celle engendrée par des législations inappropriées). L'insuffisance des politiques publiques pour prévenir et punir ces actes est pointée du doigt. La violence, selon l'étude, est un moyen d'obtenir quelque chose par la force, exploitant la faiblesse de l'autre.
3. Données Statistiques et Conséquences de la Violence
Pour les femmes âgées de 15 à 44 ans, la violence est une principale cause de décès et d'incapacités, surpassant même des facteurs comme le cancer ou les accidents de la route selon une étude de 1994. Un lien est établi entre la violence et un risque accru d'infection par le VIH. L'étude cite des statistiques de l'OMS sur la violence familiale dans dix pays, montrant des taux alarmants de violence physique et sexuelle commise par un partenaire intime. Au Maroc, le numéro vert dédié aux victimes de violence a enregistré plus de 17 511 cas entre son ouverture et 2007, dont 82,1% de cas de violence conjugale et 33,7% de violence sexuelle. La majorité des femmes victimes de violence conjugale sont des femmes au foyer (77,5%). L’étude démontre ainsi une prévalence significative de la violence, ses formes multiples et les conséquences dramatiques sur la santé et le bien-être des femmes.
II. Les Différentes Formes de Violence Basée sur le Genre
Le document détaille les multiples manifestations de la violence contre les femmes, allant de la violence familiale (viol conjugal, mutilations génitales féminines, crimes d'honneur) à la violence dans le milieu professionnel (harcèlement sexuel, intimidation au travail), en passant par le trafic d'êtres humains et la prostitution forcée. L'étude met l'accent sur la dimension sociale et culturelle de la violence, liée à des inégalités de pouvoir entre les sexes. Le document souligne également le lien entre violence et VIH/SIDA, et l'impact dévastateur de la violence sexuelle dans les conflits armés, citant des chiffres alarmants de viols au Rwanda, en Bosnie-Herzégovine, et en Sierra Leone. Les mariages forcés, souvent liés à des considérations économiques, sont aussi identifiés comme une forme majeure de violence.
1. Violence Familiale et Viol Conjugal
La violence familiale, incluant les agressions physiques et sexuelles commises au sein du foyer ou par un partenaire intime, est omniprésente. Les femmes sont particulièrement vulnérables dans le cadre de relations intimes. L’étude cite une étude de l'OMS (2005) révélant que plus de 50% des femmes dans certains pays (Bangladesh, Éthiopie, Pérou, Tanzanie) ont subi des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire, avec un taux stupéfiant de 71% dans les zones rurales d'Éthiopie. Le viol conjugal et les mutilations génitales féminines (MGF) sont mentionnés comme des formes spécifiques de violence familiale, ainsi que les violences liées à la dot et les pratiques traditionnelles préjudiciables. L'étude souligne le rôle des inégalités de pouvoir entre les sexes dans l'origine de cette violence. La définition de la violence basée sur le genre par l'UNFPA est détaillée, précisant qu’elle inclut les pratiques et les torts physiques, sexuels et psychologiques, y compris l'intimidation et la privation de liberté, au sein de la famille ou de la communauté, ou même perpétrée ou tolérée par l'État. Des statistiques sur les viols et tentatives de viol (une femme sur cinq dans le monde) illustrent l'ampleur du problème.
2. Violence au sein de la collectivité et de l État
La seconde catégorie de violence concerne la collectivité, où les femmes sont victimes de viol, de sévices sexuels, de harcèlement sexuel, d’intimidation au travail, dans les établissements d’enseignement, et ailleurs ; de proxénétisme et de prostitution forcée. La troisième catégorie est l'État, responsable de la violence qu'il a directement perpétrée ou tolérée, englobant la violence issue de législations discriminatoires. L'étude souligne l'absence de havre de paix pour les femmes, quel que soit le lieu, et pointe l’insuffisance des politiques publiques pour prévenir et punir les auteurs de ces violences. Une étude sur 1200 élèves de troisième à Genève (Suisse) révèle que 20% des filles ont subi un acte d’abus sexuel. D'autres données statistiques montrent que 10 à 12% des femmes au Pérou, au Samoa et en Tanzanie ont été victimes de violence sexuelle par des non-partenaires après 15 ans. Des lacunes juridiques dans plusieurs pays permettent aux auteurs d’actes de violence sexuelle d’agir en toute impunité. La notion de « crimes d’honneur » est abordée, décrivant l’assassinat de femmes victimes de viol, suspectées de relations sexuelles prémaritales ou accusées d’adultère.
3. Mariages Forcés Mutilations Génitales et Traite des Femmes
Le document aborde les mariages forcés, souvent motivés par des raisons économiques (« mariée monnayable »), particulièrement répandus en Afghanistan (57% des Afghanes mariées avant 16 ans). L’insécurité et les conflits armés exacerbent ce phénomène. Les mutilations génitales féminines (MGF), une pratique répandue en Afrique et dans certains pays du Moyen-Orient, affectant plus de 130 millions de femmes, sont présentées comme une violation grave des droits des femmes. L'étude note des progrès dans la criminalisation de cette pratique dans plusieurs pays depuis les années 1980. Le trafic et la traite des personnes, souvent liés au crime organisé, sont décrits comme une forme majeure d'exploitation des femmes, tirant profit de leur vulnérabilité et leur faisant de fausses promesses. Le document cite des données de l'ONU (2006) indiquant 127 pays d’origine et 137 pays de destination de la traite, avec l’Asie, l’Europe Centrale et de l’Est, et l’Afrique de l’Ouest comme principales régions d’origine. En 2006, 93 pays avaient légiféré contre la traite.
4. Violence et VIH SIDA Violence en Situation de Conflit Armé
Le document souligne le lien entre la violence et le VIH/SIDA. La peur de la violence empêche de nombreuses femmes de révéler leur statut sérologique et de recevoir des soins, comme illustré par un dispensaire en Zambie (60% des femmes ne se soignent pas par peur). Les jeunes femmes sont particulièrement vulnérables aux relations sexuelles non désirées et aux infections au VIH. La violence sexuelle est ensuite examinée dans le contexte des conflits armés, où les femmes sont des cibles privilégiées. Les civils, notamment les femmes et les enfants, sont les principales victimes des conflits récents (70%). Des chiffres accablants sont cités: près d'un demi-million de femmes violées au Rwanda pendant le génocide de 1994, 60 000 en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, et 64 000 en Sierra Leone entre 1991 et 2001. La violence sexuelle est utilisée comme arme de guerre, comme au Darfour où des témoignages de viols, meurtres et pillages sont relatés. La Cour Pénale Internationale (CPI) et d'autres tribunaux internationaux poursuivent les auteurs de ces crimes. L’infection intentionnelle au VIH a été utilisée comme arme de guerre dans certains conflits.
III. Interventions et Stratégies de Lutte Contre la Violence
L'étude présente un modèle de stratégie internationale pour prévenir la violence contre les femmes, soulignant l'importance d'une approche globale et multidisciplinaire. Des exemples d'initiatives de l'UNIFEM au Maroc, en Afrique, et en Amérique Latine sont mis en avant, incluant la mise en place d'unités de police spécialisées, la sensibilisation des communautés, le soutien aux organisations féminines et la réforme des législations. L'UNIFEM souligne le lien entre l'inégalité des sexes et la violence, et met en œuvre des stratégies pour briser le cycle de la violence et promouvoir l'égalité. Les réformes juridiques marocaines de 2003-2004 (Code Pénal, Code du Travail, Code de la Famille) sont présentées comme des avancées importantes dans la lutte contre la violence basée sur le genre.
1. Approche Globale et Multidisciplinaire
Pour éradiquer la violence contre les femmes au sein de la famille, de la communauté et de l'État, une approche globale et multidisciplinaire est essentielle. Le document préconise une stratégie qui repose sur le principe d'égalité et de partenariat entre hommes et femmes, ainsi que sur le respect de la dignité humaine. Les systèmes éducatifs doivent favoriser le respect de soi et le respect mutuel entre les sexes, encourageant la coopération. L'absence de données fiables sur la violence dans les sphères privée et publique, notamment sur le lieu de travail, entrave la mise en place de stratégies d'intervention spécifiques. Néanmoins, l'expérience montre que la mobilisation des hommes et des femmes, associée à des mesures d'ordre public efficaces, permet de s'attaquer aux causes et aux conséquences de la violence. L'implication d'associations masculines engagées dans la lutte contre la violence basée sur le genre est indispensable pour un changement durable.
2. Le Rôle de l UNIFEM dans la Lutte Contre la Violence
L’UNIFEM, considérant la violence à l'égard des femmes comme un problème universel et une violation majeure des droits humains (une femme sur trois en étant victime), se mobilise sur plusieurs fronts. Son objectif est de briser le cycle de la violence en s'attaquant à sa source : l'inégalité entre les sexes. L’UNIFEM met en œuvre des stratégies novatrices, des campagnes de sensibilisation et des partenariats avec les gouvernements, les associations féminines et d'autres acteurs du système des Nations Unies. L’UNIFEM soutient les organisations féminines, souvent les plus efficaces dans la réponse à la violence, en mobilisant des ressources et en amplifiant leurs voix au niveau national et international. Le Fonds d’affectation spéciale de l’UNIFEM subventionne des projets innovants de lutte contre la violence, menés par des organisations communautaires, nationales et régionales. Ces projets ont permis de promulguer de nouvelles lois, de former la police et de sensibiliser la population masculine.
3. Exemples d Initiatives de l UNIFEM
Des exemples concrets d'actions menées par l'UNIFEM sont présentés : en Somalie, une formation du système judiciaire et des actions de sensibilisation ont conduit à la condamnation du mariage forcé des victimes de viol par l'Assemblée des chefs traditionnels. En Ouganda, la collaboration avec la police a permis de créer des unités d'enquête spécialisées sur la violence, et au niveau régional, FEMNET a bénéficié du soutien de l’UNIFEM pour créer un réseau masculin contre la violence et pour promouvoir l'égalité des sexes. Au Maroc, l’UNIFEM, en partenariat avec le PNUD et l'UNFPA, a soutenu une stratégie nationale contre la violence sexuelle, menant à des modifications du Code pénal plus sévères. En Amérique Latine, une collaboration régionale vise à reformer les lois contre la violence sexuelle, tandis qu'au Pérou, l'UNIFEM aide les victimes de viol commis pendant le conflit interne, en impliquant les hommes des communautés.
4. Réformes Juridiques et Stratégies Nationales au Maroc
Les réformes juridiques marocaines de 2003-2004 (Code pénal, Code du travail, Code de la famille) sont mentionnées comme contribuant à la lutte contre la violence basée sur le genre. Le nouveau Code de la famille instaure l'équité et l'égalité dans les responsabilités familiales, améliorant les procédures liées aux liens conjugaux et reconnaissant la pleine citoyenneté des femmes en supprimant la tutelle. Les femmes peuvent désormais se constituer partie civile en cas d'atteinte à leur intégrité physique, sexuelle ou morale. Le Ministère délégué chargé de la famille et de la condition féminine a élaboré une stratégie nationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes, dans le cadre d'un accord avec le système des Nations Unies (UNIFEM, UNFPA, UNICEF) signé en septembre 2005, axée sur l'approche cycle de vie. Cette stratégie nationale vise à lutter contre les différentes formes de violence en ciblant les catégories vulnérables.
